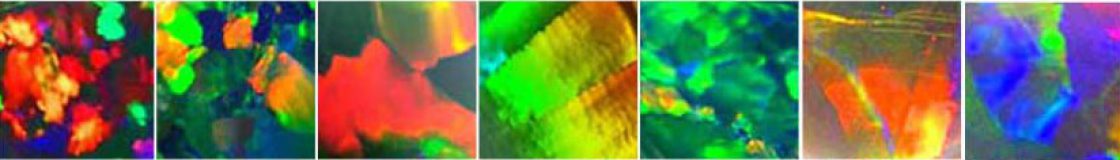Contribution à la compréhension de la philosophie de Nishida, par Junyu Kitayama, Kant-Studien (Traduction)
Traduction par Fl. Boucharel de l’essai Die moderne Philosophie Japans. Ein Beitrag zum Verständnis der „Nishida-Philosophie“ (La philosophie moderne du Japon : Une contribution à la compréhension de la philosophie de Nishida) de Junyu Kitayama, publié dans le journal Kant-Studien, volume 43, cahiers 1-2, 1943, pp. 263-274.
Junyu Kitayama (1902-1962) est un philosophe japonais qui passa l’essentiel de sa vie en Allemagne et, après la Seconde Guerre mondiale, en Tchécoslovaquie. Il étudia la philosophie en Allemagne de 1924 à 1929, où il eut Karl Jaspers comme directeur de thèse doctorale. Ses travaux sur la pensée japonaise et bouddhiste sont dits avoir influencé la compréhension de la pensée asiatique par Jaspers mais aussi Heidegger (ce qu’il partagerait avec son compatriote le philosophe Keiji Nishitani, étudiant de Heidegger à Fribourg de 1937 à 1939). Kitayama enseigna dans diverses universités allemandes et fut à partir de 1936 directeur adjoint du Japaninstitut à Berlin. Sa bibliographie est principalement en langue allemande ; il en donne quelques exemples dans les notes du présent essai (note 4). Un ouvrage non cité est une « Métaphysique du bouddhisme », Metaphysik des Buddhismus, parue en 1934.
Le présent essai, rédigé en allemand, porte sur la philosophie de Kitarô Nishida (1870-1945), principal représentant de l’école dite de Kyôto. Il s’agit sans doute de l’un des plus anciens textes présentant la pensée de Nishida en Europe, où cette philosophie ne commença véritablement à être connue qu’à partir des années soixante. C’est peut-être même purement et simplement le premier : l’article servait, peut-on supposer, à accompagner la publication par le Japaninstitut en 1943 de la traduction allemande du livre de Nishida Le monde intelligible, premier livre de Nishida traduit dans une langue européenne (bien avant la traduction anglaise d’Étude sur le bien en 1960 aux États-Unis, incorrectement et injustement donnée par l’intelligence artificielle Grok comme la première traduction d’un livre de Nishida dans une langue européenne).
.
*
.
La philosophie moderne du Japon :
Une contribution à la compréhension de la philosophie de Nishida
.
Junyu Kitayama, Berlin
.
Quand la philosophie japonaise prétend au statut de philosophie dans le sens où l’on parle de philosophie en Europe, elle ne peut s’appuyer seulement sur la tradition de l’Asie. Elle doit de surcroît, comme la philosophie occidentale, avoir l’homme, la nature, Dieu et le tout du monde comme problème et objet. La philosophie moderne du Japon, à l’instar de la culture japonaise dans son ensemble, est confrontée à la tradition occidentale. Elle ne s’occupe pas seulement de sa propre tradition spirituelle mais veut aussi savoir ce qui s’est passé et continue de se passer dans un autre monde culturel.
On a longtemps reproché à l’Extrême-Orient de rester orgueilleusement fermé à l’histoire mondiale et d’avoir laissé perdre ainsi ses possibilités de développement dans un cercle monotone de longs siècles. Appliqué à la culture japonaise, ce reproche est entièrement erroné. L’esprit du monde au sens de Hegel, se déployant dans la plus grande variété de formes de conscience, a fait ses preuves et porté des fruits en Extrême-Orient avec la même force qu’en Europe. Sa puissance s’est seulement affaiblie à la fin du quatorzième siècle en Chine, où cela a conduit à une sclérose, tandis que se produisait au Japon au même moment une renaissance par le biais de l’influence indienne et chinoise. L’esprit japonais connut par la suite une nouvelle efflorescence via le contact avec l’Europe.
La philosophie japonaise dans sa forme contemporaine est une philosophie mondiale, qui s’intéresse tout autant à la connaissance de l’histoire humaine en Occident qu’en Orient. Ainsi, la philosophie du Japon peut aujourd’hui reprocher à la philosophie européenne de ne connaître de son côté qu’un seul héritage, de ne prendre pour objet de son examen, de façon simpliste, qu’une seule forme traditionnelle de conscience dans l’histoire humaine, par là-même oubliant le tout.
Le problème et la crise de la philosophie européenne produisent aujourd’hui un doute quant à la philosophie au Japon également. Le doute sur l’esprit et l’accomplissement de la philosophie est essentiellement le même au Japon qu’en Europe.
L’introduction de la philosophie européenne au Japon fut le résultat de circonstances plus ou moins fortuites. Quand les travaux des philosophes européens Mill, Spencer, Schopenhauer et Kant arrivèrent au Japon et que les premiers philosophes japonais se rendirent en Angleterre ou en Allemagne pour apprendre la philosophie européenne, ces philosophes et leurs disciples passaient pour des hommes de premier plan de leur époque. On apprenait Kant via l’enseignement de Kuno Fischer et de Windelband, Schopenhauer via Eduard von Hartmann, Paulsen et Eucken. En même temps qu’Eucken furent connus au Japon Henri Bergson et le pragmatiste américain William James. Après cette première phase d’introduction de la philosophie européenne et américaine à la fin du dix-neuvième siècle, une seconde vague concerna presque exclusivement la philosophie allemande. Pour l’œil spirituel du Japon, c’est là que semblait se trouver la plus grande richesse, la grandeur réelle de la philosophie européenne. Depuis lors, seule la philosophie allemande reste vivante au Japon en tant que tradition philosophique de l’Occident. À Kant et Schopenhauer succéda l’étude de Fichte, Schelling, Hegel et Nietzsche. Parmi les connaisseurs de la philosophie au Japon, des écoles se formèrent : « Kantiens », « Hégéliens », « philosophes de la vie ». Tel est l’état du développement au début du vingtième siècle. Puis les nouvelles directions de la philosophie allemande se firent connaître au Japon : l’école de Marbourg d’abord, ensuite l’école de Heidelberg, enfin la phénoménologie de Husserl. Ces quarante dernières années, les écoles philosophiques au Japon se sont développées parallèlement aux tendances correspondantes des écoles allemandes. Récemment, depuis la parution de Sein und Zeit de Heidegger en 1927, on a commencé à s’intéresser à la philosophie de l’existence. En même temps, on apprit à connaître Karl Jaspers et le Danois Sören Kierkegaard.
À côté des philosophes allemands, on continua de s’intéresser aux philosophes anglo-saxons et français. On peut diviser la philosophie européenne au Japon de la même manière qu’en Allemagne, selon les tendances suivantes : néokantisme, phénoménologie, néohégélianisme et philosophie de l’existence. Aujourd’hui, la philosophie japonaise se consacre principalement aux problèmes de l’anthropologie et de l’ontologie. Les philosophes japonais au sens européen ont en outre cherché à éclairer leur propre tradition, voire à la fonder, à la lumière de ce nouveau patrimoine intellectuel. Le thème principal, dans cette démarche, fut le bouddhisme. On interpréta la doctrine bouddhiste de la transmigration de l’âme (théorie du karma) selon les méthodes logiques, dialectiques et celles de la philosophie de l’existence. En 1927 eurent ainsi lieu sur ces questions de virulentes controverses entre trois théologiens bouddhistes. Un philosophe tenta même d’interpréter la mystique zen d’après ce nouvel esprit philosophique.
Le seul philosophe au Japon qui, détaché de toutes les modes de la philosophie européenne et ne se déclarant l’épigone d’aucune école, pendant quelque trente ans, indifférent aux mots d’ordre du jour, à la manière retirée d’un moine bouddhiste, se confronta sérieusement et en profondeur avec l’esprit occidental et de qui presque aucun philosophe de l’Occident n’est inconnu, est Nishida, qui fut professeur titulaire de philosophie à l’Université de Kyôto. Il n’a pas une seule fois voyagé en-dehors du Japon. Mais il connaît les philosophes européens de Platon à Heidegger en passant par saint Augustin, Kant, Hegel. Les travaux modernes de Cantor, Hilbert et Minkowski ne lui étaient pas non plus inconnus, et il se consacra de même à l’esthétique de Max Klinger et de Konrad Fiedler. Nishida est le sommet de la philosophie japonaise moderne. Son système englobe tous les domaines du savoir et éclaire les résultats des sciences naturelles et des sciences humaines selon des points de vue entièrement nouveaux. On peut décrire la philosophie de Nishida comme un des sommets synthétiques et métaphysiques de la philosophie moderne mondiale. Ce dont la culture du Japon moderne peut à bon droit s’enorgueillir1.
La philosophie de Nishida se trouve développée dans douze volumes. Ce n’est pas une tâche facile que de présenter brièvement ce contenu intellectuel très dense. On ne peut tout au plus obtenir de cette manière qu’une vague vue d’ensemble sur la position spirituelle fondamentale du philosophe. D’un côté, il s’agit d’une critique de la totalité de la philosophie occidentale et, de l’autre, de la prestation créatrice de l’esprit japonais moderne. La position de Nishida vis-à-vis de la pensée occidentale passée et présente est aussi le jugement de l’esprit asiatique sur la tradition de l’Occident. Dans sa confrontation avec la philosophie grecque, scolastique et allemande, nous apprenons le doute asiatique quant à la culture occidentale jusqu’à nos jours.
Des penseurs européens de premier plan tels que Hegel et plus récemment Spengler dans leurs considérations sur l’histoire ont insisté sur l’idée que dominerait en Occident le principe combatif et paternel tandis que règnerait en Orient le principe maternel. Le sentiment général en Occident est, dit-on, optimiste tandis que l’Orient ne sortirait pas d’un pessimisme stérile, incapable de développement. Du point de vue de l’Extrême-Orient, l’optimisme européen a quelque chose de juvénilement enjoué et présente une orgueilleuse tendance à la démesure, dispositions essentiellement tragiques et pessimistes. Sans doute le principe paternel est-il de nature combative, mais il n’a pu, au bout du compte, parvenir à un succès définitif eu égard au désaccord animique (Seelenzwist) entre le monde et l’esprit. Pour maîtriser décisivement l’esprit du monde et la destinée humaine, l’arme faustienne ne peut suffire. Le principe maternel qui, selon cette conception occidentale, est censé être le terreau nourricier de l’esprit oriental, s’enracine dans un optimisme inébranlable et une grande confiance dans la vie et dans le monde. Le combat de l’homme pour l’affirmation de soi conduit à l’individualisme. La ruse de guerre produit le calcul logique abstrait qui doit pourvoir à toute situation d’antagonisme. Un tel esprit combatif prétend en outre à la défaite de tous opposants et généralise ses propres découvertes spirituelles. Enfin, il conduit à l’illusion d’être inconditionnellement vainqueur ultime et cause son propre déclin par son arrogance et sa présomption. Le principe maternel au contraire adhère toujours au concret, aime le monde et se connaît soi-même. Établi dans le sein de son origine première, il ne se perd pas hors de soi dans le monde flottant des idées abstraites mais reste au contraire dans sa patrie, où il est né et dont il reçoit ses forces créatrices. L’Extrême-Orient est resté fidèle à la patrie de son esprit. L’esprit européen cherche depuis des siècles, mouvant et sans repos, sa patrie et ne la trouve pas. C’est pourquoi la philosophie de Nishida voit dans l’esprit occidental et son développement historique son enfant perdu. Nishida observe le premier pas de ce développement tragique dans la Grèce antique. Il écrit : « Le cœur de la culture grecque est l’apollinien. Le formel et le conditionné furent pensés par les Grecs comme réalité. Finalement la forme devint l’essence ! Cette conception du formel en tant qu’essence de tous les phénomènes s’enracine dans la mentalité artistique des Grecs, qui aimaient le « plastique » et l’« harmonique » et ne pouvaient tolérer l’obscur et le disharmonieux. De ce sentiment de la forme est né le rationalisme grec qui est la source de la conceptualisation rationnelle de toute la philosophie occidentale ultérieure. Le non-conceptualisable et le ‘néant’ sont ignorés en tant qu’irrationnel. Pour les Grecs, ce qui est fondateur c’est la forme par opposition à l’informe, le statique au lieu du mouvement, l’être au lieu du néant. »
L’immobile et le formel ont en fin de compte, selon Nishida, un besoin dynamique de l’universel qui dénie son essence à l’individuel et prescrit une valeur inférieure à l’éphémère et au mouvement. Nishida révoque en doute cette conception du monde et de l’être, doute que la totalité de ce qui est ne se laisse saisir que rationnellement. Selon lui, dans cette totalité de ce qui est, l’individuel n’est pas pensé seulement sub specie comme essence perdue mais se détermine lui-même et conditionne à son tour le tout par son existence.
Le problème du rationnel et de l’irrationnel, du général et de l’individuel est, dans la philosophie grecque, toujours présenté de manière statique, et n’est jamais parvenu à une solution dynamique et par là authentique.
Pour nous, Asiatiques, la culture grecque est trop anthropomorphique, et l’apollinien, trop humain et trop pris dans l’être. Dans la scolastique, la culture grecque de l’être se mêle au culte moyen-oriental de la personne. L’ontologique (Seinshaft) se trouve de même au fondement du système aristotélico-thomiste de la théologie romaine, dans la mesure où Dieu y est certes compris, dans les représentations et la croyance, comme un être surhumain mais affublé de caractéristiques humaines portées à l’infini. Même la théologie négative de Denys l’Aréopagite repose sur l’idée de négation de l’ontologique pour pouvoir exprimer la divinité transcendante. Mais la négation de l’être ne peut jamais constituer l’essence du « néant ». Aussi la connaissance du néant reste-t-elle elle-même enferrée dans le cadre de l’ontologie. L’anthropomorphisme et la philosophie de l’être ne peuvent saisir le tout de la relation entre l’homme et Dieu ; entre la négation de l’être de l’homme et la transcendance de Dieu il y a un abîme : « Le mystère de la révélation et la magie de l’Église. »
Après que la philosophie de Descartes eut introduit un nouveau concept de la conscience dans la tradition spirituelle européenne, la tradition grecque de l’accentuation de l’être, sous la forme de la science de la nature, et la tradition chrétienne de l’anthropomorphisation de Dieu, sous la forme de l’idéalisme allemand, se rejoignirent. Le cosmos grec fit place à la nature comme objet de la science, et la saisie personnelle de la relation homme-Dieu-monde fit place à l’esprit idéal ou moi absolu. Pour la science moderne, qui a pour objet l’univers, l’Esprit absolu au sens de Hegel n’a aucune place ; pour la philosophie idéaliste, la nature n’a qu’une valeur contingente. Hegel tenta finalement de « sursumer » [traduction par Yvon Gauthier de l’aufheben hégélien reprise dans les traductions françaises de Hegel par Jarczyk et Labarrière] la relation entre être et personne dans l’histoire. L’histoire devient l’être de tout le spirituel et de tout le divin, et en elle le néant, la grande obscurité, est devenu un moment du processus historico-dialectique. Goethe et Nietzsche furent deux grandes figures de l’esprit allemand dont l’une représentait la culture grecque de l’être, l’autre, bien que dans une inversion paradoxale, la culture chrétienne de la personnalité. La croyance de Goethe en l’être éternel est l’ultime réalisation de l’idéalisme platonicien, le doute de Nietzsche vis-à-vis des hommes est le renversement du personnalisme chrétien et par là-même le bouleversement de toute valeur ontologique dans la tradition ou l’histoire, que Hegel avait de manière si grandiose spiritualisée et approfondie et qui aujourd’hui se débat dans l’espace vide des querelles politiques internationales et du mécanisme de la science de la nature, dans le courant sans but du quotidien en vue d’une irrévocabilité jamais atteinte. Séparé du Cosmos, abandonné de Dieu et méprisé par l’Esprit, l’homme occidental est seul. Un abandonnement complet au sens de Nietzche couvre l’Occident ainsi qu’un lugubre ciel d’orage.
La philosophie de Nishida est née de l’esprit de l’Asie comme un miroir de la tradition occidentale. Nishida connaît la face lumineuse et la face sombre de la tradition spirituelle occidentale, il connaît la grandeur et la force cosmique du passé grec, la rigueur et la confiance en soi extraordinaires de la pensée scolastique, la splendeur rayonnante et la surabondante richesse de l’idéalisme allemand. Mais il voit dans le développement de l’esprit occidental une absolutisation de la culture anthropomorphique et rationaliste de l’être. La philosophie de Nishida se distingue de la tradition spirituelle occidentale par son opposition au rationalisme et à l’anthropomorphisme. À la place de la raison on trouve chez lui l’intuition, au lieu de l’être il place au fondement de sa philosophie le « néant ».
Le premier stade du développement de sa philosophie est la confrontation avec la philosophie occidentale, au cours de laquelle il se positionne dans une opposition consciente au rationalisme kantien et néokantien en adoptant le point de vue de Fichte et de Bergson. La philosophie rationnelle suppose l’être comme principe de l’objet de toute philosophie et privilégie la relation sujet-objet comme horizon et théâtre de la pensée. La philosophie rationnelle établit donc sa tente de ce côté-ci de l’horizon. La philosophie de Nishida, au contraire, part de l’alternative entre être et néant au-delà de la relation sujet-objet. Nishida appelle l’être « expérience pure » ou bien « expérience directe ». Le but de sa philosophie est d’explorer cet au-delà de toute opposition. Si ce travail avait été accompli sur le seul terrain de la saisie rationnelle, il se serait fracassé sur la frontière que Kant avait déjà délimitée avec ses antinomies. Mais s’il avait procédé sans l’aide de la réflexion rationnelle, il aurait sombré dans le mysticisme. Nishida s’efforce à la fois de ne pas rester bloqué dans l’impasse d’antinomies insolubles et de ne pas tomber dans l’abîme du mysticisme. Il évite fondamentalement l’erreur fatale du rationalisme : il ne considère pas comme celui-ci l’objet de la raison, l’être ultime, comme quelque chose se tenant de manière intangible devant la pensée subjective, mais bien plutôt introduit l’être ultime, l’universel dans la pensée active. L’être proprement dit n’est donc pas une formation objective qui puisse être appréhendée dans une contemplation passive au sens de la theoria aristotélicienne : il est la pensée et la contemplation elle-même. Nishida cherche à comparer cette approche de son système avec la Tathandlung de Fichte et l’élan vital [en français dans le texte] de Bergson. Il voit le processus de ce système de l’être actif par soi-même dans les mathématiques et le fonde par le concept de continuité du rapport entre pensée et expérience, esprit et réalité. Cependant il y a entre la continuité de l’expérience possible et la totalité une faille : l’angle mort de la philosophie, connu depuis des temps immémoriaux. Nishida surmonte cette crise en revenant à son point de départ et en voyant dans l’au-delà du sujet et de l’objet non pas l’être mais le néant, pour la seule pensée insaisissable. La réflexion philosophique indépendante de Nishida commence avec la philosophie du néant, libérée de toute influence de philosophes occidentaux. C’est pourquoi nous l’appelons « la philosophie du néant »2, contrairement à la philosophie de l’être de l’Occident, de Platon à Heidegger. Le néant, auquel Nishida parvient comme au terme de tout être et de la pensée, est l’antique héritage de l’esprit asiatique. Il intervient comme problème tant dans le bouddhisme que dans le taoïsme. Nishida l’intègre systématiquement, à partir de sa confrontation avec la tradition de l’esprit occidental, dans l’horizon de sa pensée comme en étant le centre. Après avoir gagné ce concept du néant, Nishida entreprend de juger la philosophie occidentale depuis une perspective entièrement nouvelle et de développer en opposition consciente à la culture anthropomorphique de l’Occident une philosophie libre de toute contradiction et englobant l’ensemble de l’histoire humaine. Le néant apparaît chez lui en relation à différents mondes d’objet de la philosophie. Nishida écrit : « Le motif de la réflexion philosophique ne se trouve pas dans l’étonnement mais dans le tragique profond de la vie, de sorte que la philosophie commence avec le fait de la contradiction du moi avec soi-même. »3
La philosophie de Nishida est une philosophie de la contradiction par laquelle les sphères individuelles se singularisent et se « sursument » l’une l’autre. Non seulement la nature et l’homme, non seulement la société, mais Dieu lui-même doit être perçu à partir du fondement qu’est la contradiction. Mais toute contradiction devient incertaine quand elle est reconnue en tant que contradiction. Une nouvelle vie germe en elle. Cette germination de vie nouvelle dans la contradiction, Nishida l’appelle la détermination de soi ou le conditionnement de soi par l’universel ultime qui est, en soi et pour soi, « néant ». Nishida n’entend pas considérer les phénomènes du monde à partir d’un point de vue, que ce soit l’idéalisme ou le matérialisme, ni tout rapporter à l’esprit ou bien à la matière ; il cherche systématiquement le réel dans le dépassement de toute abstraction et de toute généralisation. Tout point de vue est pour lui de l’idéalisme ou rationalisme abstrait. La vitalité du monde et de la vie est dans la contradiction de l’équilibre entre la vie et la mort. Mais ce n’est pas tout homme, tout esprit qui peut faire l’expérience de cette incertitude de son existence. C’est pourquoi tout un chacun cherche sa patrie dernière dans des hypothèses ou des théories ou bien en Dieu.
Mais pourquoi la contradiction est-elle si insoutenable ? Parce que la vie s’oriente d’une part dans le temps fluctuant et d’autre part dans l’espace immobile. L’espace contient l’étant individuel de manière stable et sûre, mais le temps l’ébranle et l’entraîne dans son cours. Le temps ne se laisse même saisir dans son instabilité que si sa représentation est liée par des symboles spatiaux : à savoir, quand on le décrit ainsi qu’une ligne géométrique continue. La pensée rationnelle abstraite est un symptôme typique de la position vitale et spirituelle de l’Occident, qui a cherché à fixer pour tous les temps l’être dans la méthode ou dans un point de vue. Mais à peine l’esprit européen avait-il trouvé son oxygène dans la conception goethéenne organique du monde que Hegel vint et sapa celle-ci avec le mouvement pendulaire de sa dialectique. Lorsque l’on s’imagina alors avoir établi et ordonné le monde dans la pensée dialectique, l’âme dionysiaque de Nietzsche, comme un démon, fit irruption dans le patrimoine intellectuel objectivé de l’Occident – cette âme qui « possède l’échelle la plus longue et peut descendre au plus profond, à savoir, l’âme qui peut le plus marcher, errer, se perdre en soi ».
Nishida cherche, en opposition avec le rationalisme occidental, à éclairer et comprendre cette source d’inquiétude, l’abîme du tragique. La contradiction ne doit pas être obscurcie par un système théorique ni par l’abandon à un Dieu inconnaissable ; la philosophie doit au contraire montrer avec la plus grande acuité l’abîme ouvert devant l’homme et son esprit. L’esprit humain doit se voir directement devant cet abîme béant, sauter dedans puis se retrouver soi-même pour, en lui et depuis lui, devenir certain de la vie dans le courant du monde et de la réalité. Cette voie de la quête de l’abîme est de même rang que le rationalisme. L’accès à cette découverte de la vraie contradiction et de son arrière-plan, ou le premier pas vers eux, ne commence pas chez Nishida dans la science mais déjà dans le monde concret des faits. La pensée théorique des sciences telles que pratiquées jusqu’à présent voit son objet dans un monde objectivement préfiguré. La science rationnelle veut saisir par le concept, le jugement et le syllogisme la relation entre l’individuel et le général, entre les choses changeantes et la loi constante. On cherche à comprendre quelque chose d’individuel et on le place pour cela dans un rapport au général.
Le général, dont dépend l’individuel, ne doit pas rester dépendant. Cet indépendant, sur lequel repose tout être individuel, ne doit plus posséder le moindre caractère d’être, il peut seulement être la « place » ou le « lieu » dont l’existence ne nuit pas au caractère particulier de l’étant individuel. Ce lieu est, dans la conviction de Nishida, quelque chose qui affirme sa propre existence par le fait de laisser exister l’individuel en tant qu’individuel.
On se trouve en présence du même phénomène lorsque l’on considère la conscience. Les contenus individuels de la conscience, que ce soient des sensations visuelles ou perceptions de couleur, des efforts de volonté ou l’irruption de sentiments, appartiennent en tant qu’individuels à une conscience générale que nous appelons le champ de conscience. Nishida recourt à ce terme de la gnoséologie et de la psychologie rationalistes mais ne voit pas dans le champ de conscience, comme Kant ou encore Husserl, un fantôme de la conscience saisissable objectivement et définissable à la manière d’un objet, ou une conscience transcendante, il y voit bien plutôt, comme Bergson, quelque chose d’insaisissable, d’indéfinissable, dont la présence ne peut être éprouvée que dans l’intuition. Nishida conçoit les opinions existantes sur la conscience comme la résultante de ces points de vue hypothétiques selon lesquels celui qui considère la conscience se situerait lui-même en dehors du courant de la conscience et pourrait ainsi considérer et analyser celui-ci objectivement. Nous rejetons cette façon de voir comme du rationalisme. Les analyses biologiques, psychologiques ou phénoménologiques ne peuvent pas appréhender pleinement la conscience. Elles observent toujours la dynamique instable de ces processus depuis un point de vue fermement statique. Cela signifie une chosification de la conscience. L’essence de la conscience consiste tout d’abord dans son insaisissabilité depuis l’extérieur, ensuite dans la saisie elle-même et non dans l’objet saisi. La fonction de la saisie est dans l’identité de la saisie avec son objet. La sensation est aussi une saisie, tout comme la perception. Mais les choses qui sont saisies dans la sensation ou la perception sont, tout d’abord, transcendantes à la saisie – elles ne sont tout simplement pas complètement saisies – et, ensuite, non continues. Elles ne deviennent continues que par le souvenir, qui lie le passé au présent et jette leur ombre prospectivement dans le futur. Parce que le souvenir du passé est, phénoménalement, une conscience dans le présent, tout souvenir est en tant que saisie quelque chose de présent. La saisie est donc quelque chose de momentané et de présent. Cependant, la conscience a, d’une part, une connaissance de la continuité de l’expérience et, d’autre part, une connaissance concomitante de l’identité permanente profonde du moi. Cela tient manifestement à ce que le passé est reçu dans le présent. Seulement, l’objet de la saisie n’est plus la chose transcendante mais le moi passé. Or la saisie n’approche de son objet que lorsque le moi lui-même devient objet. Cette saisie n’est alors plus sensation ou perception, ni un travail de l’entendement considérant le moi depuis l’extérieur ; c’est un moi qui veut se saisir soi-même. Ce moi n’est toutefois plus le champ de conscience qui peut devenir un objet de considération objective au sens de la théorie de la connaissance et de la psychologie ; c’est quelque chose d’insaisissable qui ne peut devenir sujet de la pensée, étant au contraire « prédicat ». Le rationalisme entend saisir cette propriété du moi, selon laquelle il peut devenir à lui-même son objet, par le biais du schéma logique a – a, comme chez Fichte. Mais dans sa saisie de soi, le moi s’engendre soi-même. Le moi ne se réfléchit pas une fois pour toutes dans la connaissance de son identité, à chaque moment il est infini et par conséquent présent. Aussi, nous ne pouvons comprendre la saisie de soi-même par le moi via l’abstraction logique ni via le comptage des moments infinis ; car la saisie de soi-même est directement présente. Cette présence du moi ne peut être niée ; une tele négation serait elle-même une activité du moi présent. Nishida désigne cet état, par une expression tirée de saint Augustin, comme l’« instant éternel ». L’instant est éternel car il ne connaît aucun être déterminé derrière soi comme véhicule mais se tient directement devant le « néant ».
Les états individuels du moi sont des formes du moi singularisées les unes des autres et étant chacune pour soi. Mais derrière le moi individuel il ne se trouve pas une tierce partie mais le néant, car ce moi est seulement présent et direct. Ici s’applique le mot de dépendance de l’indépendant ou de « continuité du non-continu ». La saisie est pour le moi le présent dans lequel il vit réellement. Quand le moi veut se saisir soi-même, il n’a pas devant lui un moi logique ni un moi psychologique, il s’engendre lui-même. Cet engendrement de soi-même par le moi est la saisie pure, qui est, d’un côté, connaissance de soi, de l’autre, acte. La connaissance est acte, l’acte est connaissance. Le lieu ou la place où cela se passe n’est pas le monde de la nature mais celui de la communauté humaine qui « sursume » le monde de la nature. En elle, tous objets et toutes choses sont l’expression de l’acte ; ce sont des « faits », des « actes-choses » [Tat-Sache, décomposition du mot Tatsache, en français un « fait »] et ce sont du présent. Si une saisie directe n’est possible que dans la forme d’une saisie de soi-même par le moi, nous ne pouvons connaître le fondement ultime de l’être ou l’abîme de la connaissance humaine que dans le moment présent. Ce présent est, à la différence de la considération rationaliste, le « fait » qui englobe à la fois le monde de la nature et celui de la personnalité. Dans le fait concret, le moi a pour objet le monde en tant que communauté, en se faisant soi-même objet, en agissant. Dans l’acte nous rencontrons pour la première fois l’être inexpugnable et irrésistible que nous nommons réalité. Les résistances dont nous faisons l’expérience nous communiquent de dures réalités. Tant que nous considérons les choses et le monde dans une contemplation passive, il ne s’agit pas encore d’« objets », nous ne les « confrontons » pas encore. Mais ils doivent d’autre part être notre propre expression ; car autrement ce ne sont pas des « faits », « actes-choses ». Nous nous trouvons là de nouveau devant une contradiction, mais cette fois-ci elle paraît insoluble. Cette contradiction tient à ce que l’on cherche l’essence du moi dans l’individuel. Tant que nous considérons le moi comme individuel et que nous supposons derrière le moi un moi abstrait transcendant, nous ne pouvons saisir l’essence du « fait ». Nous comprenons cette relation par le biais du principe de contradiction entre l’individuel et le général. Le « fait » nous assigne, nous humains, à la communauté, qui ne consiste pas en moi individuels ou en une somme de moi mais dans la relation tendue entre le toi et le moi. Le milieu, la communauté commence dans cette relation entre le toi et le moi. Mais dans ce fait primordial (Grundtat-sache) se trouve à nouveau la contradiction que le moi combat le toi et se réconcilie avec lui comme un individu. Ce toi, en tant que le combattant d’un autre moi, est l’esprit lui-même. Quand il doit être combattu par un autre, c’est un esprit chosifié qui n’est pensé que comme être indépendant, isolé, individuel. Le combat proprement dit entre le moi et le toi a lieu à une autre « place ». À cet égard, nous ne devons pas oublier que la relation primaire entre le toi et le moi est toujours déjà présente en nous-même. Mon corps est pour mon esprit le toi, mon moi passé est pour mon moi présent le toi. En niant en nous le toi passé, nous voulons trouver dans le moi présent un autre moi. La négation du passé est possible par l’amour du présent. Quand nous croyons pouvoir nier ou combattre le toi sans l’aimer, nous nous nions nous-même complètement.
L’amour que nous devons porter même dans le combat en nous-même, Nishida ne l’appelle pas « Eros platonicien » mais « Agapê ». Dans l’Agapê, où le moi et le toi sont liés inconditionnellement, se trouve la communauté humaine. Dans la communauté, en tant qu’individu, personnalité libre on est devant l’abîme de l’indépendance, devant la solitude absolue du néant, mais en tant qu’ami on est dans la dépendance réciproque qui constitue l’essence de la communauté. Quand cette contradiction nous devient sensible, nous nous tenons alors directement devant Dieu, non devant un Dieu personnel possédant les qualités humaines portées à l’infini ou à une démesure gigantesque, mais devant le Dieu qui « sursume » en lui tout étant et pourtant le laisse exister. Dieu est le prédicat, et l’homme est l’objet. Dieu est au contraire de l’individu un néant, mais il est en même temps le concret absolu que chaque individu a pour l’expression de l’objet de soi-même. Il n’y a pas pour nous humains d’autre monde que celui-ci : pas d’au-delà, pas de paradis, ni avenir ni passé, mais à l’intérieur de l’opposition absolue Dieu nous rencontre dans le néant comme abîme. Le monde réel existe au-delà de l’être et du néant – dans le néant absolu où Dieu lui-même est nié. Le monde réel est le présent retrouvé derrière chaque contradiction4.
.
Notes de l’auteur
1 En langue allemande : Die intelligible Welt [de Nishida], éd. Walter de Gruyter, Berlin 1943.
2 Sur la philosophie du « néant » doit paraître un autre essai de l’auteur, dans le 3e cahier du volume 43 des Kant-Studien.
3 Nishida, Die selbstbewußte Bedingtheit des Nichts, p. 140.
4 Voir, de l’auteur : West-östliche Begegnung, Walter de Guyter, Berlin ; Der Buddhismus im japanischen Geistesleben, éd. Limpert, Berlin ; Das Heldische in Japan und Deutschland, Walter de Guyter, Berlin.