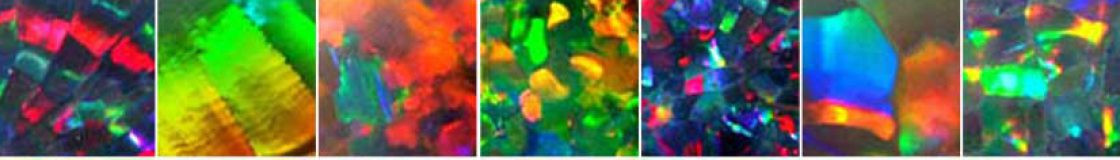Tagged: Verlaine
La Louis-le-Grandiade : Poème épique
Table des matières
I/ La Louis-le-Grandiade
II/ Galions
III/ Garrigue
1
La chanson du gueux
N’ayant pas eu l’honneur comme Jean Richepin
De passer ma jeunesse à l’École Normale
En sortant d’un lycée à Paris, droit chemin,
Pour faire La chanson des gueux route normale,
Je ne puis vous chanter que La chanson du gueux…
Chaville fut le bourg où je grandis, sauvage.
Chaville au bois dormant, c’est dire Périgueux,
C’est dire Tombouctou, c’est dire… un marécage.
J’ai bien connu les fils du chauffeur, du postier !
Quand de boulevardiers Jean Richepin s’entoure,
L’enfant de l’infirmière occupe mon plumier.
Quand je m’épris, ce fut de la fille d’un bourre.
(Croyez bien cependant que je n’en savais rien :
Elle ne disait mot de son père, et pour cause !)
Je grandis sans savoir ce que c’est que le bien,
Ce que c’est que le mal, en sous-urbain morose.
La télévision pourtant nous distinguait :
Chez nous Roland Garros annonçait les vacances.
Malgré mon bon vouloir le sport me fatiguait,
Je m’étonnais parfois de quelques dissemblances.
Mais je suis de tout cœur avec les Chavillois
Dans la haine sans fard des lettrés bureaucrates.
Notre école est sans doute un peu trop près des bois
Pour lever de futurs poètes hydropathes.
*
2
Ulrique-Élisabeth, ange de Swedenborg !
Toute femme, après vous, est une hydre, un cyborg,
Chimérique robot dont Frankenstein allume
Les ampoules des yeux, coud la noire amertume
De son cœur sous le sein d’écailles d’un lézard,
Et crible d’électrons le visage blafard
Que la bouche grenat d’une escarre fissure.
Vous seule éblouissez mon rêve, qui s’azure
Aux feux élyséens de vos yeux cérulés.
Je vais parmi les rocs de temples écroulés,
Ne voyant que les fûts d’une sylve nouvelle,
Et dans ces bois j’entends la voix célestielle
Dont vous dites un jour, pour moi : « Comment vas-tu ? »…
Je vais tellement bien, sur le monde abattu !
Ulrique-Élisabeth ! au nom de qui je chante,
Au nom de qui je prête au songe qui me hante
Des aspects de féerie et d’arbres enchantés
Où vit emmi les fleurs des rameaux apprêtés
Une cité d’amis au-dessus de la terre,
Ils disaient à l’enfant que j’étais « Crois, espère ! »
Et leur voix dans le vent qui murmure, si bleu,
M’accompagne et me dit : « L’Amour affirme Dieu. »
.
I
La Louis-le-Grandiade
.
3
D’un regrettable malentendu
Tout était raté dans le cours
De ma vie : études, amours,
Projets, objectifs quels qu’ils fussent.
Les badauds, trop intelligents,
Ne pouvaient me voir sans qu’ils n’eussent
À frémir des appels urgents.
Ma nullité si manifeste
La faisait fuir comme la peste,
Comme si je tendais la main.
Je ne sais quel sens magnanime
Rendait autrui sur mon chemin
Soudain tyrannique et sublime.
Quelque affreuse difformité
Donnait le droit, d’autorité
Car cette leçon m’était due,
Aux inconnus de se saisir
De l’occasion de ma vue
Pour exprimer leur déplaisir.
2
quand on est jeune c’est pour la vie (Philippe Soupault)
Oui, si j’avais mieux réussi,
Moi-même alors, dans l’insouci,
J’aurais exprimé ma très forte
Désapprobation, aigreur,
En manifestant de la sorte
Mon irrécusable hauteur.
En effet, nous vivons en foules
Et les hommes étant des poules
Il faut qu’ils picotent du bec.
Si j’avais aussi le diplôme
Qui m’aurait rendu pâle et sec,
Comme je serais ignivome !
Si j’étais de Louis-le-Grand
je ne serais pas ignorant,
Et si j’étais de Henri-Quatre
Ou bien à Stanislas connu,
Je ne serais pas comme un pâtre
Du Péloponnèse ingénu.
Hélas, je lisais des poèmes
Qui se riaient des anathèmes
Lancés par de vieux professeurs.
J’ignorais encore, ô Candide !
Que leurs beaux, leurs divins auteurs
En étaient, de ce club splendide.
*
4
Si j’étais de Louis-le-Grand
Si j’étais de Louis-le-Grand,
Je ne serais pas ignorant.
Je me connaîtrais de l’élite,
Je pourrais me dire écrivain
Qu’on recherche, que l’on édite,
Je ne penserais pas en vain.
Et si je clamais : « Plus de rime ! »,
Cela ne serait pas un crime
Car ce serait la nouveauté.
L’élégance la plus baroque
Semblerait la modernité
Et nullement de basse époque.
Je serais un nouveau Claudel
Au Mystère donnant du sel.
J’inventerais la négritude
Comme Aimé Césaire ou Senghor.
Dans ma profonde solitude
J’aurais tout un état-major.
Je serais comme Baudelaire
Un poète très solitaire
Apprécié du Tout-Paris.
Le tribunal serait la scène
Où seraient en mon nom flétris
Les vils pourfendeurs de l’obscène.
Comme Théophile Gautier,
Je ne ferais pas de quartier
Aux ennemis du romantisme.
Sortis eux de l’on ne sait où,
Les Anciens, suiveurs d’un sophisme,
Seraient aussitôt mis au clou.
Je pourrais être Jean-Paul Sartre,
Jaunâtre, louche, atteint de dartre,
Philosophe et cabaretier,
Et l’on viendrait me voir au Flore
Sur des liasses de papier,
Où l’éclat des cuillers me dore.
Ou si je n’étais pas « Jean-Paul »,
Je serais « Paul », Bourget, moins fol
Sans doute, moins philosophique,
Malheureusement oublié
Après avoir mis en musique
Ceux dont il fut déifié.
Autrement, la grande virile,
Robert Brasillach à la ville,
Qui, sachant qu’on l’allait punir,
Peignit Hésiode en Gribouille
Et fut le premier grand Vizir
À traduire ὄρχις avec « couille ».
*
5
Hernani, ou La bataille de Louis-le-Grand
Dans la salle guettant tout ce qui rage ou bouge,
Théophile Gautier avec son gilet rouge !
Pour son ami Victor Hugo, poulain cabrant,
Au vers tumultueux de déclive rivière.
Et pour l’honneur aussi de leur Louis-le-Grand.
C’est ainsi que se fait la valeur littéraire.
*
6
De l’influence de Rimbaud sur Louis-le-Grand
Avant lui nos auteurs venaient de ce lycée ;
Après lui, tout autant. Notre Gaule effacée,
Des provinces où règne un silence de mort,
Se laisse diriger par une cour d’école :
La richesse n’est rien en cas qu’elle n’en sort.
Tout le pays croupit devant cette coupole.
Rimbaud vint à Paris, sépulcre de Musset
(Henri-IV), pour voir Verlaine (Condorcet).
« J’aimais un porc », dit-il, qui tenta de l’occire.
Le porc était bien vu, Rimbaud un Africain
Qui ne demanda point son reste de délire,
Le Voyant quasi mort aux mains d’un Arlequin.
Fermons la parenthèse. Étoile consacrée,
Il donne à Charleville une palme sucrée.
« On n’est pas sérieux quand » à Louis-le-Grand,
D’où le Français béat apprend sa patenôtre,
On prétend que Rimbaud est sublime, inspirant :
Ils parlent des « Assis » comme de quelqu’un d’autre !
*
7
Nom de l’assassin : Paul Verlaine
Car il était de Condorcet,
Se croyait Alfred de Musset,
Écrivant des arlequinades
Qui sentaient leur dégénéré
D’après Lombroso, ce taré
Devint l’auteur de pistolades.
On a parlé de passion
Amoureuse : déception !
Quel autre exemple d’homophile
Tirant sur un de ses amants ?
Ce n’est là qu’un de ces romans
Qu’on sert au public imbécile.
Non, sous les guêtres d’Arlequin
Se mussait un loup, un requin,
Un sadique irrécupérable,
Un criminel congénital
D’après Lombroso ; ce brutal
Bouffon, de tout était capable.
Or Paul Claudel (Louis-le-Grand),
En critique toujours errant,
Convaincu l’appelle un poète
Chrétien, tandis que Mauriac,
Qui pour ça mérite le sac,
Nous fait Rimbaud analphabète
(Rimbaud serait un « blouson noir » !).
La victime du « désespoir »
De l’Arlequin de bon lycée
Serait ainsi le singe affreux,
Alors que c’est ce malheureux
Dont la main gauche fut blessée.
Écoutez les faits à présent !
Le clown faunesque et malfaisant
Haïssait à mort le génie
De l’innocent provincial,
Lui cachait son fiel glacial,
Son homicide vésanie.
Rimbaud jeune, encore naïf,
Aux yeux bleus de contemplatif,
Ignorait ce que nos élites
Ont de haine dans un cœur froid,
Lui-même étant pur, simple et droit,
Si loin de ces vapeurs maudites.
On a parlé d’amour : c’est beau,
Si beau, comme un roman-photo.
On a parlé de jalousie :
C’est vrai ! celle de l’écrivain
Pour un rival sublime et fin
Haï jusqu’à la frénésie.
Sous les dehors de l’amitié,
Le fourbe serpent sans pitié
Dans le noir fourbissait son arme.
En se faisant le picaro,
Le Triboulet, le Figaro,
Il paralysait toute alarme.
Oui, cette tête-là de bouc
Vendeur de beautés dans un souk
Voulut tuer le plus céleste
Ange de notre panthéon.
– Va jouer de l’accordéon,
Ægipan, vieux satyre agreste !
Tu l’as dégoûté d’être roi.
Il était prince, lui, pas toi,
Digne produit de ton école !
Tu n’étais, toi, qu’un tueur né,
Ton noir amok était inné,
Ta cervelle endurcie et folle.
Lui se couronne de lauriers,
Vous n’êtes que des écoliers.
Et toi, la criminologie
Nous a fait ton portrait-robot :
Ton citron fêlé comme un pot
À Sainte-Anne est d’anthologie.
*
8
École
Car nous ne sommes pas égaux
Devant l’école, que de maux
Sous silence passés par elle.
Avant la grande école il est
Plus petite école, c’est celle
Dont il faudrait sucer le lait.
La petite mène à la grande,
Le reste est une vaste brande
De genêts, fougères, chardons.
Plus petite encore s’impose
Pour accéder aux nobles dons
De la petite, grande chose.
En un mot, si vous n’êtes né
Sous le chambranle suranné
De cette école ou bac à sable,
Voie étroite du devenir,
Votre destin est lamentable,
L’on n’aura de vous souvenir.
Cette opinion n’est point neuve
Mais du fait j’apportai la preuve,
Chiffres à l’appui, mes auteurs !
Que ne le disiez-vous, misère !
Que vos délires enchanteurs
Avaient Louis-le-Grand pour mère.
Hélas ! que ne le disiez-vous.
Nous n’aurions alors, pauvres fous,
Cru devenir un jour des vôtres,
Puisque nous étions de Clamart
Où les fortunes sont tout autres.
Nous eussions connu notre part.
Sous-urbains ou de la province,
Que notre balourdise évince,
Nous sommes vos commentateurs
Tout au plus, louons vos prouesses
À des enfants de travailleurs
Qui n’auront jamais vos richesses
(Immatérielles s’entend).
Vous celiez ce fait important
Que si nous l’avions su naguère
Nous vous aurions dit « M*** alors ».
Surtout nous ne nous fussions guère
Lancés vers d’impossibles ports.
*
9
Dignes fils
Dignes fils de Louis-le-Grand !
Quand l’un à la rime s’en prend,
Un autre aussitôt à sa suite,
S’en faisant le commentateur,
Dit que la rime périclite,
Que c’est, rimer, trop réducteur.
Est-ce le chemin de la gloire ?
Un conseil : méditez l’Histoire,
Ce sont moyens de charlatans ! –
Les plus sublimes pyramides
Jaillissent dans les premiers temps
Sur des plateaux venteux, arides.
Puis, avec la prospérité
Se répand la facilité :
Les monuments portent la marque
D’une paresse sans recours,
L’Art se décompose, la barque
D’Osiris navigue à rebours.
Plus le terme fatal approche,
Plus le ciseau mordant la roche
Produit de chétifs avortons.
Ces tristes efforts lamentables,
Hideux des derniers pharaons
Sont moins courageux que coupables.
Aussi, dans le tombeau scellé
De la rime et du vers ailé
Qu’est aujourd’hui la poésie,
Ne vois-je que le remuement
D’une instante paralysie,
Un funèbre aboutissement.
Et c’est vous, les intelligences,
Le plus grand soin de nos dépenses,
Accueillis en de sacrés murs,
Qui désappointant nos attentes
Promouvez les cultes impurs,
Les corruptions décadentes.
*
10
Du mandarinat considéré comme un des beaux-arts
Poètes d’un régime éclairé, quel lycée
Que celui qui nous vaut votre âme policée !
Savez-vous bien qui sont les poètes « maudits » ?
Ceux que Louis-le-Grand n’a jamais dégourdis.
Vous êtes donc, messieurs, plus que la bourgeoisie,
La malédiction de notre poésie.
Si vous n’étiez point morts dans le mandarinat,
Tous vous mériteriez qu’on vous assassinât.
Pauvre de qui se crut digne de Castalie !
C’était le robinet de votre plomberie.
Ô vous que l’on forma maîtres de l’intellect,
Chiffes ! vous n’avez su garder le vers érect.
Vous étiez mandarins avant que gens de lettres,
Des chefs surnaturels sans la vertu des prêtres.
Le public n’entend plus cette forme d’exploit ?
Depuis quand le public lit-il quoi que ce soit ?
Vos ouvrages, messieurs, me laissent l’amertume
D’avoir voulu pour moi l’encens qui vous enfume.
Le temple était gardé par un géant dragon,
Ce bon M. Durand, concierge à Fénelon.
*
11
Aimé Senghor
Adepte de l’exactitude,
Je définis la négritude
Dans la cour de Louis-le-Grand
Où la pensée est à son comble,
Plaignant un peu le fils errant
Qui n’invente que le candomble.
La négritude, apport inné,
En latin : negritudine,
Aurait pu naître à Henri-Quatre
Comme à la Chambre des débats
Mais je ne crois pas au théâtre
Où s’engendrent les macumbas.
Je lisais, digne, solitaire,
Comte, Victor Cousin, Voltaire,
Fumais avec Thierry Maulnier,
À qui j’ai rendu quelque hommage,
Souffrant qu’à l’Opéra Garnier
Un jour il dît : « Anthropophage. »
J’augurais au pensionnat
Que pour moi le mandarinat
Ne serait pas toute l’Histoire ;
Et quand je vis tomber du ciel
La neige, je me mis à croire
À mon moi présidentiel.
Surtout j’aime la poésie,
Cette olympienne ambroisie
Comme dit Catulle en ses vers.
J’ai chanté des Éthiopiques
Sonores comme des pics-verts
Sur des fromagers séraphiques.
Et j’ai chanté les baobabs.
Dans mon respect pour les toubabs,
J’enrichis la littérature
Avec des mots rares, savants
De botanique, de nature
À charmer les êtres vivants.
Sans jamais oublier ma dette
À Napoléon, à Colette,
Au général, à Diderot,
À Charles IX, à Louis XVI,
À Clovis et Sadi Carnot,
À Danton et sainte Thérèse.
*
12
Hommage
À un écrivain, pourvu qu’il soit de Louis-le-Grand
Quand je vous vis à la télé,
Comme un albatros esseulé,
Parmi des spots publicitaires
Pour de la soupe et des savons,
Je sus ce que sont vos lumières
Et la chance que nous avons.
Car je la regardais encore
En ce temps, mais l’esprit s’essore
Un jour pour voler dans l’azur.
Quand je vous vis, tête banale,
Sans élégance, je fus sûr
De votre beauté cérébrale.
Et j’entendis des mots si plats
Qu’enchanté je ne doutai pas
De votre succès littéraire.
Vous parliez de rébellion
Et me rendiez si réfractaire
Envers ma télévision !
Vos propos grêles, emphatiques
Avaient le ronron des moustiques.
Vous étiez si hors du commun,
Du sens commun, que l’évidence
S’imposait que vous êtes un
Homme à hanter avec prudence.
Vos propos de salon de thé
Taquinaient la vulgarité.
Avec vous, merci ! comment croire
Qu’une ambition d’écrivain
Est une douloureuse histoire
Pour le gros du troupeau sans fin ?
Si j’avais été femme, ô maître !
Je vous eusse écrit une lettre
Avec deux ou trois haïkus.
Je sais que vous m’auriez reçue ;
La femme en moi, si près de vous,
N’eût été rien moins que déçue.
Si j’avais été moins huron,
Quel plaisir d’écrire au luron
Fameux que vous êtes mes rêves
Et mes souffrances d’incompris !
Devenir l’un de vos élèves,
N’étant même pas de Paris !
*
13
Littéraire provincial
Littéraire provincial,
Aussi célicole et royal
Que soit ton verbe poétique,
Il n’intéresse point Paris.
On n’y saura rien de tes cris
Quand tu deviendras lunatique.
Là Mistral est le nom d’un vent,
Le félibrige un mot savant
Connu d’aucun dictionnaire.
Tes brandes, tes palmiers, ton bourg,
N’étant pas dans le Luxembourg,
Ne connaissent point la lumière.
Tu seras le commentateur
Du loustic et du riboteur
Qui sortiront de Henri-Quatre
Ou rien : connais-toi donc toi-même,
Pour exister dans ce système
Ne cherche point d’autre théâtre.
Ton intellect colonisé,
Même de tous chez toi prisé,
Que vaut-il pour la capitale ?
C’est ta métropole, mon Noir !
Mets tes olives au pressoir,
Donne ton huile, sans chorale.
Si dans ta médiocrité
Une femme, ange de bonté,
Te donne un chiard, lui peut-être,
Dans la cour de Louis-le-Grand
– Tance-le, bats-le ! –, s’il comprend,
Peut penser devenir un maître.
Tu restes au bord du chemin,
Où ton oranger, ton jasmin
Aspirent l’odeur de la terre ;
Cela, devant notre public,
N’a point le bon ton ni le chic
Indispensables pour lui plaire.
Ta vie et tes produits locaux,
C’est tout un pour eux, tes égaux
Qui te ne voient qu’en indigène.
Les Parisiens sont le sel,
Le parangon universel,
Leur monde une étoile lointaine.
*
14
Trois dizains réalistes
Isambour, voulez-vous savoir
Pourquoi je gardai le silence ?
Puisque j’étais au désespoir,
Il me fallait tenter ma chance ?
Hélas ! je ne sais que trop bien
Que vous parler ne pouvait rien !
Vous m’auriez écouté trois, quatre
Minutes puis, en soupirant :
« Sans être de Louis-le-Grand ?
Sans être au moins de Henri-IV ? »
2
Si vous me demandez pourquoi,
Isambour, je fus si timide,
La réponse est qu’en cet émoi
Vous paraissiez une sylphide
Aérienne au noble essor
Dont les boucles de flamme et d’or
De bougainville étaient coiffées,
Et dans mon lot vous adorant
Où voyait-on Louis-le-Grand
Pour y croire, au conte de fées ?
3
Ah je ris ! Avoir publié
Chez un éditeur de province,
Agreste, pour être oublié
Sans attendre… Je ris ! ça grince !
Isambour, je vous aurais dit,
En main l’opuscule maudit :
« Adorez-moi, je suis poète ! »
De rire vous eussiez pleurant,
En pensant à Louis-le-Grand,
Compris que je suis une bête.
*
15
Paul Durand
À genoux il était tombé
Devant le trésor de son âme,
Et son torse s’était bombé
Quand ils s’avouèrent leur flamme.
Mais il s’appelait Paul Durand.
Elle avait fait Louis-le-Grand
Et lui n’était qu’un réfractaire.
Quand il l’apprit, c’était trop tard,
Son visage devint blafard,
Son amour s’éboula par terre.
La haine remplaça l’amour,
Il sombra dans le nihilisme,
Pensant qu’elle avait dit oui pour
« Faire peuple » dans son snobisme,
Le bon ton du Quartier latin
Qui va trouver Félix Potin
Pour s’encanailler, triste folle,
Tout en montrant sa vanité
Avec la magnanimité
D’un choix en dehors de l’école.
Dès lors il n’eut plus à l’esprit
Qu’un sombre projet homicide.
Elle ne vit pas qu’il s’aigrit
Car il l’appelait sa sylphide
Et la mignardait comme avant,
Lui faisait des cadeaux souvent.
Quand elle décéda, personne
Parmi les parents, les amis
Ne dit qu’il pût avoir commis
Un crime : son âme était bonne.
Ce fut pour tous un accident
Et lui dissimula sa joie.
Il lui paraissait évident
Qu’il pourrait suivre cette voie
Et débarrasser le pays
D’autant de ces êtres haïs
Que possible : les sottes fières
Que nous devons porter sur nous
Pour avoir, sur les bancs des fous,
Lu deux ou trois dictionnaires.
Mais combien en séduisit-il,
Combien déborda-t-il de portes,
Ce Durand un peu trop subtil ?
Combien dans sa toile sont mortes ?
C’est ce dont les autorités
Privent les curiosités
Du public au goût trop morbide,
Par respect de Louis-le-Grand,
Que fit ce scandale atterrant
La victime d’un scolicide.
*
16
Le Don Juan de Louis-le-Grand
Il se voyait premier de sa promotion
Et dans la cour aimait se mirer dans les flaques.
Quel est le sens final de cette expression,
Le Don Juan de Louis-le-Grand ? C’est « tête à claques ».
Qu’un marquis séduisît des femmes en tous lieux,
C’est propre à fasciner nos frivoles bas-bleus.
Que le voyou se range avec une vérole,
C’est la loi naturelle, ignoble des faubourgs.
Mais qu’un littérateur de la meilleure école
Joue à ce jeu, c’est trop présumer d’un concours.
*
17
Tchandâla
De tous ces écrivains, notre élite, incubés
Dans quatre ou cinq préaux moisis en vain prestige,
À qui des rêves bleus dans leurs berceaux tombés
Leur montrèrent la Muse aimante et callipyge
Sommer leurs toupets chauds de laurier immortel,
Aucun n’a pu sauver le vers sacramentel.
Tous ont suivi l’obscure et tchandâlesque pente
De la facilité, du remous plébéien.
Un tel dénigrement de l’héritage ancien
Montre qu’était inné leur goût pour la fiente.
.
II
Galions
.
18
Ulrique-Éléonore
Ulrique-Éléonore ! en bateau, d’Elseneur
Tu passais comme un ange, et depuis ma fenêtre
Je vis tes cheveux d’or, je contemplai ton être.
Ton bateau ce jour-là me prit tout mon bonheur.
Car depuis ma fenêtre, où je fumais la pipe
En suivant dans le ciel des nuages huileux,
Je ne pensais à rien qu’à des sapajous bleus,
J’étais un Hollandais tulipier sans tulipe,
Et je vis ton bateau traverser lentement
Le bras de mer, tes yeux plus beaux que tout au monde,
Que tout dans l’univers et que tout à la ronde.
Ce fut de ma fenêtre un éblouissement.
Tu passais comme un cygne au milieu des nuages,
Tu souris sans me voir, mon âme s’exalta ;
Et ton bateau passé, ma fenêtre resta,
Moi dedans, prisonnier de vertiges sauvages.
Ulrique-Éléonore ! en quel burg, quel château
T’emporta loin de moi ta frégate cruelle ?
Je voulus me jeter dans le grau derrière elle.
Plût à Dieu qu’il changeât ma fenêtre en bateau.
*
19
Ulrique-Éléonore II
Ulrique-Éléonore ! à vous je pense épris.
Votre bateau passa quand je fumais la pipe
À ma fenêtre, un jour où les toits vert-de-gris
Se reflétaient dans l’eau, trémébonde tulipe.
Je voulus être alors le Hollandais volant
Pour vous suivre au château d’Helsingborg en Scanie.
Du moins un sapajou pour sauter pétulant
Dans les haubans du mât, mon audace impunie.
Un pirate batave, un singe capucin,
Tout mais pas ce moi-là ! Je ne voulais plus être,
Voyant votre bateau passer dans le bassin,
Cet homme qui fumait la pipe à sa fenêtre.
Les balcons cependant s’ornent d’un garde-fou !
L’horizon vous prenait à moi, vous que j’adore,
Et ma main qui tremblait se tendit, geste fou,
Dans le vide. Un soupir : Ulrique-Éléonore !…
*
20
Ulrique-Éléonore III
Ulrique-Éléonore ! épris je pense à vous
Dans mes jours sans couleurs et mes nuits, toutes blanches.
Ma vie est un désert : Les Palmes sans les Guanches
Ou Ponta Delgada sans ses bouvreuils jaloux.
D’avoir vu votre nef passer dans l’estuaire
Comment pourrai-je, aussi, me remettre jamais ?
Et vous, que voyiez-vous, quand au loin je fumais
Ma pipe ? Vîtes-vous ce pauvre solitaire ?
Vous n’avez pas, ô non ! vu se brouiller mes traits
Au moment où je vis vos mirages sublimes,
Vos yeux à l’horizon zinzolin, vers les cimes
De la Dalécarlie aux nivéens attraits !
Mais vous étiez pour moi la montagne dorée
Dans les rayons tremblants d’un destin radieux –
Le bonheur avec vous ! – quand je posais les yeux
Sur vous par qui la bouque était toute éclairée !
Ulrique-Éléonore ! ah, si vous aviez vu
Mon faciès, révélant que me perçait la flèche,
Ma douleur eût peut-être en vous fait une brèche,
Et l’Histoire eût changé, d’un atome imprévu.
*
21
Louise-Ulrique
Louise-Ulrique ! où donc votre nef s’en va-t-elle ?
Allez-vous découvrir, via le Groenland,
À nouveau l’Amérique, entendez le Vinland
Tout peuplé de skrælings cagneux, vous en dentelle ?
Et si votre vaisseau, drossé comme Cabral,
Débouchait au Brésil sur le bord de ses jongles,
Vous dont une servante a poli, peint les ongles
Des mains, à votre teint ne serait-ce fatal ?
Majesté, laissez donc ces folles odyssées
Aux peuples dont les rois sont dits « Navigateurs » ;
De votre sang viking modérez les ardeurs
Pour le sel de la houle et les voiles hissées !
Vous avez bien déjà le Noir Gustav Badin
Pour page et chambellan, voulez-vous donc un Jaune
Une plume en travers du nez auprès du trône ?
Quel est en vous ce goût pour l’étranger, soudain ?
Mon Dieu, que direz-vous quand un roi cannibale
Voudra vous convier au plantureux festin
Qu’il doit à Votre Altesse, assis sur du rotin
Et nu, la peau rongée à moitié par la gale ?
De grâce, accoutumez votre âme à vos alleux.
Le poète attitré que je suis peut le dire,
On n’est bien qu’à la cour, et pour tout un empire
Je ne donnerais pas nos loisirs précieux.
*
23
Louise-Ulrique II
Ayant dompté Pégase en preux Bellérophon,
Je suis, Louise-Ulrique ! en votre cour poète,
Et malheureusement de même un peu bouffon.
Je ne sais pour quel rôle on coiffera ma tête.
Ainsi, j’osai parler des ongles de vos pieds !
Mais il ne nous sied point de vous croire ce membre
Que jamais l’on ne vit, vous croire des souliers,
Et, même chambellan, de vous croire une chambre.
Ce n’est point inspiré des Muses que ce terme
De ma bouche sortit, non : c’est en Triboulet
Absurde, extravagant, jouant au pachyderme.
Moins sot, j’eusse reçu plusieurs coups de stylet.
À présent le poète a droit à la parole.
Louise-Ulrique ! qui s’imagine savoir
Qu’un pied sur vous termine une jambe frivole
Est, quand il voit un ange, incapable de voir.
*
24
Louise-Ulrique III
Louise-Ulrique ! Reine absolue en mon cœur,
Vous n’avez point de pieds, vous n’avez point de jambes,
Vous planez dans l’éther, l’azur de nos iambes,
N’avez d’autre séant que le trône vainqueur.
Dieu fasse qu’en pinçant les cordes de ma lyre
Je ne la tienne point pour marotte de fou
Et ne parle en bouffon ! Vous n’avez point de cou,
Vous avez en dentelle un collet, que j’admire.
Ce qui tient le bâton ne peut être une main,
La couronne n’est point sise sur une tête,
C’est ce que je comprends, en l’état de poète.
Vous n’avez point de pieds, vous montrez le chemin.
Vous n’avez de cheveux, c’est votre diadème.
Vous n’avez point de dos, étant le Souverain
Que l’on ne peut surprendre, infiniment serein,
L’image conservée en soi lorsque l’on aime.
*
18
L’ami d’Ulrique
Mon Ulrique ! adorer ta beauté bavaroise
Est le sens de ma vie, alors écoute un peu.
Qu’on m’invite à choisir entre une bavaroise
Et ton baiser, je dis : L’amour n’est pas un jeu !
Bien des fois n’ai-je point témoigné que je t’aime ?
Que l’on daigne épargner à qui t’aime vraiment,
S’il goûte tes baisers et les choux à la crème
Par ailleurs, les lazzi d’un mauvais sentiment.
Ah, regarde à quel point est écumant, est aigre
Le sourire jaloux de ces piteux Don Juans
Quand j’avale à ton bras une tête-de-nègre
En passant devant eux, ces yeux de chats-huants !
On peut apprécier le sucre en digne barde !
Et s’il est dans mon goût d’aimer l’apfelstrudel,
Le baba, le kouglof, le flan et la flognarde,
Ne puis-je aussi trousser pour ma belle un rondel ?
Qu’ont-ils à mépriser le läckerli de Bâle,
Dont je sais qu’on en sert au sultan au harem ?
Et je ne me sens pas dépourvu du teint pâle
D’un dévot, en mangeant un pastel de Belem.
*
25
Ingeborg-Amélie
Mon château sur le fjord, Ingeborg-Amélie,
Se réfléchit dans l’eau quand la glace a fondu,
Comme ton regard bleu dans ma mélancolie,
Ainsi qu’un oiselet sur l’océan perdu.
2
Nous aurions visité les pays de la vigne
Et du soleil à deux, cœur exceptionnel,
Si le tumulte affreux d’une canaille indigne
N’avait tout recouvert, insurrectionnel.
3
La fortune, l’amour, le bonheur, illusoires.
Mon château sur le fjord a sombré dans le feu,
Sa ruine fumante exhale en loques noires
Un cri de mendiant vers le ciel et vers Dieu.
*
26
Ulrika
In memoriam Jacques de Mahieu
Par l’historiographe de Louise-Ulrique
Fille d’Ullman, Normand qui fut le dieu toltèque
Nommé Quetzalcoatl, la petite Ulrika
Fût devenue avec le temps princesse aztèque,
N’eût été la noirceur de Tezcatlipoca.
Ce rebelle, versé dans la nécromancie
Indigène, adoptant un culte souterrain,
L’âme de rituels sanguinolents farcie,
Fomenta le chaos contre son suzerain.
Le feu tourbillonnait autour des pyramides
À têtes de serpent ; la petite Ulrika
Vit, muette d’effroi, les luttes fratricides
Anéantir son monde, et puis l’on s’embarqua.
Les fidèles d’Ullman allèrent au rivage
Pacifique, lançant des bateaux sur la mer.
Le perfide ennemi les vit depuis la plage
Atteindre l’horizon et se fondre dans l’air.
Longtemps, longtemps les naufs sur leurs planches fragiles
Bravèrent l’océan, la petite Ulrika
Fut la première à qui firent signe les îles :
C’est sur O-Tahiti qu’enfin l’on débarqua.
Devant les naturels saisis, ces têtes blondes
Bâtirent un village ensemble sur l’atoll.
Et le Normand pêcha dans ses eaux peu profondes
Et la nuit se remplit de chants de rossignol.
Et quand vint Bougainville à ces lagons pervenche
Envoyé par Louis des Lys, il remarqua
Que les chefs étaient roux, qu’ils avaient la peau blanche,
Et ne le comprit point, ô petite Ulrika !
*
27
Ingeborg
Sans vous je n’ai plus d’yeux pour la beauté du monde.
En partant sans un mot, vous m’avez pris ma voix.
Pourtant j’allais vous dire : « Ingeborg, quand je vois
Votre beauté, je tombe en extase profonde ! »
Oui, j’allais tout vous dire, avouer devant vous
Mon extase transie, en surmontant l’obstacle
De mon trouble muet, en portant au pinacle
Votre beauté de lys qui me met à genoux !
En me voyant si gauche, et mes saluts moroses,
Pouviez-vous concevoir en moi la passion
Dont j’étais labouré ? cette dilection
Qui me crucifiait sur un jardin de roses ?
J’allais vous dire : « Prends ce stylet, occis-moi ! »
J’étais crucifié sur un petit nuage,
L’amour le plus brutal, délirant et sauvage
Me rendait devant vous un agneau plein d’effroi.
Sans vous qu’est-ce, le monde ? Un sinistre appareil
Servant à Dieu sait quoi, grinçant et phosphorique.
Une maison hantée, ingrate, chimérique,
Où n’entrent plus jamais les rayons du soleil.
Car vous étiez ma joie en ce monde profane
Et j’allais tout vous dire, amour, rêve, Ingeborg !
Si vous ne m’aimez pas, envoyez un cyborg
Anéantir ce cœur qui trop longtemps se fane.
*
28
Ingeborg II
Prêtez attention à ces mots, Ingeborg :
Si vous n’envoyez pas sans tarder un cyborg
Des lasers de ses yeux tournants, électroniques
Me réduire en poussière, en atomes cosmiques,
Je vais, écoutez bien, ordonner posément
L’organisation de votre enlèvement.
Kuslir Agha Brahim, le chef de mes eunuques,
Vous accompagnera dans mon boutre aux Moluques
Et si vous résistez devra dans des liens
Vous serrer, ajustés par ses bras nubiens,
Rugueux pour vos appas, ce qui serait dommage.
Là-bas mon avion, prêt pour le décollage,
Vous conduira tous deux jusques à mon harem,
Un peu loin – désolé – du moûtier de Belem,
Le harem où j’attends avec impatience
Que vous et moi fassions plus ample connaissance.
Fatma vous enduira d’onguents délicieux,
Zineb mettra du khôl sur le tour de vos yeux,
Après que Rachida vous aura bien massée
Et Zulaïka peinte au henné, damassée
Comme un rare tapis de Bagdad ou de Fez,
Et Jasmine enrobée en bijoux d’Agadez,
Et Loulou, ce qui veut dire « perle » en arabe,
Tâchera de chasser de vous le spleen souabe
Que vous ressentirez dans les premiers moments.
Alors nous serons, vous et moi l’Émir, amants !
Si vous n’agréez point cette idylle recluse,
Si vous trouvez que c’est moins conquête que ruse,
Je vous le dis, lancez sans tarder, Ingeborg,
Pour me désintégrer au laser un cyborg !
*
29
Ingeborg III
Un cyborg accosta, cherchant à me tuer.
Or, bien que nous fussions en pleine canicule,
Il était incapable, Ingeborg, de suer,
Ce qui me le rendit suspect et ridicule.
Si bien que j’assénai sur sa tête un coup tel,
De ma plus longue et belle et plus tranchante alfange,
Que le robot s’ouvrit en deux et que le ciel
Est témoin que ce corps n’était point d’homme ou d’ange
Mais un tas de ferraille et de boulons, de fils
Électriques faisant sauter des étincelles,
Et les yeux, de petits canons noirs sous les cils.
Fendu, le tout faisait un bourdon de crécelles.
En fouillant, je trouvai dans les poches du mort
Une photo de vous, Ingeborg, à la plage
Et je sus que son cœur monté sur un ressort
Avait été saisi d’un captivant mirage.
Il vous aimait, ce tas de circuits performants !
Et mourut en jaloux sous ma lame effilée.
Ne devant rien sentir, il connut les tourments,
Comme moi, d’avoir vu votre splendeur ailée.
*
30
Ingeborg IV
Raconte ton histoire, Ingeborg ! la romance
« Le robot qui m’aimait » et que j’anéantis
Car il avait voulu, prônant la violence
De ses lasers, changer l’émir en confettis.
L’émir sut recevoir un céladon de tôle !
Il crut, sous des dehors ma foi peu singuliers,
S’approcher près de moi suffisamment, le drôle,
Mais la sueur manquait à ses traits réguliers !
Le baron Frankenstein doit revoir sa copie :
Il sied non seulement que ruissellent les fronts
Mais aussi – c’est plus fort que la nyctalopie –
Que résistent les cœurs aux appas doux et blonds !
Car j’ai su que la pauvre, inane créature
Sans ordre avait agi, que c’était un jaloux !
Comment dès lors compter sur une joint-venture
Si c’est pour qu’en Pierrots soient investis les sous ?
Et je ne voudrais pas, de grâce ! qu’une armée
De ces loyaux amants, de l’atelier surgis,
Parce que nous aimons la même Dulcinée
Se présentent fâchés ensemble à mon logis !
*
31
Ingeborg V
Ingeborg ! en français ton nom est Isambour,
Nom que tu recevras aussi dans mes poèmes.
Isambour ! si je peux espérer que tu m’aimes,
Sache que j’ai pour toi le plus fervent amour.
Ton nom dans le silence est comme une parole.
L’écouter me transporte au-delà de la mer
En un pays de brume et d’armures de fer,
Et je quitte le bisht d’un émir du pétrole.
Nom si beau, bien français, doux comme ta beauté,
Ton nom est Isambour, ton nom est Ingeburge,
Nom de reine de France étonnant qui me purge
De chagrins atavaux, d’étrange hérédité.
Sois Isambour, aimée au sommet du Parnasse
De tous les troubadours les plus parnassiens,
D’elfes de la forêt verte, magiciens,
De licornes mirant leurs traits dans une glace.
*
32
Isambour
La Danoise Isambour fut de Philippe Auguste
La noble et digne épouse, et jetée en prison
Le jour suivant l’hymen, de manière un peu fruste.
Le « nouement d’aiguillette » en serait la raison.
Le pape fulmina contre le roi de France :
Expresse injonction d’honorer Isambour.
Mais quelque effort, dit-on, qu’il fît avec vaillance,
Il restait sans moyens, même au son du tambour.
Isemberge resta vingt ans sa prisonnière
Avant de remonter sur le trône : c’est tard.
De ce rapprochement je ne sais la matière,
Philippe se trouvait sans doute plus gaillard.
*
33
Isambour II
Belle était Isambour, nous assure Étienne,
Évêque de Tournai ; Philippe, cependant,
Fut noué d’aiguillette, en conçut de la haine.
Ceci changea la face à jamais d’Occident.
(« Philippe n’eût pas eu l’aiguillette nouée,
La face de la terre aurait changé » : Pascal)
Se peut-il qu’Isambour ne fût guère douée ?
Vierges, apprenez donc le talent capital !
Votre beauté pourrait vous nuire, à Dieu ne plaise :
Veillez à conjurer l’injurieux nouement !…
Je mets fin, Isambour, à cette parenthèse.
Plût au ciel que j’en fusse à craindre un tel moment !
*
34
Je voulus rêver à la brune
De vous, plus belle que le jour,
Dans l’insouci, sans peine aucune
Fouler l’herbe, mon Isambour !
Je voulais rêver sous la lune
Au milieu des coquelicots,
Cette nuit lyrique, opportune…
Mais j’écrasai deux escargots !
*
35
Quand je vous vis, mon Isambour,
Je crus tomber à la renverse,
Et je sus que c’était Amour
Qui me blessait, âme perverse.
Rappelez-vous ! j’allais tomber,
Avec un soupir, sur la tête.
Mon cœur s’était mis à flamber,
Je dus vous paraître une bête.
Et j’ai soupiré chaque nuit,
Chaque jour depuis ma culbute
Dans vos rets si doux, comme un fruit
Faisant sur l’herbe un bruit de chute.
J’allais voir les coquelicots
Dans la prairie ensoleillée,
Parlais de vous aux escargots
Sous la lune d’or émaillée.
Je chantais à la tourterelle
À Versailles, voyant poudrée
Votre image dans la dentelle,
Sur la pelouse diaprée.
Enivré de votre beauté,
Je visitais la tour Eiffel
Où je tendais surexcité
La main vers vous mais dans le ciel.
Puis je volais aux Invalides,
Mais pardon si c’est trivial,
Comme à de blanches Argolides
Baiser votre péplos fatal.
Sous des piliers marmoréens,
Je discourais à l’Assemblée
De vos seuls appas cycnéens
Et de votre splendeur ailée.
Brûlé par cette passion,
Je sautai dans un bateau mouche
Où je croyais qu’en papillon
J’approcherais de votre bouche.
Mais je revins au Champ-de-Mars
Où je courus à perdre haleine
Et m’enrhumai – c’était en mars –
Vous pourchassant, nymphe, en Silène.
C’était non loin du quai Branly
Où la Seine aux ondes verdâtres
Emportait mon cœur apâli
Vers l’océan aux eaux saumâtres.
Et je sus que c’était Amour
Qui me blessait, âme perverse.
Quand je vous vis, mon Isambour,
Je crus tomber à la renverse…
*
36
C’était non loin du quai Branly,
Mes ans y furent solitaires.
Mon courage était amolli
Par des façons célibataires.
Arrivé fat de mon bel air,
Je connus la mélancolie,
Été, printemps, automne, hiver,
Tout l’an, d’aimer à la folie.
Sachez-le, j’aimais Isambour,
Plus belle que toute autre femme !
Voulais lui jouer du tambour
Pour lui communiquer ma flamme.
Mais je ne pus, tel est mon dam,
En fat dénué de bravoure,
Figurer plus qu’un nul quidam,
Qu’un paillasse rempli de bourre.
Elle ne sut pas mon malheur,
Isambour que j’avais élue !
Sentit-elle que ma pâleur
Venait de fureur absolue ?
Et me voilà moulu, perclus,
Sourd, aveugle, chauve à cette heure.
Seigneur, ne la verrai-je plus ?
Sans elle faut-il que je meure ?
*
37
Quai Branly
C’était non loin du quai Branly.
Sourd à la voix intérieure,
Je couvris d’un voile d’oubli
Toute raison supérieure.
J’avais jeté mon dévolu
Sur Ingeburge, cycniforme,
Me disant : « Puisque tu m’as plu,
Attends que je te chloroforme ! »
Je ne vis pas d’autre moyen
De parvenir à sa conquête,
Ne chantant pas l’italien,
Ne maniant point la raquette,
Ne sachant danser le tango,
Étant mauvais joueur de dames,
De whist, de crib, d’échecs, de go,
Ne sachant rien qui plaise aux dames.
Au sujet de ma passion
Je ne me fis aucun reproche,
J’implorais que l’occasion
Se présentât, la fiole en poche.
J’étudiais son agenda,
Sa routine, ses habitudes,
Patient comme le Bouddha
En ces travaux et servitudes.
Je négligeai mon entretien,
Mes fréquentations, le monde,
La mise en valeur de mon bien
Et ma vocation profonde,
Mes devoirs les plus absolus,
Les hommages à d’autres belles,
Ma garde-robe, enfin les plus
Indispensables bagatelles.
Il me fallait déterminer
L’instant qui conclurait l’affaire,
L’angle où me positionner
Sur sa route pour bien méfaire.
Je me disais : « Attends un peu,
Il doit venir une minute
Où nous serons en même lieu
Seuls, cachés, vaine toute lutte. »
Un acharnement surhumain !
J’identifiai l’heure exacte,
Le point précis de son chemin
Où je pourrais passer à l’acte.
J’y fus, j’attendis Isambour
Dans l’ombre, palpitant, avide.
Elle passa… Je dis bonjour
Et retournai chez moi, livide.
*
38
Gros-Caillou
C’était non loin du Gros-Caillou,
Dans la paroisse ainsi nommée.
Les touristes criaient « Oh you ! »,
Belles sur ma route acclamée.
Mais je restais indifférent,
Devant ces émeutes barbares,
À ce délire sidérant,
À ces amoureuses fanfares.
Car j’étais trop plein d’Isambour,
N’avais à l’esprit que le crime
Que je ruminais chaque jour,
Chaque moment, crime sublime.
Et sous les baisers qui volaient,
Parfois les murmures obscènes,
Les pleurs qui dans mon dos coulaient,
Je me passais les mêmes scènes :
C’était Isambour avec moi,
Abruptement chloroformée,
Près du Gros-Caillou pour la foi,
Dans la paroisse ainsi nommée.
Lecteur qui blâmes mon désir,
Réponds : était-il admissible
Qu’elle eût éprouvé du plaisir
Et fût vertueuse ? Impossible.
Si j’avais son consentement,
J’en perdrais toute mon estime.
Je ne devrais donc ce moment
Qu’à l’exécution d’un crime.
Tant, lecteur, j’attache au respect
Du sexe faible une importance
Prééminente ; cet aspect
Du cœur, je le dois à la France.
Et ma flamme pour Isambour
Provoqua ma déconfiture :
Le monde me châtia pour
Cette monogame aventure.
À présent c’est sous les lazzi
Que va ma route mal famée,
Non loin du Gros-Caillou, saisi,
Dans la paroisse ainsi nommée.
*
39
Arts premiers
Quand, toute ma science usée,
Mes feux pschittaient sur des glaciers,
Transi, je courais au Musée
Jacques Chirac des arts premiers.
Comme Ingeburge, cycnoïde,
Planait trop haut dans l’éther pur
Et je manquais d’un androïde
Qui me la remît en lieu sûr,
Je plongeais dans la Préhistoire,
Au trente-sept du quai Branly.
Mais ce n’était point pour la gloire
De tout savoir du spath poli :
Je voulais au dieu crocodile
Des Papous de l’île Bismarck
Chuchoter l’oraison utile
Pour l’amour et le tir à l’arc.
Je voulais des têtes réduites
Des Jivaros, dans mon chagrin,
Connaître le secret des rites
Qui me ferait aimer sans frein.
Je demandais à la déesse
Poisson des nus Andamanais
Les mots qui provoquent l’ivresse,
Comme aux vieux totems javanais.
J’épluchais les notes savantes
Des kangourous momifiés,
Des déités et des atlantes
En bois, des dieux scarifiés,
Pour découvrir les protocoles
Partageant le pouvoir divin
De tant de puissantes idoles
Et gagner Ingeburge enfin !
J’aurais consacré les prémices
De mon traitement mensuel,
Accompli mille sacrifices
Aux esprits des eaux et du ciel
Pour, toute ma science usée,
Baiser à genoux ses souliers !
C’est pourquoi j’allais au Musée
Jacques Chirac des arts premiers.
*
40
Musée
Par mon amour trop apâli,
Transi, je courais au Musée
Jacques Chirac du quai Branly,
Comme d’autres vont en fusée.
Et je me souvenais alors
D’une visite électorale
Que Chirac, exhumé des ors
De son alcôve sépulcrale,
Fit dans des quartiers peu cossus
Pour des jeunes là-bas rejoindre,
Et qu’il se fit cracher dessus.
Cela faisait ma peine moindre.
2
Et je me rappelais de même
L’espèce d’ardent hallali
Qu’ils criaient dans leur joie extrême :
« Chirac Branly ! Chirac Branly ! »
3
Touché par cet encens flatteur,
Je n’ai jamais bien pu comprendre
Qu’on entendît « Chirac menteur ! »
Qui ne se pouvait guère entendre.
Parmi les plumes, les atours
Des totems cannibalistiques,
Je méditais : « Êtes-vous sourds,
Commentateurs journalistiques ? »
*
41
Rococo
Enfant je vécus au Mexique,
Loin de mon Hurepoix natal,
Et j’appris d’un savant cacique
Cette histoire d’amour fatal.
.
Au temps de la Nouvelle-Espagne
Et des églises rococos,
Don Pèdre de Bellemontagne
Était la fleur des hidalgos.
Au Zocalo de mille lustres
Arriva de l’Escurial
Madrilène, d’aïeux illustres,
Done Ulrique, cygne ducal.
Quand elle quitta la calèche
En son grand panier chaloupé,
On eût dit, la voyant si fraîche,
La Vierge de Guadalupe.
Au milieu de son long cortège
De reîtres et minnesingers,
Les yeux d’Ulrique étaient un piège
Pour les cœurs bien nés, tous les cœurs.
Don Pèdre en perdit l’étiquette
Tant son esprit fut ravagé,
Se crut à la bonne franquette
Dans les ors, le teck ouvragé.
Sa façon de hanter Ulrique
Déplut fort, jusqu’au Vice-Roi.
Il lui disait « Ich liebe Dique »,
« Mein Harz », « Ongel », n’importe quoi.
Quand un burgrave de la suite
Vint le souffleter, l’hidalgo,
Son honneur lavé, prit la fuite,
Dut s’exiler de Mexico.
On raconte dans la campagne
Depuis ce temps qu’un justicier
Nommé Zorro, de la montagne
Descend parfois justicier.
Mais on dit aussi qu’un évêque
Envoya Don Pèdre accablé
Dans une guerre chichimèque,
Et qu’il fut de flèches criblé.
Apprenant sa fin, Done Ulrique,
Pressant une flor-de-mayo
Sur son bavarois sein féerique,
Pâle, soupira : « Le quiero !… »
*
42
Done Ulrique
Mon ange gardien, mexicain,
M’a donné tout bien réfléchi
Non le costume d’Arlequin :
Un habit de Mariachi.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Velours noir et boutons d’argent,
Arabesque, volute, orfroi,
Un blason de jais réfulgent,
Cet habit grandit avec moi.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Entendez le son de cristal
Des guitares, son de jasmin,
Le long de votre piédestal
Entouré de roses carmin.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Vous montrerez-vous au balcon
Pour un harmonieux amant ?
Ce soir la lune est un jargon,
Vous êtes le seul diamant.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Je suis le chantant rossignol
Qui trille à la brune transi.
Prendrai-je cette nuit mon vol
Avec celle qui m’a choisi ?
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Me lancerez-vous un baiser
À travers le ciel étoilé ?
Vous seule pouvez apaiser
Ce pauvre cœur inconsolé.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Je vous promets mille trésors
Et des îles de tant de fleurs
Et des oiseaux de tant d’essors,
Des clartés de tant de couleurs
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Que ce sera le Paradis
Sur terre, Ulrika, pour nous deux
Et pour tous les cœurs, ablandis
Par un dévouement gracieux.
Ô Done Ulrique, Done Ulrique !
Ô Done, Done, Done Ulrique !
*
43
Don Pèdre
Clarice, unique objet qui me tiens en servage (Corneille)
« Ulrique, unique objet de mon gros sentiment,
De ce féal amour et pieux dévouement !
Exhalant mon chagrin au milieu des pastèques
Et des maïs, faisant la guerre aux Chichimèques
En châtiment d’avoir occis un chevalier,
Qui vous était hélas ! parent et familier
Et dans la nuit profonde entendit mon aubade,
Qu’épris je vous donnai, dans le ton de Grenade,
Sous le balcon fleuri de rose et de jasmin.
Notre explication me barre le chemin
De la cour enchantée où vos yeux servent d’astre,
Dont m’exile un forfait achevant mon désastre.
Voici pour vous, Ulrique, un bleu vergiss-mein-nicht.
J’ai perdu mon soleil, ma lumière, mein Licht !… »
Ainsi divaguait sous un cèdre,
Blessé sans plus d’espoir, Don Pèdre,
Nous dit le père Mendoza
Qui dans la mort le confessa.
*
44
Baroque
La chapelle churrigueresque
Où Done Ulrique allait prier
Mêlait l’extase à l’arabesque,
Tournait la tête au marguillier.
Sous une couronne hispide,
Les gouttes de sang presque noir
De la sainte face livide
Disaient le divin désespoir.
Le Dieu fait homme, à l’agonie,
Au terme enfin de sa douleur
Allait fermer sur l’infamie
Du monde des yeux sans couleur.
Une Vierge miraculeuse
Avait pleuré des larmes d’eau
Sur la bûche à peine rugueuse
De son visage triste et beau.
Et Done Ulrique, teutonique
Vierge aux agréments impollus,
S’absorbait dans cette mystique
Image aux célèbres vertus.
Or, dans un recoin de l’église,
Caché par des rangs de piliers,
Don Pèdre qui la divinise
Couvre de larmes ses colliers.
*
45
Loulou-garou
Avec le loulou-garou (Robert de Montesquiou)
Don Pèdre, dans son désespoir
D’amour transi pour Done Ulrique,
Voulut consulter un cacique
Versé dans l’art funeste et noir.
À cette rencontre honnie
Voici ce qui fut résolu.
Pour chien Ulrique avait élu
Un loulou de Poméranie
Nommé Gunther, qu’en son giron
Elle prenait le soir assise,
À qui Pèdre enviait l’exquise
Proximité de son jupon.
Le magicien autochtone
Conçut un breuvage maudit
Par les conciles interdit
Qui mettrait Pèdre sur ce trône,
Le giron d’Ulrique, en loulou,
En remplacement du navré
Gunther kidnappé, séquestré
Par Don Pèdre loulou-garou !
Prenant son chien, quelle surprise
Reçut Ulrique l’entendant
Crier « Ô joie ! » en se tordant
Comme une palme dans la brise.
Ordinairement compassé,
Gunther n’avait point l’habitude
De manquer à la rectitude
De mœurs d’un monde policé.
Alors les duègnes s’emparèrent
De Pèdre poméranien,
Gémissant pauvre petit chien
Que les duègnes désespérèrent
En le présentant au prélat
Pour sacramentel exorcisme
Par application du chrisme,
Privation de chocolat.
On claustra la bête bavarde,
On manda l’Inquisition…
Le bourreau muni d’un tison
Me réveilla : « Je cauchemarde ! »
*
46
Loulou
Done Ulrique avait
Un sourire d’ange.
Don Pèdre éprouvait
Des frissons, rêvait
Un heur sans mélange.
Gunther le loulou
D’Ulrique était drôle,
C’était le chouchou,
Tendre, un peu foufou,
Goûtant fort son rôle.
Sous les bananiers
Que le soleil dore,
Parmi les paniers
Les cœurs prisonniers
Aiment la mandore.
Le bon Vice-Roi
À l’aimable règne,
Appui de la loi,
Garant de la foi,
Badine la duègne.
Quoi ! tu viens chanter
Une sérénade,
Pèdre ? C’est tenter
Le fer de porter
Une estafilade.
Tu saisis ton luth
Quand monte la lune
Versant son bismuth
D’argent : et ton but,
Dans cette nuit brune ?
Tu parles d’amour
À la belle Ulrique ?
N’osant pas de jour
Lui faire ta cour,
Ta voie est oblique.
Entends donc son chien
De Poméranie,
Comme il entend bien
Ajouter du sien
À ton harmonie !
Il éveillera
Trois ou quatre rues
Et ton opéra
S’éparpillera
En coquecigrues !
Ah loulou méchant,
Gâcheur de tendresses,
Tu veux, empêchant
Ce fébrile chant,
Toutes les caresses !
*
47
Sa duègne à Done Ulrique :
« Votre charme angélique
Est un puissant attrait
Pour les chevaleresques
Galants churrigueresques
Qui s’enflamment d’un trait.
Et sous nos vertes palmes
Quand les brises sont calmes,
L’orage et ses éclairs
En sauvage ruée
D’une sombre nuée
Recouvre les cieux clairs.
Craignez, quand vous ennuie
La cour un jour de pluie,
De céder aux appas
Qu’ont de sombres pupilles
Suggérant des quadrilles :
Ne les écoutez pas.
On me dit qu’à la brune
Il s’entend, quand la lune
Est dans le firmament,
Comme une symphonie,
Les sons d’une harmonie
S’élever doucement.
Que ces notes conspirent,
Quand les brises expirent
Un parfum sans pareil
De jasmins et de roses
Enveloppant les choses,
À troubler le sommeil.
Dieu sait quelle folie,
Quelle mélancolie
Ces musiques de nuit
Peuvent bien faire naître
Si vous laissez paraître
Du trouble à ce doux bruit !
C’est pourquoi Don Garcie
Qui de vous se soucie
Veut apprendre ce soir,
Armé, sous votre grille
S’il entendra ce trille,
Bien caché dans le noir.
J’éprouve tant de crainte
Et j’exhale une plainte,
Me sens clouée au sol !
Faudra-t-il que la ruse
Maniant l’arquebuse
Abatte un rossignol ?… »
*
48
Marbella
Mon cœur était blessé, mon aile
Aussi, la nuit n’était plus belle,
Les jours étaient trop longs, et gris,
Un goût d’échec et de misère
Pesant rendait ma vie amère,
Tous les filons étaient taris.
Et je la vis. Sa chevelure
Irradia sur ma blessure
Les rayons d’un soleil d’avril,
Ses yeux, comme la scintillante
Vague d’une mer accueillante,
Étaient un murmure subtil.
Fuyant les clameurs imbéciles
Pour l’horizon émaillé d’îles
D’un asile où tout échanger,
Nous déposâmes nos bagages
Dans un hôtel au bord de plages
Aux parfums de fleurs d’oranger.
Je voulais marcher avec elle,
Suivre notre route, laquelle ?
Espérant au soleil couchant,
Sur le gouffre étale des ondes,
Hors de l’espace, hors des mondes,
Monter et finir, comme un chant.
*
49
Marbella II
J’avais perdu l’envie
De vivre cette vie,
Je ne voyais qu’affronts,
Acrimonie, injures,
Infâmes impostures,
Haine sur tous les fronts.
Et puis, dans un sourire
Elle gagna l’empire
De mon sang, de mon cœur.
Sa beauté supernelle,
Comme la citronnelle
Épandait sa fraîcheur.
Nous fûmes où les terres
En plages solitaires
Se bercent au respir
Des vagues scintillantes,
Aux brises larmoyantes,
Ce cristallin soupir.
Je voulais avec elle
Contempler l’éternelle
Nuit vaste et sans contours,
Où dans cette étendue
Nous fondre, âme éperdue,
Pour nous aimer toujours.
*
50
Belle Marbella
C’étaient les orangers, la mer,
Les palmes dans le ciel si clair,
Le parvis des blanches églises
Sur le bord de plages sans fin,
Les jardins à l’odeur de pin,
Le soupir des vagues, des brises.
C’étaient nous deux main dans la main,
Que te semble de ce chemin ?
Près des jasmins ma renaissance.
C’était le jour après la nuit,
Des baisers donnés sans un bruit,
De mon cœur la convalescence.
C’était la rose avec l’œillet,
C’était la main qui les cueillait,
Mon âme qui pleurait de joie,
Tes mots comme un vin andalou,
Un trotte-menu de loulou
Dans l’après-midi qui poudroie.
C’était dans la sublimité
Mon rêve fait réalité,
Nous deux pour nous deux, la tendresse.
Et parfois, comme d’un lointain
Nuage au-dessus du destin,
Un long roulement qui m’oppresse…
*
51
Marbella la douce
Je l’avais emmenée au bord
D’une mer lapis sur un port
Embaumé par la fleur d’orange,
Marbella : son fidèle amant,
Je lui montrai le diamant
Du cœur, moins beau que son cœur d’ange.
Ses yeux s’emplirent d’un bonheur
Qui me ravit par sa douceur,
D’étincelles de mer turquoise.
Le temps s’arrêta, je compris
Que sa main n’avait pas de prix.
Je suis son âme siamoise.
Le temps arrêté, cet instant
Je fus éternel et pourtant
Je sentais tout l’amour possible
D’une vie en dehors de soi
Attachée en acte de foi
À plus que soi, son cœur sensible.
Ce rêve sera mon linceul.
Dans cette vie où je vais seul,
Je dois avancer sur la route
Où je m’engageai sans savoir
Qu’elle conduit au désespoir…
Au désespoir mais non au doute.
.
III
Garrigue
.
52
Célimène
Je contemple la mer seul depuis la garrigue,
Pensant à Célimène, ondine aux cheveux d’or
Que dans un pin me chante un enjoué becfigue.
Dans l’étincellement des flots est mon trésor.
Célimène, reviens ! dis-je dans ma détresse,
Sors à nouveau de l’onde, humide, les bras nus,
Car je n’ai plus de goût ni pour la bouillabaisse
Ni pour le cotillon aux hameaux biscornus.
La pinède peut bien retentir de cigales,
Je n’entends que ta voix, sourd à tout autre son.
Je t’aime tant ! Qu’importe aux âmes provençales
Que les sirènes soient mi-femme mi-poisson ?
Le Papet m’a conté que les écumes blanches
Dissimulent des mas grands comme des châteaux
Où vivent les ondins, habillés des dimanches,
Parmi des champs de vigne à longueur de coteaux.
Mais je t’aime pour toi, Célimène, toi seule :
Non pour tes pampres lourds de bumaste et jacquez,
Ni pour la tapenade écrasée à la meule,
Non plus pour tes palais comme de Saint-Tropez.
À la mer je descends par le chemin des chèvres,
Vers Célimène, ondine aux yeux d’indigo clair,
Et j’implore un baiser suave de ses lèvres,
Dût-il, ce doux baiser, me noyer dans la mer…
*
53
La sylphide
Ma sylphide à tous yeux cachée,
Des bras vous empêchez le roc,
Le colossal, énorme bloc
D’écraser ma tête penchée.
Le monde tomberait sur moi
Et je ne pourrais m’y soustraire
Si de votre aile de lumière
Vous ne moquiez sa dure loi.
Ne seriez-vous même qu’un rêve,
Je crois au pouvoir souverain
Qu’il a sur le glaive d’airain
D’imposer bienveillante trêve.
Fée invisible du chemin,
Je crains même votre colère
Contre le fou, le pauvre hère
Qui sur moi lèverait la main ;
Oui, je crains les peines sanglantes
Dont votre impétuosité
Fustigerait l’iniquité
Des ignorances violentes.
Car il vous plaît d’accompagner
Ma déréliction morose
De votre étincellement rose,
Il vous plaît de tout m’épargner.
*
54
Pour la première fois cette nuit, au matin,
Plein de respect profond je vis vos seins en rêve.
Puis – en y repensant un sourire m’enlève –
Vous laissâtes mes yeux approcher d’un tétin,
Penché sur vous ainsi qu’au bord d’une fontaine…
Vous ne souriiez pas mais vos yeux m’appelaient,
Comme des flots d’azur et d’or étincelaient,
Et mon âme adorante était claire, sereine.
Dans la simplicité de ce don lumineux
Je vois, linéaments de formes adéquates,
Plus de réalité qu’en mes jours disparates
Et comprends que je suis grâce à vous bienheureux.
Vous avez tout pouvoir sur l’onde tourmentée !
Depuis que vous servez d’étoile pour ma nauf,
J’ai la conviction de rester sain et sauf.
Quelle vague pourrait me couler, Galatée ?
*
55
Vénus paléolithique
Nous à qui le clinquant de la société,
Les chinés oripeaux de la haute culture
Semblent comme à Rousseau servage, impiété,
Un bouillon nidoreux de blême pourriture,
Nous aimons Célimène à la taille de sphinx !
Nous la vîmes entrer dans l’oasis subtile,
Des roseaux exondée au son de la syrinx.
Nous avons chanté l’eau dans le croissant fertile !
Son âme de cristal ameublit nos poings durs.
Et dans une caverne où nous l’avons suivie,
Nous avons adulé son ombre sur les murs
Et soumis au limon de ses pieds notre vie.
Ô blonde comme un champ sauvage de blés d’or,
Comme sable infini sur l’océan ô blonde !
Nous avons chanté l’eau, chanté l’alligator,
Sa beauté sans savoir que la terre était ronde !
*
56
Écrivains combattants
À Suzel
Je ne vous parle pas des Résistants,
Qui vont nous assommer encore un temps,
Mais de nos grands auteurs de la Première,
« La der des der », de ces illustres morts
Qui passèrent quatre ans sur le derrière
Au fond d’un trou de fange avec les porcs.
Je parle des Poilus dans les tranchées,
Grâce à qui nos Suzel sont revanchées.
Non contents, fiers soldats, d’un tel honneur,
Il vont par le menu dire la soue !
Hélas ! malgré leur dette au parfumeur,
Leur cervelle restait pleine de boue.
*
57
Président du Panthéon
La lettre de la loi suprême
En faisait un signe passif.
C’était, de l’aveu de lui-même,
Un président décoratif.
Jusqu’au jour où son équipage
Croisa Sante Geronimo
Caserio : ce bon nuage
Alors fut nimbé d’un halo.
2
Le poignard panthéonisa
Cette fonction avachie.
Sadi Carnot s’intronisa
Saint laïque par l’anarchie.
3
Carnot, entre donc ! La Patrie
Reconnaissant l’épanchement
De ton sang dessus la voirie
Te doit le plus pur monument.
Entre donc et sois un grand homme
Pour la coite postérité,
Rejoins notre Panthéon comme
Martyr de l’inutilité !
*
58
Ami, si tu vas à Porto,
Tu verras mainte belle église,
Comme l’on n’en voit guère à Pise,
Guère plus à Sacramento.
N’eût été la guerre civile,
L’Espagne en aurait tout autant.
Le bolchévisme serpentant
A tout ravagé, l’imbécile.
L’or des Incas est à Moscou
Depuis ces actions barbares,
Ce qui prouve que les Tartares
Entendaient nous tordre le cou.
Ami, si tu vas à Lisbonne,
Blanche terrasse au bord de l’eau
Où l’on écoute du fado,
Tu sauras que la vie est bonne.
*
59
Une couronne
Notre nom à tous est personne ;
Paris, nous sommes ta couronne.
Nous sommes, Paris, tes faubourgs.
C’est là que nous vivons, farouches,
Nos désespoirs et nos amours
Que sans les voir jamais tu touches.
Vers toi nous sortons de nos trous
En domestiques ou voyous
(« Les voyous des faubourgs » : poète
Philippe Soupault, tu vois bien !),
Le propos toujours déshonnête,
Pour tout dire : faubourien.
Vers toi nous sortons de nos antres
Non pour nos esprits : pour nos ventres
Si nous sommes des travailleurs,
Ou comme des oiseaux de proie
En sombres essaims querelleurs
Si te nuire fait notre joie.
Qui dira « Paris, à nous deux ! »
Sans passer pour sot outrageux
Chez nous ? Qu’à ces marivaudages
Se délasse un provincial,
S’il peut te présenter des gages
Sur son bien patrimonial.
Quand nous n’avons pas trop de haine
Pour ton ignorance hautaine,
C’est que nous sommes des niais.
Mais nous avons la suffisance
De nos miettes : si tu savais
Comme nous méprisons la France !
*
60
Kremlin
Isambour rencontra quelqu’un
Qu’elle n’eût jamais dû connaître.
Voyou de faubourg importun,
Aux Barnufles, Kremlin-Bicêtre,
Sur je ne sais quel boulevard
Lénine, Khrouchtchev, Gagarine,
Il n’eût point semblé trop pendard,
Mais Isambour fut sa voisine
Dans le quartier du Gros-Caillou :
Comment cela fut-il possible ?
Ce pays deviendrait-il fou
Et plus rien n’est inadmissible ?
La belle Isambour au grand cœur
Doit-elle souffrir que des mufles
Se méprennent sur sa valeur ?
Qui l’a fait sortir des Barnufles ?
Qui l’a fait sortir des faubourgs
Gagariniens de non-êtres
Où l’on a de banals amours
Et le linge pend aux fenêtres ?
Comment peut-on, c’est sidérant,
Approcher d’elle en ce bas monde
Sans avoir fait Louis-le-Grand ?
Depuis un faubourg ? C’est immonde.
C’est qu’il possédait quelque argent,
Me dites-vous : La belle affaire !
Cela rend-il intelligent
Et sachant ce que l’on doit faire ?
Sa présence la dégradait,
Il sentait son Kremlin-Bicêtre
Et son attitude gardait
Un air de linge à la fenêtre.
*
61
Musette
Comment, moi banlieusard, me suis-je cru poète !
J’aurais peut-être été chanteur, à mon sommet,
Ou de variétés ou, mieux, de bal musette
Sous la boule miroir d’un moite estaminet
Inélégant, aux murs exsudant le salpêtre,
Au milieu des radis en un site champêtre.
C’était là le piton de ma vulgarité
Puisque je n’étais pas un produit d’hypokhâgne,
Et qu’entre la banlieue et la verte campagne
Le Tout-Paris connaît la similarité.
*
62
Ma vulgarité
Dans ma vulgarité les diplômes sont vains.
Dans ma bassesse ont droit à leur apologie
L’alexandrin, les vers que nos grands écrivains
Ont voulu dépêcher vers l’archéologie.
Jamais je ne serai l’ami de ces félons,
J’appelle ce qu’écrit un goujat des flonflons.
Sans état d’âme ils ont trahi leur héritage,
Disant qu’il n’était plus pour cela de lecteurs,
Quand c’était leur devoir de sauver ces hauteurs
Car, de Louis-le-Grand, ils pouvaient davantage.
*
63
Ma goujaterie
Dans ma goujaterie, affirmer qu’un public
Décide de ce qu’est la valeur littéraire,
Que le ravin doit dire au célestiel pic
Ce que contemplera l’aigle depuis son aire,
C’est triste quand on sort d’un établissement
Qui produit quasi tout le divertissement
De la société du meilleur ton en France,
Quand à Louis-le-Grand on s’est imbu de soi,
Élevé pour dicter à la plèbe sa loi
Et régner sur « le Tout-Paris » sans concurrence.
*
64
Katmandou
Je vous aurais suivis, amis, sur vos chemins,
Car quel espoir avais-je, issu de ma banlieue
Où mon âge heureux fut embaumé de jasmins
Dans les jardins où croît la clématite bleue,
De me faire une place au milieu de serpents
Choisis pour leur venin, écailleux et rampants ?
L’internationale humble des barbes blondes
Et des cheveux au vent m’aurait vu militer
Dans ses rangs vagabonds, sur la route chanter,
Et tomber à la fin parmi les chiens immondes.
De la versification 2
Le présent billet fait suite à Versification française : Prolégomènes (x). Dans la mesure où je n’entre pas encore ici dans un exposé méthodique des règles de la versification, on peut considérer qu’il s’agit de prolégomènes à nouveau. Cependant, le lecteur qui n’aurait pas une connaissance générale des principes de la versification aura peut-être du mal à suivre, car il s’agit de la présentation critique, sur quelques points particuliers, d’une brochure présentant ces règles ; dès lors que j’aborde des points particuliers, il est à craindre que le défaut de familiarité avec les principes généraux rende cette lecture difficile.
Je tiens cependant à rédiger cette note préalablement à des travaux plus pédagogiques (au cas où je déciderais un jour de m’atteler à cette tâche) afin d’appeler l’attention des poètes souhaitant se familiariser avec la versification française sur certaines erreurs, imprécisions et confusions que j’ai trouvées dans cette brochure, dans la lignée de mon précédent essai, où je dénonce entre autres choses une fâcheuse erreur de présentation et, semble-t-il, d’interprétation relativement aux allitérations et assonances, de la part de personnes dont les qualifications sont a priori au-dessus de tout soupçon (en gros, des professeurs de lettres).
*
La brochure dont je veux parler, pour commencer n’a pas de titre. Il s’agit de feuillets imprimés que m’a remis il y a une dizaine d’années une poétesse qui s’occupait à l’époque d’une revue appelée Les Céphéides ainsi que d’un prix de poésie Maurice Rollinat. Cette brochure de seize pages est en deux parties : « Du vers » (pp.1-14) et « Des formes fixes » (pp.15-6, visiblement incomplète puisqu’elle ne parle que du sonnet). Je ne trouve aucun nom d’auteur.
L’auteur anonyme résume, c’est assez clair, le point de vue du poète Martin-Saint-René (pseudonyme de Gustave Lucien René Martin, 1888-1973), nommé à de multiples reprises. Martin-Saint-René est l’auteur d’un traité de versification –non cité par notre auteur anonyme– sous le titre assez pompeux† de Précis de poésie pour servir à la composition rationnelle des vers, qui serait de 1932 (réédité en 1953). C’est vraisemblablement ce précis que suit la brochure anonyme.
Cet auteur anonyme indique d’ailleurs formellement suivre l’œuvre de Martin-Saint-René. Il écrit en effet, p. 11, à la section « De la diphtongue » : « Voici les tableaux, merveilleusement clairs, établis par Martin Saint-René et que sa dévouée secrétaire et exécutrice testamentaire Louise Chassagne m’a autorisée à faire paraître, puisque je poursuis sa tâche. »
Il convient que je cite mes propres sources avant d’aller plus loin car mon point de vue s’appuie sur elles quand il diffère de celui de l’auteur anonyme et/ou de Martin-Saint-René (que j’abrégerai à présent en MSR).
Ces sources sont au nombre de deux : (1) L’art des vers d’Auguste Dorchain (1857-1930), 2e édition, sans date (il semble, après une rapide recherche, que la 1ère édition date de 1905 et celle-ci de 1920), et (2) Le Dictionnaire des rimes, précédé d’un Traité de versification française, de Louis Cayotte, de 1913. Le traité de Cayotte fait 38 pages. Comme la plaquette tirée de MSR, c’est donc un vade-mecum pratique, tandis que le livre de Dorchain, de plus de 400 pages, est en quelque sorte un traité scientifique (ce sont les réflexions d’un poète sur son art).
Les trois auteurs cités sont tous des représentants du classicisme le plus exact, et il convient ici d’ouvrir une parenthèse. Parmi les grands noms de la poésie française, certains, comme Aragon, écrivaient encore en vers dans les années soixante (voyez par exemple les poèmes du Fou d’Elsa, 1963). Le plus souvent, ces œuvres ne suivent cependant plus le corpus des règles dites classiques mais un mélange de ces dernières et d’innovations, quant aux rimes, au compte des syllabes, etc. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le genre « néo-classique » bien que ce dernier se caractérise en fait principalement par l’idiosyncrasie, chacun y allant de sa façon de versifier (quand il serait tellement plus simple, et sans doute de meilleur goût, dans ces conditions, d’écrire des vers libres). Les règles néo-classiques suivies par nos poètes célèbres sont néanmoins celles, à peu près, qu’a rappelées Aragon dans l’essai La rime en 1940 (dans le recueil Le Crève-cœur) et concernent en particulier la distinction des rimes féminines et masculines, à la suite des remarques de Guillaume Apollinaire à ce sujet. – Je reviendrai, Deo volente, sur cet essai d’Aragon dans un autre billet.
D’autres poètes encore, tels que Robert Sabatier, ont continué d’écrire des vers classiques mais sans rimes, des « vers blancs » (voyez par exemple Icare et autres poèmes, 1976). Comme ces vers sont en outre insérés dans des strophes régulières, on a au premier regard une poésie tout ce qu’il y a de classique. Où manque cependant l’élément le plus déterminant. Si certains de ces vers sont assez beaux, l’intérêt d’une telle démarche n’est toutefois guère évident. Y a-t-il rien qui puisse donner le sentiment de la décadence littéraire comme cette imitation sur le mode inférieur, tout comme l’architecture de l’Égypte ancienne, contrainte, aux basses époques tardives, d’imiter en dégradé la technique des anciens que l’on n’arrivait plus à reproduire ? Je crois sincèrement que le vers libre est préférable à toutes ces imitations où la plupart des prétendues innovations vont dans le sens de la facilité : chez Sabatier et ceux qui l’auraient suivi (s’il y en a), on continue de compter les syllabes mais on ne rime plus, chez d’autres, comme Aragon, on continue d’écrire des alexandrins mais on ne respecte plus la césure à l’hémistiche, etc. Au moins le vers libre peut-il passer pour un choix délibéré, conscient, raisonné contre la prosodie et donc se défendre par-là d’être une forme de décadence, se réclamant au contraire d’un renouvellement. Autant je fais crédit à cette démarche, autant les divers compromis « néo-classiques » m’inspirent le plus grand scepticisme.
D’un autre côté, les théoriciens de l’art classique ne sont pas non plus toujours modérés††, et il existe une réelle tendance à vouloir enserrer la versification dans des contraintes toujours plus grandes. Alfred de Musset s’opposait déjà à l’enrichissement imposé de la rime, par exemple, et je l’approuve, en particulier parce que c’était un pas vers ce qu’Apollinaire et d’autres critiquaient en introduisant des innovations « néo-classiques », à savoir que plus la jauge de la richesse d’une rime est haute plus on restreint le nombre de mots pouvant rimer entre eux et donc plus on va vers un état de la poésie où les mêmes mots riment ensemble. (C’est déjà une admission assez pénible, pour un poète classique, que lorsque Lamartine emploie le mot « cieux » à la rime, il y a de bonnes chances –je n’ai pas fait le calcul mais un logiciel le pourrait facilement– qu’on trouve des « yeux » au vers suivant.)
Je pose en principe (de ma propre pratique poétique) que la poésie classique a historiquement atteint son équilibre et qu’elle ne peut plus évoluer dans un sens ou dans un autre, ni vers moins ni vers plus de contraintes, si ce n’est marginalement, sans dégénérer. Ce point d’équilibre est représenté par Victor Hugo, dont les « révolutions » sont à vrai dire, du point de vue contemporain ignorant de la technique prosodique, totalement imperceptibles, car elles ne portent que sur (1) une plus grande souplesse dans la césure de l’alexandrin, qui reste cependant toujours à l’hémistiche, et (2) une plus grande souplesse dans l’enjambement (d’un vers à l’autre, par un retour à ce que permettait la prosodie française avant Malherbe).
S’agissant de (1), je souscris ; s’agissant de (2), tout en souscrivant, je ne peux m’empêcher de constater qu’elle entraîne des effets choquants dans la scansion. (En réalité, c’est le cas de [1] également et je ne suis donc pas très cohérent, mais les effets choquants de [1] me paraissent moins critiquables, car bien moins choquants, que ceux de [2]). Peut-être faudra-t-il admettre un jour que le point d’équilibre était atteint, en réalité, chez Malherbe, Boileau, Racine, que les révolutions, imperceptibles pour le commun, du père Hugo sapaient le vers en attaquant la scansion, et qu’après lui la versification classique ne pouvait par conséquent, à terme, que s’écrouler ?†††
Les grands versificateur ultérieurs, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud…, qui ont révolutionné la poésie à leur manière, n’ont cependant produit aucune innovation dans la prosodie elle-même (voyez néanmoins les remarques à 1/ infra sur les vers impairs). Leurs effets les plus novateurs sur le plan formel sont dans la continuité des innovations (1) et (2) introduites par Hugo. Puis vinrent les innovations d’Apollinaire déjà évoquées et nous entrons alors dans une nouvelle ère que l’on peut qualifier de crépuscule de la poésie classique. Mais, comme Hugo en son temps, Apollinaire cherchait à remédier à des problèmes au sein de la forme, sans considérer que la forme elle-même avait fait son temps. Cependant, et c’est un point que je discuterai en examinant l’essai précité d’Aragon, on peut critiquer ce point de vue lui-même, tout comme on pouvait critiquer celui de Hugo, dans les innovations duquel pourrait être décelée la cause première de la décadence ultérieure. Certes, il m’en coûte d’écrire cela, puisque je suis, au plan formel, la versification « hugolienne » dans ma propre activité. D’autre part, la poésie classique est devenue secondaire dans toutes les littératures occidentales et l’évolution ne peut donc guère être imputée à tel ou tel auteur – si ce n’est par l’influence prédominante de la littérature française sur nombre de littératures européennes encore à l’époque.
Toujours est-il que telle est la poésie que nous appelons ici classique, non celle de Malherbe et Boileau (qui l’est, indéniablement, à un stade de ses conventions plus ancien) mais celle de Hugo et de toute la période qui va de ce dernier à Apollinaire ou à tous ceux qui n’ont ni suivi les innovations d’Apollinaire ni choisi le vers libre, et qui ont disparu de ce qui s’appelle le monde littéraire qui compte.
†Je dis que ce titre est pompeux car personne n’ambitionne d’écrire des vers « rationnellement » et la formule est donc malheureuse. Il me paraît toutefois évident qu’elle se veut la traduction d’une pensée que je partage, à savoir que les règles de la versification reflètent une connaissance rationnelle empirique d’un ensemble de lois esthétiques orientée vers la production d’un effet maximal. Ces lois relèvent de domaines multiples, à commencer par la physiologie (la physiologie des sens). Le vers est né dans la culture orale, où il représentait la seule technique de communication. Que cette technique particulière ait été supplantée par bien d’autres depuis lors n’empêche pas qu’elle reste puissante dans son domaine. Je ne suis pas le seul à vouloir écrire des vers après avoir ressenti l’effet profond que ceux-ci produisent.
††Pour le public, ces gens n’existent pas. Et pourtant. J’ai nommé plus haut une revue, qui se présentait comme l’organe d’un Conservatoire de la poésie classique française, et j’ai moi-même contribué pendant plusieurs années à la revue de poésie Florilège, où le vers classique occupe une place importante. Malheureusement, la qualité de cette production contemporaine me laisse dans l’ensemble très sceptique. Le présent essai n’est pas tant un appel à lire ce qui s’écrit en poésie classique aujourd’hui, car je craindrais beaucoup de déception de la part du lecteur, qu’une invitation à en écrire soi-même, en espérant que des poètes dignes des grands noms sauront se distinguer.
†††Hugo ne se serait jamais permis d’écrire un alexandrin où la césure médiane tombât au milieu d’un mot (et je ne sais qui peut être considéré comme l’introducteur de cette « innovation », laquelle, pour le coup, me paraît être l’une des plus propres à faire parler de décadence, compte tenu de l’impossibilité totale où de tels vers mettent le lecteur de scander). Avec un peu d’exagération (car le problème résidait principalement dans des principes de la dramaturgie que je ne discute pas ici), on peut dire que la fameuse bataille d’Hernani, nouvelle bataille entre les anciens et les modernes, portait sur un enjambement. L’effet d’un enjambement paradoxal (« l’escalier / Dérobé ») peut être en soi comique, bien que ce ne soit pas l’effet recherché ; or, ce qui est comique sans le vouloir doit-il être porté au crédit de l’auteur ou à son débit ? Les défenseurs de Victor Hugo disaient que c’est à son crédit car ils prétendaient avec leur champion que les règles de l’enjambement, trop rigides, devaient être assouplies. Les détracteurs de cette incongruité burlesque n’auraient-ils pas dû se contenter d’en rire ? Las ! comment le pouvaient-ils, voyant que l’on en faisait un argument ? Or de tels enjambements tirés par les cheveux doivent nécessairement rendre le travail des acteurs plus difficile et forcer leur diction de textes versifiés vers celle d’une pure et simple prose, ce qui n’a pas manqué de se produire avec le temps. Cayotte défend ainsi l’enjambement : « Il est devenu très fréquent avec la réforme romantique et d’autant plus fréquent que la rime plus riche rendait plus sensible le rythme du vers. » (p.XXIII) L’enrichissement de la rime évoqué plus haut, vu comme un progrès, aurait donc servi à déliter la structure du vers par un autre côté. Le vers malherbien est le seul qui permette à l’acteur (ou au lecteur de vive voix) de rendre la versification avec le plein effet que ses règles ont pour but de produire. Dès lors que l’on acceptait les enjambements paradoxaux avec les gilets rouges de la bataille d’Hernani, on rendait futile le fait d’écrire des pièces en vers. L’histoire a donc donné raison aux « anciens » dans cette bataille. Le drame romantique est une figure paradoxale et transitoire entre le drame classique et le théâtre en prose. Les « anciens » le savaient, les « modernes » étaient aveugles.
*
Voyons à présent ce que l’auteur anonyme de la plaquette nous dit au sujet de l’art des vers.
En puisant dans Martin-Saint-René, notre auteur énonce des incongruités dont il ne paraît pas conscient. C’est ce genre de choses que nous entendons pointer du doigt car elles sont de nature à donner une image erronée de la versification à ceux qui voudraient la pratiquer.
.
1/ L’impair
.
Prétendre qu’« [i]l n’y a pas de vers de 9 ou 11 pieds, en prosodie régulière ils sont en dehors du rythme » (p.1), alors que le Français moyennement cultivé a vaguement entendu dire que ces vers sont la spécialité de Verlaine (« l’impair »), ressemble beaucoup à de l’outrecuidance, car Verlaine passe pour un excellent versificateur. Son intérêt pour les vers impairs, qui ne me paraît ni blâmable ni particulièrement recommandable, avait sans doute, né d’une lassitude des formes plus communes, un petit côté provocateur à l’époque, mais lâcher une telle phrase comme si Verlaine n’avait jamais existé, c’est quelque chose.
Cayotte est bien plus pondéré et, selon moi, dans le vrai : « Le vers de neuf syllabes, ou ennéasyllabe, fut peu employé jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, sauf dans la déclamation musicale, chansons ou opéras. La recherche de formes neuves ou rénovées amena les poètes, postérieurs à Théodore de Banville et à Paul Verlaine, à étudier les conditions d’équilibre de ce mètre impair. » (p.IV) & « Le vers de onze syllabes ou endécasyllabe, comme le vers de neuf, n’a été usité d’une façon courante que dans la seconde moitié du XIXe siècle, et surtout depuis Paul Verlaine qui, dans son Art poétique, conseilla de préférer l’impair à tous les autres mètres. » (p.V)
Il faut croire que MSR ne goûtait pas, mais vraiment pas du tout, l’Art poétique de Verlaine, cependant c’est là une opinion hétérodoxe et il eût par conséquent été bienvenu, en la citant, d’en présenter les raisons ; sans cela, on cherche à faire passer clandestinement une hétérodoxie (qui peut au demeurant ne pas être sans mérite) pour un point de vue établi. En l’occurrence, je suis frustré de ne pas connaître les raisons de MSR car elles ont pour elles un certain sens commun poétique dans la mesure où ces vers n’étaient guère usités avant Verlaine, qui cherchait du neuf.
Ce sens commun hypothétique a cependant des limites car il ne porte que sur les vers de 9 et 11 syllabes et non sur tous les vers impairs, Cayotte rappelant, au sujet du « vers de sept syllabes, ou eptasyllabe (sic : plus souvent, heptasyllabe) » que « La Fontaine l’employa beaucoup ». Que les vers de 9 et 11 vers soient « en dehors du rythme » alors que les vers de 7 syllabes seraient quant à eux « dans le rythme », me rend très douteuses les raisons sous-jacentes à l’affirmation elle-même. La raison principale en est sans doute qu’il faut une césure dans ces vers impairs plus longs et que la césure d’un vers impair ne peut couper le vers en deux parties égales, par définition. Une fois qu’on a dit cela, il reste à dire pourquoi ce serait « en dehors du rythme ». (Je montre sans doute là mon défaut de connaissances en matière d’écriture musicale, alors que je soupçonne MSR de vouloir raisonner à partir de ce genre de connaissances ; je ne peux donc dire si, pour lui, loin d’être un équivalent de la technique du contretemps, laquelle resterait dans les limites du classique musical, ces vers impairs longs nous font basculer vers l’équivalent de l’atonalité musicale, plus du tout classique.)
.
2/ L’e muet des verbes au pluriel
.
« Les mots terminés par un E muet qui se trouvent être au pluriel comme : joies – patries – oies – nouent, sont absolument interdits dans le vers et ne peuvent être utilisés qu’à la rime. Il en est de même pour les verbes à la troisième personne du pluriel, où l’ent fait suite à une voyelle sonore, à tous les temps, sauf à l’imparfait et au conditionnel. » (p.3)
Dans le membre de phrase « à tous les temps, sauf à l’imparfait et au conditionnel », c’est « sauf à l’imparfait et au conditionnel » qui devrait être souligné, puisque l’exception, considérable en soi, fait que la règle ne s’applique en fait qu’au présent et au présent du subjonctif, les quatre temps en question étant les seuls où le cas de figure puisse se présenter (si je ne m’abuse). Pour le verbe nouer, on ne trouve au pluriel un e muet qu’au présent (ils nouent), au présent du subjonctif (qu’ils nouent), à l’imparfait (ils nouaient) et au conditionnel (ils noueraient). Nous avons par conséquent une règle qui ne peut s’appliquer qu’à deux temps, puisqu’à l’imparfait et au conditionnel, par convention, elle ne s’applique pas et qu’à tous les autres temps elle ne peut pas trouver à s’appliquer.
Dès lors la question se pose de savoir s’il convient de garder ce traitement exceptionnel pour le présent de l’indicatif et le présent du subjonctif. Certes, la règle découle du fait que l’e muet final ne peut s’élider quand le mot est terminé par une marque du pluriel, mais puisqu’une exception est permise pour certains temps je serais enclin à étendre l’exception aux deux présents également, c’est-à-dire à tous les verbes conjugués, car je ne vois pas en quoi « ils voyaient » et « ils voient » appellent un traitement différent. Autrement dit, il me semble, pour qu’une exception soit cohérente en la matière, qu’elle concerne tous les e muets suivis de la marque du pluriel en -nt.
En p.7, l’auteur rappelle que les verbes à l’imparfait et au conditionnel font des rimes masculines, à savoir, « elles nouaient » est une rime masculine parce qu’« elle nouait » est une rime masculine. A contrario, « ils nouent » est une rime féminine, tout comme « il noue ». Mais ce point, qui établit une différence entre des temps au point de vue de la rime, n’implique pas une différence au plan qui nous occupe ici.
On trouve dans Lamartine « Beaux enfants de la nuit, que vos yeux soient ouverts ! » (La chute d’un ange). Je note également ce vers de Charles Coran, un contributeur du Parnasse contemporain : « Ô le triste climat, maudits soient les hivers ! »
En p.7 encore, l’auteur explique que « quelques verbes au présent suivent la même règle » que les verbes à l’imparfait, à savoir : comme « il fuit » est masculin, « ils fuient » est masculin et peut donc figurer tel quel à l’intérieur d’un vers. Par conséquent, dans l’exemple que j’ai pris, « ils voient » est également permis. Cependant, et cela devient comique, cette permission ne s’étend pas au présent du subjonctif ! Car le singulier d’un tel verbe au subjonctif étant « qu’il fuie », son pluriel au subjonctif « qu’ils fuient » ne peut se voir appliquer la même règle ! L’auteur précise : « Bien entendu, la même forme n’a pas le même caractère au subjonctif où elle n’a pas la même exacte prononciation ». Il fallait oser : « fuient » indicatif n’a pas la même prononciation que « fuient » subjonctif††††. Ou plutôt « la même exacte » prononciation, c’est-à-dire la même prononciation, oui peut-être, mais pas la même exactement…
Ces subtilités ne sauvent pas, on le comprend, le vers de Lamartine cité plus haut puisqu’il s’agit là de toute façon d’un subjonctif. Or ce vers est tout de même sauvé, par la remarque suivante : « Pour soient (subjonctif du verbe être), l’ent a le même caractère de marque du pluriel qu’à l’imparfait du verbe (la conjugaison indique l’absence d’E muet : que je sois, que tu sois, qu’il soit). » (p.7)
L’excessive subtilité de ces règles plaide pour une simplification. (J’appelle l’attention du lecteur sur le fait qu’être subtil n’est pas toujours une qualité : voyez ce que dit Kant de la philosophie scolastique, caractérisée par sa subtilité [Subtilität].)
††††J’imagine qu’on puisse trouver une sorte de différence d’inflexion entre « ils fuient » et « qu’ils fuient » : qu’en est-il de la phrase « au cours de l’attaque ils fuient », ce « qu’ils fuient » indicatif est-il encore différent d’un « qu’ils fuient » subjonctif ? Même si c’était le cas, même si l’on ne pouvait jamais rendre la prononciation pour l’un et l’autre temps parfaitement identiques en toute rigueur, je gage que personne ne fait la différence en dehors de quelques cercles qui prennent peut-être trop au pied de la lettre certaines conclusions de linguistique. Quand des individus sont les seuls à entendre des voix, le plus souvent ce n’est pas une cause d’admiration. Mais surtout, pourquoi une simple différence d’inflexion devrait-elle avoir des conséquences dans un problème qui relève du compte des syllabes ?
.
3/ L’hiatus
.
« La règle est absolue : on ne peut accepter aucun hiatus en poésie. » (p.4)
L’auteur précise cependant que la règle ne s’applique qu’entre deux mots et pas à l’intérieur d’un même mot (comme « consensu-el »), avec une justification plutôt hermétique : « La rencontre de deux voyelles à l’intérieur d’un même mot : la diphtongue, est une liaison de sons coulés dans une même émission de voix, et est différente. Seuls font hiatus la rencontre de deux mots différents, en deux émissions de voix. » (p.4)
Je ne vois pas bien ce qu’est une « émission de voix », ici, puisque la voix, pour être quelque chose, doit forcément s’émettre, mais il est certain que la règle de l’hiatus ne peut s’appliquer à l’intérieur d’un même mot sauf à exclure par-là de la poésie un grand nombre de mots.
J’ajoute que la règle n’est pas non plus suivie pour certaines expressions, qui pourraient d’ailleurs être décrites comme « une liaison de sons coulés dans une même émission de voix », telles que : « çà et là », « peu à peu », « un à un »… Par exemple, dans Baudelaire : « Traversé çà et là par de brillants soleils » (Les Fleurs du mal).
Je trouve par ailleurs dans Hugo : « Sur le sommet du Pinde on dansait Ça ira » (Les Contemplations). Hugo a sans doute considéré le refrain sans-culotte « Ça ira » comme une seule et même « émission de voix », lui qui changea pourtant, comme l’indique Dorchain, un « là aussi » qui ne choque guère l’oreille en un « aussi là » rendant le vers illisible.
.
4/ La consonne d’appui
.
« Le manque de mots pour certaines rimes ne permet pas toujours de suivre cette règle [la consonne d’appui pour la rime] qu’on doit cependant respecter, chaque fois qu’on le peut. » (p.5)
Cette injonction est maladroite. Le principe est en réalité le suivant : même sans consonne d’appui, une rime est suffisante si le nombre de mots d’une langue pouvant rimer entre eux avec ce son est relativement faible. Une rime cothurne-diurne est amplement suffisante, sans que le poète se sente obligé d’employer le mot « taciturne » à la place de « diurne » (et la rime cothurne-taciturne peut quant à elle être considérée comme riche).
Et si je voulais trouver une rime avec « Mab, urne », il existe bien le mot « burne » qui me permettrait de respecter la règle de la consonne d’appui, mais la question est plutôt : est-ce que je le dois ? et la réponse est non.
Enfin, je refuse de pinailler quand la consonne d’appui manque même pour les sons plus communs, en particulier dans des pièces un peu longues. C’est le bon sens même. Certes, un sonnet gagne beaucoup à des rimes riches, mais dans des poèmes plus étendus ce serait un exercice de virtuosité qui pourrait y compris brouiller l’effet du poème, ainsi que le fait remarquer Dorchain, pour qui le pittoresque peut appeler un rythme soutenu de rimes riches, des pièces plus intimistes nullement.
.
5/ La rime seulement auriculaire
.
« [I]l faut bannir les rimes inexactes comme Toi et Toit – Luit et Lui – Nuit et ennui » (p.6)
Le faut-il, après Baudelaire : « Il rêve d’échafauds en fumant son houka. / Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat » (Les Fleurs du mal) ?
Personnellement, je n’adopte pas cette liberté de Baudelaire, sauf au pluriel, dont la marque annule la contrainte d’équivalence des consonnes muettes (d avec t etc.) : au pluriel, toutes les lettres muettes sont équivalentes. Je crois tirer ce principe de Dorchain ou de Cayotte ; je l’ajouterai en commentaire à ce billet si je retrouve le passage. Cela me paraît découler du principe même de la rime visuelle : la marque du pluriel dans les deux cas suffit à rendre la rime visuelle.
Encore une fois, notre auteur anonyme est un peu trop péremptoirement impératif, contre l’usage même des plus grands classiques pré-apollinariens. Baudelaire fait également beaucoup rimer le mot « sang » avec des participes présents en -ssant. Dès lors, la règle « il faut bannir… » demande d’abord, avant d’être suivie aveuglément, à être justifiée, si elle doit l’être, contre des exemples répétés de notre littérature.
.
6/ La femme a-t-elle une âme ?
.
« Le mot femme rime avec les mots en ame. Les mots en âme avec un accent circonflexe, ne riment pas avec ceux qui n’en ont pas, comme d’ailleurs couronne et trône ou homme et fantôme. » (p.6)
À ce stade, je pense qu’il est superflu de souligner que la rime femme-âme est fréquente. Cependant, au crédit de notre auteur, c’est un reproche que l’on faisait déjà à Voltaire.
Or le raisonnement de l’auteur est mauvais. Certes, l’o d’homme n’est pas le même que celui de fantôme, mais l’o de fantôme est le même que celui de chrome qui n’a pourtant pas d’accent circonflexe. Il ne s’agit nullement d’une question de graphie, et, pour ce qui est du son, j’avoue n’entendre aucune différence entre l’a de femme et celui d’âme.
Certes, je ne suis pas le meilleur juge en la matière puisque j’ai fait un jour rimer parfum et fin. Mon grand-père Cayla (paix à son âme), qui lut ces vers, appela mon attention sur le fait que le son n’était pas identique dans les deux mots. En exagérant beaucoup, sans doute, la prononciation, il me fit entendre une vague différence ; je changeai donc mon poème et n’utilise plus cette rime, sans pour autant être capable de prononcer des sons différents pour ces mots, sauf à produire un effet comique. (En l’absence de différence sensible, les consonnes muettes m et n étant équivalentes, la rime est correcte.)
.
7/ De la variété linguistique d’un couple de mots à la rime
.
« Il faut essayer (ce n’est pas toujours facile, et ce n’est qu’une indication) de ne pas faire rimer deux noms, deux adjectifs, deux adverbes – en somme, chercher la variété et fuir la monotonie. C’est là que le chant intérieur et le travail de la composition jouent. » (p.6)
Cette fois l’auteur mitige l’impératif : « ce n’est qu’une indication ». Il n’y a toutefois qu’à se reporter au passage tiré de Boileau en p.4 pour voir ce que vaut cette indication :
Ayez pour la cadence une oreille sévère :
Que toujours dans vos vers le sens coupant les mots,
Suspende l’hémistiche, en marque le repos.
Gardez qu’une voyelle à courir trop hâtée
Ne soit d’une voyelle en son chemin heurtée.
Il est un heureux choix de mots harmonieux,
Fuyez des mauvais sons le concours odieux :
Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée
Ne peut plaire à l’esprit, quand l’oreille est blessée.
Sur quatre rimes, une seule suit le conseil de notre auteur, la dernière, où pensée est un nom et blessée un adjectif. Autrement, riment entre eux (1) deux noms, (2) deux participes passés et (3) deux adjectifs.
Oui, la variété est une bonne chose mais une telle indication est au fond absurde car il est très fréquent que deux noms, deux adjectifs, etc., riment ensemble, c’est même le plus fréquent ; il n’y a donc aucune raison de dire « il faut essayer de l’éviter », une balourdise. C’est si le poète constate que toutes ou la plupart de ses rimes sont des noms ou des adjectifs, etc., et qu’il a donc gravement négligé la variété, qu’il doit retravailler son poème.
.
8/ Sans commentaire
.
« Les rimes trop faciles et banales sont médiocres, comme songe et mensonge. » (p.6)
Ici l’auteur atteint au monomaniaque. Dire qu’une telle rime est médiocre en soi, c’est complètement insensé. Il est au contraire évident que cette rime peut permettre d’excellents vers ; cela n’a rien à voir avec la rime elle-même, qui sera bonne si le poète est bon, médiocre s’il est médiocre.
J’insiste pour bien montrer à quel point le raisonnement est vicieux. Après avoir dit en 4/ qu’il fallait une consonne d’appui à la rime « chaque fois qu’on le peut », à présent l’auteur prétend interdire l’usage de songe et mensonge à la rime car, en dehors d’un improbable axonge (« graisse de porc fondue, utilisée comme excipient pour des préparations dermatologiques »), il n’existe pas d’autre rime avec cette consonne d’appui (du moins dans le Cayotte, même si parmi les quelque 36 000 communes de France on doit pouvoir trouver un nom qui convienne, et le poète n’aurait alors plus qu’à transporter son poème dans cette commune). Certes, un poète qui voudrait utiliser une consonne d’appui chaque fois qu’il le peut, même pour -onge (qui ne compte que dix-huit choix possibles dans le dictionnaire des rimes de Cayotte) n’aurait d’autre alternative, s’il écrit un vers se terminant par songe (mensonge), que de faire terminer le suivant par mensonge (songe). Dans ce cas, la rime devient en effet banale puisqu’on ne peut lire l’un de ces mots à la rime sans attendre l’autre, mais c’est là le résultat d’une règle (la consonne d’appui) elle-même exorbitante dans de nombreux cas et en particulier pour les mots à la terminaison relativement rare, comme ceux en -onge.
Enfin, il n’y a pas de rimes faciles ou difficiles ; je peux très bien utiliser le premier mot qui me vienne et écrire quelque chose d’excellent, comme je peux le faire et écrire quelque chose de mauvais.
.
9/ Le cas des rimes embrassées
.
« Au cours d’un poème, jamais une rime masculine ne doit être suivie d’une rime masculine différente (ou une rime féminine d’une rime féminine différente). Beaucoup de poètes débutants font la faute en commençant un quatrain par une rime du même genre que celle qui a terminé le quatrain précédent. » (p.8)
Ceci est démenti par la structure des deux quatrains d’un sonnet, qui reste cependant exceptionnelle. J’ai publié un certain nombre de poèmes où des quatrains à rimes embrassées suivent le modèle du sonnet et sont donc fautifs de ce point de vue, mais je revendique l’exemple de Baudelaire, dont le poème liminaire des Fleurs du mal, Au lecteur, est lui-même ainsi construit :
La sottise, l’erreur, le péché, la lésine,
Occupent nos esprits et travaillent nos corps,
Et nous alimentons nos aimables remords,
Comme les mendiants nourrissent leur vermine.
Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches ;
Nous nous faisons payer grassement nos aveux,
Et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux,
Croyant par de vils pleurs laver toutes nos taches.
&c (On notera au passage la rime lâches-taches, que notre auteur, en 6/, a prétendu prohiber, ainsi que l’absence de consonne d’appui pour aveux-bourbeux, alors que la terminaison -eux n’est pas rare en français.)
Ici le « débutant » Baudelaire fait commencer un quatrain avec une rime féminine (lâches) alors qu’il a terminé le précédent aussi par une rime féminine (vermine). Baudelaire ne réitère pas cet écart dans le recueil, mais la mise en exergue, à la place liminaire, d’un poème présentant une structure considérée comme fautive, est significative. Quoi qu’il en soit, ceux de mes poèmes que j’ai écrits ainsi se réclament de ce modèle : le poème Au lecteur des Fleurs du mal.
Les rimes embrassées (a-b-b-a) sont les seules susceptibles de produire une telle « infraction » et, pour cette raison, exigent une alternance d’un quatrain à l’autre : le premier commençant par une rime féminine (ou masculine), le second doit commencer par une rime masculine (ou féminine), et ainsi de suite. Cette particularité rend l’usage normal des rimes embrassées un peu plus difficile : en effet, si un poète souhaite retrancher ou déplacer un quatrain dans son poème, c’est possible sans autre formalité avec des rimes croisées mais pas avec des rimes embrassées, car le retrait d’un quatrain aux rimes embrassées rompt la règle susdite, et le poète doit donc supprimer deux quatrains successifs ou ne rien supprimer.
.
Conclusion
.
La lecture de cette plaquette crée un sentiment allant de la douche froide au comique. L’auteur multiplie les injonctions péremptoires au point qu’elles risquent d’en devenir paradoxales. La tendance est clairement à la virtuosité, voire aux acrobaties, sans doute au détriment du fond. L’ensemble est maladroit et ne peut être que dissuasif. J’espère avoir rendu, par cette mise au point, la versification française plus attrayante, en lui ayant rendu purement et simplement justice.