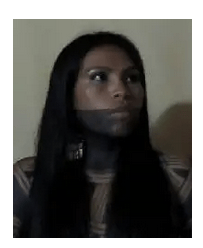Tagged: poésie latino-américaine
Poésie emberá et kuna contemporaine du Panama
Les poèmes suivants, traduits de l’espagnol en français, sont tirés de l’anthologie Cantos de Abya Yala: Poesía contemporánea de los pueblos originarios de Panamá (2107) (Chants d’Abya Yala : Poésie contemporaine des peuples premiers du Panama), réunie et présentée par le poète panaméen Luis Wong Vega. L’anthologie est disponible en ligne (ici).
Elle rassemble des œuvres en langue indigène et en espagnol de poètes contemporains des ethnies Ngöbe-Buglé, Emberá-Wounaan (ci-après Emberá) et Guna (ci-après Kuna).
Nous avons retenu des poèmes dont le texte original est en espagnol : pour l’ethnie emberá, trois poèmes de la poétesse Raquel Cunampio, et, pour l’ethnie kuna, des poèmes d’Irik Limnio (un poème), Leocadio Padilla (un), Artibel Igar Mendoza (deux), Aiban Velarde (un), Aiban Wagua (un), ainsi que trois poèmes du plus connu des poètes kunas, Arysteides Turpana.
Aiban Wagua, avec qui je suis en contact par e-mail au sujet des présentes traductions, tient à signaler que quatre poèmes attribués dans l’anthologie au poète Aiban Velarde sont en réalité de sa plume. Ces poèmes sont : Ríos de versos, Me han robado un dios, ¡Qué ganas tengo!, et Véndame los ojos (non traduits ici). (Je consacrerai à Aiban Wagua la traduction d’un choix plus étendu de ses poèmes, qui fera suite au présent billet.)
*
Emberá
Trois poèmes de Raquel Cunampio
Ces poèmes appellent quelques explications préalables. Dans le premier poème, la « lune piriati » (traduction de luna piriatí) ainsi que la « nuit piriati » (noche piriatí) me paraissent une façon de désigner la lune et la nuit de Piriati, c’est-à-dire de la région du Panama où vivent les Emberá (que l’on trouve aussi en Colombie, dans la région frontalière du Chocό, ainsi qu’en Équateur).
Deuxième poème. Cocoloti est le nom d’un maître emberá renommé de musique traditionnelle, chanteur et flûtiste, à qui le poème serait donc un hommage. Je dois cependant à la vérité de dire que le mot est sans majuscule dans le texte original – tandis que certains vers du même poème commencent par une majuscule – et qu’il pourrait donc s’agir, si ce n’est pas une coquille, de toute autre chose que ce dont je viens de parler ; il pourrait ainsi s’agir d’un nom commun en langue emberá dont le sens, même si l’on peut y deviner, mais sans certitude, un terme d’affection, ne se laisse cependant pas trouver sur internet puisque, même en affinant les recherches, on ne trouve que le nom propre dont j’ai parlé. [Ajout du 3/7/2020. Dans un e-mail du 2 juillet 2020, Raquel Cunampio me confirme que, dans ce poème, cocoloti avec une minuscule est le nom du maître de musique emberá.]
Enfin, dans le troisième poème, le jagua est le suc d’un fruit dont il tire son nom, suc avec lequel les Emberá produisent une teinture d’un noir intense dont ils se couvrent abondamment le corps de motifs symboliques et magiques. La photo ci-desous de Raquel Cunampio la montre avec le visage et les épaules peints au jagua.
Profite de la lune piriati,
du silence
de la tranquillité,
savoure d’être sans lumière électrique,
on est bien comme ça (pour le moment).
Souvent je m’étonne de cette tranquillité…
Belle nuit piriati.
Cette nuit j’ai rêvé
de toi
et me suis réveillée
avec un sourire
que je ne puis cacher
ni effacer…
cocoloti !
Quelqu’un comprend-il ce sentiment ???
Il n’est vêtement
ni maquillage
ni accessoire
qui me fasse sentir aussi belle
que lorsque je me peins au jagua…
quand le jagua et moi
ne faisons qu’un…
car c’est alors que devient visible
la vraie beauté
d’être emberá
*
Kunas
Les Kunas ou Gunas de l’archipel de San Blas dans l’actuel Panama sont connus en France, sous le nom d’Indiens des Sambres, depuis le XVIIe siècle en raison de leur soutien aux flibustiers et boucaniers français – comme d’ailleurs à ceux des autres nationalités – dans leurs entreprises contre les colonies espagnoles en Amérique. Les Kunas en effet, farouchement attachés à leur indépendance, voyaient dans la flibuste européenne un moyen de contrer les empiètements des Espagnols sur leurs territoires.
Plus tard, ce même esprit d’indomptable liberté leur fit proclamer en 1925, au cours de la Révolution kuna (Revoluciόn guna ou Revoluciόn dule), célébrée depuis lors chaque année, une république autonome, la République de Tulé (República de Tule) (dont le drapeau, que les Kunas utilisent toujours, représente une croix gammée traditionnelle, symbole présent chez de multiples ethnies amérindiennes). Le retour des Kunas, la même année, dans le giron du Panama se fit à la condition seulement de garantir une large autonomie à la région de San Blas ; cet accord et l’autonomie qu’il établit perdurent jusqu’à nos jours.
Les Kunas, leur vision du monde, leur cosmogonie sont le sujet du poème éponyme du recueil Los ovnis de oro (Les ovnis d’or) d’Ernesto Cardenal.

Nudsugana comunicándose con los aliados (Nudsugana communiquant avec les Alliés), tableau du peintre kuna Oswaldo De Leόn Kantule illustrant un thème de la cosmogonie kuna (Source: sagapanama)
Mouvement du hamac (Movimiento de la hamaca) par Irik Limnio
Tremblant et oscillant
le hamac naît
du sourire de l’eau
et de la négation de la mort.
Il s’étend sur les galaxies,
niche dans les sillons du chant
qui procèdent du nombril de l’arbre
à la mémoire universelle.
Il va jusqu’au crépuscule du manguier,
de la banane grillée au feu,
du cocotier qui épanche ses seins,
du poisson qui retourne à la mer
tant de fois.
Il vient berçant et grinçant
et ses grincements nous reposent
dans un labyrinthe humide qui sort de ceux
qui ne sont pas encore ou des jarres grises
qui tournent à nos côtés.
*
Un poème de Leocadio Padilla
En pirate je volai tes mangues mûres, ô femme, sirène abandonnée.
Alors nous fûmes deux esprits naviguant sur l’océan mort.
Nous secouâmes les vagues, l’horizon, avec ma ceinture et ta courbe.
C’est ainsi que nous annonçâmes l’amour dans la bouche du firmament.
Nous fûmes dauphins, parfois baleines, et d’autres fois ressac,
dérivant à la merci des récifs, à la merci du cœur.
Dans la nuit, timide nuit de l’abordage,
je m’éreintais par ton jardin comme un colibri.
Ma sève brute, mes racines te suffoquaient,
comme un pirate je butinais tes sels dans le lit vert.
Dans la nuit timide, tes volcans fragiles, mangues mûres,
attisaient une passion endormie dans le noyau de mon cœur.
Tes yeux, océans, m’oublièrent en pleurant.
Ton corps, littoral, se convertit en sable.
Mon corps, étoile fugace, devint de l’air.
Et nous nous éteignîmes entre sirènes et tritons.
*
La chanson de ma mère (Canto de mi mamá) par Artibel Igar Mendoza
Ma mère, vêtue de fine mola1,
et le hamac berçant un nouveau-né ;
« Quand tu seras grand, tu iras avec ton papa – chante ma mère –
labourer la terre et semer la noix de coco et le maïs… »
La chanson de ma mère et le cliquetis des maracas.
Ainsi tisse ma mère, édifiant de ses mains
le monde des hommes et des femmes de l’avenir.
Je suis enveloppé dans les rêves de la mélodie de la hutte,
et je rêve au manioc, aux poissons…
de cette strate de la vie je me suis nourri,
pain et amours d’une aube nouvelle.
La voix de ma mère est la main
du grand-père Antonio, sculpteur de dieux :
son murmure me sculpta jour après jour,
nuit et jour.
1 mola : La mola est le tissage artisanal des femmes kunas, de même que le vêtement ainsi réalisé.
*
Au nom du progrès (En nombre del progreso) par Artibel Igar Mendoza
J’enfielle ma bouche
par des poèmes toujours colonisateurs :
au nom du progrès, du développement,
de la civilisation…
Cette Amérique latine étouffe des peuples,
arrache avec leurs racines
ceux qui les premiers cultivèrent cette terre.
La terre mère blessée sanglante rampe
sur les chemins et dans les villages indiens.
Ils piétinent la dignité de mon peuple,
et me crient : « Au nom de la civilisation ! »
Ils nous calment par d’hypocrites caresses,
nous disent à l’oreille : « Ta culture est bonne
car elle est notre folklore » ;
« ta religion est intéressante
car elle nous donne nos superstitions… »
Ils nous imposèrent un nom,
nous appelèrent « Indiens »,
et nous prirent nos terres ;
ils nous confinèrent dans des forêts stériles,
nous forcent aujourd’hui à crier avec eux :
« Pour le développement !
Pour la civilisation !
Pour le progrès ! »
Frère indien, armé de rage
pour la ferme brûlée,
pour la fille violée,
pour les enfants qui n’apprennent plus
à saisir l’arc des ancêtres,
unissons nos voix,
redevenons sarbacanes, flèches,
et guerres victorieuses…
Bugasu est avec nous, ainsi que Nele, et Colman2…
ils nous demandent de serrer les rangs.
Peu importe combien de temps dure cette lutte ;
l’important est de se battre !
2 Bugasu, Nele, Colman : Bugasu, ou Bugsu, est le dieu de la guerre. Nele Kantule et Simral Colman sont les deux principaux héros de la Révolution kuna de 1925.
*
En touchant le ciel (Tocando el cielo) par Aiban Velarde
Soudain tu surgis à la pointe du jour
avec tes premiers regards
en touchant le ciel des mains
jusqu’à y faire paraître l’aube
ainsi te vois-je avec tes pas interdits
à l’heure du vol des papillons
belle, tu nais de l’eau si claire
tu possèdes ce que je cherche
l’œillet dans tes mains
je ne sais pourquoi la lune reflète dans tes yeux la danse de la pluie
je ne sais pourquoi tes cheveux de jais chantent à la lune sur la mer
rien ne vient à mon cœur qu’à travers toi
car tu es à portée de mes yeux
tu es comme la pleine lune car mes mains te touchent à peine
ne disparais pas au-delà des vagues
reste à la fenêtre avec moi
toutes les nuits que tu voudras
oui tous les matins que tu voudras
je sais que tu retourneras te réfugier dans la mer sereine
pour rêver dans un hamac
un peu plus bleu que la mer
*
Je voulus façonner un talisman (Pretendí labrar un talismán) par Aiban Wagua
Je voulus façonner un talisman en bois d’igua’uala3 ;
me dicter à moi-même des trilles et des rires.
Je voulus dire que l’Indien d’Amérique
n’avait pas de quoi se plaindre,
ayant encore les œufs de l’iguane,
le chinchard et la sardine et la forêt et la malaria.
Je voulus que mes vers
eussent l’innocence d’un enfant
un bec de toucan
une plume de chapeau d’Indien.
Je voulus me faire nuit
et pardonner à la poussière
et faire de la pluie une surprise.
Je voulus me taire,
me coucher sur le rivage d’Ustupu4,
déchiffrer le sourire des bonnes gens
et croire que nous sommes tous égaux devant la loi.
Je voulus que se cachât le soleil,
que le nuage fût étoile
et l’eau un chapelet
de coquillages verts
et ma douleur une prière de cristal.
Je voulus ne rien dire
et rimer des vers
sur chaque écharde de roseau sauvage ;
embaumer de menthe mon panier…
Je voulus que tout fût doux,
clair, divin, simple.
Je voulus que ces vers fussent lus
par un enfant libre une fleur à la main.
Et l’arête de la lumière
me contraignit à dire
que quelqu’un pleurait…
3 igua’uala : Nom kuna de l’arbre Dipteryx panamensis.
4 Ustupu : Nom d’une île de l’archipel de San Blas.
*
Je t’avais rêvée si souvent (Ya te había soñado muchas veces), par Arysteides Turpana Igwaigliginya
Et de tant te rêver tu pris corps
Devant mes yeux et tu grandis
Verdoyante comme l’arbre joyeux
De l’écosystème enchanté
Dans mon humble cœur tu édifias ta maison
Alors tu parvins au fond de ton souffle vital
Tes flammes à la fin trouvèrent leurs racines
*
Il pleut sur les maisons de l’archipel (Llueve sobre las moradas del archipiélago) par Arysteides Turpana
Avec la tristesse sépulcrale d’un vers de Verlaine
Sous le firmament fébrile des fulgurances
Les cocotiers délirent des arias aux paroles absurdes
– Désirs inutiles de remuer ton corps –
Que comprend assez la lumière de mes passions
Dans ces Ayligandi5 artificielles de châteaux où
Sans toi la moitié de mon hamac est de trop
5 Ayligandi : ou, plus souvent, Ailigandi, une île de l’archipel de San Blas.
*
Ma maison se situe entre l’enfance et le rêve (Mi hogar queda entre la infancia y el sueño) par Arysteides Turpana
Dans le village où je suis né
hommes et femmes
se nourrissent de poisson et
de fruits de mer
– dule masi6 –
Dans le village où je suis né
sous une pulsation de ténèbres
on entend grincer les hamacs
Dans mon village marin
quand vient la pêche à la tortue
Des fleurs éclosent dans la cocoteraie
et le Vent du Sud répand
des parfums de prune.
Alors viennent les pluies
dans mon village
avec le mois de mars
au-delà de la rizière saccagée
par les cochons sauvages
Un cri clair, fort :
aux blancs roseaux
de ma maison arrive
le vent
Il aura mille yeux saturant
la maison
avec le feu de bois vert
quand mon cœur sensuel
païen
cessera de battre pour toujours
Mais seulement deux larmes
familières
couleront sur la tombe que
j’attends
La lanterne de ma pirogue s’est éteinte
couvert d’ombres, glacé
je cherche une voix humaine
– Il n’y a que le clapotis des rames –
6 dule masi : Plat traditionnel kuna.
Poésie de Diana Carol Forero
Diana Carol Forero est une poétesse contemporaine de Colombie. Je suis entré en contact avec elle après avoir traduit, avec d’autres poèmes d’un même site internet des FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), trois de ses poèmes, dans mon billet intitulé Poésie des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) sur le présent blog (ici, billet en date du 23 septembre 2018) ; certaines de ces traductions ont entre-temps été publiées dans le numéro 174 de mars 2019 de la revue Florilège (rubrique « Poètes sans frontières »), dont deux poèmes de Diana.
Ces poèmes de Diana Forero étaient tirés de son recueil Balada para Piel de Luna (Ballade pour Peau de Lune) publié, sous le pseudonyme Gabriela Méndez, en 2016 par les FARC.
Diana a passé douze ans dans les rangs des FARC. Quand je l’ai contactée, elle était « promotrice de réintégration » (promotora de reintegraciόn) au sein de l’Agence colombienne pour la réintégration (Agencia Colombiana para la Reintegraciόn, ARC), l’organisme public chargé de la réinsertion des ex-combattants des FARC dans la société civile, et elle étudiait la psychologie dans le cadre de l’éducation à distance.
La situation de Diana comme celle de l’ensemble du pays semblait être la conséquence naturelle de l’accord de paix signé en 2016 entre le gouvernement colombien et la guérilla, après un long processus de négociation à La Havane (Cuba) ; cet accord et la constitution des FARC en parti politique, donc leur participation au processus électoral, paraissait devoir mettre un terme définitif à un conflit armé de plus de cinquante ans.
La pacification du pays a malheureusement connu depuis lors un revirement notable. Au moment où Diana et moi commencions à correspondre (via internet), en 2018, le nouveau président élu de Colombie, président d’un parti « centriste » dont le slogan « main ferme, grand cœur » a les accents typiques de la propagande autoritaire sans cœur et toute main, déclarait ne pas être lié par l’accord de paix signé par son prédécesseur avec les FARC. Diana, qui vit, comme la plupart des autres ex-combattants, dans un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), « espace territorial de capacitation et réincorporation » – cet indigeste jargon bureaucratique désignant un camp ni plus ni moins, en l’occurrence, dans le cas de Diana, situé dans une région isolée, dans lequel les ex-guérilleros vivent comme derrière un cordon sanitaire (depuis août 2017 ils sont cependant libres de circuler) –, a perdu son emploi pour l’agence gouvernementale ARC et vit d’une activité coopérative conduite avec d’autres anciennes guérilleras.
Par ailleurs, alors qu’en 2016, la situation des ex-combattants était déjà marquée par une forte discrimination sur le marché de l’emploi et l’accès aux études, et que 68 % des personnes liées à l’agence ACR étaient de ce fait employées dans le secteur informel, les assassinats d’ex-combattants désarmés sont devenus monnaie courante à partir de fin 2018 (un fait évoqué dans le texte Amasando sueños ci-dessous), au vu de quoi nombre d’entre eux décident de retourner à la guérilla, étant donné qu’une minorité dissidente des FARC, l’ELN, avait rejeté l’accord de paix et refusé de déposer les armes.
En outre, le processus de normalisation politique des FARC est compromis par une forme de persécution judiciaire de ceux de ses membres convertis en personnalités politiques, à l’instar du poète guérillero Jésus Santrich (dont j’ai traduit des poèmes à côté de ceux de Diana), devenu sénateur de la République mais faisant l’objet d’une demande d’extradition par les États-Unis pour trafic de drogue en dépit de l’amnistie entérinée dans l’accord de paix (les États-Unis invoquent des faits ultérieurs à l’accord) ; dans une histoire embrouillée aux rebondissements multiples, qui a vu entre autres un rejet formel de la demande d’extradition par la Juridiction spéciale pour la paix, l’organe juridictionnel créé par l’accord, s’avérer insuffisant pour garantir le sénateur Santrich du fumus persecutionis à son encontre, Santrich est entré en clandestinité, avant de déclarer publiquement avec d’autres ex-FARC en août 2019 la reprise des armes, déclaration à laquelle le président de Colombie a répliqué par l’annonce d’une offensive militaire. Cette reconstitution des FARC par des figures historiques ne peut manquer d’accroître, au vu des assassinats dont ils sont la cible, selon un véritable « plan » homicidaire de l’actuel gouvernement d’après certains, les retours à la guérilla de combattants désarmés, parqués et discriminés.
Le contexte est donc rien moins qu’apaisé, contrairement à ce que l’on pouvait croire au moment où je commençais à traduire en français de la poésie des FARC.
Diana, dont le voisin dans l’« espace territorial » a été assassiné et qui a elle-même reçu des menaces de mort, est de surcroît en délicatesse avec les FARC, vu qu’elle a décidé d’en quitter les rangs peu avant l’accord de paix, elle et son compagnon craignant pour la vie de leur bébé. Si son recueil publié par les FARC présente la poétesse comme « Gabriela Méndez, Guerrillera de las FARC-EP » (EP pour Ejército del Pueblo, armée du peuple : FARC-EP est le nom complet de la guérilla), il se pourrait que ce passé, en dépit de ce que l’on pensait et espérait au lendemain de l’accord de paix, soit bien difficile à porter au cas où cet accord ne s’avèrerait avoir été qu’une vaine tentative au bout du compte.
Diana me fait aujourd’hui l’honneur et l’amitié d’accepter la publication sur ce blog d’un choix par moi-même des poèmes qu’elle m’a envoyés au cours de notre correspondance. Ces poèmes sont inédits (sauf Identidad déjà publié en ligne, comme d’autres que j’ai reçus). Alors que ses poèmes réunis en recueil sont de la poésie engagée, ici Diana Forero montre une autre facette de son talent, et c’est entre autres pourquoi il me semble important de faire connaître ces poèmes, afin que le public ait une idée de la diversité de son inspiration.
*
BOTELLA AL MAR
Arrastro mis versos
a tus pies
como plegaria cotidiana,
confiando en que el lamento
de este amor impenitente
alguna vez me acerque
al tibio milagro de tu indulgencia.
Arrastro mis versos
a tus pies
como una ofrenda,
palpitante homenaje
a tu belleza pétrea,
botella que se agita
enfrentándose, obstinada,
al frenético oleaje
de tu olvido.
*
DEVENIR
Entre ecuaciones y fórmulas,
relatos y versos
transcurre para ti lejano
el devenir de mi universo.
Ajeno a mi mundo
y a mi cuerpo,
no logro tocarte
más que en el recuerdo
que me habita,
devorándome por dentro.
Y, como siempre, cada día,
resplandece el horizonte
en la imagen de tu sonrisa,
veo brillar el sol
en el reflejo de tus ojos,
no existe una canción de amor
que no me hable de ti,
ni un poema que no lleve
tatuado para mí tu nombre,
amor;
no hubo una vida probable
en que no te hubiera soñado
y, sin embargo,
solo he sido
esta dolorosa letanía,
esta muda vigilia,
este agrio ensalmo,
este abismo oscuro y sordo
en el que intento convencerme
que a pesar de no tenerte,
he vivido.
Hace siglos que te quiero.
*
INFIERNO
He vuelto a tus versos de sangre
como quien transita de nuevo
un camino conocido
y largo tiempo abandonado.
He vuelto a recorrer tu agonía
hecha metáfora,
como si asistiera, expectante,
al morboso espectáculo
de mi propio dolor.
Desciendo en silencio
entre las sombras
y las llamas refulgentes
de tu infierno,
buscando asir tu mano,
no para rescatarte de ti misma,
sino para hundirme en el abismo
con tu reflejo clavado en el alma.
Desde el ojo de la noche,
tus palabras ávidas
hincan en mi sus filosos labios.
A Clemencia Tariffa, poeta, amiga.
*
IDENTIDAD
Soy yo,
la que escribía versos
intensos y breves
como heridas de bala
Soy yo,
quien te enviaba
cartas de amor en latín
Soy yo
la que perdió sus vísceras
y endureció su aliento
en una sangrienta guerra
contra sí misma…
Sigo siendo yo,
la que hoy vuelve
a intentar abrir
las puertas de tu mundo,
a mendigar tu amor
en tres idiomas
A cientos de kilómetros de tí
abrazando tu sombra
besando el rastro de tus pasos
Soy yo
y he vuelto del infierno
pero el infierno habita dentro de mí
*
TÚ
Eras el poema
que garabateé en esa servilleta
que guardaste por años
una foto borrosa y marchita
en la que nunca estamos
este agónico vacío en mi pecho
un teorema sin solución posible
eras no más que
un puñado de momentos
un punto acaso
en la curva insondable del tiempo
eras los libros
que amaba leer
y olvidé en el anaquel de tu alma
no has dejado de ser
la avalancha de papel en blanco
que me inunda de silencios
eres, desde siempre
el sordo repicar del teléfono
que nunca nadie contesta
el vacío que me devora
este beso que agoniza
dolorosamente
cada noche
entre mis labios
*
PODCAST
Hace muchos años –tantos,
que ya olvidé cuántos–
salí corriendo de tu lado
pretendiendo escapar
de tu mortal influjo
queriendo reencontrarme
con ese algo de mí
que se extravió
en el ámbar de tus ojos
en el tacto firme y terso
de tu piel de luna
Hace un tiempo, tanto
que ya perdí la cuenta
de minutos
horas
días
semanas
meses
y años
atrapada en el podcast
de mi propia vida
como un perpetuo bucle
en diferido; soy pero no soy
estoy pero no siento
Alguien pregunta por qué
siempre pido dos tazas de café
y no sé si confesar
que es para el hombre
que nunca ha dejado
de habitar mi corazón
*
OCASO
Nada pesa tanto en mí
como el ocaso
La sensación agobiante
de que un día más
ha pasado en mi vida
sin vivirte
veinticuatro horas
de esta lenta
y angustiosa muerte
sin tocarte
sin besarte
sin amarte
La noche se abalanza sobre mí
y sigo siendo
la presa inerme del tiempo
la oscuridad de mis días
se hace una
con la bruma del paisaje
con el frío de mi corazón
invadido de nostalgia
amor
El canto de las cigarras
hace eco en mis adentros
y tiemblo de pensar
cuántas noches más
como ésta
habré de morir
ausente de tu cuerpo
lejos de ti
*
CARAVANA
Cada célula de mi cuerpo
vibra ante la sola mención
de tu nombre
amor
El tiempo ha carcomido
con su máquina de muerte
mis cimientos, mi mundo, mi todo
resguardando tan solo
este deseo incesante de ti,
ansia voraz
que ninguna fórmula podría calcular
inquietud incansable
que me fuerza a repetir
como una letanía
tu nombre
caravana de amarguras
en que se suman
una a una
las noches
tejiendo la agria superficie
de esta muerte
que es la vida sin ti
*
COPERNICANA
Hace casi quinientos años
Copérnico planteó
que todo nuestro mundo
gira alrededor del sol
Pero yo
habito en las nubes
desde que te vi,
hace media vida
–y no he vuelto a aterrizar
desde que no toco tu piel–
Todo gira en torno al sol
–excepto yo–
Tú eres mi luna y mi astro rey
y por si acaso
todas las estrellas
mi alfa y mi omega
mi alba y mi ocaso
el único destino de este cuerpo
fustigado de ausencia
la razón de ser de mis pupilas
el palpitante núcleo de mi alma
el centro incandescente de mi universo
*
NEURONAL
Sabes que me voy a morir
amándote
que me voy a llevar
tu recuerdo
en las pupilas
y en la piel
y en cada soma
en cada axón
en cada dendrita
de cada neurona
Y entonces los bichos
que se alimenten de mí
comerán tu recuerdo
y sabrán a qué saben
tus besos
y entenderán como
nadie más podría
por qué
nunca pude olvidarte
*
PRUDENCIA
Ella esconde
tímidamente
sus miedos.
Para que no se espanten
al verla.
*
DICOTOMÍA
Él se negaba a sí mismo.
Sólo para saber si era cierto.
A Alirio de Jesús, siempre.
*
ANOXIA
Dices que mi amor te asfixia.
Ojalá te estrangule hasta el último aliento.
*
SIN DESEOS DE MORIR
Sólo corté mis venas
para destilar de mi sangre
tu recuerdo
*
HUELLAS
Una gota de ausencia
rodó por mi garganta
–trago amargo–
dejando un profundo surco
una arruga prematura
Envejezco a los veinte años
*
ORIGAMI
Me doblo
Me fundo
Me pierdo
Nuevas formas surgen
de mi piel
de blanco papel
La caricia de tus manos
hace de mí
un nuevo ser
*
DISLEXIA
Hubo un momento
–de esto hace un tiempo–
en que sentí
que no podía ya
seguir jugando con las palabras
Ahora
ellas juegan conmigo
*
FRAGMENTO
Lamento que no haya dado para más
este amor tan breve
que hoy sólo ocupa tres renglones
*
PURGATORIO
Si Dios tuvo la culpa
quien puede juzgarlo
pasarle la cuenta de cobro
por haberme engañado
Me prometió el cielo
y te alejó de mí
Me prometió la vida
y asesinó mi alma
Si Dios tuvo la culpa
quien puede juzgarlo
Declararlo reo ausente
y condenarlo para siempre
A sentir el dolor que siento
A vivir esta vida que muero
*
DESPUÉS DE TI
Antes de amarte, amor
el mundo era vasto desierto:
como sordo quiróptero volaba sin rumbo
nada importaba ni lograba tocarme
mi piel era traslúcida
como alas de mariposa
y en mi corazón solo habitaba el silencio
Tú llenaste cada rincón
de mi cuerpo de luz
de sonidos y furia
de temblor extasiado, de vida
Pero la soledad se aferró a mí
como rama seca al borde del abismo
me inundó de temores y vértigo
me arrastró a la orilla misma de la muerte
y allí se sentó a llorar conmigo
Después de amarte, amor
mi mundo es camino cerrado
en torno la luz turquesa de tus ojos
mi piel hecha jirones atesora
la ardiente caricia de tus manos de luna
habitas el agua, el viento
la música y la noche
todo está lleno de ti
aunque mi alma sin ti esté vacía
*
MIEDO
He sentido su nefasto aliento
a almidón reseco
a mortaja avinagrada
toqué su piel de serpiente
–corteza muerta de las horas fugadas–
He presentido su paso
de rumor cansado
deslizándose como viento quemado
entre los árboles
Lo acompañé por horas
a hacer visitas familiares
con el obligado nudo en la garganta
le he servido las tres comidas de rigor
le presté mi cuarto
he sido su anfitriona dedicada
Al miedo no le hicieron pantalones
por eso, en ocasiones
le he tenido
que prestar los míos
*
INGREDIENTES
Fragmentos de cráneo
mandíbula, huesos
tibia, dientes, peroné;
no son más
que una lista de mercado
ingredientes de una sopa abominable
o el nauseabundo elixir
que quizás me permita hallar
por fin la paz del olvido
Fragmentos de cráneo
mandíbula, huesos
tibia, dientes, peroné
harapos y huaraches;
eso encontraron en una
de tantas fosas comunes
en Iguala
Raqqa, Damasco
Dabeiba o La Escombrera
Eso hallarás aquí
cuando recuerdes
por fin que existo
y vengas a buscarme
Y aún vagará
–lo sé–
sobre mi sangre seca
como alma en pena
el eco de este dolor sordo
el espectro de este amor fosilizado
que me consume la vida
*
PRIMIGENIA
Hace trespuntonueve eones
una lluvia de meteoritos
–surgida de incandescentes restos
de la formación del sistema solar–
bombardeó nuestro planeta
Atrapadas en cristales de sal
en su interior
miles de gotitas de agua
cruzaron millones de kilómetros
hasta llegar aquí
haciendo posible la vida
en lo que hasta entonces fuera
inhóspito infierno
Cada sorbo, cada charco
cada gota de agua
que ahora bebemos
existe aún como testimonio
de esa colisión primigenia
resistiendo a todo
incluso a nosotros mismos
Como mi amor por ti
*
ASAMKHYEYA
Un día de 1965, en Varsovia, en la esquina superior izquierda de un lienzo totalmente negro, pintó el número 1, al que siguieron a la derecha el 2, luego el 3, y demás números, en orden creciente. Sus lienzos –de 1,96 x 1,35 metros, escritos con un pincel número cero impregnado en óleo blanco con grafía sencilla–, negros al principio, pasaron a ser grises en 1968 y, al alcanzar el número un millón, en 1972, empezaron a ser aclarados mediante la introducción de 1% más de blanco, hasta el punto que –a partir de 2008–, prácticamente pintaba números blancos sobre fondo blanco. Pintó sobre el infinito –o la imposibilidad de alcanzarlo- y el paso del tiempo. El 6 de agosto de 2011, cuando Roman Opalka falleció, el último número que había pintado era el 5.607.249. Habían pasado 46 años y 233 “detalles”, como él llamaba a cada uno de sus cuadros, que hacían parte de su obra “1965/1–∞”, la cual concluyó en el momento de su muerte. “El problema es que somos y estamos a punto de no ser”, dijo Opalka en alguna ocasión.
Y yo sé que no soy si no es contigo.
*
AMASANDO SUEÑOS
A mediodía Alexa corría cañada abajo. Con mucho cuidado, se aferraba a su fusil, vigilando que sus zancadas, rápidas y ágiles –más saltos que pasos en realidad–, no hicieran ruido. Ese día, su comandante les contó que se gestionaba un acuerdo de paz, pues los jefes del Estado Mayor estaban en conversaciones con la gente esa del gobierno. Pero como nunca se sabe, y en la guerra y en el amor dicen que todo vale, aquí estaban, huyendo de un desembarco sorpresivo, en plenas negociaciones. Los soldados de la fuerza de despliegue rápido en pocos minutos habían copado la explanada en la cual se encontraba una hora antes el campamento guerrillero. De pronto, dio un paso en falso y cayó, peñasco abajo, rodando entre el cauce de la catarata que rugía bajo su cuerpo.
En eso, despertó sobresaltada. A veces, sucedía que los sueños la llevaban de vuelta al ajetreo de las montañas. A veces, mientras esperaba que el pan diera punto en el cuarto de crecimiento, y su bebé dormitaba en el corralito, detrás del área de producción, tenía microsueños, que eran más como recuerdos repentinos de emociones y temores, algo así como imágenes titilantes del pasado que la asaltaban por instantes, para recordarle que debía dormir con un ojo abierto. De suerte, pues si no, el pan se hubiese pasado de punto y la masa se habría caído al hornearla. Había aprendido a hacer pan, casi al mismo tiempo que aprendía a ser madre. Con su primer hijo no pudo, pues lo parió estando en filas, y apenas una semana después debió dejarlo en custodia de la familia del que entonces era su compañero. Recién ahora, gracias al proceso de paz, volvía a encontrarlo, y ya él, de trece años, poco o nada quería saber de esa madre que estuvo siempre ausente, atrapada en el conflicto. Pero a Alejito sí lo tuvo en este campamento de transición, ocho meses después de entregar las armas; él era un hijo de la paz, y Dios mediante, ojalá nunca tuviera que vivir los horrores de una guerra. Por él y para que su destino fuese diferente, decidió ser panadera. Junto con ocho compañeras más, casi todas madres solteras como ella, se asoció para gestionar esta iniciativa, que ahora les permitía un respiro de esperanza en medio de tanta incertidumbre. Porque las negociaciones de paz no habían traído ésta a sus vidas, más bien una suerte de temor constante a ser atacadas, desaparecidas, asesinadas. Un año después de la firma de los acuerdos, ya pasaban de cien sus excompañeros inmolados, víctimas de manos criminales y bandas paramilitares.
El pan de maíz en el cuarto de crecimiento ya había dado punto, así que Alexa se apresuró a precalentar el horno, para introducir en este las bandejas. Recordó que cuando era muy pequeña, su madre le cantaba, desgranando con ella los amarillos copos que llamaba mahís, que en arawak significa literalmente “lo que sustenta la vida”. Cientos de especies de esta planta, variedad de colores y tamaños, miles de creaciones culinarias a lo largo y ancho del continente, justificaban ese nombre; el maíz, ahora en el horno, olía a nueva vida, a felicidad, a tibia gratitud, a caricia del universo, a los besos de su hijo, a la posibilidad de un futuro.
Lo de aprender a hacer pan, había sido toda una odisea, como cada cosa que estaban aprendiendo en este proceso de apersonarse de nuevo de sus vidas, de retornar a la legalidad, a una civilidad que nunca había sido amable con ellos, pues el Estado, en zonas como esta, prácticamente ni existía. Por eso las guerrillas tomaron tanta fuerza, y eran consideradas autoridad en las remotas regiones en las cuales instauraron su área de influencia y en las cuales, jóvenes como Alexa, como Yolima, Yessica y las otras asociadas a la panadería y las demás excombatientes que vivían en el campamento, encontraron su única oportunidad de crecer y sobrevivir. Ahora, sobrevivían gracias al maíz y al trigo, a la cebada y el ajonjolí; ahora aprendían juntas, experimentaban nuevas técnicas, buscaban nuevas maneras de hacer las cosas y sus vidas tomaban forma como la masa que, en sus manos, crecía como la esperanza. Este era su futuro y su destino, su trasegar y su camino, amasando sueños.
Un chillido angustioso le avisó que Alejito había despertado. Se puso a toda prisa los guantes de carnaza y dio vuelta a cada una de las bandejas. Luego corrió a la trastienda y lo encontró ya levantado, aferrado a los barrotes del corralito, con el ceño fruncido y la mirada llorosa. Sin necesitarlo ya, pero con toda la intención de presionarla, el bebé chilló una vez más, con tono agudísimo y ululante, como de alarma de incendio o de ambulancia de socorro. Ella lo tomó en sus brazos, lo aupó y esbozó una amplia sonrisa, mientras tarareaba la canción del maíz, que su madre le cantaba cuando niña:
“Maíz hermano
Granito eterno
Jinete de rayos negros
Abrigo de niños tristes
Si al silencio te condeno
Ojecen las cataratas
Que eres fuego
Si careces en las grutas
Alzas tus brazos poblados
Y así vuelves
Aunque al tirano te muerda
Siempre serás maíz maíz
Aunque te arranquen los ojos
Siempre serás maíz maíz
Himno de bravas calandrias
Huacha pakai
Pawañui picausa chicny
Pancito de la ternura
Humilde oro de mil corazones
Plumita chicta chitarinuspa…”
*