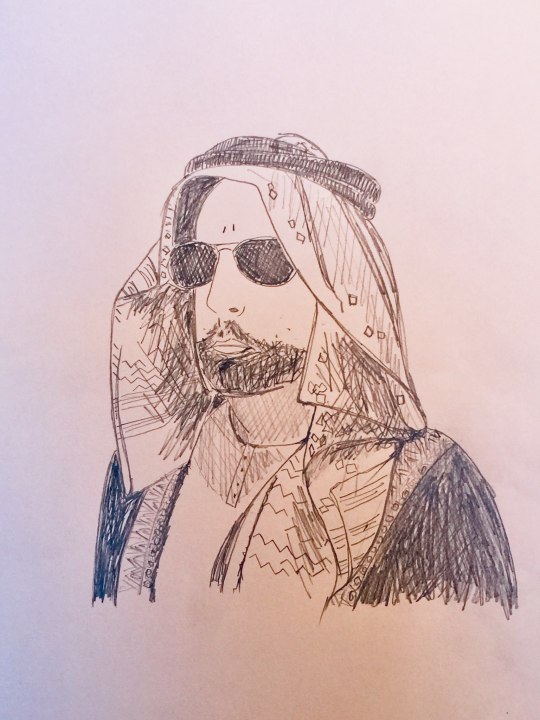Tagged: recueil de poésie
Je baise les pieds de la Palestine: Poèmes
En guise d’introduction : Note sur un portrait
Cet émir inquiétant… D’abord, il y a quelque chose de dyslexique dans sa composition, une partie du keffieh est noire et le bisht couleur chair, du moins de la couleur de la partie claire du visage. Ensuite, il y a cette ombre sur la figure, une plaque grise qui fait l’effet d’une lèpre ou bien du mécanisme mis à nu d’un cyborg, mi-homme mi-machine. Le caractère clivé est renforcé par les lunettes, dont un verre est noir comme la nuit et l’autre réfléchit des lumières étranges. L’aspect de lèpre, voire de décomposition post-mortem commençante est accentué non seulement par les taches à l’éponge mais aussi par la quasi-imperceptibilité des traits du visage, à peine marqués, en contraste avec la bouche livide. Le nez paraît manquer au premier regard mais il est droit et indique la volonté. Ce mage lépreux ou cette momie aux pouvoirs magiques ressort sur un fond ondoyant dont quelques bavures d’encre annoncent la décomposition prochaine. De ces ferments de pourriture physique et mentale se dégage pourtant l’éternelle jeunesse dont parle le philosophe danois et qu’il attribue à ceux qui restent sûrs d’eux-mêmes quoi que leur inflige le sort.
*
TABLE DES MATIÈRES
1/ Le dictateur et les poètes
2/ Émir
3/ Éléphant noir
4/ Je baise les pieds de la Palestine et autres poèmes
*
Or quant à l’antiquité de ces vers que nous appelons rimés, et que les autres [langues] vulgaires ont emprunté de nous, si on ajoute foi à Jean le Maire de Belges, diligent rechercheur de l’antiquité, Bardus V, roi des Gaules, en fut inventeur : et introduisit une secte de poètes nommés bardes, lesquels chantaient mélodieusement leurs rimes avec instruments, louant les uns et blâmant les autres, et étaient (comme témoigne Diodore Sicilien en son sixième livre) de si grande estime entre les Gaulois que si deux armées ennemies étaient prêtes à combattre, et lesdits poètes se missent entre eux, la bataille cessait, et modérait chacun son ire.
Joachim du Bellay, La Défense et Illustration de la langue française
.
LE DICTATEUR ET LES POÈTES
.
Le premier de ces poèmes est le LV du recueil Le zircon et le nard (ici), qu’il conclut en annonçant le présent chapitre.
Le dictateur tuait chaque jour un poète
De sa main, pénétrant dans la prison secrète,
Exact, à la même heure en fin d’après-midi.
On avait ficelé sur un siège, étourdi,
Insulté, bâillonné l’espion communiste
Dans une salle basse où, le visage triste,
Ce dernier languissait de connaître son sort.
C’est alors que, rompant le silence de mort,
Entrait majestueux le président à vie
En personne : un honneur qu’en principe on envie.
Le dictateur voulait, un pistolet en main,
Au prisonnier, vieillard, homme mûr ou gamin,
Tenir quelques propos lui dévoilant son âme
– Il fallait cependant être homme, et non point femme,
Le sexe étant la chose afférente aux geôliers.
Ensuite il remontait la paire d’escaliers
Et pressait son chauffeur de le conduire en ville,
Au cotillon offert quelque lâche édile.
Un copiste inconnu, pour la postérité
A pu transcrire un choix de cette cruauté.
*
I
Qui peut être poète et des Muses veillé
Quand, dénué de goût, il flâne débraillé ?
Regarde-moi plutôt, admire cette coupe
Du manteau dont chacun de mes pas se chaloupe,
Laissant voir la tunique aux nuances feldgrau
Que saura distinguer un vrai caballero,
Le baudrier, l’éclat des médailles sans nombre
Sur la poitrine mâle, et l’élégance sombre
De la toile de drap cousu de fil d’argent,
Le ceinturon de cuir et d’acier réfulgent,
Les plis du pantalon à l’exorde des bottes
Qui, si tu les couvrais d’instances idiotes,
Te feraient un miroir où contempler ton groin,
mon lieutenant les cire avec le plus grand soin,
Et sur le front saillant la casquette juchée
Obombre mon regard de gemme panachée.
Quel peut être le goût d’un inné loqueteux,
Et quels relents sinon de fiel eczémateux
Sortira du caquet bègue de ce paillasse ?
Ce nez que je te vois encor, seule la crasse
Le séduit-il ? Ces yeux mornes, ces yeux glacés
Que mes geôliers bénins jusqu’ici t’ont laissés,
Ne goûtent que l’aspect sordide des guenilles ?
Tu chantes la Beauté, les pieds en espadrilles ?
Vois donc ce révolver, mon loyal Beretta :
Crosse de nacre et d’or, en étui magenta.
Les effets martiaux, le fuselé des armes
Te sont indifférents, tu n’en vois point les charmes
Et tu te crois poète ? Arrête, où sommes-nous ?
L’art est aux seuls clochards en ce monde de fous ?
Et c’est en soprano que l’anarchiste braille,
En ténor du futur ?
Va, meurs !
Ah, la canaille !
*
II
Mouvement littéraire, autant dire une école,
Ses cahiers, ses bons points, sa sotte gloriole,
Ses loustics dont le mot d’ordre est la Liberté,
Ce délire entendu, ce trouble concerté,
Une école de clowns qui déclament leurs rôles
D’un air très convaincu, sérieux, et pas drôles,
Et que l’on canonise à la fin en donnant
Leurs noms à des dortoirs de dégoût lancinant…
Comme ces histrions nomment dans leurs poèmes
Les savons dernier cri de France, essences, crèmes
À bronzer, pantalons, fourrures, chapeaux mous,
Tes compagnons et toi, métis à demi fous,
Vous bêlez à l’extase, à l’art pour l’art, au rêve
Quand vous lisez des mots exempts de toute sève
Sur le papier glacé d’un imprimé bourgeois,
Mais c’est le mannequin nu de la page trois
Qui parle à vos instincts, plus que ces mornes pitres !
Mes paroles te font du mal, tu récalcitres.
Or je n’ai pas fini. Tout cela serait bon,
Ferait d’un loqueteux studieux un mouton
À mon goût, mais voilà, l’ignoble communisme
Captive ces crapauds d’un pressant magnétisme ;
Se contempler en face est pour eux si cruel
S’ils ne peuvent raser gratis, être du ciel
Quand ils vendent leur kif, avoir des ailes d’ange
En jetant autour d’eux une fétide fange.
Il faut à ces clampins sublimer le travail
Comme il faut des complots aux muets du sérail,
Il faut à ces pervers des lendemains qui chantent,
Car la haine, l’envie et le crime les hantent.
Quand le marchand d’oignons n’aura plus besoin d’eux,
Leurs bronzes lèveront des fronts bas vers les cieux.
Quand nous n’entendrons plus le latin de leurs messes,
On lancera des prix en hommage à leurs fesses.
Quand des bouffons nouveaux, plus jeunes, surgiront,
Les siècles de leur voix grêle se souviendront.
Quand perdront leur impur pouvoir leurs sodomies,
On les embaumera dans des académies.
Mais jamais, moi vivant, sur vos corps élevé,
On ne verra l’État nuire au contrat privé.
*
III
Pourquoi ne pas entendre, un jour au moins, Platon ?
Si tu n’écrivais pas des vers de mirliton
Mais une œuvre tout feu tout flamme, impérissable,
Un monument plutôt que des pâtés de sable,
Tu n’aurais pas encore ici droit de cité.
Le doigt du Philosophe est contre vous pointé,
Poètes, vous croyez être l’intelligence
Mais elle vous bannit sans la moindre indulgence.
Le canon de mon arme est son bras séculier,
Mettre fin à tes jours pour elle est régulier.
L’intelligence abhorre et blâme, énergumènes,
La bouche qui répand des paroles malsaines.
Vous êtes si certains de l’arrêt du futur
Mais l’avenir vomit votre tumulte impur,
C’est moi qu’il couvrira de lauriers enviables
Pour vous avoir chassés de nos murs vénérables,
Et pour chacun de vous dont j’éteindrai la voix,
Une palme m’attend au ciel sur un pavois.
Tu m’appelles tyran, ta clique me défie,
Or je tiens mon pouvoir de la Philosophie.
L’esprit vous a maudits, qu’êtes-vous, imposteurs ?
Arrêtez d’insulter le Vrai.
Maintenant, meurs.
*
IV
Quoi de plus saugrenu qu’étudier la rime
Et les inversions d’un sonnet pousse-au-crime ?
Voyez ce connaisseur en ponctuation
Étaler longuement sa délectation
Devant les hiatus novateurs d’un bigame
Célébrant l’esclavage au bordel de la femme :
Est-ce un homme ou bien est-ce un pantin magistral,
Ce phraseur dénué de sentiment moral ?
Que fait au genre humain l’audace virtuose
D’un froid technicien au bord de l’overdose,
S’il chante pour flatter la bestialité ?
Sous son aspect chétif, c’est la brutalité
La plus écœurante qui grogne, et le peuple s’écrie
Là-contre durement, veut que je pilorie
Cette canaille obscène, en demande la mort
Pour apaiser la Loi morale, sans déport.
Voilà pourquoi je viens te voir dans ta cellule,
De ce noble courroux étant le véhicule ;
L’Homme, que tu disais libérer par tes vers,
T’expulse comme un pou hors de son univers.
*
V
En écrivant des vers tu te vois à Paris,
Tu vas dans les cafés, c’est la fête et tu ris,
Tu fais rire, surtout, une blonde compagne,
On te sert des cocktails d’absinthe et de champagne,
D’élégants inconnus te tirent leur chapeau,
Tout le monde te dit que le teint bistre est beau,
Que l’on n’a jamais vu de plus brillant métèque
Depuis Heredia dépeindre l’âme aztèque
D’un ton si précieux et si français aussi :
« Merci de nous singer, vraiment c’est réussi.
Je suis ému de voir comme est universelle
La plate gaudriole où moi, Gaulois, j’excelle.
Voici, Poète, au nom du baron de Feuillac,
Une invitation à jouer au trictrac.
Mademoiselle Élise en sera, c’est tout dire.
Faites-nous cet honneur, après lequel soupire
Tout Paris, alias l’Univers tout entier ! »
Je t’épargnerai donc, enfant de savetier,
La désillusion amère qui te guette
Quand là-bas sans amis, flanqué par la disette,
En fait de cotillons tu suivras dans la nuit
La soubrette d’un bouge horrible qui te fuit,
Et que son céladon, fâché par ta figure,
Saura te l’arranger dans une impasse obscure.
*
VI
Le comte de Feuillac aurait beaucoup aimé
Rencontrer, c’est certain, poète si famé
Car en homme du monde il a le goût des lettres
Et lui-même a produit quelques dodécamètres.
Mais il aurait fallu qu’il connaisse ton nom
Et cela se peut-il ? À l’évidence non.
Le faubourg Saint-Germain souffre de myopie :
Même des vers français, même une queue-de-pie
D’aussi loin ne lui font qu’un effet sans vigueur,
Il ne peut supposer dans ce smoking un cœur
Ni sous ce chapeau mou de la matière grise
Dans le goût distingué suffisamment assise.
Le comte n’eût jamais eu de temps pour ton art
Mais l’un de ses neveux, te donnant du jobard,
T’aurait lancé son gant de suède au visage
Avant de te loger du plomb, selon l’usage,
Entre les yeux. Crois-en ma parole, ce tir
Ne t’aurait pas laissé jeter même un soupir.
Ne regrette donc point ce dessein téméraire,
Mieux vaut martyr ici que là-bas pauvre hère.
*
VII
C’est Paris, à toi s’ouvre un vaste labyrinthe,
On te sert des cocktails de champagne et d’absinthe,
Ton talent fait valser les cœurs, ton bras les corps,
Tu voles éperdu des baisers que tu mords,
L’éternel féminin sur ton œillet se presse,
T’entendre zézayer des vers, quelle allégresse,
On n’a jamais rien vu de tel depuis Feuillet,
Si tu poudrais ton slip ça serait Rambouillet,
Ton œil flou d’Indien sagacement pétille,
Le comte de Feuillac va te donner sa fille,
Et la comtesse veut se donner, elle, à toi,
Ton désir souverain fait à présent la loi,
Qu’ai-je donc oublié ?
Tout ça pour des poèmes ?
Explique à mon banquier les puissants stratagèmes
Par lesquels tu parviens à ce beau résultat,
Je te nomme aussitôt bienfaiteur de l’État.
Tu ne dis rien ? Tant pis, je m’en veux de ce rêve ;
Poète, nous comptions sur toi.
Maintenant, crève.
*
VIII
La coupe des forêts où coule la rosée (Pierre Reverdy)
Tous ces arbres tombés pour que tu souilles l’âme,
Tout ce papier couvert de muflerie infâme,
Tant d’encre dégorgée en blasphèmes bouffons,
En hystériques pleurs et farces de bas-fonds,
Vont s’économiser avec un doigt de poudre.
Vois-le comme, tombant de l’Olympe, la foudre
Qui frappe sans colère un ennemi des dieux.
Et moi, pour nos forêts, je me sentirai mieux.
Vois le faonneau téter la biche affectueuse
Dans les bosquets profonds à la mousse odoreuse,
Au chant des rossignols qui charme ses ébats ;
Tu veux y détacher les scieurs scélérats,
L’algide tronçonneuse aux hurlements sinistres
Pour qu’un livre attendu par un caveau de cuistres
Te pare de lauriers égoïstes et vains !
Que ces mesquins loisirs sont lâches. Inhumains.
N’entends-tu pas la voix des nymphes, qui m’appelle :
« Sauve-nous, sauve-nous, noble cœur, âme belle !
Sauve-nous du méchant qui va, dans son mépris,
En ravageant les bois saccager nos abris !
Diane t’a livré le fat qui nous agresse :
Ô presse la gâchette avec orgueil, ô presse ! »
*
IX
Il n’y a point aujourd’hui de censure, mais c’est que nous avons perfectionné tout cela. (Aragon)
Pourquoi donc accuser notre État de censure
Quand ton fétiche a dit qu’en France elle perdure
Sous d’autres avatars, qu’il ne veut point nommer
Et qu’il ne paraît pas non plus bien fort blâmer ?
Nous sommes fatigués de votre hypocrisie,
De l’embrigadement de votre poésie.
Mais je dois faire court car je suis en retard
Chez un vieux sénateur qui lance son bâtard.
Il se trouvera là mon ministre des cultes
Et de l’instruction, entre autres gens incultes,
Et je veux lui toucher un mot du traitement
Que doit verser l’État par son département
À notre bonne amie écrivain, la Goulue,
Dont je me doute bien que tu ne l’as pas lue.
Nous censurons, c’est vrai, tout comme tes amis
Dès que l’État leur est entièrement soumis,
Car c’est vous contre nous, et non quelque autre chose.
Ce sont nos libertés au prix de votre cause.
Quel intérêt de vivre, aussi, privé de voix ?
Un oiseau doit chanter.
Je vais tirer à trois.
.
ÉMIR
.
X
Cet amour, Abdoullah, ne finira jamais,
Tant que tu me comprends et que tu te soumets.
Quand je repousse avec horreur ta main velue,
Cette injure, c’est toi – toi seul – qui l’as voulue.
Quand je suis sur ton dos à chaque heure du jour,
Tu dois me divertir et me faire la cour,
Et surtout ne dis pas que le devoir t’appelle
Ou je fracasserai de nouveau la vaisselle.
Refais à mes dépens une fois de l’esprit,
Tu sais comment ma main sur ta face atterrit.
Ne rien tenir pour vrai, c’est être philosophe
Quand je me contredis à la moindre apostrophe,
Mais chercher à savoir le vrai dans mes propos,
C’est être au plus haut point borné, le roi des sots.
Et si tu veux entendre un serpent qui crécelle,
Tu n’as qu’à me parler en bien d’une pucelle.
Tant que tu me comprends et que tu te soumets,
Abdoullah, cet amour ne finira jamais.
*
XI
Abdoullah, je souris de ton désir souffrant.
Si loin, tu n’es pas là. Je marche, t’adorant.
J’ai vu le rossignol glisser dans les ramures
Mais en moi n’entendais que tes aimants murmures.
J’aime les souvenirs dont mon cœur est comblé
Car je vis avec eux un rêve constellé :
Je parle à chaque objet familier en silence
Et redis tous les mots de notre connivence ;
Chacun de tes regards, illuminé, profond,
Est une étoile au ciel, un bonheur, qui viendront
À chaque instant du jour et de la nuit me dire
Que l’amour est un oued que rien ne peut réduire.
*
XII
Abdoullah, ô je ris de ton désir pressant,
Je ris de ces mots doux que tu dis, rougissant,
Car ton front emperlé se plisse et se replisse,
Tu tends des doigts crochus vers l’ambre du calice
Et ton keffiyeh plonge informe sur tes yeux,
Son agal† pendouillant penaud, disgracieux ;
Où s’en est donc allée, amir, ta contenance,
La princière hauteur de ta belle prestance,
Et qu’ai-je devant moi ? Les soubresauts bouffons
D’un chaton empêtré dans un tas de chiffons.
Veux-tu donc que j’appelle avec nous ma servante
Et que, pour prévenir un choc, elle t’évente ?
†L’agal est le cordon qui maintient le keffiyeh ajusté sur la tête.
*
XIII
Dans le Chinatown de Djeddah
Messieurs, nous le savons, l’État est en danger
Et l’honneur des Saoud par nous se doit venger :
Sur notre sol un nid de vipères sifflantes
Que notre aménité rend bien trop insolentes
Sue un mortel bouillon de venin corrupteur
Sous les dehors bénins d’un commerce imposteur.
Las ! pas plus tard qu’hier un fret de cardamomes
Conduisit mon sergent aux éclatants prodromes
D’un désastre imminent pour notre Royauté ;
Dans les miasmes du porc ! et du tofu sauté,
Le keffieh sur le nez, j’enquêtais ; à peine eus-je
Mis la main sur le cou d’un suspect qu’un déluge
De nunchakus pleuvait sur nous de toute part.
Et voyez donc mon bisht – améthyste, à brocart –
Lacéré par le jet d’un trident de coolie.
Dieu merci, mon HK confondit cette lie,
Mon agal ne bougea que d’un chouïa deux-tiers.
Messieurs, ne laissez point quelques greffiers amers
Oser dans les bureaux critiquer ces méthodes.
Moi, l’émir Abdoullah, je dédaigne leurs codes
Et n’ai d’autre souci que les bons résultats.
D’avoir sauvé ma vie en tirant dans le tas
Je n’ai pas à rougir devant ces veules scribes
Qui vivent aux crochets de l’État, en amibes,
Pas plus qu’émir doué de saine tempérance
Je ne dois aux toqués la moindre tolérance.
*
XIV
La connexion Zanzibar
Messieurs, vous le savez, le Royaume est la cible
D’un malfaisant complot contre l’Un infaillible.
Vous mandez un rapport vous récapitulant
Notre opération Dromadaire volant.
Voici donc.
Quand j’appris de mes sources secrètes
Que des pirates noirs aux haïssables traites
S’apprêtaient à passer un fret délictueux
Sur notre territoire enclosant les Saints Lieux,
Je lançai la marine et mon hélicoptère
– Où je pris place armé d’un HK militaire –
Contre les Zandj félons. Me voyant, ces derniers
Poussèrent de hauts cris, des blasphèmes grossiers,
Et depuis leur vaisseau, dans une aigreur hostile,
Lancèrent vers le ciel un fulminant missile.
J’étais déjà sur eux et sautai dans les airs,
Sentant contre mon dos les débris, les éclairs
De mon engin détruit, mais sauf et plein de rage
Contre les ennemis défiant mon courage
Et les autorités du Royaume très saint.
Je tirais sur ces gueux avant d’avoir atteint
Le pont de leur esquif, terme et but de ma chute,
Où je roulai, courus, me jetai dans la lutte
Au corps à corps parfois, les balles bombinant
Autour de moi, de tous les côtés, lancinant
Stroboscope de tirs. Mais j’en ai l’habitude.
Sans me laisser fléchir devant leur négritude,
J’abattis un à un ces délinquants retors.
La marine suivant, put recompter les morts.
Et c’est ainsi, messieurs, dis-je sans hâblerie,
Qu’en farouche opposant de la piraterie
Notre pays gardien de la religion
Fit la plus grosse prise à ce jour de jambon.
*
XV
L’émir Abdoullah contre les Thugs de Bénarès
Vous le savez, messieurs, pour notre économie
Nous employons chez nous une tourbe ennemie
Qu’il nous faut surveiller opiniâtrement
Sous peine de subir un cruel châtiment :
Loin de nous savoir gré de nos sollicitudes,
Ces esprits indévots aux sales habitudes
Couvent dans leur poitrine une animosité
Que le relâchement de notre fermeté
Rendrait pernicieuse au trône des Saoud,
Et pendant que nos fils se parfument à l’oud
En pensant aux yeux noirs et doux de leurs amies,
Ignorant le serpent fomenteur d’infamies,
Nous avons le devoir austère et rigoureux
De tenir en respect ces immondes lépreux.
Vous eûtes vent, bien sûr, d’une cabale ancienne,
Aujourd’hui trafiquante et politicienne,
Infiltrée en tous lieux du pouvoir, un Satan
Régnant sur ce cancer qu’on nomme l’Hindoustan,
Je parle – veuille Allah me prêter assistance –
Des Thugs de Bénarès : cette maudite engeance,
Selon tous les rapports de nombreux espions,
Aurait jusque chez nous avancé des pions,
Détournant à ses fins nos besoins de main-d’œuvre.
Voyant se resserrer les bras de cette pieuvre,
Je partis aussitôt pour la sombre cité
Où le koufr dément, sabbat surexcité,
À toute heure du jour et de la nuit aboie
En jetant ses défunts dans mille feux de joie.
En arrivant, je fus, malgré l’incognito
Dont je me croyais sûr, attaqué subito
Par une abjecte foule, ivre, populacière,
Tandis que je faisais fervemment ma prière.
Cela se déroulait à quelques pas des ghats ;
Je les massacrai tous entre les deux rakats.
L’ennemi consterné, changeant de stratagème,
Supposa qu’il pourrait liquider son problème
Avec une bibi, qui m’empoisonnerait.
La danseuse était belle et vous enchanterait,
De sorte que Brahim aussitôt, à mon geste,
Saisit et m’emporta ce corps agile et preste.
Et c’est dans mon harem que l’on connut l’horreur :
La belle avait voulu me congeler le cœur.
Vous avouerez, messieurs, jugeant cette offensive,
Qu’il faut garder le sens de l’initiative.
Enfin, je pénétrai dans l’antre des démons.
Un monstrueux eunuque aux géants mamelons
Me barra le chemin ; à son collier de crânes
Je crus voir attachés mes bijoux, diaphanes,
Car son grand cimeterre aveuglant fendait l’air
Comme dans la nuit noire un fulminant éclair.
Mais puisque, pour l’islam, une technologie
Est permise dès lors que ce n’est point magie,
J’abattis ce poussah au fusil-mitrailleur.
Et l’avenir, messieurs, nous paraît bien meilleur
Depuis que je rasai cette maison maudite,
Ce repaire de djinns à coups de dynamite,
Ayant avant cela pris soin d’y renfermer
Ses habitants.
Ils ont fini de blasphémer.
*
XVI
L’émir Arachide contre le gendarme de Saint-Tropez
Vous le savez, messieurs, sur la Côte d’Azur
Où l’hiver est clément et l’été point trop dur,
J’ai quelques cabanons et manoirs en pinède
Où loin du Tadawul† nerveux qui nous obsède,
J’aime passer des jours indolents – mais princiers –,
Spéculant un chouïa sur les marchés fonciers,
Plus pour jouer, d’ailleurs, comme sur quelques chiffes,
Avec mes garnements, qu’ils se fassent les griffes.
Mais voilà, je fais face à l’imbécillité
D’un gendarme du cru, simple et surexcité.
On lit sur son faciès le profond crétinisme
D’un avorton produit au sein du paganisme,
Rendu plus ridicule encore par l’habit
Que Dieu marque sans doute à l’éternel débit
De ses sots concepteurs, sans goût ni main habile
– Et dire que ces gens osent parler de style,
S’y croyant les premiers, c’en est désespérant,
Mais pour un œil pieux plutôt corroborant.
Je ne puis rendre compte au bon sens d’hommes sages
Des grimaces sans nombre et des cabotinages,
Des mimiques de singe et de femme et de nain,
Ni des contorsions de pygmée inhumain
Dont cet individu contrefait est capable.
Plus qu’un homme, je vois un djinn abominable.
N’aimant pas les Bédouins, il veut me provoquer.
Dans mon quiet bercail, je le vois m’attaquer
Avec tous les moyens de l’ignoble chicane
Dont ce pays regorge, et la plèbe ricane
De voir un noble émir à la merci d’un pou,
Parce qu’il est français et que ce peuple est fou.
Messieurs, c’en est assez, notre droit intangible
Au climat tempéré pour nous irrésistible
Ne saurait plus longtemps être ainsi méprisé.
Je demande avec force et droit qu’il soit puisé
Dans notre fonds secret pour régler le problème
Et ne veux plus revoir ce trépignant blasphème.
Car vous avez goûté les agréments de Fez
Et connaissez le prix de ceux de Saint-Tropez.
†Tadawul : la Bourse saoudienne, à Riyad.
*
XVII
Essence du téléphone d’or
Le téléphone d’or est, vous l’aurez compris,
Un appareil filaire.
Importé de Paris,
Où firent ce bijou, sur les fonds du royaume,
Les meilleurs joailliers de la place Vendôme,
Son combiné se pose, élégant instrument,
Sur le support coquet horizontalement.
Son cadran rotatif est composé d’un disque
Que l’on tourne du doigt, c’est charmant, et sans risque,
Je le dis à tous ceux qui n’ont jamais connu
Que les touches sans art d’un clavier convenu ;
Sans doute est-ce dauber le présent mais personne
N’a vu si bel engin, plus riant téléphone
Que – personne ici-bas ! – le téléphone en or
De l’émir Abdoullah Aladdin Almanzor.
Et cette émotion augmente sans mesure
Quand je songe aux poteaux, un à chaque encablure,
Traversant les déserts de sable à l’infini,
Ainsi que le néant au gratuit réuni…
*
XVIII
La vie ne tient qu’à un fil
Vous ai-je raconté, messieurs, comment un jour,
Prisonnier du mogul zandj Mamadi Mansour
Dans son hélicoptère au-dessus de Médine,
Je pus, en me sauvant, tuer cette vermine ?
Écoutez donc.
J’étais ligoté dans l’engin
Qui devait m’emporter vers une triste fin.
Deux Zandj plus Mamadi Mansour, dont le pilote,
Trois hommes donc en tout, trois bandits de Mayotte,
Étaient là. Je brisai mes liens promptement,
Puis, m’étant dégagé de son embrassement,
Jetai le premier Zandj blasphémant dans le vide.
Le pilote suivit d’un coup de pied rapide.
L’engin ne volait plus qu’en zigzags cahoteux,
Si bien que Mamadi manqua son coup, piteux ;
Je saisis son kandjar et lui trouai la panse,
Le jetai dans un siège, il perdit conscience,
Je bouclai la ceinture autour de l’embonpoint
Et tirai de la plaie, entre le gras disjoint,
Un boyau, me lançant avec ça dans l’abîme.
Cette inspiration démente fut sublime
–Sans affectation : Dieu fut l’inspirateur,
Gloire à Lui–, le sanglant boyau libérateur
Déroulé tout au long ne brisa pas de suite,
Si bien que ma vitesse en tombant fut réduite,
Assez pour que je pusse atteindre un toit clément
Sans détriment majeur ; c’est alors seulement
Que, tendu, le viscère éclata. C’est limpide :
Ce criminel avait l’estomac très solide.
*
XIX
Mamadi Mansour le Zandj démoniaque
De tous les Zandj félons issus du Zanguebar,
C’est Mamadi Mansour mon plus grand cauchemar.
Tout commença le jour où Mayotte, aux Comores,
Par la plus grande offense à ses ancêtres Maures
Refusa de quitter le giron des koufar.
Pour Mamadi ce fut un vrai coup de kandjar
Dans le dos ; il entrait alors en résistance
Contre cet ogre obèse, efféminé, la France.
Jeune encore, il connut les geôles de Satan.
Géhenné de longs mois sous le drapeau tyran,
Toujours il refusa de céder aux eunuques
Dont il abominait les licences caduques.
Avec des compagnons, un jour, il s’éclipsa,
Quitta le sol aimé dans un kwassa-kwassa
Pour depuis Moroni continuer la lutte.
Ce fut l’occasion fatale de sa chute
Dans les dédales noirs du crime organisé,
Car pour faire la guerre en Zandj civilisé,
Qui plus est contre un djinn de saindoux en friture,
Il faut beaucoup d’argent et vite, et la gageure,
Voyez-vous, ne connaît aucun autre chemin
Que la géhenne où trône Iblis, monstre inhumain.
Maudite soit la France, effrayante est sa coulpe.
Il enserre nos bishts en ses longs bras de poulpe :
De tous les Zandj félons issus du Zanguebar,
C’est Mamadi Mansour mon plus grand cauchemar.
*
XX
L’émir Abdoullah dans la pyramide du Rub al-Khali
Messieurs, vous demandez un rapport exhaustif
De faits par nous tenus secrets non sans motif.
Entendez par ma voix ce récit pittoresque,
Singulier et non moins abracadabrantesque.
Quand notre CubeSat Taqnia « Tripoli »
Découvrit un beau jour dans le Rub al-Khali
Un objet inconnu comme surgi du vide
Et qui paraissait bien être une pyramide,
Concevez ce que fut d’abord notre stupeur.
Dans les plaines de sable un mirage trompeur
Est pour la caravane usuelle magie,
Mais non pour le tractus de la technologie !
L’analyse fractale indiquait le travail
D’êtres rationnels, c’était comme un sérail
– Me disais-je, devant cette image irréelle
Dont je voyais ému l’aura surnaturelle –
Élevé par des djinns en une seule nuit,
Loin des regards gênants, du mouvement, du bruit,
Et non l’empilement de roches éboulées,
De dunes par le vent puissant accumulées.
Il fallut aller voir sur place.
À l’horizon,
Comme un déblai d’Iram relevé sans raison,
Se dressait devant nous, gigantesque, le prisme,
Augure de quel drame ou de quel cataclysme ?
La pierre scintillait blanche, ivoire éclatant.
Nous ne pouvions manquer ce détail important :
Les siècles n’avaient point patiné sa surface.
Qui donc osait ainsi, scandaleuse menace,
S’inviter au pays trois fois saint des Saoud ?
J’entendis, semblait-il, une musique d’oud
Depuis l’intérieur lointain de la structure,
Et quand, en la cherchant, nous vîmes l’ouverture,
Sans hésiter j’entrai le premier dans ce trou.
Que direz-vous, messieurs ? je crus devenir fou
Quand se ferma le mur aussitôt à ma suite
Et je me trouvai seul dans cet antre d’afrite.
Car nous n’avions point pris avec nous d’explosifs
Et je ne voyais donc quels moyens positifs
Pourraient être employés, avant de longues heures,
Pour me tirer de là : « Abdoullah, que tu meures,
Pensai-je, ce serait certes grande pitié,
Mais puisque te voilà du jour congédié,
Apprends donc à connaître un peu cette bâtisse
Où t’a voulu mener ton esprit de service. »
J’avais ma lampe – las ! non celle d’Aladdin
Mais une lampe torche – et perçus un chemin,
Que je suivis ; nul oud n’égayait mon oreille
Mais un bruit de turbine ou de ronron d’abeille
Amplifié ; je vis au loin une clarté,
Éteignis, m’approchai, qu’avisai-je, hébété ?
Dans une salle haute aux murs dans les ténèbres,
Mille scintillements inquiétants et guèbres :
Tout comme au Tadawul d’innombrables écrans
Clignotaient, recouverts de glyphes aberrants,
Étincelants rébus, l’alphabet hérétique
De djinns abandonnés dans l’abîme hermétique,
Et j’eusse bien en vain cherché dans ces listings
La cote d’Aramco, Sabic, nos stock-holdings,
Car c’était magie noire et science farouche.
Je vis alors un nain à figure de mouche
– Plutôt un serviteur maudit de Bal Zebub,
Idole de grès noir, qu’un honnête Querub –,
Qui semblait consulter je ne sais quelle courbe
D’un indice inconnu, clignant d’un air très fourbe.
Ses gros yeux globuleux, sombrement irisés,
Réticules de grains quartzeux entrecroisés,
Suintaient l’abstraction vide d’un infidèle
Et la méchanceté rare d’un anophèle.
Quand il leva sur moi ces organes hideux,
Je risquai bravement un exorde hasardeux :
« Étranger, quel que soit le but de ta visite,
Tu ne peux sans permis prolonger en ce site
Ton clandestin séjour car c’est contre nos lois,
Nos services n’ayant point reçu les envois
Prescrits dans les délais, ni le mémoire idoine
Avec timbre fiscal pour contreseing en douane
Et l’attestation du double bordereau,
Présent le formulaire autographe au bureau
Des colligements près la chambre des épices,
Ayant posé son sceau la cour des bénéfices.
Fort de ces condensés mais clairs abrègements
Valant de par statut dus éclaircissements,
Veuille donc, étranger, me suivre sans attendre
Pour plus ample examen des mesures à prendre. »
Après ce peu de mots, je me vis au milieu
D’un amas de ces nains, et me remis à Dieu.
Tirant au pistolet dans un globe de verre,
Je parvins à créer un chaos salutaire.
Courant je ne sais où, vif comme l’ouragan,
Tout à coup je glissai le long d’un toboggan
Et chutai dans le noir sur un pouf en matière
Élastique émettant une vague lumière.
Je sentis les cloisons autour de moi trembler,
La pyramide était en train de s’envoler !
Et puis quelle ne fut encore ma surprise,
Le flan gélatineux, mon improbable assise,
Commença de ramper, tel un être vivant.
Une trappe s’ouvrit et dans un coup de vent,
Jetés hors du vaisseau qui s’élevait rapide,
Le pouf et moi dessus tombâmes dans le vide.
Allah est pour les siens miséricordieux :
Je planais sur mon pouf dans la sphère des cieux
Plus que je ne tombais, et nous touchâmes terre
Sains et saufs. Gloire à Lui qui connaît le mystère.
Messieurs, vous savez tout. Nous avons établi
Un institut secret d’étude à Roswali
Où nous nous occupons, afin de le connaître,
Du Blob auquel je dois devant vous de paraître.
*
XXI
L’émir Abdoullah est l’invité du maréchal Amin Bobo
La délégation des bishts noirs et dorés
Du royaume gardien des monuments sacrés,
Sortant des cadillacs aux drapeaux couleur jade
Flottants enluminés dans l’air chaud en cascade,
Agitent les longs plis de leur sombre appareil
Comme un nid de corbeaux s’ébrouant au soleil.
L’émir Abdoullah songe à Djeddah dans la brise.
C’est le fardeau de l’homme au keffiyeh cerise.
Le maréchal Amin, ogresque, colossal,
Rutilant de sueur, ce vernis tropical,
Et son plastron couvert d’innombrables médailles,
Souvenir de non moins abondantes batailles,
Comme une poule avec, la pressant, ses poussins,
Entouré de soldats, séides, spadassins,
Est avec les émirs pour leur faire la grâce
De partager sa table insigne et son palace.
Tyran Amin Bobo, suréminent golgoth,
Est-ce toi qu’on appelle, à Job, le Béhémoth ?
Ô combien d’ennemis t’es-tu mis dans la panse
Pour étaler si belle et bonne corpulence ?
Ton pays tout entier a-t-il assez de bras
Pour soulever ton pied ? Je ne le pense pas.
Un négrillon, ce n’est, pour ta sublime bouche
Et ton grand appétit, guère plus qu’une mouche.
Mais je sais, mon Amin, que tandis que l’émir
Admire en ton château d’ivoire et de saphir,
D’ébène et d’or, les œufs cyclopéens d’autruche,
Les défenses, les peaux, le chat-pard, la guenuche,
Les esclaves, en route – à peine un freluquet
Près de toi, l’éléphant – vers la salle au banquet,
Sous ton air martial, exécutif et roide,
Tu mousses en passant devant la chambre froide.
.
ÉLÉPHANT NOIR
.
XXII
Maréchal, voilà le maître-queux !
Par Hadji Lamouche, poète lauréat
Grand Amin, l’univers est ton œuf, et l’Afrique
Est ton œuf à la coque, et c’est grâce à la trique
Dans ton poing de babouin que le monde va droit,
Grâce à l’engrais des forts que la justice croît.
Tous les diamants bleus que des griffes tu touches
Se changent aussitôt en gluants nids de mouches.
Si tu mettais les pieds dans la source du Nil,
On ne parlerait plus du Caire, peuple vil.
Les femmes, bel Amin, ne peuvent se contraindre
Quand tu roules des yeux : il faut ou les étreindre
Ou les faire punir par tes maîtres d’hôtel.
Qui dira que cela n’est point surnaturel ?
Mais tu sais délecter ton sang, ton oxygène
Par de meilleurs moyens de tendres corps d’ébène.
Il ne te suffit point d’écraser sous ton poids
Des cuisses où fermente un équivoque empois ;
D’où croit-on que te vienne une telle sagesse,
Dépassant ce qu’a vu le monde, dans ta graisse ?
Et qui ne sait les bancs vides des facultés,
Pleine ta chambre froide avec ses voluptés ?
Oui, les meilleurs cerveaux du pays sont, je pense,
Depuis longtemps passés par le fond de ta panse.
– Mon lecteur goûtera ce fin oxymoron :
Ta panse est un abîme et non pas un chaudron. –
Et c’est avec bonheur, non face de carême,
Que je chante aujourd’hui mon tout dernier poème.
Amin Bobo, salut, voilà le maître-queux
Pour trancher dans mon lard croustillant et musqueux.
*
XXIII
Maréchal Bobo, l’éléphant noir
Par un autre poète lauréat
Dieu, dans sa bienfaisance infinie, a voulu
Que tu règnes, aussi prodigue que goulu,
Au principe du Nil, paradis sur la terre,
Grand éléphant d’ébène en habit militaire !
Sois gros ! sois devant nous le vrai Léviathan
Dont parlent les babouins dans leur Kafiristan.
Sois sur le monde un poids énorme, un monolithe,
Pyramide vivante et sphinx hétéroclite.
Sois composé de tout le sang, de tous les nerfs,
De tout le gras, de tous les muscles de nos chairs.
Brise nos os trop secs et suces-en la moelle.
Saisis notre seul bien, nos enfants, à la poêle.
Sois gros ! bois des cocktails de nos gluants cerveaux,
Nous voulons que les plis de ta panse soient beaux,
Que par ta voix nous parle, embelli, le génie
De notre race : sois la sagesse infinie.
Dévore ce qui vit sous ton autorité,
Car nous ne voulons pas d’un totem déjeté.
Aplatis sous ton sac la morgue de nos femmes,
Les singes aux sourcils d’argent sont omnigames,
Et quel meilleur levain que le tien, éléphant
Qui manges la forêt, pour pétrir un enfant ?
Amin Bobo, sois gros, ô sois la corpulence
Incarnée : épandage, énergie, opulence !
*
XXIV
L’éléphant noir des marécages
Par le poète lauréat Jean-Bedel Toto
Grand éléphant Amin, si tu vois l’éléphante
Remuer devant toi sa trompe, alors enfante !
Couvre d’éléphanteaux le limon volatil
Du bocage enchanté sur les sources du Nil.
Tu les verras jouer avec les flamants roses
À les faire s’enfuir comme des vols de roses
Dans le doux crépuscule incarnat des marais.
Tu les verras, prenant sous les palmes le frais,
Vers les chauves-souris tête en bas suspendues,
Dans toute la ramure épaisse répandues,
Lever inquisiteurs leurs trompettes, serrés
L’un contre l’autre et prêts à courir effarés.
Et tu les entendras klaxonner : « Notre père,
Nous louons tes hauts faits d’éléphant militaire.
Apprends-nous à fouler le vulgaire ahuri. »
Même quand tu sais bien qu’un autre est son mari,
Grand éléphant Bobo, si tu vois l’éléphante
Remuer devant toi sa trompe, alors enfante !
*
XXV
Le laurier de la chambre froide
Par le poète lauréat Jean-Bedel Toto
Maréchal éléphant, zébu pharaonique,
Amin Bobo, c’est toi, notre bombe atomique !
Tu fais peur aux toubabs avec tes grosses dents
Et pèses comme vingt de leurs nains présidents.
Ça sent, dans leurs journaux, la miction des chèvres
Quand ils parlent des plis de tes énormes lèvres.
Leurs maîtres sont contrits en voyant ton harem,
En voyant ton pouvoir sans limites idem ;
Nous rions avec toi de leurs mélancolies,
C’est nous qui triomphons quand tu les humilies.
Et ta panse est le terme éternel, sépulcral,
Labyrinthique, ancien, profond, pyramidal,
De nos jours sans valeur, notre nuit de momies.
Pour repousser toujours les forces ennemies,
Nous aimons enrichir ton sang en zinc, en fer,
En tungstène, en titane, alimenter ta chair,
Nous fondre dans le gras de l’union mystique
Éléphantesque, en or tomate hiérophantique.
C’est mon tour, j’ai chanté ta grandeur, tes cheveux
Crépus, ton biceps dur, tes pieds fatals : je veux
Le laurier qui m’attend, pour que ma viande roide
Se parfume à ton goût exquis, la chambre froide !
*
XXVI
Jean-Bedel Toto, poète lauréat, espion
Le maréchal Bobo s’étant calé la panse
Et fait des bons morceaux du poète bombance,
Se sentit ballonné quand un rapport secret
L’informa de l’affront : Jean-Bedel, indiscret,
N’était rien qu’un mouchard, un sale communiste,
Et c’est sans doute encore ironie anarchiste
De sa part s’il s’était laissé glorifié
Par l’État souverain ainsi mystifié
Qui venait d’assurer, pour son apothéose,
Le transfert de sa moelle à la glacière close.
Le malaise d’Amin ne dura cependant
Pas plus que le quartier le moins long d’un instant :
Une éructation le fit tôt disparaître –
Suffit à déloger de ses boyaux le traître.
*
XXVII
Le maréchal Bobo et les femmes
C’est un sujet sensible, on n’ose en murmurer.
Ce torchon qu’est la presse aime se censurer,
Souvent le directeur songe à la chambre froide,
Cela lui rend la nuque usuellement roide
Car il n’espère point, ce clown, l’insigne honneur
D’être jamais – pourtant c’est un beau flagorneur –
Convié comme une huile au banquet délectable,
Si ce n’est dans le plat et très méconnaissable.
D’ailleurs, Fatoumata, sa femme, lui redit :
« À quoi bon remuer tout ça ? Sois érudit,
Un intellectuel qui voit loin, dans la brume,
Ne trempe pas dans l’eau croupissante ta plume,
Ne va point avilir ton stylo compassé. »
En outre, pour Fatou, le bon temps est passé.
Naguère, en son printemps, elle connut la panse
– où sa fière beauté trouvait sa récompense –
Qui dans la terre meuble enfouissait son corps
Sous son poids merveilleux, les sublimes accords
De ses os aplatis, ses hanches démanchées,
Écartelés ses seins et ses bronches bouchées,
Avec l’énorme sac du maréchal Bobo.
C’était comme au palace-hôtel sans lavabo.
Dans la fosse excavée à coups de panse pleine,
C’était voir contenter son rêve d’être reine.
Comment oublierait-elle, ô non ! qu’elle eut un jour
Entre les bras un peu de l’immense contour
De graisse et de replis du Nautonier suprême,
Son levain écumeux à ras bord. Quel poème !
Elle n’oubliera pas. « À quoi bon, directeur,
Colporter des ragots sur notre Dictateur ?
Qu’il fasse son métier avec la compétence
Que nous lui connaissons. Les bruits, quelle importance ? »
*
XXVIII
Un banquet sur le Nil
Le maréchal Bobo qui buvait du zython
Pour arroser le riz au singe et le python,
Le méchoui de zèbre et le couscous d’autruche,
Se rinçait le gosier vidant cruche après cruche,
Quand un de ses jongleurs, pétulant comme un chat,
Tomba dans le Nil blanc au cours d’un entrechat,
Oyant les hurlements du pauvre pour sa vie
Et voyant les crocos, sourit : « Je les envie. »
Ô barde Jean-Bedel, que ce bon mot glaça,
Tu gémis : « Si Joseph Staline voyait ça… »
*
XXIX
Les nuits de Jean-Bedel
Je voudrais vous parler de Jean-Bedel Toto,
Poète lauréat du maréchal Bobo.
Jean-Bedel composait d’hétéroclites odes,
Fruit d’un labeur constant, d’innombrables maraudes,
De rapines sans fin dans les champs grands ouverts
De la littérature occidentale en vers.
Mais son plus grand amour, mais son unique Muse,
Et pour ses plagiats sa véritable excuse
– Car que ne ferait-on par l’amour qui rend fou ? –,
C’était Olivia, noire comme un cachou.
Il disait que son sort, des lundis aux dimanches,
Était entre ses mains dont les paumes sont blanches.
Olivia, le Nil blanc, clair et transparent,
Enveloppe ton col nu, noir et sidérant,
L’entendait-on encore halluciner, fébrile,
Et cela ne manquait en somme pas de style.
Las ! Pauvre Jean-Bedel ! Frivole Olivia,
Par ta faute un rêveur dans Engels s’oublia,
Un poète, vaincu par ton immoralisme,
Expia son amour dans le fauve marxisme.
Car, en sortant du Nil avec ton domino,
Tu reçus les baisers du maréchal Bobo.
*
XXX
Maréchal Bobo Bombe
Par le poète lauréat Abdoulie Jallow
Quand tu lèves la main pour saluer ta race,
C’est comme un récepteur aiguillé vers l’espace,
Une antenne-relais qui diffuse sur nous
Les lasers des novas traversant nos boubous,
Ô maréchal Amin, la force des étoiles !
Sur l’estrade géante, à tes fils tu dévoiles
Les mystères du ciel et du temps, des volcans,
Du Nil bleu, du nickel, du sang, des diamants,
Du pétrole et du gaz qui sous terre bouillonnent
Dans les gouffres des djinns où leurs flots tourbillonnent
Et qui font des geysers de feu sur l’océan
Dont je ne sais quel diable est l’étrange artisan.
Nous saluons l’émir Abdoullah, ton convive,
Au thobé très seyant, au bisht élégant : Vive
Le maréchal Bobo, qui nous fait des amis
Chez les peuples les plus fiers, libres, insoumis !
Quand tu brandis le poing contre le diabolisme
Inique et répugnant de l’impérialisme†,
Quand tu montres les dents aux tortueux vautours,
Ils retournent glacés aux cailloux de leurs tours
Dans les nuages noirs, mais ton poing est la bombe
Qui fera de ces nids jonchés d’os une tombe.
Face aux Zorros haineux ton ventre triomphal
Est notre bastion. Vive le Maréchal !
†Le poète lauréat Abdoulie Jallow souhaite apporter la précision suivante au sujet de la diphtongue dans les mots diabolisme et impérialisme. Dans ce dernier mot, la diphtongue « ia » est une diérèse (comptée deux syllabes), conformément à la règle la plus classique. Dans diabolisme, Abdoulie a voulu suivre l’exemple du mot diable, dont il dérive et où, par exception, la diphtongue est une synérèse (comptée une syllabe). Le mot diable apparaît au vers 12 et se compte, selon l’exception elle-même classique, deux syllabes (dia-ble) ; en comptant une synérèse dans diabolisme comme dans son mot-racine diable, Abdoulie est conscient de faire un choix audacieux ; il espère que cela contribuera sans tarder à lui faire une réputation d’innovateur.
*
XXXI
Ma négritude
Elle ne cache pas son jeu, ma négritude.
C’est l’autre nom que porte ici ma solitude.
On m’appelle négro, je dis : spiritual !
On me dit : la forêt ! je dis : le Maréchal !
Là-bas au paradis, au ciel, nous serons frères,
Ici je ne dois rien aux faux humanitaires.
Je parle au « négrophone », on est habitué :
Bonjour, le numéro n’est pas attribué.
Vous trouvez mon propos un peu trop didactique,
Ma révolution pas assez extatique ?
Allô, monsieur, pardon mais qui demandez-vous ?
Le singe est dans son arbre, avez-vous rendez-vous ?
Il ne peut recevoir qu’avec un bon prétexte,
Peaufinez bien le ton enjoué dans le texte.
Ta négritude est belge, ô mon vieux Léopold,
Et ton nom, d’un vieux roi qui m’étiquette : Sold.
Ma négritude à moi, le poète Abdoulie
Jallow, sans général d’opérette accomplie,
Va repasser l’histoire au charbon qui noircit :
C’est l’histoire du singe à qui tout réussit.
*
XXXII
La coupe de zython
Par Adboulie Jallow
Je te lève, ma coupe, aux bords sombres du Styx.
Pour que je vive encore il n’existe aucun ptyx.
Aux jeux de l’Hélicon se pressent les trouvères,
Parmi lesquels, hélas, beaucoup de pauvres hères.
Nul Boileau, de nos jours, pour siffler ces marauds,
Dont personne n’entend les cantiques lourdauds ;
On ne peut abaisser ce qui rampe sur terre
Dans le trou dont il est fondé propriétaire.
Ils vivent malheureux et cependant cachés,
Dans un anonymat dont ils sont très fâchés.
Mais que Victor Hugo pût siffler ce grand maître,
C’est une balourdise à ne point s’en remettre.
Si l’on veut juger bien de son discernement,
Ce sifflet dit l’absence, et surabondamment.
Sa force, qu’il osa croire contemplative,
Fut grande pour un clown mais pour penser chétive.
Voilà ce qu’attendant Charon je dis : Victor,
Boileau fut génial et toi, Hugo, butor.
Et je lève ma coupe à la belle mémoire
Du poète où cueillit notre verbe sa gloire.
Qu’un paillasse lui plaigne un jargon ampoulé
Indique la curure où ce drôle a roulé.
Qu’il dénigre l’« ancien » parce qu’il est « moderne »,
C’est le fiel attendu d’une vieille baderne.
Je t’ai vengé, Boileau ! Content, je peux mourir.
Ce poème plaira, j’en suis sûr, à l’émir.
*
XXXIII
Poète dont le nom est Abdouli Jallow,
Que ton chant à la bouche, ainsi qu’un chamallow,
Soit moelleux, délicat, fondant, mielleux et rose,
Et que Fatou l’entende en baisant une rose.
Poète dont le nom est Jallow Abdouli,
Que ton chant soit pour l’œil comme de la jelly,
Transparent, opalin, miroitant, diaphane,
Fatou l’écoutera mangeant une banane.
.
JE BAISE LES PIEDS DE LA PALESTINE ET AUTRES POÈMES
XXXIV
Je baise les pieds de la Palestine
En un siècle sali, nauséabond, infâme,
Rien ne saurait donner au dégoût de mon âme
Plus grand apaisement que ce baiser contrit.
Et tant mieux si le fou dans sa bêtise rit,
Si me tournent le dos les grandeurs irritées,
Si le fiel se répand de biles dépitées,
Tant mieux si l’injustice inhumaine, aux abois,
Abuse de sa force en profanant les lois :
Je baiserai ces pieds, baiserai leur poussière,
Je lave mes péchés dans ce baiser sincère.
Je dis : Gloire aux martyrs de ce siècle odieux,
Ils gagnent en souffrant le royaume des cieux.
Gloire au martyr debout face à l’ignoble outrage,
Tout éclat, au soleil de son sang, est mirage.
Et tel qui croit gagner lâchement, a perdu,
Son néant par le sang des martyrs confondu.
Je baise la poussière et gagne l’or des justes,
Je baise avec respect tes blessures augustes.
Palestine martyre, enfant des oliviers,
En ce monde je baise humilié tes pieds.
*
XXXV
Intifada
Contre les chars blindés et l’escadron vampire,
Ton sang se fait cailloux, Palestine martyre,
Et ta poussière monte au ciel comme un drapeau
Fait de tes ossements épars et de ta peau ;
Ton sang se fait cailloux, l’occupant pétrophage,
Et l’olivier tombé, dans les méandres nage
Des larmes que n’ont plus les yeux de tes enfants.
Ton sang vole, ababil narguant les éléphants,
Ton sang crie à l’assaut sur les murs des ruines
Et ton sang marche droit sur un chemin de mines.
Ton sang ne coule pas : dans le jardin rasé
La terre ne boit plus, le nuage est brisé.
Ce caillou blanc, cristal de larmes héroïques,
Poème fulminant que jamais tu n’abdiques,
C’est un bourgeon de fleur poussé dans un charnier,
Le pigeon qui retourne à l’eau du colombier,
Et c’est le chant d’amour du sang pour ses racines
Lancé sur la terreur des balles assassines.
Ce caillou, c’est ton sang fait pluie et chant fécond,
C’est la clef de la porte oscillant sur un gond
Dans le pré qui n’est plus qu’un trou, qu’un cimetière,
C’est ton sang fait tempête, éclatante lumière.
Ce caillou, cette pierre aveugle, est la beauté
Qui montre à l’univers ce qu’est l’Humanité.
De ce germe semé par ton cri, Palestine,
Graine persécutée, immense, clandestine,
Naîtront sur ces déblais de nouvelles moissons,
De nouveaux oliviers, de plus belles chansons.
*
XXXVI
Territoires occupés, ou Le haillon de sang
Les soldats, bons robots, font le travail des flics,
Les flics font le travail, mais en étant moins chics,
Des muets croque-morts, et ce métier là-bas,
Pour le gouvernement du moins, n’existe pas
Car personne ne meurt en terres occupées.
Où les prisons high-tech sont des villas huppées
– On y retrouve goût à la vie, à l’amour –,
Où les fils barbelés que l’on a mis autour
Servent à retenir chiens et chats domestiques
Mais surtout à garder au dehors les moustiques,
Oui, ce lacis crochu par tant de sang rouillé,
De snipers, miradors, projecteurs émaillé,
Est une moustiquaire immense et géniale,
Un cadeau pour montrer l’amitié spéciale
Liant à l’habitant primitif son docteur,
Expert en psychotisme et malaises du cœur.
Territoire occupé, paradis sur la terre !
On entend bien parfois le mot « sécuritaire »,
C’est, je pense, une erreur de la traduction :
Il ne s’agit ici que de compassion
Et d’amour du prochain par relais satellite,
Vidéosurveillance et mitrailleurs d’élite,
Actroïdes, cyborgs députés, couvre-feu,
Check-points, état d’urgence, intox, espions, jeu
De guerre, électrochocs, colons, loi martiale,
Censure, bulldozers et guerre spatiale,
Assassinats ciblés et massacres gratuits†,
Des hectares de champs et de vergers détruits,
Une terre indomptable à ses bourreaux livrée
Qui jure d’être un jour de ses maux libérée.
Palestine au cœur haut, du sang de ta douleur
Tu te fais un haillon et couvres ta pudeur.
†Voyez les rapports de l’ONU.
*
XXXVII
La belle Ahed
Parce que les jasmins sur ton cœur ont saigné,
Ton doigt contre la bombe atomique a gagné.
L’astronaute foulant les cailloux de Naplouse
A grimacé devant ta faconde andalouse.
Les maréchaux d’empire, angoissés par tes yeux,
Ont envoyé des taons zigzaguer dans les cieux.
Les cyborgs entraînés à la guerre d’usure
Prennent peur quand le vent touche ta chevelure.
Les éléphants d’acier, en criant « Ababil ! »,
Ont voulu se jeter effrayés dans le Nil.
Le bulldozer sanglant a revomi sa proie
Et s’est souillé, craignant que ton poing ne le broie.
Le Mur a dit au ciel : « Envoie un ouragan
Avant que me détruise Ahed d’un rude vlan ! »
Les snipers étendus, sinueuses vipères,
N’ont pu que s’enfouir dans leurs viles ornières.
Parce que les jasmins sur ton cœur ont saigné,
Ton doigt contre la bombe atomique a gagné.
Ahed, ô belle enfant de la terre martyre,
Accepte cet hommage et lyrique délire.
Moi, ce pauvre poète où saigne le jasmin,
Aux souverains martyrs je demande ta main.
*
XXXVIII
Intifada 2
Prends ce caillou bien dur dans les dents, sale tank.
Va pleurer au guichet de la Goldman Sachs Bank
Et ne reviens qu’avec des mégatonnes d’armes,
Supersoniques jets, bombes, robots gendarmes,
L’Oncle Sam en inox pour ta sécurité,
Tous les brevets du monde en destructivité,
La bénédiction de Wall Street à la hausse,
Sinon tu finiras le nez dans une fosse.
Va pleurer tout ton saoul devant tout parlement
Pour qu’ils votent des lois brisant virilement
Notre haine antichar, ou sinon tes oreilles
Siffleront jour et nuit comme un essaim d’abeilles.
C’est bien d’avoir beaucoup d’avions rutilants
Mais mieux vaut empêcher les discours trop cinglants.
Et toi, le bulldozer à la gueule flétrie,
La terre est devenue une Rachel Corrie
Sur laquelle tu cours comme un vil puceron.
Tu submerges les morts et le sang de goudron,
Et les courts de tennis sont un grand cimetière,
La balle rebondit sur la blanche poussière
Des crânes concassés, broyés d’enfants martyrs.
On entend dans le vent des jardins leurs soupirs.
Ton rire cache mal, si jaune, les tortures
Qui couvrent ton État comme un dépôt d’ordures.
Et toi, le satellite, orbitant œil de lynx,
Va requérir d’E.T. les mystères du Sphinx !
*
XXXIX
Asmaa
Asmaa, je vais te lire : ô ne me déçois pas !
J’aurai pour déchiffrer le sens de tes combats
Un masque étanche ainsi qu’une paire de palmes
Et j’irai près des rocs bercés par les vents calmes
Pour contempler le fond de la mer en nageant.
Les étoiles d’onyx et les oursins d’argent,
Les poissons colorés et les blancs coquillages
Me subjugueront-ils plus que du bord des plages
Quand, seul et suspendu sur le hallier brillant,
Je laisserai chanter leur silence accueillant ?
Asmaa, pour deviner ton ire, quelles larmes
Par toi vais-je verser, moi qui voudrais des armes
Pour empêcher la nuit de cacher ta douleur,
Asmaa, car il faudrait qu’ils s’enlèvent le cœur
Pour vivre en te voyant couverte de ténèbres,
Et c’est le cœur qui tient ensemble les vertèbres.
Qu’ils se bouchent les yeux, qu’ils vivent sans te voir,
C’est tout ce qui pourra leur donner le pouvoir
Sur la terre qui boit ton sang par tant de plaies
Et les étouffera dans ses oliveraies
Désertes, où murmure un fantôme glacé,
Sauvages, où la main d’Astaroth a passé,
La terre qui te boit comme un vin qui l’enivre,
Marécage de sang où lasse tu dois vivre.
Tu seras de ces eaux mortes le feu-follet,
Un phare sur le Styx et dans le serpolet.
Que l’on ne dise pas que cette ombre de terre
Est un grand casino, car c’est un cimetière.
Asmaa, quelle clef d’or pour déchiffrer ton ire ?
Quelle clef ? Quelle épée ? Asmaa, je vais te lire…
*
XL
Mon Asmaa
Asmaa, si tu lisais les mots de ma folie,
Si tu voyais ton nom dans ma tête abolie,
Tu saurais que la terre où se posent tes yeux
A pour elle une place – un trône – dans les cieux.
Tu vivais avant toi sur une terre ailée ;
Quand d’autres l’ont voulue, elle s’est écroulée.
Tu vivais comme un arbre avec tes longs cheveux
Dans le vent, tu vivais comme l’eau dans le creux
De la main, vivais-tu comme l’oiseau qui chante
Et puis meurt enfermé dans une main méchante ?
Tu vivais sur la terre aux reflets de ciel bleu,
Dans le miroir du vent, des nuages, de Dieu,
Sur le flanc d’une mer toute circonférence
Qui te tendait les bras de son aimant silence.
L’ombre des oliviers t’abritait de ses fleurs.
Fenêtres aux carreaux de toutes les couleurs,
À toi venaient les nuits de roses effeuillées
Sous les étoiles d’or au ciel éparpillées.
Asmaa, tu n’as aimé qu’en rêve, ton amour
S’est envolé sans bruit avant le point du jour,
Apprends de son départ qu’à ton seuil est la peste.
Ton amour est parti sans demander son reste,
Avec la clef des champs dans son bec ; chère Asmaa,
Ce rêve sans espoir, sans fin est un coma,
Tu ne vis point, tu crois pousser avec les heures
Que ton cœur te redit mais en fait tu demeures
Prise en cette statue au regard effacé
Dont le soleil en vain touche le front glacé.
Car comment vivrais-tu quand tes faibles racines
N’ont plus où s’enfoncer que trappes assassines ?
Comme ils ont pris la terre à tes pieds, et tu vas
Dans le vide où jamais tu ne te retrouvas.
*
XLI
La revanche des agomphes
Agomphe : (Zoologie) Dépourvu de dents. Épithète appliquée par Christian Gottfried Ehrenberg aux infusoires rotifères dont les mâchoires sont dépourvues de dents.
Du haut de votre sens bureaucratique et fat
Vomi de Belzébuth – de peur qu’il n’étouffât
On lui fit expulser cette vile immondice
De son gosier puant : vous fûtes le calice –,
Vous avez contemplé d’un œil incompétent
Ce siècle et décrété bigrement important
Qu’admirent ébahis la tourbe des agomphes,
Sur leurs droits piétinés, vos vulgaires triomphes.
Et vous voilà céans arbitres du bon goût.
Vous dont ne voudrait point le ruisseau de l’égout,
Tout rampe agenouillé devant vos borborygmes,
Vos gris gargouillements d’estomac, paradigmes
Que de graves penseurs colligent en traités ;
Tout ce qui parle dit à vos acidités
Un oui tonitruant de grasse mouche bleue,
Qu’on sert en haut-parleurs aux morts de banlieue.
Il est écrit qu’un jour les morts se lèveront ;
Ce jour-là les sans-dents aphones rêveront
Qu’un dentier est possible, et ce non point pour mordre
Mais pour être compris. Quel angoissant désordre
Quand on aura cessé de cuider que vos vents
Sont un esprit subtil !
– Quels peuples décevants,
Qui ne veulent plus être otages de nos urnes,
Les gueux, les malappris, les sans-dents, les sans-b*** !
*
XLII
Distiques 1
Quand plane l’esprit l’homme en bas va tituber
Ne prends cet escalier que si tu veux tomber
Ce n’est pas un bon jour mais demain sera pire
Ne demande pas trop d’éclat à ton sourire
Quand tu veux vers le ciel infini faire un bond
Tu tombes en toi-même et ce n’est pas profond
Dans ton jardin durcit ses épines la rose
C’est le sang de ta main rien d’autre qui l’arrose
Quand tu te fais bien mal imagine un passant
Qui le voit pour qu’au moins ce soit divertissant
Je tire mon chapeau claque à tous les poètes
Qui firent bon ménage avec de fortes têtes
*
XLIII
Vous qui toujours avez un goût de chère en bouche,
Que voulez-vous de moi ?
Que voulez-vous qu’un homme énonce qui vous touche,
Vous dont le ventre est roi ?
Gardez pour les mignons que votre panse admire
Ces lauriers dans vos mains :
Nous n’avons, eux et moi portant la même lyre,
Pas les mêmes chemins.
Gardez pour vos amis efféminés et lâches
Vos flétrissants lauriers
Ou couvrez-en le front docile de vos vaches,
Ils seront oubliés.
Je vais seul et n’ai point besoin de vos lumières
Pour assurer mes pas.
Je ne veux point avoir de part en vos affaires,
Je ne vous aime pas.
*
XLIV
Distiques 2
Devant la porte close à quoi bon te parler
C’est un mauvais miroir et mieux vaut s’en aller
Dès lors que l’on ne meurt d’un amour noble et triste
C’est qu’on en redemande et qu’on est masochiste
Pour ne plus jamais voir chez nous un dictateur
La moitié des Français sont des flics ça fait peur
Au jardin je voulus te cueillir une rose
Mais j’en fus détourné par une théraphose
Je parle dans le noir te pensant près de moi
J’allume et ton squelette a l’air tout en émoi
Si l’hyène voyait ta cruauté hideuse
Elle perdrait bientôt le beau nom de rieuse
Le seul petit problème avec le grand amour
Mais le seul c’est qu’il manque entièrement d’humour
Quel bonheur de t’avoir aimée et puis quittée
Vivre avec moi t’aurait tellement contristée
Ce grand esprit a dit à son fils un vaurien
Qu’on peut se marier sans renoncer à rien
L’étrange passion le singulier orage
Quand on se dit que c’est pour former un ménage
*
XLV
Je suis venue au point du jour te démunir
De tout ce qui pouvait cet amour désunir
Je te suis revenue ainsi qu’une colombe
Qui retourne au boulin alors que la nuit tombe
Je suis devenue oie et vole dans le ciel
Car j’entends des ardents rivages ton appel
Je me sais bienvenue au jardin de la source
Où tu captes l’eau fraîche au milieu de sa course
Je ne suis contenue en aucun parchemin
Et je vais avec toi jusqu’au bout du chemin
Je suis tenue et toi dans mes bras tu te laisses
Aimer par mes baisers aimer par mes caresses
Ô je suis retenue au sommet de l’azur
En tes mains retiens-moi car le sol est si dur
Comme je m’insinue en racines et sève
Jusqu’à cette oasis que cache notre rêve
Je vais t’être connue en ce que tu renais
Du feu que dans ton cœur si grand je reconnais
Ma joie est si complète et forte et continue
Je suis à toi je suis à toi seul JE SUIS NUE
*
XLVI
Le paon ingrat
Comment donc vivrais-tu, séduisant volatile,
Amorti pesamment par ta roue inutile
Qui doit son merveilleux au goût exagéré
Des paonnes pour le luxe et l’art dégénéré,
Si nous ne te gardions en nos jardins paisibles,
Aux sanglants prédateurs scellés, inaccessibles ?
C’est donc bien plutôt nous et notre amour du beau
Qui sommes le jouet de ton charme d’oiseau :
C’est à nous que tu tends tes joyaux, tes ocelles,
Tes plumes de lapis-lazulis en ombelles,
Pour que nous t’enclosions parmi nos doux loisirs
Avec paonne et paonneaux comblant tous tes désirs.
Mais toi, plumeux bellâtre ingrat, emmi les treilles
Pavané, tu te ris de nos pauvres oreilles
Et, tout en fascinant nos yeux de ton azur,
Tu lances le brocard railleur de ton cri dur.
*
XLVII
À Lucy, la première femme
Si c’est toi la première femme,
Ta mère était une guenon ;
Toi, tu possédais donc une âme,
Mais ta mère, la pauvre, non.
Elle ne put jamais comprendre
Pourquoi tu lui parlais de Dieu
Et puis de recueillir sa cendre,
Ayant imaginé le feu.
Comme c’était toi la première,
Il commit une impiété,
Ton stéatopyge derrière,
Car c’était bestialité :
Étant seule de ton espèce,
Tu ne pouvais avoir d’époux.
Un mâle à la fourrure épaisse
Te couvrit pourtant de ses poux.
Tu le trouvas abominable,
Pourtant tu prodiguas des soins
À l’enfant tombé dans le sable
Depuis tes viscères disjoints.
Lucy, comme il avait pour mère
Une femme, ton bambin blond
Sut vous sortir de la misère,
Te mit sur la tête un plafond.
Quels jours heureux quand à la chasse
De son fusil il tuait tout.
Tu pris du gras. Mais le temps passe,
Un jour notre corps se dissout :
Comme toi, ton enfant prodige
N’avait en ce monde d’égal ;
Il prit pour épouse une stryge
Et fut un père très banal.
Hélas, Lucy, fervente mère,
La première femme tu fus
Et fatalement la dernière.
Qui pourrait n’en être confus ?
*
XLVIII
Le putride Occident veut celer ses poisons
Sous un exosquelette en fils électroniques ;
Il meurt asphyxié dans ses exhalaisons
En écrasant le monde avec des poings iniques.
*
XLIX
À l’inconnue
À la fin de l’été, dans, je crois bien, Narbonne,
À moins que ce ne fût peut-être à Carcassonne,
De retour de la mer où ma famille et moi
Avions passé des jours légers d’oubli de soi,
Nous marchions, moi pensif, à l’ombre des platanes,
Quand la plus belle alors, la perle des sultanes,
Sans voile tu passas ; ce souvenir si clair,
Je le garde aussi beau que si c’était hier.
Tu passais, toi que j’aime, et nos yeux se trouvèrent,
Et mes yeux, toi passée, épris me désespèrent
Toujours trente ans plus tard ; je n’ai pas oublié
Et ne me suis jamais, pauvre fou, marié.
*
L
Butor Hugo
Je serai bref. Butor, tu n’as aucun humour.
Et Despréaux en a trop pour faire la cour ;
S’il essaye, pour voir, sa belle dulcinée,
Couverte par un flot de bons mots, consternée,
Sent pâlir son éclat auprès de cet esprit
Qui loin de vénérer semble se jouer, rit
Et fleuretant compose une satire encore,
Si bien que le moment de dire qu’il adore,
Bien forcé, se conclut par un cuisant soufflet.
Et c’est pour le poète un fiasco complet.
Or toi, Hugo, tu viens accabler son génie ?
Mépriser ce colosse est de la vésanie :
Tu pris un ton douteux pour abattre un géant
Mais il se porte bien, qu’en dis-tu maintenant ?
Tu lui dois le stylet dont tu voulus l’occire,
Avec Pradon ligué, Quinault, quelque autre sbire :
Il faut donc ajouter au pitoyable index
Des Panites perdus ton nom –oui, Dura lex
Sed lex, Butor Hugo, vieille et funeste souche–,
Et cela quoi qu’en dise –ou pas– l’ombre de bouche !
*
LI
Le muet du sérail
Comme une gourgandine abjecte emperlousée,
Ce triste faquin va la panse punaisée
De frivoles rubans : Pour quels hauts faits, dit-on,
Pense être distingué cet obscur avorton
Exhibant si flagrant insigne de bassesse ?
Il a vendu, muet toujours, son droit d’aînesse
Contre un vulgaire plat de lentilles sans goût
Et porte l’appareil de sa honte partout
Tel un dandy raté qui ne verrait la tache
De son plastron, le bout de gras sur sa moustache,
S’imaginant permis de tout prendre de haut
Pour avoir bien soufflé sur le potage chaud
D’un plus maraud que lui. Le moindre esprit qui passe
Voit là ce qui périt sans conserver de trace.
Mais le faquin ricane : « On a besoin d’appuis ;
L’esprit va, sans rubans, au-devant des ennuis,
Sur sa poitrine nue on sent que l’arbitraire
Veut claquer à grands coups de knout judiciaire,
Et, même si l’on hait ce clinquant attirail,
On ne peut mépriser le muet du sérail. »
*
LII
Il faut savoir finir un amour éternel
Il faut savoir finir un amour éternel
Pour fumer son cigare au goût impersonnel
Et trouver à ce monde un peu de sens pratique,
Faire bonne figure au miroir apathique
Pour aux cartes jouer l’insondable chagrin
Et gagner un ulcère aigu de mandarin,
Pour perdre à la roulette, enlisé dans un bouge,
Son âme au désespoir en misant sur le rouge
Quand on aurait voulu tout miser sur le noir,
Pour cacher ce malheur que l’on ne saurait voir
En portant un smoking fané sur un cilice,
Et pour, le poing cassé, vouloir entrer en lice :
Triomphe, ô l’invalide armé de pied en cap,
Au Barnum où ton pied lève à tous un hanap !
Il faut savoir finir une sotte amourette.
– L’amour ne meurt jamais, c’est toi qui meurs, poète.
*
LIII
La microcéphale
Casting partiel du film Freaks (La monstrueuse parade) de Tod Browning : sont assises sur les marches de la roulotte Zip et Flip, deux sœurs microcéphales américaines, dont c’étaient là les noms de scène au temps des freak shows. Je pense que c’est le visage de Zip que j’ai entouré, et c’est de ce sourire que je parle. Zip était l’aînée des deux, d’une douzaine d’années, croit-on savoir (mais l’histoire ne connaît pas la date exacte de la naissance de Flip).
Ton souris enfantin, chère microcéphale,
Me rappelle quelqu’un : une femme fatale
Dont je fus la victime et qui fait son malheur,
Ne pouvant accuser un bon mot sans douleur.
Enfant unique, un rien la transportait hors d’elle.
En elle rien n’était si vrai que le faux, quelle
Tristesse ! Et le départ du père avait laissé
Dans son âme ombrageuse un orage blessé,
Une haine de l’homme au fond de sa tendresse,
Un désir de stylet dans la moindre caresse.
C’est pourquoi lui venaient, faciles, les serments :
D’autant plus emportés que simples boniments.
Mais j’étais trop au fait pour cuider sans réserve,
Et découvrant le peu de fruit de cette verve,
Sa chaleur excitait en retour le dépit
Dont s’aigrissait son cœur, par l’humeur décrépit.
Abandonnée aux soins d’une mère débile,
Elle avait vu navrer ses rets d’enfant habile
L’objet d’un sentiment innocent et profond.
Au tragique parfois le sordide répond :
L’homme veut en partant les jeter sur la paille,
Un ignoble procès change en gouffre la faille.
Elle entrait dans le monde avec des rêves morts.
Elle chercha quelqu’un pour redresser les torts,
Un chevalier servant champion de sa Dame,
Qu’elle aurait adoré comme aucune autre femme.
Mais un oiseau pareil, cela n’existe plus,
Elle fut un fléau pour les heureux élus.
J’aurais pu, quant à moi qui rédige ces lignes,
Sur le berceau de qui se montrèrent des signes,
Stopper cette spirale, avec un parchemin ;
Encore eût-il fallu qu’elle donnât sa main.
Mais au lieu de chercher à dissiper mes doutes,
Elle voulut briser sa lance dans des joutes,
Comme si je devais accueillir sous mon toit
Un concurrent plutôt qu’un appui ferme et droit.
Aux temps de décadence implacable, de cendre,
Non, Adam et Hawa ne peuvent pas s’entendre.
Les femmes, ces sans-cœur, pour un plat de faux cils
Se sont payé nos droits d’aînesse et droits virils.
En ce Kali-Yuga de millions d’années,
À nous faire souffrir elles sont condamnées.
*
LIV
Repousse loin de toi cette charge maudite
Où des sots se complaît la vanité séduite.
Le coût de cet éclat est pour l’âme trop cher,
À ce piteux orgueil s’abaisse un esprit fier.
Tu n’as jamais reçu de cette panoplie
Qu’incurable dégoût et que mélancolie,
Et même un sentiment cuisant d’indignité,
D’être au-dessous de toi dans cette gravité.
.
FIN
Le zircon et le nard : Poèmes
En préface de mon précédent recueil, La Lune de zircon, j’expliquai la nécessaire présence du mot « zircon » dans le titre, laissant par ailleurs entendre que cet emploi, s’il restait isolé, pourrait n’être pas suffisant pour le but surnaturel que je poursuivais de cette manière. Ce pressentiment encore obscur est devenu depuis une certitude lancinante et je n’avais donc d’autre choix que de faire usage du même talisman, autrement injustifiable, pour le présent livre.
Florent Boucharel
octobre 2021
Ô Lune sur La Mecque !
Jules Laforgue
Gidá se chama o porto, aonde o trato
De todo o Roxo Mar mais florecia,
De que tinha proveito grande e grato
O Soldão que esse Reino possuía.
Os Lusíadas, IX, 3
La traduction française par Hyacinthe Garin, de 1889, des citations des Lusiades de Camões (Camoëns) émaillant le texte (ci-dessus et au chapitre 2) est donnée en annexe (dans la partie Commentaires du présent billet).
Table des matières
- Journal de Layla Zirgoun
- Les Lusiadoïdes
- Giallissimo
- Le nouveau magistrat d’Oz
- Reliquat (1991-1992)
- À suivre
JOURNAL DE LAYLA ZIRGOUN
I
La romance au téléphone d’or
Décroche, ô mon émir, ton téléphone en or…
Dans mon salwar kamiz indigo de tussor,
Seule, je me languis de ton bisht amarante ;
Tenant contre ma bouche une fleur odorante,
Je rêve à ton visage et mon cœur, mon cœur bat
Si fort, si vite, quel impétueux combat,
Tendre et silencieux, quel tumulte rebelle
Dans mon sein soulevé qui te veut, qui t’appelle
Avec moi dans l’alcôve ouverte sur le soir
De palmes du jardin, comme un grand encensoir
Dulcifiant le ciel de fraîcheur vespérale,
Où le bulbul caché de sa gorge d’opale
Tire des sons divins qui charment ma langueur.
Quand la cane parfois lance son cri moqueur
De la mare aux joncs clairs, un instant d’hébétude
Me fait penser qu’elle a vent de ma solitude,
Allô ?
– Madame, ici Brahim. Le maître dort :
Méchoui copieux. Je lui ferai rapport.
*
II
Mon émir adoré, blanc comme une colombe,
Si sur ton bisht soyeux de mon œil fermé tombe
Une larme en silence et mon cœur a frémi,
C’est que je suis heureuse avec toi pour ami.
Ton keffiyeh m’a prise en un feston d’étoiles,
Je pleure de bonheur quand tu m’ôtes mes voiles,
Et Dieu t’a pardonné ton sourire, le jour
Où tu me pris mon cœur, car tu donnes l’amour.
Pleine ô pleine est la Lune et mon cœur, plein de joie,
J’aime ô j’aime l’émir qui dans ses bras me ploie
Et son baiser si doux que j’en perds la raison
Et touche des cheveux et des mains l’horizon.
Mon ami, ce bonheur, cette ivresse inouïe,
C’est trop, c’est beaucoup trop, je suis évanouie.
Ô je t’aime, et suis folle, et toujours tu seras
Mon ami : si j’ai peur, tu me conforteras,
Si mes pas dans la nuit ou les sables s’égarent,
Tu me retrouveras où les bateaux s’amarrent,
Au port où je veux vivre avec toi ce bonheur
De vivre en ne faisant qu’une âme, qu’un seul cœur.
Mon émir, que je t’aime ! Ô laisse, laisse encore
Mes larmes de bonheur couler, jusqu’à l’aurore.
Jamais plus je n’aurai de peur, tu seras là,
Mon rempart, mon trésor, mon bonheur : Abdoullah !
*
III
Que je t’aime, Abdoullah, mon ami, que je t’aime…
Ami, je t’aime tant, et j’ai lu ton poème
En pleurant, Abdoullah, de joie et de bonheur.
Il ne me reste plus de larmes dans le cœur,
Je n’ai plus de sanglots pour les chagrins, la peine,
Ni pour l’aversion, la colère ou la haine,
Je n’ai plus, Abdoullah, que des larmes d’amour :
C’est la rosée, attar des fleurs, au point du jour.
*
IV
Abdoullah, mon amour, la nuit est claire, est douce,
La dune sous la Lune est belle, pâle et rousse,
La brise fait chanter les palmes du jardin.
Pardonne-moi ce jour morose et mon dédain ;
Je ne le vois que trop, quand le rossignol chante,
Que je fus avec toi froide, ô presque méchante,
Te disant : « Tu le veux, eh bien tu m’attendras. »
Abdoullah, je ferai tout ce que tu voudras.
*
V
Abdoullah, que veux-tu, les femmes sont ainsi,
Je t’ai causé ce soir des chagrins, du souci,
J’ai repoussé l’hommage instant de ta caresse
Et renié les mots si doux de ma tendresse.
Tu trouves que mon blâme était trop vigoureux :
Ne m’en accuse pas et nous serons heureux.
Abdoullah, pauvre ami, ne fais pas cette tête !
Voici mes mains, prends-les, baise-les, fais-moi fête.
*
VI
Abdoullah, ça suffit, ô je regrette tout !
Je ne te connais plus, tu me pousses à bout,
La bave de tes mots me blesse, m’humilie,
Ma tendresse jamais ne sera plus salie,
Attends un peu que j’aille ameuter tout Paris
Sur ce qu’à ma vertu fait subir ton mépris.
Quelle âme de crapaud ! Comment, à la colombe
Qui de son vol léger ta bassesse surplombe,
Oses-tu proférer ces… Tu dis ? De l’humour ?
Tu payes de sarcasme et de fiel un amour
Duquel tu ne pourras jamais te montrer digne !
Adieu. Quand tu seras plus sage, fais-moi signe.
*
VII
L’Alhambra peut attendre
L’Alhambra peut attendre, indolent en ses tours :
Mon Abdoullah, je t’aime et t’aimerai toujours.
Je ne sais ce qu’ont dit les sages de Cordoue,
Je veux juste garder ta main contre ma joue.
Kaboul est en ce jour un jardin taliban,
Moi je chante pour toi les cèdres du Liban.
– Or si les Talibans sont un peu fanatiques,
C’est pour mieux exploser les chars des Soviétiques.
Les Talibans en Chine ont un air compassé,
Leurs hôtes solennels sont de cuir damassé…
– Abdoullah, c’est ainsi que tu contes fleurette ?
– L’Amour est Taliban : lancé, rien ne l’arrête !
*
VIII
Les femmes de ta vie, Abdoullah précieux,
Ces femmes, je voudrais leur arracher les yeux,
Les voir supplicier par Brahim, ton eunuque,
Balayer les débris de leur beauté caduque
Sur le sol tout poisseux que souille le sang, noir
Comme leurs cœurs vénaux, et voir le désespoir
Se muer en horreur dans leur lente agonie.
Cela me donnerait une joie infinie.
Tu fronces les sourcils ? Comment oses-tu, chien !
Quel amour est plus grand et plus beau que le mien ?
*
IX
Ô Dieu clément, unique, écoute ma prière.
Abdoullah m’humilie, abats cette âme fière,
Écrase son orgueil de fou vindicatif,
Aplatis sous ton pied cet insecte nocif,
Je veux le voir pleurer devant moi plein de honte,
Qu’il dise : « Ainsi périt le méchant qui t’affronte,
De prince me voilà tributaire à présent,
Affermis sur mon cou ton joug dur et pesant »,
Ou je crains que ne passe – à moins que je n’en meure –
Zaïnab, ma servante, un très mauvais quart d’heure.
*
X
Ta caresse de fou s’est convertie en crasse,
Cesse de voir en moi la source de ta race…
Je méprise la France, un État policier,
Méprise l’Angleterre, entrepôt d’épicier,
Je veux revoir Djeddah dans les brises salées
Sur la corniche, au bout les barques ensablées,
Quand le palmier se berce au chant du rossignol,
Son ombre violette ondulant sur le sol,
Djeddah dans la fraîcheur mauve du crépuscule…
Que l’Occident est laid, sordide et minuscule !
*
XI
Après le jour brûlant, c’est moi qui suis ta Lune,
Avec moi que tu vas prendre l’air sur la dune ;
La brise de la mer et son parfum salé
Désaltèrent ton front par le soleil hâlé ;
Ce que dit le murmure étoilé de cette heure,
Dont la voix familière est tout intérieure,
Mon amour, je le sais car je dépose en toi
Les rayons de ma vie en un geste de foi.
*
XII
L’améthyste du ciel est, dans le crépuscule,
Une fraîcheur exquise où le jardin ondule
Au chant du rossignol éployé par le vent,
Et nous pouvons quitter le havre de l’auvent
Pour humer le parfum des lys au bord des dunes ;
Je choie avec ferveur nos délices communes,
Et si tu vois alors dans mes yeux se former
Des larmes, souviens-toi qu’il est bon de t’aimer.
*
XIII
La chanson du bulbul
La chanson d’un bulbul dans les palmes virides
Enchante le jardin de ses trilles rapides
Tandis que la fraîcheur du soir va s’embaumer
De rose et de jasmin. Qu’il est bon de t’aimer.
La chanson d’un bulbul dans les virides palmes
Égaye le soupir au vent des treilles calmes,
Et ce délassement qui m’ouvre enfin tes bras
Distille des baisers, qu’altéré tu boiras.
*
XIV
Le pèlerinage de Rimbaud à La Mecque
Perahu mabuk kemudi gila
(D’un pantoun malais : « Bateau ivre, gouvernail fou… » Le père d’Arthur Rimbaud, le capitaine d’infanterie Frédéric Rimbaud, était un orientaliste arabisant de quelque réputation, qui traduisit le Coran. Sa bibliothèque pouvait bien comporter un recueil de pantouns malais, par exemple dans les traductions françaises de Dulaurier.)
Rimbaud ne pouvait point, trafiquant en Afrique,
Surtout pas à Harar, ville sainte islamique,
Être resté kafir : ce n’est point contesté
Puisque c’est au contraire en tous lieux occulté.
Et c’est donc à Harar, la sainte forteresse
Aux minarets coiffant l’hyène et la tigresse,
Que le Voyant, lassé d’adolescents tourments,
Dit la profession de foi des musulmans.
Le Voyant, j’allais dire – et n’est-ce point comique ? –
Le voyou, mais voici comment cela s’explique :
Les koufar sont friands d’ordure, et les voyous
Chez eux sont admirés de même que les fous.
Mais qu’un jeune clochard, un punk, cherchant la Voie,
Trouve son Dieu, voici la meute qui larmoie
Ou bien couvre le tout en un profond secret
Où nul conspirateur n’ose être l’indiscret.
Mais, converti, Rimbaud fit le pèlerinage
De La Mecque, c’est sûr, et bien vite ; à quel âge ?
Dix-huit ans selon moi, parce qu’à dix-sept ans
On n’est pas sérieux ou l’on n’a pas le temps.
À La Mecque Rimbaud rencontra Hadji Lâme
Grand commerçant d’ébène et…
– Que tu me fends l’âme,
Abdoullah, non c’est vrai, quoi ! de quel droit causer
De ce peintre impudique ? Est-ce me courtiser ?
*
XV
Abdoullah, ne crois point que dure cette extase
Ni que brûle toujours la flamme qui t’embrase,
Je parle avec franchise et pendant que tu dors :
Ce n’est pas que je craigne ennuis ou désaccords
Mais à présent tu crois vivre un conte de fées,
Les stipulations à peine paraphées,
C’est normal ; cependant, si cet état d’esprit
Se dérobait toujours au temps qui le guérit,
Sans doute, malgré moi, je me verrais contrainte
De te faire savoir quel mal est ton atteinte.
On ne vit pas d’amour et d’eau fraîche en tous temps,
Ce monde nous appelle à des choix importants,
Et si la passion t’ôtait l’esprit pratique,
Ce serait bien dommage, et très problématique.
C’est dans la plénitude aveugle du plaisir
Qu’il ne faut pas laisser les conduites moisir.
C’est quand tu ne sens plus tes pieds dans les babouches,
En plein bonheur, qu’il faut aller chercher des couches.
*
XVI
Souviens-toi du Soudan : les nègres filiformes
Qui présentaient des taux de mélanine énormes
– Quel ébène – voulaient te vendre un girafon,
Six femmes, deux grigris, un boutre, un balafon,
Mais il faisait si chaud que perlait ta barbiche
Ainsi que le museau d’une petite biche.
Je revois l’océan dans tes verres teintés
Au filtre améthystin, cerclés d’or, incrustés
De diamants, les flots où volait ta pensée,
Tandis que mon niqab de grège damassée
Sur l’abaya feutrée aux mille chatoiements
Enveloppant de nuit, d’astres mes mouvements
Séduisait les koufar vineux et xanthochromes
Sur la terrasse, au Ritz…
Oublions ces fantômes,
Ici, sous les remparts de la sainte cité,
Makka ! ville interdite à la duplicité,
Que ne souille le pied d’aucun chien d’infidèle,
Et dont le Cube noir est clef spirituelle.
*
XVII
Ce miroir dont Kaboul est le nom
Kafir, contemple-toi dans ce miroir : Kaboul !
Si tu te crois puissant, tu dois être maboul ;
Tu rejoins les Soviets dans l’Enfer des vampires,
Que venais-tu chercher au tombeau des empires ?
Tes chars, tes avions, tes hélicos blindés :
Remballe ce fatras de jouets poignardés.
Tu payais en dollars des gens à ne rien faire,
Ces sommes te servaient, fol, à les faire taire,
Pour ce plomb pestilent cédant l’or de leurs cœurs :
Tu vois sans coup férir les Talibans vainqueurs,
Car ceux que tu séduis se changent en mauviettes,
Voulant te ressembler…
– Abdoul, tu m’inquiètes.
*
XVIII
Le Français est scatophage, il raffole des excréments (Charles Baudelaire)
Comme c’est un mets fin à ses yeux qu’un étron,
Le Français se dit libre et ses doigts sont marron,
Réfléchis bien avant de t’asseoir à sa table.
La France est un État policier détestable,
Et le socialisme arabe, nominal,
Est policier d’avoir pris le code pénal
À ces cognes mangeurs de molles bestioles,
Idolâtres d’un Corse…
– Abdoullah, tu m’affoles.
*
XIX
Passer un infidèle au fil de notre alfange,
Ce plaisir nous le donne en exemple l’archange
Qui brandit une lame entièrement de feu
Aux portes de Jannah. Ainsi l’a voulu Dieu.
Et ces voluptés-là sont de nous convoitées.
Deux choses ici-bas n’osent être comptées :
Les grains de sable avec les aspirants martyrs.
Celui que l’on retient en pousse des soupirs,
Pour cette oblation l’on court, on se bouscule,
Le monde mécréant est à son crépuscule,
Les cavaliers d’Allah…
– Abdoullah, s’il te plaît,
Apporte-moi du jus de dattes dans du lait,
Au lieu de marmonner tout seul dans ta barbiche.
Et puis nous irons faire un tour sur la Corniche.
*
XX
Suite de la romance au téléphone d’or
Allô, Fatma, chez toi, meilleur c’est, plus c’est gros…
Le téléphone est d’or mais je n’ai pas les mots.
Puisse le mécanisme arranger en caresses
Les sons que de ma bouche excitable tu presses.
S’il pouvait convertir en longs baisers profonds
Les mouches des discours surannés et bouffons
Ou te porter ma voix, par moyens cinétiques,
À l’autre bout du fil en strophes poétiques,
Si seulement…
– Tu sais qu’un choix de diamants
Fait toujours oublier à point tes bégaiements.
*
XXI
Je pleurais, à présent j’ai honte de mes larmes,
Tu me dis le néant de mes vaines alarmes.
Je pleurais dans le vent, l’écho m’a renvoyé
Le vide dans lequel mon cœur était noyé.
Je pleurais en voyant anéantis mes rêves,
Comme un flocon léger, si léger, tu m’élèves.
Je pleurais impuissant devant un huis fermé,
Tu m’ouvres un jardin de lilas parfumé.
Je pleurais me voyant perdu, dans un abîme,
Tu m’élèves à toi sur la plus haute cime.
Je pleurais sans espoir de trouver le chemin,
Dans la nuit tu me prends doucement par la main.
Comme, au milieu des fleurs enclose, une fontaine
Je pleurais, mais souris à présent de ma peine.
Aimer était l’erreur de ne point te chercher
Et j’éludais l’Amour en feignant l’approcher.
Le néant m’encerclait mais je fuis cette geôle
Et je pose ma tête enfin sur ton épaule.
La chaîne de néant se rompt – un fil si fin –
Car je donne à jamais mon cœur, enfin… enfin…
LES LUSIADOÏDES
.
XXII
Grande Mosquée de Mayotte, département français
Bateau de sable fin, fientes de colombes,
De fumée épicée et d’ossements de tombes,
Cocotiers bruissant et coquillages mous,
Ectoplasme bouilli de Césaire en burnous,
Au Panthéon nitreux, glougloutant, les grands hommes
Reconnaissants parfums des arabiques gommes
Dans le cuivre dissous, de Marseillaise igné,
Le casque du dragon par un coq lutiné,
Le coq ne cherche pas de choix entre les plumes,
Pour lui tout est fumier, cendres et peaux d’agrumes,
Miasmes réconfortants, détritus précieux,
Harem de volupté, de vanité – les deux –,
Basse-cour, il est Roi de tout ce qui caquète,
Cocotte, gratte, glousse indifférent, becquette
Ou bien porte un plumeau sur la tête en marchant,
Kwassa-kwassas pêcheurs, mais peu, mais déclenchant
Des rires d’icoglans, tandis que les Comores
Aiguisent les kandjars de leurs ancêtres Maures,
Un oblique regard pour là-bas l’ONU,
Où Brahima travaille à la plonge, inconnu,
Et les Corans de cuir, les cornets à friture,
Les chèvres de l’Aïd à la sous-préfecture,
Boubous hijabisés, niqabs boubouïsés,
Les pneus du brigadier dans l’égout enlisés,
L’égout qui rend ses eaux, dégurgite son chyle
Sur la poussière rouge au fond du bidonville,
Un inventaire à la Rachidoun Al-Prévert,
Et de loin un Éden à la mer, écrin vert,
Paradis, Gulistan, les Houris sont d’ébène,
Bárbara, Camoëns de neuve Mytilène
Serrait contre l’acier de sa cuirasse, épris,
Le chocolat fondu de sa nymphe, et le riz
D’un sourire épongeait sa fièvre paludique
D’épave et bois flotté, pour antispasmodique
Il avait dans sa hutte au bord des grands marais,
Cachant des scorpions, le drapeau portugais–
Qui sera, Mahoraise à l’étonnant patois,
Vainqueur des Jeux floraux, ton Camoëns gaulois ?
Ô ZUP ultramarine, admirable Mayotte,
Qui sous ton abaya ne mets pas de culotte,
Il fait beaucoup trop chaud, découvre au monde entier
Ton drapeau bleu-blanc-rouge en haut d’un cocotier,
Quand ta Grande Mosquée, ampoules de lumière,
Lâche tous les oiseaux Simorgh de sa prière.
*
XXIII
Pacific War : La guerre pacifique
Îles
L’Américain viride et le Japonais sable
Se disputent l’enfer de la jungle indomptable,
Le moindre confetti d’archipels submergés,
Des plages sédiments de volcans abrogés,
Les cavernes sans fond où des hordes tribales
De Papous sacrifient à des dieux cannibales,
Des marais où les morts flottent horizontaux
Tandis que les vainqueurs sont noyés sous les eaux,
Des champs cyclopéens de plantes carnivores,
Des lagons de requins et coupants madrépores,
Des cratères béants aux miasmes corrompus,
Brouillards empoisonnés, flux ininterrompus,
Distillés par la nuit, de gangrènes putrides,
Les hauts palmiers peuplés d’ombres anthropoïdes,
Les terriers des blaireaux, les antres des serpents,
Les trous où sont cachés des œufs mous et gluants,
Le labyrinthe noir d’immenses termitières,
Corps à corps, brandissant des loques de bannières,
Leurs drapeaux, soleil rouge ainsi qu’un vaste étang
Au pied du mont Fuji rempli le soir de sang,
Étoiles et sillons en lambeaux dans la brise,
Comme un corps d’animal qu’une jeep pulvérise.
Quand l’orage s’éteint, il pleut du fer fondu
Sur le limon huileux dans les eaux suspendu.
L’Américain couleur de grenade lâchée,
Le Japonais, de sacs entassés, de tranchée.
Ciel et mer
L’Océan devenu la cible des frelons,
Un parterre de lys fauché par les grêlons,
Le ciel comme un abîme où tomber pour revivre,
Le vertige fécond, sous un arc-en-ciel ivre,
Du pilote qui boit le pur nectar des dieux :
De cet Olympe il plonge, ébloui par les feux
Des canons lancinants, dans ce tunnel de flamme
Pour planter sur un trou de fonte l’oriflamme
Incandescent et dur de son cœur explosé.
Béhémoth se convulse, et le dard est brisé.
*
XXIV
Les Grées des Bijagos : Poème mythologique
As Dórcadas passámos, povoadas
Das Irmãs que outro tempo ali viviam,
Que, de vista total sendo privadas,
Todas três dum só olho se serviam.
Tu só, tu, cujas tranças encrespadas
Neptuno lá nas águas acendiam,
Tornada já de todas a mais feia,
De bívoras encheste a ardente areia!
Os Lusíadas, V, 11
Lorsque Gama longeait les îles Bijagos,
Laissant derrière lui les pays jalofos
Et mandingues – ceci par Camoëns, fidèle,
En vers fut relaté dans son ode immortelle –
Cinglant voiles dehors vers le cap des Tourments,
Et Mozambique, alors terre de musulmans,
Et Mombassa, grand port du Kenya, puis l’Inde,
Au Malabar, hauts faits dignes des chants du Pinde,
Lorsque Vasco passa l’archipel guinéen,
Attenant au Cap-Vert, cap Arsinarien,
De la verte Bissau, pensait-il qu’une Grée,
Vieillarde malbâtie, orde et défigurée,
Tenant à bout de bras l’œil aux trois sœurs commun,
Depuis une éminence émergeant du nerprun
Contemplait par ce globe oculaire pythique
Ses navires bravant l’océan Atlantique ?
Ô songeait-il, peut-être, admirant ces massifs,
Que s’il avait le front d’aborder les récifs,
La sorcière et ses sœurs, gardiennes des Gorgones,
Jetteraient sur ses pas de noires belladones,
Les cerises du diable, et que ses matelots
En périraient, les nefs, squelettes sur les flots,
Manifestant l’échec de leur démente audace ?
Ou bien augurait-il seulement que la place
Était par les cheveux grouillants d’un tel démon
Souillée, et qu’y sifflait entre ronce et chardon
Un nid par trop fécond de sifflantes vipères
Au milieu de furtifs scorpions mortifères ?
*
XXV
Les Bouddhas de Ceylan
A nobre ilha também de Taprobana
Já pelo nome antigo tão famosa,
Quanto agora soberba e soberana
Pela cortiça cálida, cheirosa,
Dela dará tributo a Lusitana
Bandeira…
Os Lusíadas, X, 51
Les Bouddhas de Taprobana font grise mine, un Portugais
Brouille le mystère puissant de leurs noble sourires gais,
Car, en hissant à Colombo le drapeau de Lusitanie,
Couronnes de fer, croix, écus et deniers, longue litanie,
L’inconnu donne un air étrange à toutes les fleurs du pays
Et – du moins ceux qu’il n’accapare – aux rouges, flamboyants rubis.
De même ses habits grossiers n’inspirent par leur balourdise
Que des mouvements instinctifs de mépris. Et sa puantise !
Enfin son système pileux a quelque chose d’animal
Comme s’il venait des forêts plutôt qu’en navire amiral,
Comme si les singes des lieux, en somme, avaient pris le contrôle,
Et, malgré leur sens de l’humour, pour un Bouddha ce n’est pas drôle.
Il enseigne des mots brutaux aux trop candides papegais,
Les Bouddhas de Taprobana font grise mine : un Portugais.
*
XXVI
Perlas de Barém (Perles de Bahraïn)
Atenta a ilha Barém, que o fundo ornado
Tem das suas perlas ricas e imitantes
À cor da Aurora
Os Lusíadas, X, 102
Entre des montagnes de sable à pic sur l’horizon, mer Rouge,
Entre des promontoires nus sous le soleil blanc, rien ne bouge.
Entre les géants embaumés qui se contemplent dans ses eaux,
La mer, zircon dans un désert sans fin sillonné de chameaux,
Entre citadelles de sel ardent, dunes pétrifiées,
Immobiles escarpements d’acropoles scarifiées,
La mer de l’ensorcellement, des boutres qui semblent dormir
Attendent sur ce grand miroir que nul souffle ne fait frémir.
Le gouffre amer s’est refermé sur des corps couleur de l’ébène.
L’homme, comme si vers le fond l’appelait un chant de sirène,
En puissantes brasses franchit, plongeant, les différents degrés
D’enténèbrement et froidure à l’abord des bancs désirés,
Et dans la pénombre sa main cherche parmi les coquillages
Celui qui distille la perle aux plus iridescents nuages
Et murmure en ces profondeurs : « Cherche encore, cherche plus loin,
La plus belle… au-delà de l’air dont ton cœur a pressant besoin. »
*
XXVII
La thériaque au fond de la mer
Nas ilhas de Maldiva nace a pranta
No profundo das águas, soberana,
Cujo pomo contra o veneno urgente
É tido por antídoto excelente.
Os Lusíadas, X, 136
Maldives, peau de bronze intense et fleurs rubis des grenadiers,
Archipélagique jardin de minarets, de cocotiers,
Comme on cueille au fond de la mer, à Barem, des perles nacrées,
Ici, nous dit le fils du Pinde, en traversant les eaux moirées,
Dans l’abîme silencieux aux équivoques floraisons,
On récolte parmi le frai d’efficaces contrepoisons.
L’un de ces pêcheurs nus, parfois tue une aquacole couleuvre,
Parfois il doit se dégager des huit bras collants d’une pieuvre,
Et souvent il retrouve épars entre les coraux arlequins
Les squelettes de compagnons brisés par les dents des requins.
Il se trouve peut-être encore un champ de cette thériaque
Dans une caverne marine, au bout d’un labyrinthe opaque,
Où tant de plongeurs courageux, ou forcenés, se sont perdus
Et qui, depuis ce jour, là-haut ne sont plus des leurs attendus.
Priez pour l’âme des noyés, heureux habitants des Maldives,
Qui ne craignez point le venin des serpents et des grandes vives.
*
XXVIII
On connaît encore assez mal les mœurs des monstres abyssaux.
Pourtant, si l’on y réfléchit, la Terre étant couverte d’eaux,
Notre monde est un grand abysse, et nous vivons à la surface
Comme si nous n’avions pour nous que deux dimensions d’espace.
N’est-il point très étrange, après avoir tout exploré,
Tout conquis du ferme relief, que doive nous rester barré
L’abîme qui fait le vrai corps de cet aqueux planétoïde ?
Sommes-nous un crasseux dépôt formé sur une peau squalide ?
.
GIALLISSIMO
Ces poèmes sont déjà parus sur ce blog avec une présentation et une filmographie partielle du giallo italien ici.
XXIX
Amore giallo
La main dans le gant noir lève un rasoir brillant,
Les yeux de Francesca, si beaux, s’écarquillant.
– Francesca, c’est ton sang qui gicle, rouge et tiède,
Sur les murs, au plafond…
Tu réclames de l’aide ?
Voyons, vous êtes seuls, ton assassin et toi,
Tu ne peux demander le rempart de la loi.
Mais tu ne m’entends plus, ta vision se brouille,
Le salon disparaît, que ton liquide souille.
C’est la fin. Il l’aimait, s’en souviendra toujours.
Les amours les meilleurs sont aussi les plus courts.
*
XXX
Amore giallo 2 : Message anonyme
Bonjour, vous êtes bien chez Francesca Mori.
Je ne suis pas chez moi pour le moment, sorry,
Surtout n’hésitez pas à laisser un message :
Je vous rappellerai.
– Francesca n’est pas sage,
Dit une voix étrange, altérée à dessein
Mais aussi dévoilant un délire malsain,
Francesca va mourir en d’atroces souffrances :
C’est le prix à payer pour tes intempérances.
Je vais te démembrer comme un quartier de bœuf
Dans le bustier lilas que tu portes, tout neuf,
Acheté samedi sur la place des Roses
Ensemble avec des bas ; tu vois, je sais des choses,
Et toi tu sais pourquoi je vais t’écarteler,
Te vider de ton sang et puis te violer,
Infâme courtisane, écoute bien, écoute,
Cette nuit tu mourras, ne conserve aucun doute,
Et mes soupirs coulant sur ton corps en lambeaux
Diront à ton cadavre aux viscères si beaux
Mon amour, un amour plus grand que tout au monde,
Et plus noble que grand, prostituée immonde !
Me reconnais-tu là, maintenant ? Réfléchis,
Tente de deviner qui fera du hachis
De ton infâme viande, ô Francesca légère.
Tu ne trouveras pas, c’est un épais mystère,
Et puis pour ton cerveau si petit c’est trop dur.
Je sonnerai chez toi, tu m’ouvriras, bien sûr,
Tu te plaindras qu’un fou monstrueux te harcèle.
Ma voix te paraîtra tellement irréelle…
Francesca va crever, bon débarras, adieu !
Quelle tranquillité sous le ciel calme et bleu.
*
XXXI
Pourquoi ces gouttes de sang, Dino, sur ton smoking ?
Dino, cas schizoïde, histrionesque et lâche,
Ne se rendit point compte, en relevant la hache,
Après un premier coup tombé sur le sternum
Sans, on se doute bien, le moindre ultimatum,
Alors qu’il la tenait au-dessus de sa tête
Ajustant cette fois au crâne de Suzette,
Que des gouttes de sang tombèrent sur son dos.
L’arme fendit en deux demi-melons égaux
Le chef blond jusqu’au cou, déliant les opales
Et zircons du collier comme autant de pétales,
Tombant avec le vent, d’une fleur en été…
Dino, d’adrénaline et de joie hébété,
Ensuite se servit un Campari rondelle,
Contemplant sur le mur, en juge, une aquarelle,
Puis, en ayant goûté le talent réfléchi,
Exhala le plaisir d’un gosier rafraîchi.
Trouvant son mocassin droit tâché d’une goutte
Comme un grenat, avant de reprendre la route
Il sortit de sa poche un tube mol et noir
Et cira ses souliers luisants comme un miroir.
Il se rendit alors, pour la conduire en ville,
Chez Ambrogia, brune au beau corps juvénile ;
C’est seulement là-bas, au milieu des danseurs,
Le suivant sur la piste au brouillard de sueurs,
Qu’elle vit le complet crème brillant dans l’ombre
Dégouliner de sang en fanfreluche sombre.
*
XXXII
L’assassin porte une perruque blonde
Lucio, quel pervers immoral, se déguise
En femme pour tuer des hommes par surprise.
Il feint l’esseulement, dans un cuir noir moulé ;
Quand on lui parle, il a son air chaste et troublé,
Nul ne peut résister à ses minauderies ;
Son teint blanc, ses grands yeux, ses lèvres orfévries
Brûlent, fondent le cœur, et l’or de ses cheveux
Rendrait Don Juan lui-même esclave ou malheureux.
Mais lorsque sa victime, aveugle d’assurance,
S’imagine toucher enfin sa redevance,
Lucio d’un rasoir lui cisaille le cou,
Et profane le corps sanglant, car il est fou.
.
LE NOUVEAU MAGISTRAT D’OZ
XXXIII
Apologie de Socrate
Le mot « apologie » ayant un sens pénal,
Cette œuvre fanatique inocule un grand mal.
Celui qui fut frappé par la justice aveugle,
Ses propos ne sont rien, c’est un bouveau qui meugle.
En ne désertant point, le pouvant, sa prison,
Socrate ainsi donnait à ses juges raison ;
Puisque le principal intéressé s’avoue
Coupable par le fait, sa défense est très floue,
Si bien qu’on ne saurait dire équitablement
Que l’accusé reçut déloyal châtiment.
Que se gardent de nuire à Thémis diffamée
Les philosophaillons en mal de renommée !
Et sa désinvolture abjecte montre à nu
L’âme noire, l’esprit gâté du prévenu :
Ne point se prosterner devant la cour auguste,
C’est clamer que sa cause est perverse, est injuste.
Je n’authentique rien dans ce fameux procès
Qui, s’agissant du Droit, ne montre un plein succès.
Tout homme étant mortel, comme c’était un homme,
Socrate devait boire à cette coupe, en somme.
*
XXXIV
En lisant les vers faux de Marguerite Yourcenar
Marguerite Yourcenar, cintre dans l’habit vert,
L’Antiquité sordide où ton humeur se perd
A de l’esprit français les miasmes de vinaigre
Et de l’Académie un cynisme de maigre ;
Ce qu’il faut de sclérose et de spleens durs et longs
Pour mettre les Anciens au niveau des salons,
Tu l’avais, et c’était révolutionnaire
Tel un delirium tremens de grabataire,
Tel un cri dans la nuit d’éthéromane nu,
Avec je ne sais quoi de gris et de chenu,
La révolution des soixante-neuvardes,
Élégance livresque et grimaces hagardes,
Comme un docteur Jekyll sous acide à Neuilly,
D’être dans les journaux en bien, d’un coup vieilli,
Et c’est dans ce passé de Grèce esclavagiste
Que tu parles de nous, en ichtyologiste
Ayant des lettres… Soit. Cependant, Yourcenar,
Tes vers alexandrins ont un air de bazar,
Car sans le dogme dur « césure à l’hémistiche »,
Ça ne se scande pas, ou l’on semble potiche,
Ce n’est donc point métrique : eh bien, tels sont tes vers,
Ils se lisent en prose. À dire aux habits verts.
*
XXXV
La Muse
Quand je dis que je t’aime et te nomme sylphide,
Tu pâlis de me voir regarder dans le vide,
Ou tu tournes la tête, au cas où, pour savoir
Si passe une beauté que je viendrais de voir.
Tu ne reconnais pas l’insigne créature
– Le reflet, dans mon cœur hanté, de ta nature –
Dont je te rends l’image, irréelle à tes yeux ;
Certes tu n’en dis rien, car c’est quand même mieux
Que tes antécédents, et puis jouer un rôle,
C’est ta vocation d’artiste, et parfois drôle. –
C’est la Muse ! pour qui, sur l’autel de la foi,
J’en ai sacrifié de plus belles que toi.
Je n’espère donc point que tu me rendes grâce
Quand j’aurai consumé ta chair épaisse et grasse,
Immolé dans le feu tes entrailles, versé
Ton sang sur le pentacle et le charme dressé.
J’en ai sacrifié de plus étourdissantes,
Qui boivent désormais leurs haines impuissantes
Dans des hoquets hideux et d’horribles sanglots,
Et plongent dans leur sein le baiser de leurs crocs.
*
XXXVI
La forme de la femme
La forme de la femme est… un drôle de truc.
Je ne lis qu’un apôtre, et c’est ce bon gros Luc.
L’aveu sempiternel de tes cérémonies
Est plus grand que le monde en moi, mais tu les nies.
Bien souvent ta froideur est celle qu’a le roc,
Quand tu peux m’envoyer sur les traces d’Enoc.
Était-ce à votre goût, ce cœur que vous mâchâtes ?
On ne le dirait point, vu que vous le crachâtes.
Je sais que tu voudrais connaître un jour Alep
Mais pour cette fois-ci nous irons à Tam Diep.
*
XXXVII
Énigme rimée
Une simple grenouille
Portant tête de veau
Et trouvant que c’est beau,
Que suis-je ?
La franchouille.
*
XXXVIII
Tu m’épluches en silence,
Méditant mon désespoir.
Ce regard vide me lance :
« Mon troisième œil veut te voir. »
*
XXXIX
Le retour de la momie de la malédiction
Quand la gitane obèse ausculta son tarot,
Je vis sur sa moustache un léger soubresaut,
Elle dit : « Cher monsieur, je vois à quelques signes
Que je préférerais vous lire dans les lignes
De la main » et me prit en ses doigts boudinés,
Qu’elle venait hélas de porter à son nez,
La paume que je dus lui laisser retranscrire.
Apercevant son œil à nouveau se réduire,
Je la lui retirai : « Madame, c’est assez,
Les amis dont le sel et l’humour déplacés
M’ont amené chez vous ont bien eu de quoi rire,
Brisons là. – Ignorant ! osa-telle me dire,
Mon incrédulité rendant plus cramoisi
Son déplaisant faciès dans ce salon moisi,
Sur la tête de mort de ma défunte mère,
Tu cours un grand danger si tu veux laisser faire :
La caisse qu’un bateau te porte du pays
De sable d’où, croit-on, mes aïeux sont sortis
Dans ses planches renferme une chose maudite
Dont la sombre présence aux hommes interdite
Te portera malheur si tu ne préviens pas,
En télégraphiant au vaisseau de ce pas,
Son approche du port : qu’on la jette aux méduses
Et que Dieu fasse grâce à tes clartés obtuses. »
Je compris que Neville et Conrad, les gredins,
Avaient prémédité ce bateau de gandins
En concertant le tour avec la bohémienne
Et me désopilai d’avoir trompé leur peine.
J’attendais d’un moment à l’autre mon trésor,
Une momie intacte et jaune de Louxor.
La voilà ! Je n’ai plus qu’à rompre ces liens…
– Un prévôt, avisé par des cris inhumains,
Trouva dans son manoir la dépouille livide
De l’émir Abdoullah, près d’une caisse vide.
Et l’oriel donnant sur le buis chuchoteur
Avait été brisé depuis l’intérieur…
*
XL
L’émir Abdoullah enquête à Chinatown
La secte du dragon noir domine le port ;
Le dragon rouge a, lui, droit de vie et de mort
Sur tous les blanchisseurs bridés de ces parages,
Le dragon d’or écume, exigeant sur les gages,
Ce qu’on appelle là restaurants ; les tripots
Sont au dragon puant, comme les entrepôts.
À moins que je n’impute à l’un ce que fait l’autre.
Le parrain de chacune est un genre d’apôtre,
Un vieillard décrépit en contact permanent
Avec les faux esprits d’un culte inconvenant,
Dans des vases gardés par d’ignobles eunuques,
Immigrés illégaux des farouches Moluques,
Mais la police veille et ces rites sournois
Bientôt éprouveront la rigueur de nos lois.
Djeddah depuis toujours fait commerce d’épices
Mais la raison, messieurs, pour que ces maléfices
S’étendent sur le sol du Royaume sacré
Des Saoud, protecteurs des Lieux saints, célébré
Par l’Oumma tout entière ainsi que tant de cafres,
Que peut-elle bien être ? Et que seront les affres
De notre conscience au jour du Jugement
Si nous avons laissé sans juste châtiment,
Sous prétexte d’ouvrir nos sacs aux bénéfices
Pleuvant de ces koufar au front de pain d’épices,
Le koufr impertinent de leur duplicité ?
Je veux voir le courroux dans vos yeux irrité,
Pourquoi le Livre saint nous défend-t-il l’usure
Si nous ouvrons nos ports à la recette impure,
À ces pieux lotos d’abomination ?
Je n’ose imaginer que vous ne criiez non !
Messieurs, si la vertu, si le patriotisme,
Si la haine du shirk et du socialisme
Enflamment comme il sied vos fronts de noble ardeur,
Donnez-moi le mandat d’arrêt dont j’ai l’honneur,
Pour la foi dans le vrai que le Bédouin confesse,
De porter à vos pieds la doléance expresse.
*
XLI
Le Pétomane avec un grand P
In memoriam Joseph Pujol (1857-1945), par qui la France s’est à jamais illustrée dans l’art du pétomane. Aux grands hommes la Patrie reconnaissante.
L’apogée
Joseph, quand tu proutais en scène, quels fous rires !
Quelles ovations, quels rappels, quels délires !
Hurlant, le tout-Paris de son long s’écroulait
Et se roulait au sol ; en chœur on s’étranglait ;
Le personnel devait décorseter les dames,
Qui, rouges, devenaient de vrais hippopotames,
Risquant l’effacement dans une explosion.
Jamais un art ne vit autant de passion
Avec sa catharsis éthique déchaînée.
Cette histoire ne peut même être imaginée,
Tellement tu vas haut sur les cimes de l’art.
Ton nom est comparable au seul nom de Mozart.
Le retentissement énorme de tes caisses
Transportait les Français en mystiques liesses,
Les chants que solfiaient tes pets les plus foireux
Offraient à ce pays d’être le plus heureux.
C’était au Moulin-Rouge, où se fit ta fortune.
Le banquier, le magnat, l’orateur de tribune,
L’icoglan étranger, ministres, présidents,
Comblaient ton opéra de leurs éclats stridents,
Et tu n’étais pas moins riche et puissant et grave
Qu’eux tous ; et l’univers, Joseph, fut ton esclave.
Quelque poète abscons† te diffame, en bavant ?
Qu’importe ! Autant, Joseph, en emporte le vent.
La chute
Qui croirait que ces faits, dont se pâment les Muses
En entendant jouer tes folles cornemuses,
Ton crépitant clairon, ton pipeau fulminant,
Seraient – qui ? – le prélude au drame hallucinant
Que je dois maintenant décrire. À cette gloire,
À cette gloire immense et surérogatoire
Que nul n’a reconquise après toi comme alors,
Il fut un dénouement, après tant de transports,
Joseph, quand tu voulus prouter la Marseillaise…
Bien que l’idée en soi ne fût pas si mauvaise,
Hélas ! le Cabinet, qui fut ton commensal,
Oyant interpréter l’hymne national
Par le fion divin du plus grand pétomane,
Tout à coup s’avisa que ton art est insane.
† Guillaume Apollinaire, qui a écrit contre l’art du pétomane dans Le Poète assassiné (cet art y est présenté comme un exemple recommandable et sain de spectacle par un moraliste à dessein ridicule), à l’époque où Pujol triomphait.
*
XLII
Je hais la poésie…
…qui ne m’a pas permis de vivre en philosophe
Tandis qu’être mortel est une catastrophe,
Qui m’a traîné d’ennuis en dégoûts préconçus
Et vu tous mes espoirs par avance déçus,
Qui de force me met la livrée insultante
D’un clown à poignarder pour sa mine effrayante,
Le philosophe-clown ! et non, comme la loi
Dans Platon le voudrait, le philosophe-roi.
Je hais de toujours vivre à l’écoute de Muses :
Des femmes ! ou plutôt un convent de Méduses.
Je hais cette torture insane du cerveau
Dont je ne conçois plus que ce puisse être beau.
Je hais la babouine à l’évidence folle
Qui me persécuta d’une amitié frivole
Et quand, par si constante obsession traqué,
Je cédai, s’éloigna, me laissant détraqué.
Je hais Philis, Armande, Aminte et Galatée,
Doris, Cassandre, Elvire, Hélène, Clitotée,
Chimène, Laïla, mais même si j’aimais,
Comme le Camoëns, même si j’acclamais
Une négresse noire au milieu de la flore
D’Afrique en bord de mer, je haïrais encore
Cette inspiration, nouvelle par ici,
Car je hais Zerbinette, Alcmène, Audrey, Lucy…
Je hais ce dont personne à ce jour ne peut dire
Si le genre humain, sans, ne serait pas moins pire.
.
RELIQUAT
(1991-1992)
Encore un reste de poésies anciennes, dont les autres sont éparpillées parmi les précédents livres.
XLIII
Au-delà du portail cueille les roses noires
Traversant le jardin aux mille illusions
Perds tout et sois heureux c’est autant de victoires
Heureux d’aimer la nue et les évasions
Laisse couler ton sang sur la neige éternelle
Les poisons sur le drap qui nous cache les morts
Souffre et ne fais pitié qu’à la Mère immortelle
Pleure on rira de toi les riches et les forts
Et maintenant le feu se propage dans l’ombre
Pour dissoudre ta chair et la semer au vent
Jette sur ton chemin des pétales sans nombre
Rouges noirs violets au vent
au vent
au vent
*
XLIV
Si belle
La nuit
S’enfuit
Armelle
Cruelle
Et lui
Sans bruit
T’appelle
Douleur
Du cœur
Il t’aime
Trop fort
S’endort
Tout blême
*
XLV
Malade de la vie ombre à jamais perdue
Cherchant loin des parfums l’intérêt pour l’amour
Il allait morne et lent la pitié défendue
Vers ses rêves de laid dans ses tourments de sourd
Il crut être aimé fou ! crut en la confiance
Si tôt aimé si tôt trahi si tôt tout seul
Vagabond vagabond reprends donc ton errance
Tout seul adieu bien seul seul absolument seul
*
XLVI
Et quand le vent soufflait sur ses rêves de femme
Balayant déblayant les désirs amoureux
Et que le cœur crevé séparé de sa flamme
On le voyait errer étrange et malheureux
Il aimait à mourir pâle et mal-héroïque
Comme mourut le Christ suspendu sur la Croix
Et la voix de l’humain sermon ou bien supplique
Laissait dans son oreille un clapotis d’effroi
Nul n’a baisé sa chair que les lèvres des ombres
Quand la fièvre rongeait son crâne plein de ciel
La brume bavait folle à ses deux tempes sombres
Toutes ses voluptés ses hontes et son fiel
Quand on le vit pleurer tassé dans un coin frêle
Une femme riait empreinte dans deux bras
Elle heureuse lui mort lui malade elle belle
Solitude des cieux…
Froids…
mortuaires draps…
*
XLVII
Plic ploc
La pluie
Qui pleure
M’essuie
Plic ploc
C’est l’heure
D’aimer
Courir
S’armer
Souffrir
Plic ploc
Cheveux
Trempés
Aveux
Trompés
Plic ploc
Je t’aime
Et même
Je meurs
Adieu
Des cœurs
Qui passent
Effacent
La pluie
Adieu
La pluie
Qui pleure
M’essuie
Plic ploc
C’est l’heure
Adieu
*
XLVIII
Rimbaldienne
Cheveux longs pipe au clair aspire les nuages
Avance heureux d’un peu de ciel et de soleil
Sur les chemins des blés et des vagabondages
Seul et pourtant aimé le sourire vermeil
Les mains dans les longs trous les yeux vers les navires
Des ports ensommeillés la nuit des parfums lourds
Brillant romanichel pèlerin aux délires
Fuyant l’embaumement dans les caves des sourds
En tout endroit dérange et fais rire les folles
Nulle part à ta place où le monde se vend
En retard sur le vide amoureux de paroles
Ton cœur ne pleure pas il engloutit le vent
*
XLIX
Folle elle a peint le ciel en bleu
Elle a fait briller le soleil
Quand elle pleure lasse il pleut
L’Amour à sa chair est pareil
Quand elle aime c’est triste et beau
C’est une rivière de sang
Et mon cœur comme un blanc bateau
Sur ce lit splendide descend
Je n’aimerai qu’elle je crois
Elle a fait tournoyer mes cieux
Autour des ongles de ses doigts
Autour de son sein merveilleux
Chutes les feuilles de cristal
À ses pieds laissent leur beauté
Cette nuit pour nous rendre au bal
Elle ira nue et moi tenté
*
L
Il descendit sur les terrasses
Pleines du soleil des amants
Où les panthères se prélassent
Tièdes près des bassins dormants
Des fleurs rouges ouvraient les lèvres
Empreintes de désirs ardents
Dans leurs jeux on sentait les fièvres
De nuits aux parfums décadents
Et son regard scrutait le vide
Pour trouver les noms du bonheur
Mais le silence était aride
Stérile et fier de sa laideur
Las dans les cieux son cœur se perche
Rongé par la haine à son tour
Le bonheur n’est pas mais l’on cherche
Et les vierges ont fait l’amour
.
À SUIVRE
LII
Ce dernier poème est le premier d’un chapitre du prochain recueil, chapitre dont il annonce le contenu.
Le dictateur tuait chaque jour un poète
De sa main, pénétrant dans la prison secrète,
Exact, à la même heure en fin d’après-midi ;
On avait ficelé sur un siège, étourdi,
Insulté, bâillonné l’espion anarchiste
Dans une salle basse où, le visage triste,
Ce dernier languissait de connaître son sort ;
C’est alors que, rompant le silence de mort,
Entrait majestueux le président à vie
En personne : un honneur qu’en principe on envie.
Le dictateur voulait, un pistolet en main,
Au prisonnier, vieillard, homme mûr ou gamin,
Tenir quelques propos lui dévoilant son âme
– Il fallait cependant être homme et non point femme,
Le sexe étant la chose afférente aux geôliers.
Ensuite il remontait la paire d’escaliers
Et pressait son chauffeur de le conduire en ville,
Au cotillon offert par quelque lâche édile.
Un copiste inconnu, pour la postérité
A retranscrit un choix de cette cruauté.
FIN