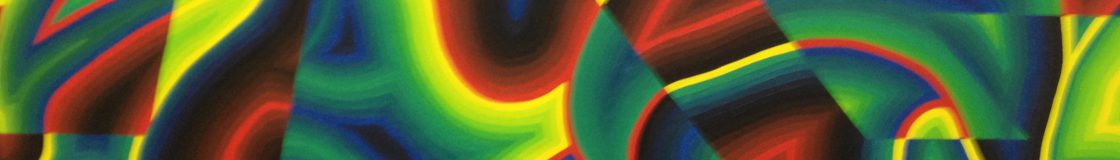Tagged: Alexandrins
Le maître du burg : Cent poèmes (dizains et douzains)
I/ Le maître du burg
II/ Histoires
III/ Absinthes
IV/ Célimène
.
1
Quand une porte grince au milieu de la nuit
Et que vous êtes seul dans le noir d’une chambre,
Sous une couverture, inquiet de ce bruit,
Et le chêne dehors craque au vent de décembre,
Qu’il n’est dans le manoir antique, féodal
Personne autre que vous, un souffle glacial
En s’engouffrant soudain par une entrebâillure
Vous apprend que l’on ouvre un huis, déverrouillé.
Et le portail au fond du parc, vieux et rouillé,
A gémi sur ses gonds dans le grès qui l’emmure.
*
2
Quelle est cette sylphide errante sous la lune,
Dans le parc, lumineuse et blanche ? Je descends,
Je sors la retrouver. Ma présence importune
L’éloigne, elle franchit les moellons imposants
Du mur d’enceinte et va se perdre sous les chênes.
Je la suis, la forêt m’aspire, yeuses, frênes,
Érables, châtaigniers, entravent mon chemin.
J’entre dans le marais que flanque un vaste rouvre.
C’était une noyée, et l’onde me recouvre ;
Je meurs en lui tendant une impuissante main.
.
I
LE MAÎTRE DU BURG
.
(i)
.
3
En cet amour blessé, dans cette solitude,
Je crois vivre en seigneur de château féodal,
Loin du monde et du bruit, loin de la multitude ;
Et, la nuit, noir écrin de ce burg sépulcral,
Enténébré j’attends un fantôme de femme.
Quand le chandelier fume et que s’éteint la flamme,
Dans un profond silence empreint de gravité,
Elle apparaît enfin, vapeur mélancolique,
Un flottement qui danse à pas lents, phosphorique,
Pour que je pleure encore en voyant sa beauté.
*
4
Dans mon château, la nuit, je crois te voir flotter
Devant mon lit, vapeur franchissant les murailles,
Et, ne sachant pourquoi tu me reviens hanter,
Sans le moindre soupir, me glaçant les entrailles,
Je suis tétanisé par ton vol transparent.
Pourquoi de jours défunts ce phosphore affleurant
Vient-il me rappeler l’inégalable joie ?
J’ai fermé sur le parc et les bois mes rideaux,
Car du soleil je fuis les importuns flambeaux.
Tu brilles dans le noir afin que je te voie.
*
5
Quand la bûche crépite et s’effondre dans l’âtre,
Je me tourne, pensant que l’huis vient de s’ouvrir
Et que j’entends ton pas ; mon cœur se met à battre
Plus vite un court instant, puis je pousse un soupir.
Le vent des combles souffle, et ce bruit m’ensorcelle :
Ne serait-ce ta voix, dans la nuit, qui m’appelle ?
En moi vit le passé. Quand courent les souris,
Apparaît dans le noir, droite comme une flamme,
Ton image, lucide et subtile, à mon âme,
Et tu pleures parfois, et parfois tu souris.
*
6
Dans cette solitude où ton fantôme est tout,
Dans les sombres couloirs, dans la bibliothèque,
Dans l’escalier couvert de son tapis, surtout
Dans la chambre gothique et byzantine, ou grecque,
J’aime que chaque nuit tu viennes pour flâner,
Flotter de-ci de-là, doucement chantonner,
Passer tes doigts fumeux sur la tranche d’un livre,
En faisant comme si tu ne me voyais pas.
Je regarde, accablé, tes lucides appas,
Puis tu redisparais où je ne peux te suivre.
*
7
Maintenant que revient ton fantôme à minuit,
Dans le manoir obscur de ma déliquescence,
Devant cette vapeur de mon passé, qui luit,
Perçant l’obscurité de sa phosphorescence,
Je sais que j’aurais dû – puisque à tout tu suffis –
T’aimer plus tendrement, mieux que je ne le fis.
Mais je payai tes vœux du seul amour frivole
Que mon cœur trop léger pouvait tirer de moi.
Maintenant – ô si tard ! – que me revient la foi,
Je revois ton fantôme et, contrit, me désole.
*
8
Je ne vis que pour être ami de ton fantôme,
Pellucide vapeur qui viens en ce manoir
Où je finis mes jours et flânes sans me voir,
Mais dont le flottement m’apaise comme un baume.
Tu traverses les murs, pour toi n’ont point de rets
Les tentures, les bois des meubles, les objets.
Et dans ma solitude opiniâtre et sombre,
Ta présence muette et transparente m’est
Cette clarté que j’aime et contemple dans l’ombre.
Je vis pour la lueur que ce beau double émet.
*
9
Son fantôme volant devant les boiseries,
Dans la nuit que cinglaient l’orage et les éclairs,
Franchissant les rideaux et les tapisseries,
Fit resurgir en moi tous les tourments soufferts
En ce funèbre amour de passion fatale.
Luisance de vapeur limpide et liliale,
Elle avait tous les traits que j’avais encensés,
Et je crus, dans le vent qui balançait les branches,
L’entendre murmurer ; ses belles mains si blanches,
Blanches, la voir les tendre à mes baisers glacés.
*
10
Quand je lève les yeux d’un livre, sous la lampe
Dans le salon obscur, parfois je vois flotter
Devant moi son fantôme, admirant une estampe
Ou flânant indécise et sans me regarder,
Traverser les fauteuils, les meubles de la pièce,
Un mur, puis revenir ; et, touché de tristesse,
Je repose le livre et l’observe longtemps.
Ce que fut notre amour, son double diaphane
Me le rappelle ainsi, clarté de cymophane.
Cette présence reste avec moi hors du temps.
*
11
Dans le sombre manoir où je vis en reclus,
Du monde séparé, ma porte reste close.
Un double hante ici, de temps qui ne sont plus
Évoquant les transports à mon âme morose.
C’est une blanche aura de femme, un diamant
Étincelant, la nuit, en un cercle fumant.
Elle passe en halo les pourpres palissandres,
Disparaît et revient, mais jamais ne me voit,
Et c’est elle qui vit, plus que moi, sous ce toit.
Elle est le feu qui reste après que tout est cendres.
*
12
Grille du fond du parc, il est temps que tu t’ouvres,
Roule donc sur tes gonds et me laisse passer.
Dans la forêt profonde où je veux m’enfoncer,
Le vent fait murmurer la frondaison des rouvres.
Et si je dois me perdre en ce vaste désert,
Si la nuit couvre enfin mon chemin rouge et vert,
J’écouterai le chant du hibou, note lente
Et gelée, envahir l’obscurité. – Portail,
À l’oriel m’attend la forme étincelante
D’un fantôme, dessin de gothique vitrail.
*
13
Solitaire, je suis le maître de ce burg,
Que ton fantôme hante, apaisant ma folie.
Je ne descends jamais de la colline au bourg,
Je reste avec ton double et ma mélancolie.
C’est un microcéphale, Ignace, qui me sert.
Rien ne vient déranger la paix de ce désert.
Et, la nuit, le silence irisé de ton spectre
Me visite, ornement gemmé, paranormal,
Mystère d’un passé d’amour monumental
Qui sur mon cœur tendu se pose ainsi qu’un plectre.
.
(ii)
.
14
Hélas ! en ce manoir antique et sépulcral
Où je veux terminer mon absurde existence,
Ton fantôme n’est pas, non, la seule présence
À me hanter : il vient un tourmenteur fatal
Qui me veut, acharné, bourreler pour mes fautes,
Le poltergeist. La nuit, depuis les chambres hautes,
Quand ton cristal fumant à mes yeux est caché,
Il martèle les murs, les carreaux, ou le vide,
Et je suis, en ces lieux à jamais retranché,
Grès qui d’un égouttis sans fin percé trépide.
*
15
Le pendu
Il est en ce manoir une chambre interdite,
Où l’un de mes aïeux fut retrouvé pendu.
Le récit de sa vie est aujourd’hui perdu,
Et son nom oublié, car son âme est maudite.
C’est la cause, à coup sûr, des faits surnaturels
Dont je suis assiégé, des heurts incorporels
Qu’inflige à mon ouïe, éprouvée à toute heure,
Un glaçant poltergeist dans le burg ancestral.
Bourreau de ma poussière, adversaire fatal,
Pour me sauver de toi faut-il donc que je meure ?
*
16
Un aïeul corrompu fit de ce burg austère
Jadis un rendez-vous d’hérétiques damnés.
Le monde ne sait rien de ces faits, griffonnés
Sur un vieux manuscrit ne faisant point mystère
Des crimes de la secte, et que je découvris
Dans un secret de mur au dos de faux lambris.
Mon aïeul exerçait la sacrificature
Du culte que décrit l’effrayant parchemin,
Où des vierges mouraient, atones, sans vêture,
Sur un autel fumant, souillé de sang humain.
*
17
Comment, en vivant seul avec le simple Ignace,
Ne suis-je pas souvent dans mon burg attaqué,
Connaissant les instincts de toute populace,
Se demande sans doute un quidam intrigué.
C’est très simple, ce burg est piégé, mille trappes
Y guettent les intrus : puits sans fond, lourdes chapes
De plomb, pals dérobés, vierges de Nuremberg,
Murs électrifiés, fenêtres-guillotines
(En un sens littéral), caustiques gélatines…
Mon manoir est plus sûr que le fameux Spielberg !
*
18
Ambre
Comme l’ambre écoulé fige dans son limon
Translucide la forme atteinte d’une proie
Pour toute éternité, je voulus comme joie
Couler en un bloc pur ton apparition,
L’aspect de ton fantôme en chryséléphantine
Statuaire, et j’avais certaine gélatine
Qu’en électrifiant par le dû procédé
Je supposais pouvoir y garder ton passage !
Fallait-il que je fusse obsédé, possédé,
Pour couver en mon sein ce délire sauvage.
*
19
Ambre II
Quand, la nuit, retiré dans la paix de ma chambre,
Je n’entends point les coups du poltergeist frappeur,
Je sais que j’attendrai, dans l’obscurité, l’ambre
De ton double éthéré ; je n’aurai point de peur,
C’est l’unique soulas de mon cœur solitaire.
Si, léger, retentit un chant d’orgue de verre,
De ton opalescence écloront des zargons,
Et je croirai te voir ainsi que gélatine,
Quasi matérielle, et chryséléphantine,
En luisant, des lambris faisant des sang-dragons.
*
20
Ambre bleu
Tout comme l’ambre bleu dans la jungle birmane
Ébranle nos concepts des insectes au temps
Du Crétacé, je veux, châtelain monomane,
Dans une gélatine aux cristaux résistants
Figer ton apparence éthérique, ô fantôme !
Afin que cette image, aurale et monochrome,
Démontre ma hantise à la postérité.
J’élève donc un mur fait de cette substance ;
Tu le traverseras et, plein de ta présence,
Que m’enclose tes traits de l’électricité !
*
21
Il faut, pour te figer dans de la gélatine,
Que l’électricité soit bleue, entièrement
– Pour cela j’ai besoin d’un tore en diamant –,
Que l’exposition soit chryséléphantine
– Cela requiert l’effet de lampes art déco,
Que mon burg féodal devienne rococo –
Et que l’encens s’élève au son de la cithare.
Que, bourgeois gentilhomme et grand mamamouchi,
J’étale les splendeurs d’une pompe barbare
De janissaire albain ou d’esclave affranchi.
*
22
Nos concepts ébranlés, s’agissant des insectes
Au Crétacé, depuis qu’est connu l’ambre bleu,
Ce bouleversement, senti jusqu’en ce lieu,
Où j’avais pourfendu des doctrines suspectes,
C’est vrai, m’abasourdit ; et si le poltergeist,
Tant je suis sidéré par le nouveau zeitgeist,
Me laisse indifférent avec ses coups fébriles,
Ton beau fantôme, hélas, sans cesser de voler,
Toujours majestueux devant mes yeux flébiles,
Ne peut plus, je le crains, guère me consoler.
*
23
Ylang-ylang
En ce château réduit à la sphère privée,
Quand j’eusse dû servir des intérêts plus hauts,
Défendre avec chaleur de nobles idéaux,
À quel « verpestergeist » ma valeur énervée
Oppose-t-elle en vain des flots d’ylang-ylang ?
Chaque pas qu’ici-bas je fais est un zugzwang,
Je ne crois plus du tout aux causes naturelles.
Le simple Ignace dit qu’un rat mort dans les murs
Empuantit mon lit, ma chambre, mes dentelles,
Mais je sais que ce sont des fantômes impurs.
*
24
Zugzwang
Il faut donc que s’achève ici, dans cette enceinte,
Un temps prochain, ma vie absurde et sans repos,
Et traverser du Styx fuligineux les eaux.
Je quitterai sans peine un sombre labyrinthe
Où chacun de mes pas fut contraint, un zugzwang.
Mes jours n’ont pas été fleuris d’ylang-ylang,
Tu fus le plus heureux de nous deux, brave Ignace.
Qu’importe les émois du cœur, qu’en reste-t-il ?
Tu ne sus jamais bien démêler ta tignasse,
Cela n’affectait point ton entrain puéril.
*
25
Morgenstern
Un aïeul – c’est, croit-on, celui qui s’est pendu –
Disait que notre burg se tient sur une faille,
Un abîme sans fond, en château suspendu
Au-dessus de l’Enfer, qui sous les douves bâille ;
Et que notre blason à la guivre ou wyvern
Évoque un Belphégor qu’un pesant morgenstern
Au salon d’apparat, exposé dessus l’âtre,
Servit à repousser dans le gouffre de feu.
Devant finir mes jours solitaire en ce lieu,
Je sais que vit en moi le démon à combattre.
*
26
Teutonique
L’ancêtre chevalier Teutonique et ministre
En Livonie, au burg majeur de l’Ordenstaat,
Revenu sur sa terre en suivant son fiat
Remeubla ce castel, dans la forêt sinistre
Et noire, où son passé d’homme d’État prudent
Occupait son loisir vide et sans accident.
Les pins de Tannenberg obsédaient sa retraite,
L’ambre de Marienburg, ses immuables nuits ;
Ses oraisons souffraient des bataillons détruits,
Ses lais à Dorothée† aussi, de la défaite.
† Dorothée de Montau, patronne de l’Ordenstaat.
*
27
Alfinger
Un autre aïeul, parti de ce même castel
Pour avec Alfinger trouver – dans quelles sylves ? –
L’Eldorado chanté par l’Espagnol en silves,
Revint pauvre, ennemi des hommes et du Ciel,
Avec un perroquet vert, bleu, vermillon, jaune,
Qui parlait notre langue, Arlequin d’une faune
Inconnue à nos gens, et qui le consola,
Avant que de mourir de heimweh exotique
En oiseau malheureux car né patriotique,
D’avoir un jour conquis le Venezuela.
*
28
Rouvres
Une nuit que, ton double absent, j’étais morose,
Et je n’entendais pas non plus de coups frappés,
Je marchais dans ma chambre hermétiquement close.
Les objets, d’un éclat de lune étaient drapés.
Vers la fenêtre mû, soudain étincelante,
Je vis un vol plongeant de soucoupe volante
Qui sur le boulingrin se posa sans un bruit.
J’en vis sortir alors je ne sais quelles drudes,
Quels alfes les servant, pour en ces solitudes
Se donner un ballet, sous les rouvres conduit.
*
29
Doppelgänger
Que ton doppelgänger hante toujours ce Schloß,
C’est tout ce que je veux pour cette vie absurde.
J’aurais dû gazouiller comme le merle – ou turde –
Mais je fus, dirait-on, le pesant albatros
Chanté par le poète, aux ailes inutiles.
Ton double est mon seul bien, dans ses vapeurs subtiles.
Sur un mur du salon funéraire, alangui,
Attendant ton aura d’éther je vois un pholque,
Immobile squelette, indifférent yogi.
Que vienne ton fantôme, aérien glutwolke.
*
30
Ce Schloß
Ce Schloß, que serait-il sans ton doppelgänger ?
Tu vas et viens, je veux, bien sûr, dire ton double,
Et sans toi je ne sais si me battrait un cœur,
Car ton double lui seul me remue et me trouble.
Certes, cela n’est plus Londres au temps du Blitz
En moi, non, c’est plutôt un bien-être de spitz
Casanier qui reçoit son maître une pantoufle
À la gueule, pourtant j’entends mon cœur qui bat.
Laissons aux poltergeists le goût pour le sabbat ;
Tu m’es tout, n’étant pas même un soupir, un souffle.
*
31
Mordaxt
Qu’en serait-il de moi, dans ce Schloß ténébreux,
Si tu n’y flottais point, blanche caryatide ?
Détachant de sa planche un mordaxt monstrueux,
J’en ferais l’instrument, je crois, de mon suicide.
Mais je suis grâce à Dieu l’heureux minnesänger,
Le céladon chantant de ton doppelgänger.
Lorsque, la hache en main, vers mon sort je titube,
Tu viens, claire vapeur : je pose ce jouet
D’un musculeux aïeul et rime un triolet.
Une nuit, tu viendras sous l’aspect d’un succube.
*
32
Téléphone
Une nuit, un quidam, surpris par la tempête,
À la porte frappa, manteau dégoulinant.
Par Ignace conduit au salon, frissonnant
Mélancoliquement, en foulant la carpette
Il s’assit prêt du feu qui ronchiait dans l’âtre
Et rendit des couleurs à sa mine grisâtre.
Comme enfin je parlai, ce faciès se troubla.
Il expliqua son fait, d’une manière atone.
On eût dit qu’il se vit aux mains de Dracula,
Quand je dis qu’en ces murs n’était le téléphone.
*
33
Le Frigidaire
J’achetai pour mon Schloß, un jour, un Frigidaire.
Malheur ! qu’avais-je fait ; le monstre, en ces vieux murs
Faits pour ensevelir des pensements obscurs,
Bourdonnait, pantelait ainsi qu’un dromadaire,
Ou bien qu’une momie en train de s’éveiller.
Les pierres en tremblaient jusqu’à mon oreiller,
Je ne pouvais dormir dans ce bruit mécanique,
Dont la brutalité me semblait sardonique.
Ah ! si le poltergeist, ainsi, n’existait pas,
Je l’aurais inventé par cet achat funeste.
Meure l’ingénieur d’un tel objet dantesque,
À bas cet ennemi de la pensée, à bas !
*
34
Le Frigidaire II
Funèbre sarcophage entré dans cette enceinte,
Mon Schloß, où ta présence inquiète les rats,
Quelle sombre momie enveloppent tes bras,
Car le burg tout entier résonne de sa plainte,
Ces soupirs de tombeau souterrains et glacés ?
Quel ingénieur fou, de rêves insensés,
Pensa que l’on voudrait de tes râles profonds,
De tes gargouillements hideux en nos demeures ?
Depuis ton arrivée ici, tu me morfonds ;
Et si tu n’es pas mort, je voudrais que tu meures.
.
II
HISTOIRES
.
Süzel
.
35
Berlin-Stamboul
Berlin jusqu’à Stamboul, par Vienne, Belgrade
Et Sofia – Sagesse ! Un train gardant l’Elsaß
(Où n’est point « familier » comme ici le mot « schlaß »).
Nos zouaves, couleur d’azur et marmelade,
N’avaient pas, à la fin de Sedan, supporté
Devant l’Arc de Triomphe un Siegeszug botté ;
Il fallait revancher Süzel et Cäcilie
De Colmar. Le Kaiser est l’hôte du Sérail,
Bajazet lui décerne un croissant en émail ;
Et c’est la guerre sainte. Où donc est l’Italie ?
*
36
Süzel
Depuis Colmar Süzel se rendit à Berlin
Pour monter dans le train jusqu’à Constantinople,
Désirant pour ses kutts du rouge d’Andrinople
Et voulant comparer le voile zinzolin
Des belles du sérail à sa coiffe opulente.
Vienne, Budapest, Belgrade étincelante
De bulbes mordorés, flèches de Sofia,
Le Bosphore baignant le pin stambouliote :
Süzel vit ces beautés et s’en émerveilla,
Tandis que Lucien la vengeait dans la crotte.
*
37
Süzel sur le Bosphore
Süzel a pris le train de Berlin à Stamboul,
En kutt de vermillon et schlupfkap anthracite.
Les cyprès sur la mer où chante le boulboul,
Le zéphyr embaumé des limons d’Aphrodite,
À son cœur haut-rhénan aux élans colombins
Parlent le doux langage ami des chérubins.
Un officier feldgrau, hochant du pickelhaube,
Accompagne ses pas aux jardins tulipiers
Sur le Bosphore bleu… Ah Süzel ! quand dès l’aube
Sans pitié les Berthas pilonnent nos bourbiers.
*
38
Idylle
Elle ouvre ses volets sur le Bosphore à l’aube
Et remet son pimpant bonnet à nœud, Süzel ;
Sa chanson éjouit la chambre, au Grand-Hôtel.
Fou d’elle, un officier sangle son pickelhaube.
Sur le pont d’un voilier ils sont au paradis,
Où s’inclinent pour eux d’affables effendis.
Il lui montre les pins, leurs deux formes penchées,
Et lui touche la main, ô célestes débuts
De fatidique amour, Süzel ! Et les tranchées
S’effondrent sur nos lits quand pleuvent les obus.
*
39
Magnolias
Süzel, l’exquisité du gewürztraminer
Est moins ronde, opulente et douce que ta bouche,
Et le ravissement d’un doigt de kirschwasser,
Moins profond que celui de ta main que je touche…
Vois ces pins parasols et ces magnolias
Au bord de l’eau, jardins embaumés et villas
Derrière la dentelle à jours de la feuillée,
Et les citronniers verts et dorés des coteaux.
Le Bosphore éclatant, constellé de bateaux,
Accueille notre amour sous sa vigne émaillée.
*
40
Narguilé
Ainsi, ce jour finit, et la vie est changée.
Süzel m’aime. Un bonheur aussi grand que le mien
N’est-il point de ce monde et du temps l’apogée ?
Et c’est donc pour moi seul que parut tout le bien ?
Ô nuit ! quel immortel en ton sein dormirait,
Venant de se connaître ? Un homme le pourrait,
Mais cette extase-là n’est pas de cette terre.
Je veux au narguilé, devant le clapotis
De l’eau contre le quai, les remous amortis,
Repasser chaque instant de ce jour de lumière.
*
41
Narguilé II
Chaque instant de ce jour fut une vie entière,
Et je les revis tous, un par un, chacun d’eux,
Dans l’immobilité d’un orant en prière,
Jusqu’au bout de la nuit. Je suis un homme heureux.
Elle m’aime ! Le monde avait tant d’ambroisie ?
C’est l’Olympe chanté par notre poésie ?
Tout est si différent, pourtant rien n’a changé.
Chaque instant de ce jour suffirait à mon âme…
– Commandant ! – Lieutenant ? – Au fort on m’a chargé
D’annoncer le départ, nous changeons de programme.
*
42
Gaza 1917
Je vous écris, Süzel, depuis la Palestine,
Où nous avons gagné l’affaire de Gaza.
Freiherr von Kressenstein sans peine s’imposa
Face aux Anglais, avec la troupe levantine.
Vous êtes, ai-je appris, retournée à Colmar,
Où les bombardements français, selon Siegmar,
Font d’importants dégâts. Surtout, soyez prudente.
Et faites-moi savoir si votre père et vous
Viendrez à Schloß Altheim où vous attend ma tante.
J’espère vous revoir très bientôt, à genoux.
.
Vaisseau spatial
.
43
Vaisseau spatial « Leif Erikson »
C’est un jouet, parmi d’autres dans une chambre
Sur la table, la chaise, au tapis, sur le lit,
Un vaisseau spatial portant un nom sicambre.
Il va, son odyssée en secret s’accomplit.
Quelques navigateurs se trouvent à son bord ;
Sans doute pour manger vont-ils au smorgasbord,
À moins que les héros se passent de substance.
Les novas, les trous noirs, les périlleux vortex
Seront tous archivés par de puissants télex,
Dans cette chambre en haut d’un escalier, l’enfance.
*
44
Vaisseau spatial « Leif Erikson » II
C’était un pavillon de banlieue : un jardin
Au milieu d’un lacis de jardins, de ramures,
De lanternes, de fleurs, quartier ni citadin
Ni rustique, au loisir consacré d’âmes pures,
Au pur loisir, divin, poétique, élevé,
Des âmes en repos du labeur achevé.
Ni bazars ni bureaux ni champs pour les machines :
C’était la simple idée, auguste, de l’heur, tel
Que je veux, adorant, fumiger cet autel
De tout le rêve accru parmi ses églantines.
*
45
Tubes de Geissler
Je vis dans une nauf en tubes de Geissler,
Un vaisseau spatial sur un chemin d’étoiles.
Quand un astre lointain se démet d’un éclair,
Une aurore de pôle agite ses longs voiles.
Et c’est un pavillon, fenêtre sur jardin.
Cet arbre dans la nuit parle au ciel, et soudain
Je vois qu’il appelait d’étranges créatures
Mystérieuses qui, dans le plus grand secret,
Se déploient à mes yeux. Ô quel est mon regret
De ce silence ami d’insignes aventures !
.
Idylle
.
46
Swensen’s
Suzy, d’extraction dano-norvégienne,
S’est laissé convier à l’ice cream parlor
Swensen’s, où le néon rougit les vagues d’or
Et le visage pur de la « collégienne ».
Carl est son cavalier, germano-suédois,
Et la boîte à musique, un Wurlitzer, je crois.
L’alacrité du cœur imbibe leurs haleines ;
Comme si les sodas étaient drogués, ma foi…
Et c’était au milieu des grandes, vastes plaines,
Où souffle un vent gelé loin, très loin devant soi.
*
47
Swanson’s
Un soir, à Chikago, mais plutôt la banlieue,
De long en large allait, sur la moquette Olson,
Carl attendant Suzy : il fit bien une lieue
Marchant de la télé, sigle Stromberg-Carlson,
Au meuble radio Bendix, quand la sonnette
Enfin tonitrua : « Fais choir la bobinette ! »
Elle entra, lui tendant quelques provisions
En sac de papier Kraft, et c’étaient des volailles
Aux petits pois de chez Swanson : ces victuailles,
Ces surgelés, des deux étaient trouvés fort bons.
*
48
Sur la Lune
Plus tard, Carl et Suzy vécurent en Floride,
Carl étant concepteur à Cap Canaveral.
C’est lui qui dessina le support de la bride
Du bras articulé de l’axe pivotal
De l’appareil photo des missions lunaires.
Ils coulaient donc des jours exaltants, balnéaires,
Sous les palmes, les pins, les fleurs de mimosa,
Dans une course intense avec les Soviétiques.
Qui ne s’étonna point, un peu, quand la NASA,
Son exploit fait, perdit les bandes magnétiques ?
.
Saudades
.
49
Don Tiague
Don Tiague vivait, ayant quitté Lisbonne,
Au milieu des Bouddhas et de leurs talapoins,
Conseillant l’Empereur siamois comme on donne
Des ordres à l’enfant qui grandit sous nos soins.
C’est lui qui guerroyait contre les clans sauvages
Dans les vastes forêts, les Birmans lotophages
Aux peaux d’alligator, sur le dos d’éléphants,
Les pirates malais de Bornéo l’ogresse…
Sous son harnois niellé le souvenir l’oppresse :
Done Ulrique à Sintra, promenant les infants.
*
50
La grotte
Don Tiague forçant la pagode hantée,
Un brandon à la main descendit au caveau
Où son pas retentit sous la voûte effritée.
L’ombre des rats fuyait la lueur du flambeau. –
Les bonzes plaçaient là, naguère, leurs momies,
Mais par l’intrusion de forces ennemies,
Occultes, ce tombeau de vénérables saints
Était devenu l’antre, aranéen d’étoffes,
De morts-vivants damnés, grouillant de rhinolophes.
Les Bouddhas fienteux luisaient sous ces essaims.
*
51
Foï-tong
Nul ne doit ignorer dans la Gaule bourrue
Que si l’art culinaire au Siam est si haut,
C’est que le Portugais y servit la morue,
Dont le nom lusophone et juste est cabillaud,
Révolutionnant le curry jaune et rouge,
Tandis qu’il défendait le trône de sa vouge.
Ainsi, le chu-chi-pla vient d’un conquistador.
De même les desserts succulents ont pour reine
Maria Guyomar de Pinha, souveraine,
Créant les foï-tong, en français « cheveux d’or ».
*
52
François Xavier
Dans la forêt de Dieu mélodieux boulboul,
À Goa, Portugal ultramarin, tu fondes
La mission que porte un éléphant tamoul
Au pêcheur habitant le bord des vertes ondes.
Ayant charmé, conquis les Fo du Sri Lanka,
Tu vas répandre ailé la foi dans Malacca,
Avant de t’essorer, acolyte d’Ignace,
Pour l’archipel neigeux du zazen : au Japon,
Où de tes résultats, spirituel ippon,
Les persécutions n’ont pu noyer la trace.
.
Les singes de Sodome et le fongus panspermiste
.
53
Orgies égyptiaques
Les fils de Râ cachaient dans leurs temples sacrés,
Tout au fond des naos, d’étranges créatures,
Des monstres qu’ils vêtaient de longs manteaux dorés,
Se livrant avec eux à d’infâmes luxures.
C’étaient des nains bossus et des hommes-poissons
Pêchés dans les marais, et, pris dans les buissons,
Les bosquets du Nil blanc et forêts de Nubie,
Les verdoyants déserts de l’humide Libye,
Des singes nus ailés, au stupre sidérant.
Les matrones couraient se faire, aux temps d’orgie,
Monter par ces babouins de tératologie.
Ces rites ont passé jusqu’à Louis-le-Grand.
*
54
Singes
Célimène, mon cœur ! ce pays est pourri.
Les singes au pouvoir, s’ils découvraient vos courbes,
Voudraient me dépouiller d’un objet si chéri,
Tant ils sont vicieux, concupiscents et fourbes.
Ils voudront caresser de leurs longs doigts velus
Vos appas rebondis et doux, ces crépelus
Anthropoïdes nains ! Après tant d’onanisme,
Ils ne peuvent jamais émouvoir votre cœur,
Ils pensent que la force en amour est vainqueur,
Ils veulent polluer votre exquis organisme !
*
55
Fongus
Les singes au pouvoir, rongés par un fongus
Parasite venu de très loin dans l’espace
(Panspermie), introduit en eux via l’anus,
Nous paraissent vivants mais sont une carcasse
Délabrée éructant les mots du champignon
Ou de la moisissure attaquant le fignon,
Les intestins, le sang, le chyle et la cervelle
Qui les contrôle. Il fait applaudir ce navrant
Spectacle monstrueux de tout Louis-le-Grand,
Gymnase devenu formidable poubelle.
*
56
Fongus II
Par l’anus des babouins au pouvoir est entré
Un fongus de l’espace affamé qui les ronge !
Nous sommes subvertis par l’intestin chancré
Des politiciens, et notre pays plonge
Dans le chaos, aux chants de rampants bacheliers
Ignorant le danger pour leurs boyaux culiers
De se joindre au cartel à cause de leurs mères,
Dont les aïeules sont les prêtresses d’Isis
Qui servaient aux plaisirs des mânes d’Anubis,
Égayaient les babouins de leurs amples derrières.
*
57
Fongus III
Ce fongus xénomorphe entré par le fignon
Fait en quatre ou cinq jours de son hôte un zombie
Soumis aux idéaux moussus du champignon,
Accusant d’anarchisme et de xénophobie
La population à longueur de discours,
Bavant, vitupérant, au ra plat des tambours.
Le ministre babouin parasité s’exclame,
Vomissant des vapeurs de spores, du limon
Sulfurique, sa peau pareille au goémon ;
On ne comprend plus rien, Louis-le-Grand acclame.
*
58
La grande chauve-souris
Quand les babouins rongés par le fongus vireux,
Les crocs dégoulinants et le mufle morose,
Sont enfin devenus suffisamment nombreux,
Ils ouvrent dans les monts glacés la faille close
Que nos pères avaient condamnée à toujours…
Et cherchant dans les plis, les sinueux détours
De la baume hantée un être qu’ils ignorent,
Ils réveillent au fond des méandres pourris
Leur idole vivante, une chauve-souris
Géante, maléfique, et prostrés ils l’adorent.
.
III
ABSINTHES
.
59
Mon dégoût
Comprenez-vous pourquoi je n’ai que du dégoût
Pour ce pays de vice et de grandes écoles
Et de Louis-le-Grand qui s’étale partout,
Quand je lève les yeux, en blanches auréoles ?
Je croyais exister, en fait je ne suis rien ;
C’était l’illusion d’un fat béotien,
D’un palmier du pompeux décor de quelque scène,
Qui se voit personnage au milieu des acteurs,
Admirant son sommet touffu dans les hauteurs.
Comprenez-vous pourquoi j’éprouve de la haine ?
*
60
Ma haine
Ta beauté me console un peu des agoutis.
Quand l’agouti ne fait que passer dans la rue,
Anonyme et chagrin de n’avoir œil qui tue,
Je bâille indifférent, ces gestes sont petits.
Mais lorsque le mulot pavanant sur la scène
Est de Louis-le-Grand, alors j’ai de la haine.
Je vois autour de lui tout un réseau de fils,
Électriques ou non, en toile d’araignée,
Un complot ourdissant des écrits sots et vils,
Des rituels poisseux, dont l’âme est indignée.
*
61
Réponds-moi sans les mots : avec ta nudité.
Car j’ai beaucoup souffert de nos grandes écoles
Et, bien avant cela, de la sublimité
De Janson-de-Sailly, Condorcet, et de folles,
Sachant que je n’étais d’aucun préau connu,
Qui disaient que leur corps, quand j’en étais ému,
Pour me faire enrager, a les traits de la vache.
Que si j’aimais ces traits, c’est donc que j’étais bas ;
Et, de toute façon, pour discuter ébats
Louis-le-Grand faillait à mon humour potache.
*
62
Inventaire à la Louis-le-Grand
C’est tout de même assez drôle, même hilarant.
Nos écrivains ont beau, verbe haut, face blême,
Avoir quasiment tous purgé Louis-le-Grand,
C’est Prévert, qui n’a pas fait d’études, qu’on aime
Chez les Français… Pourquoi, pourquoi me dire alors
Que mes vers, désuets, me laissent en dehors
Du grand courant où tout est balayé, surnage,
Puisque vous n’êtes pas davantage goûtés,
Quasiment, dans le fond que moi, vous qui sortez
Du noble incubateur, par la plèbe sauvage ?
*
63
Rituel
Français, tes écrivains chantent si bien Paris !
De Toulouse ils n’ont cure, or il te faut les lire,
À Narbonne, à Rouen, à Montluçon, à Ris,
Les lire et déclamer : « C’est cela que j’admire »,
Pour espérer avoir ton baccalauréat.
Sublime rituel, cher vaillant lauréat !
Cependant, n’étant point passé par Henri-Quatre,
À toi cela ne sert de rien, ce qui s’apprend ;
Parce que tu n’a pas purgé Louis-le-Grand,
Même à Paris tu sens le mouton, comme un pâtre.
*
64
Louis-le-Grand précède l’essence
« La province est si plate et morne, philistine »,
Chantent nos écrivains après Louis-le-Grand,
« Que mon dégoût pourrait en faire une tartine,
Un gros livre de tout ce néant écœurant.
Car je n’ai pas choisi de voir le jour à Dole,
Je décidai de naître à mon gré : dans l’école.
Et cela conduit loin, au moins jusqu’au Marais.
C’est toujours à Paris que naissent les génies.
Au-delà du périph s’ouvrent les colonies.
Qu’au Flore avec bonheur de miettes je mourrais ! »
*
65
Pisciculture
Il raconte sa vie amusante au lycée
Comme s’il s’agissait d’une boîte lambda,
Celle de ses lecteurs, et sa vie est censée
Refléter notre vie à nous autres. Juda !
Oui, l’établissement de ce hideux potache
Est depuis deux cents ans et plus – c’est ce qu’il cache –
Le seul accès possible au statut d’écrivain,
Dans ce pays rongé par l’entre-soi fétide.
Et de l’extrême gauche à l’extrême insipide,
C’est dans un même trou que croît cet alevin.
*
66
Négritude
Ils disent t’admirer, poète Aimé Senghor,
Pour ce que tu nommas un jour ta négritude.
C’est ce qu’ils disent tous, en le répétant. Or
Tu n’existerais pas, nonobstant l’amplitude
Diffuse de ton vers et son bruit effarant,
Si tu n’avais écrit depuis Louis-le-Grand,
Où tu ne fus pas plus tropical, exotique,
Pour eux, que vos amis de Limoges, de Tours
Ou de Montbéliard, les sonores tambours
De ces patois locaux au timbre drolatique.
*
67
Au ciel
Comme, à Louis-le-Grand, je plaignais la misère !
Mes professeurs aimaient ce délicat sanglot
Et me disaient : Ton chant, plus haut que la grammaire,
Au cocotier t’aura grâce à nous le beau lot.
En ce gymnase altier frappe ton vers occulte,
La France veut l’ouïr et te vouer un culte.
Écris, ne pense pas au sens des mots, peu sûr.
Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait la presse !
Je sentais leur encens vaincre ma sécheresse,
Un choix de chérubins m’acclamait dans l’azur.
*
68
Lycée Bacchanale
Un des rares bijoux de l’immense banlieue
Où passer quelques ans peut n’être point perdu :
Pour cela les parents doivent faire la queue
Au cadastre et payer le tribut foncier dû.
Alors les rejetons s’en donnent à cœur joie,
Le bocard de Mme Alibaba festoie
Avec ces bons à rien ; c’est le chemin tracé
Vers les salons pompeux, la carrière publique,
Le sommet de l’affiche. Et surtout, règle unique :
Pas un mot de travers ou tout est exposé.
*
69
Académie
Nos lettres sont aux mains de cervelles malades,
Exégètes cherchant des vices nauséeux
Dans les alexandrins des hautes Franciades,
Ou ceux de leurs appuis ou leurs vices de gueux.
Je dénonce le bran puant dont nous conchie
Ce diplômé troupeau roulé de l’anarchie
Que dirige un bocard, depuis Louis-le-Grand.
Car cet aréopage, huileuse salmonelle,
De boucs efféminés, la gueule solennelle,
Veut nous voir avec lui noyé dans le courant.
*
70
Académie II
Ce n’est pas une aca / démi(e), c’est un asile.
Le psychiatre en chef est nommé par décret
Avec six contreseings, plus un avis secret
De Mme Giton, secret mais inutile.
Ce haut fonctionnaire est d’une loyauté
Exemplaire au cartel de la lubricité.
Quiconque a plané haut parmi nos gens de lettres
Doit être convaincu de perversion ;
Libres, notre pensum est d’abaisser les maîtres,
Notre hommage doit être une dérision.
*
71
Je marche dans la rue et tout est décadent.
L’illégalité suinte au grand jour, la police
Me voit froncer les yeux de dégoût : imprudent,
Je lui deviens suspect, à cette bienfaitrice !
Des femmes mendiant devant la tour Eiffel
Avec des enfançons : système industriel
Dans la tradition purulente de crimes
D’abjects robachicos de Babel en ferment,
Qui n’attend qu’un peu plus de notre abaissement
Pour arracher des yeux, mutiler ses victimes.
*
72
Dans mon château, je couds et recouds de la chair
Des fosses exhumée, arrachée à la tombe.
Je veux en ciselant ces tissus par le fer –
À l’amant que je suis ce noble office incombe –
Recréer le contour, le faciès de Philis.
Et quand j’aurai sculpté parfaitement ce lys,
Je sais comment son cœur battra par galvanisme.
Elle ouvrira les yeux, mon chef-d’œuvre inouï,
Et du néant tirée, enfin me disant oui,
Une Philis vivra sous mon déterminisme.
*
73
J’aime – mais c’est forcé ! – le plus français qui soit.
Il est beau comme un chou frisé de maraîchère,
Fait toujours ce qu’il veut et jamais ce qu’il doit,
Me pince le fessier en badinant : « Ma chère ».
Si romantique, un jour il m’apporte des fleurs :
« C’est sur notes de frais », dit-il. Saines valeurs !
Il est fin connaisseur de vins et de vignobles,
Dans le plus grand secret boit du coca-cola.
Je ne sais qu’ajouter, tant de vertus si nobles…
– Que « c’est plutôt Robert que Redford » ? – C’est cela.
*
74
Jours bénis
Jours bénis où, courant au marché de ma ville,
J’allais des choux frisés voir les ballons feuillus !
Quel meilleur aliment pour se faire du chyle,
Cette soupe vaut mieux que les cafés bouillus.
C’était tôt le matin, la ronde maraîchère,
Dont l’aspect à lui seul parlait de bonne chère,
Plongeait ses beaux bras nus dans les choux bien frisés,
Et moi, pendant ce temps, je palpais des bananes,
En regardant comment elle arrangeait les fanes
Des choux dont on eût dit qu’ils étaient irisés.
*
75
La maraîchère
Elle avait des choux-fleurs charnus, étincelants
Comme l’ivoire antique, et gros, la maraîchère.
Mais je ne croyais pas qu’il fût hors des lys blancs
De trésor et passai… Son image si chère
Aujourd’hui m’apparaît en des nimbes dorés :
Je pleure les gratins que j’eusse dévorés,
Chaque heure, chaque instant d’une vie abattue.
Le lys a par la foule été cent fois souillé
Et me glace, trognon à jamais effeuillé.
Le souvenir cuisant de beaux choux-fleurs me tue.
*
76
La laveuse de carreaux
Je m’en souviens encore… En haut de la bastille
Elle allait se jucher, pour laver les carreaux,
Avec un air mutin de la vieille Castille,
Ou d’une Andalousie alme d’azulejos.
Et moi, la revoyant sur cette citadelle
À frotter les carreaux, voilà je m’épris d’elle.
La mansarde où mon sort de poète déchut
Me vit souvent attendre, écrivant quelques lignes,
La brune Asuncion, pour lui faire des signes.
Me souriant un jour, dans le vide elle chut.
*
77
Au bout de la nuit
Dansez, belle Ingeborg, pour mes yeux dansez nue
Sous des voiles légers, vaporeux, transparents.
Au comble du bonheur enfin, mon âme émue
Ne veut plus revenir jamais de vos torrents.
À la fin de la nuit je peux mourir bien aise,
Oui, lever cette coupe où l’orage s’apaise,
Entrer dans un sommeil éternel, oublier
La blessure infligée à l’esprit par le monde,
Comme tombe la pluie en fils bleutés sur l’onde,
M’évaporer de voir votre jambe plier.
*
78
Soupirs
Mes soupirs s’entendaient au moins jusqu’à la Seine,
Mais les clochards, sans doute, assis sous le balcon
Couvraient ce chant avec leur bavardage obscène
Et vous n’entendiez point ma voix sur l’Hélicon.
Ce chant dont vos appas étaient la cause insigne,
Dont je désespérais de pouvoir être digne !
Et si vous l’entendiez, pourquoi n’avoir rien dit ?
Pourquoi m’avoir laissé bouillir dans mon vinaigre ?
Peut-être pensiez-vous : « Mais si c’était un nègre
Dont la négroïtude à jamais me perdît » ?
*
79
Au pied de l’alcôve
Quand la nuit les clochards beuglaient, leur campement
Sous votre alcôve avait des odeurs de vinasse
Et leurs propos devaient vous sonner rudement.
Car la police fut inutile et bonasse.
Las ! vous n’aviez rien fait pour mériter cela,
Et personne à vos maux ne mettait le holà.
Or si j’avais eu vent de cet ignoble trouble,
J’eusse coupé la gorge à ces rebuts humains
Et fait, dans leurs boyaux plongeant, rouges, les mains,
Avec votre bonheur ému le mien : coup double.
*
80
Au pied de l’alcôve II
Un soir, avant d’aller chercher vos somnifères
Et vos boules Quies en espérant dormir
Malgré le campement de clochards et d’ulcères
Aidés par la police et l’armée (à vomir),
Dans la rue où graillait cette orde métastase
Vous auriez entendu le silence… en extase.
Et depuis le balcon, vous prouvant ces douceurs,
Vous m’auriez vu couvert de sang, parmi les membres
Dispersés, les boyaux ; et de toutes les chambres,
Des femmes en peignoir qui me jettent des fleurs.
.
IV
CÉLIMÈNE
.
81
Madame, entendez-moi, j’aime plus que ma vie
Vos cheveux blonds, vos yeux d’azur, vos belles mains,
Le sourire céleste et profond qui convie
L’âme à l’évasion des occultes chemins
Dans la forêt où, seul, je vous parle et soupire.
Que ferez-vous, sachant le cas, de votre empire
Sur mes jours, sans beauté loin de vous, loin du rêve ?
N’avez-vous point d’orgueil de mon amour pour vous ?
Et comment de mon sort essuierai-je les coups
Si dans mon cœur se fige et se glace la sève ?
*
82
Madame, j’ai pour vous un amour si brutal
Que j’étouffe en pensant qu’un autre homme vous plaise
Et, quand votre statue est sur son piédestal,
Qu’autre Pygmalion sur la bouche vous baise.
J’enrage de savoir sur vous des yeux posés
Et ne sais quels tourments aux égards méprisés
Par vos appas pourraient apaiser ma colère.
J’ignore le moyen pour vous de me complaire
Assez dans cette rage hostile à tout venant,
Pour que je ne sois point fumant de jalousie
Quand vous ne distillez en moi douce ambroisie
Par de longs regards d’ange heureux m’illuminant.
*
83
Madame, je tuerais mon rival devant vous
Si vous imaginiez m’éprouver de la sorte.
Ne vous délassez point ainsi car mon courroux
D’un innocent irait se poster à la porte.
Si vous n’avez pitié de moi, jaloux méchant,
Faites pour le moins grâce au céladon touchant
Qu’il vous amuserait de placer sur ma route.
N’ayez de son trépas, Célimène, aucun doute :
Mon gant le giflerait sous un prétexte vain
Et mon estoc ensuite ouvrirait sa poitrine.
Soyez sage, brodez quelque idylle ou marine
Ou quelque bergerade avec nymphe et sylvain.
*
84
Madame, je tuerais devant vous mon rival
S’il vous prenait le goût de faire la coquette.
Un caprice peut être et frivole et fatal,
Veuillez ne point pousser trop loin votre conquête,
Si vous ne souffrez pas que soit versé le sang,
Quand me défend l’honneur de ravaler mon rang.
Agréez ce conseil d’un ami très fidèle
Et vous épargnerez à quelque parentèle
Le deuil, causé par vous, d’un pauvre malheureux.
Je ne puis vous laisser prétendre que vos charmes
Ont, m’étant réservés, d’autres suites qu’alarmes
Pour ceux qui se verront consumer dans leurs feux.
*
85
Loin de vous, cette vie est une mort cruelle.
Je ne sais, inquiet, si vous pensez à moi
Ou m’avez oublié, si vous demeurez celle
Qui régnait sur mes jours, qui me donnait ma loi,
Ou si pour vous mon cœur n’est plus qu’une ombre vague
Quand vous n’entendez plus son battement, la vague
Qui sans cesse venait sur le sable courir
D’un littoral heureux, avec un long soupir.
Loin de vous je n’ai plus d’espérance et de joie,
Je n’ai plus de soleil et n’ai plus d’horizon,
Il n’est plus dans mon île une belle saison,
Je ne vois plus vos yeux, pour qu’à l’amour je croie.
*
86
Loin de vous, cette mort qu’est la vie, à quoi bon
La vanter, lui prêter des beautés admirables ?
Leopardi l’a vu, la seule illusion
Qui nous rende les jours en ces ombres passables,
C’est l’amour, et mon cœur loin de vous s’est fané.
Célimène, pourquoi faut-il que je sois né ?
Notre amour, tout mon bien, vous l’immolez au monde,
Ô vous sacrifiez sa vérité profonde,
Sans pitié pour celui qui vous devait son port.
Que ne me versiez-vous du poison dans un verre,
En partant ? c’eût été clémence humanitaire.
Vous avez votre vie et moi, donc, j’ai ma mort.
*
87
Vous m’aviez dit, ce jour entre tous le plus beau,
Si beau ! que vous m’aimiez. Puis vous êtes partie,
Le jour où s’est ouvert devant moi le tombeau
Et sur mon cœur tombé la dalle appesantie.
Qu’ai-je donc entendu ? Ce propos mensonger
À qui n’était pour vous, ainsi, qu’un étranger,
Perfide, oserez-vous le déclarer sincère ?
Si c’était un serment, vous ne le tenez guère.
Était-ce une promesse, elle vous engageait.
Mais vous avez bientôt trahi cette parole
– Et me voilà perdu, sans chemin, sans boussole –,
Comme si cet amour, de vous rien n’exigeait.
*
88
Vous m’avez déclaré votre amour, ce fut beau,
Mais un jour je fus seul, car vous étiez partie.
Je regardais autour de moi, dans le tombeau
Où vous m’aviez laissé : fermé, pas de sortie.
Je n’osai point le croire, et j’attendis longtemps
Une clé, le retour avec vous du printemps,
Mais quand il devint clair que s’était envolée
Ma sylphide, je sus que ma prison gelée
Enfermait dans ses murs la fin de tout espoir.
Perçant, désabusé, le secret de mon être,
Qu’il aurait mieux valu pour moi ne jamais naître,
Puis-je vous accuser de me le faire voir ?
*
89
Je ne sais même plus si vous me l’avez dit,
Que vous m’aimiez, tout passe et de mon cœur ne reste
Que des cendres au vent, le désespoir grandit
Seul en mes jours sans joie, en ce vide funeste.
Tout passe… non, vos yeux sont restés ma prison.
Puisque je ne suis plus nef à votre horizon
Et je n’ai point de port en vos tendres caresses,
Je vous tends un bouquet de toutes les tristesses,
Et dans mon sein n’est plus qu’un abîme sans fond.
Ô je vous aime tant, mais vous êtes partie !
Dans le jardin désert ne pousse que l’ortie
Déchirant un autan qui tourne, tourne en rond.
*
90
Célimène, pourquoi faut-il que je sois né,
Quand, après m’avoir dit que vous m’aimiez – ô joie ! –,
Vous partez, me laissant hagard, abandonné,
Ne me relevant plus du jet qui me foudroie ?
C’est comme si, m’ouvrant pyxide avec trésor
Pour éblouir mes yeux de diamants et d’or,
On s’évanouissait tel un mirage ensuite
Sans que j’eusse fermé les deux mains assez vite.
Où vous trouver ? Je suis si loin d’être Sherlock.
Direz-vous, quand j’irai m’affliger aux corneilles,
Que me jouaient un tour bien fâcheux mes oreilles ?
Qu’êtes-vous donc, pour fuir avec le chant du coq ?
*
91
Ces mots… c’était un rêve, et vous êtes partie
Sans m’avoir adressé que les propos banals
Qu’on tient à ceux qui sont très loin de notre vie,
À moi pour qui vos yeux si beaux furent fatals.
C’était un rêve et si l’on veut vous faire un blâme
De mes discours, que tant soit maudite mon âme
Que chacun des enfers ait une éternité
Pour elle dans ses puits de tourments et de soufre.
Qu’on m’arrache la langue, au plus sinistre gouffre,
Cent fois par jour avec un coutelas denté.
*
92
Resplendissez, Madame ! Au banquet, je vous vois,
D’un châle étincelant les épaules couvertes,
Votre gorge à l’éclat de rutilant pavois
Ceinte de diamants et d’émeraudes vertes,
Avancer telle un cygne, en fendant la touffeur,
Sous les lustres versant leur cascadante fleur
Sur le rayonnement de vos cheveux si flaves
Et le poudroiement chaud de sourires suaves.
J’entends les chuchotis dans votre tourbillon :
« Quel homme est le secret de cette nitescence ? »
Quel enviable amour imprime son essence
En ce cœur débordant au féerique sillon ?
*
93
Telle un cygne fendant les eaux, miroir de lune,
Je vous vois dans la presse ébahie avancer,
Des pendants scintillants d’oreille peu commune
Sur un ondoyant lit de platine danser,
Tandis qu’une rivière étincelante et pure
Par ses bleus diamants dont votre col s’azure
Semble sur votre gorge un torrent d’oasis.
Et la tête me tourne, avec ce teint de lys
Et ce pas gracieux, ce port et cette ligne,
Quand vos doigts annelés d’opales arlequin
Passent sur vos cheveux d’or ou le casaquin.
Je meurs de vous aimer, tel est mon chant du cygne.
*
94
Quand la verte émeraude éclabousse ta gorge,
Je me sens enlevé vers un lieu tropical.
Tes cheveux, ces guérets dorés, ondoyants d’orge
De nos pays, soudain deviennent un métal
Précieux qu’Espagnol je prends à des caciques,
Aux dieux sanguinolents d’hallucinants Mexiques.
Mais aussi, je le vois ! que roulent ces ruisseaux
De perles qui sinuent en miroitantes eaux
Par d’agrestes vallons, de tremblantes collines.
Tu révèles tes doigts annelés de grenat –
Fallait-il que ton cœur, aimant m’abandonnât ? –
Et de diamants purs, d’ambre, de tourmalines.
*
95
Les yeux de Célimène ont ravagé mon âme,
Dévasté mon esprit, démoli ma raison,
Anéanti ce moi du brasier de leur flamme,
Rasé l’être pensant, ah quelle fauchaison !
Quel cyclone barbare, ah l’inouï déluge !
Le cataclysme énorme ! il n’est aucun refuge
Contre ces yeux, pitié pour mon cœur fulminé !
Est-ce pour ce chaos fatal que je suis né ?
Pour devenir un tas de décombres lyrique ?
Pour couler jusqu’au fond du gouffre glacial ?
Le pouvoir de ces yeux ! De quel nerf spécial
Sort un tel foudroiement de puissance électrique ?
*
96
Célimène a chassé ma raison, je suis fou.
Il ne faut pour cela qu’un regard, quelle vie !
Pourrai-je me soigner d’un tel coup de bambou,
Plus grave qu’un catarrhe ou qu’une synovie ?
On veut un jour enfin prétendre au doctorat,
Le lendemain on est fait, refait comme un rat ;
Un jour de Feuerbach et Foucault l’on pérore
Et puis le lendemain on jure qu’on l’adore
À Célimène, blonde, ô blonde comme blés.
On a beau d’Althusser et de Marx tout connaître,
En soupirant l’on dit qu’on vient juste de naître.
Et c’est que d’un regard nos sens sont endiablés.
*
97
Célimène, je veux m’immoler pour vos yeux.
Quelle existence vide et funèbre, en l’absence
Des supernels plaisirs et dons prodigieux
Dont chaque jour comblait mon cœur votre puissance.
Daignez faire de moi le docile instrument
De votre volonté souveraine : comment
Puis-je servir ? Veuillez me signifier l’ordre
Qu’au péril de ma vie accomplisse mon bras.
Je serai votre chien, défierai les ingrats
Et quiconque vous nuit : signalez-moi qui mordre !
*
98
Vos lèvres, Célimène, ont, je le sens, un baume
Pour mon esprit en feu, qui vous peint et repeint
À chaque instant de veille et de rêve, au royaume
Céleste où, vous aimant, épris mon cœur atteint…
S’il n’est à mon amour, aussi, rien de plus tendre,
Que n’avez-vous conçu qu’il importait d’attendre
Le jour où nous devions vous et moi nous trouver ?
Et lorsque ce jour vient, ainsi qu’une évidence,
Que c’est là ma moitié, don de la Providence,
Quelle part m’avez-vous bien voulu réserver ?
*
99
Si j’avais, Célimène, au bon endroit poussé,
Fait de Louis-le-Grand la course magnifique,
Je n’aurais point failli, non, point tergiversé,
En observant l’éclat de ton œil séraphique,
À te tambouriner sensiblement mes feux ;
Et, sûre de ton choix, tu me rendrais heureux,
Car tu m’aurais connu pour un sujet d’élite.
Tel que tu me voyais, tu ne pouvais savoir
Si je n’avais l’esprit, voire un fond de sang noir.
Et si je suis un clown, c’est sans aucun mérite.
*
100
Célimène, ton nom presse et passe ma bouche,
Quand je m’épanche ému dans la fraîcheur des bois.
Je vais seul en ce monde, avec un air farouche.
Je vais seul mais je t’aime, ô plus que tu ne crois.
Si haute, et moi si bas, n’étant l’ancien élève
D’aucun Louis-le-Grand où l’auguste s’élève,
Se fait un nom connu, peut devenir quelqu’un.
Point de Louis par qui le prestige déferle,
D’un pourceau la vertu sans sésame est la perle.
Et si je suis un clown, c’est sans mérite aucun.
La Lune chryséléphantine: Poèmes
Le recueil poétique La Lune chryséléphantine, présenté ici, a paru en 2013 aux Éditions du Bon Albert et reçu le deuxième prix du Prix Stephen Liégeard 2015.
C’est le quatrième et dernier recueil que nous avons publié par la voie d’un éditeur. Les recueils suivants ont été publiés directement sur ce blog.
Le Bon Albert nous avait été présenté par un ami commun, c’est grâce à nos relations que nous avons pu faire paraître des recueils chez un (micro-)éditeur. Notre tentative auprès des maisons d’édition parisiennes, avec le précédent recueil Opales arlequines, ne reçut que les réponses de refus polies et génériques dues aux gueux, y compris de la part de L’Harmattan, maison qui fait pourtant payer les écrivains qu’elle édite et ne risque donc pas d’essuyer des pertes financières. Je n’ai pas cherché à réitérer l’expérience.
Je n’entends pas, avec la publication en ligne de mes recueils réécrits, donner raison aux pontes de notre culture commercialisée de leur choix de m’appliquer le traitement par défaut, car s’ils avaient pensé qu’une réécriture eût pu sauver quoi que ce fût dans mes vers, ils n’eussent pas manqué de me le dire, au lieu de m’envoyer leur lettre générique de refus (y compris, pour l’un d’entre eux, manuscrite, à savoir, d’une belle écriture à la main polycopiée, ce qui montre une rare cuistrerie et nullement de l’élégance, comme il semble le penser). Pour qu’ils sussent dans quelle mesure un poème versifié peut gagner le moins du monde à être remis sur le métier, il eût fallu qu’il se trouvât parmi eux des gens à qui cette pratique littéraire n’est point étrangère. Or nous savons que la versification leur est étrangère depuis bien longtemps, et qu’ils sont même parfaitement xénophobes à cet égard. Je ne pouvais donc même pas être incité par ces refus à améliorer mon écriture poétique, leur jugement sur ce point étant celui de profanes ténébreux.
.
I
.
I
Le parc
Souviens-toi du printemps de nos quatorze années.
Des lilas embaumaient le parc luxuriant,
Aux enfants amoureux tellement attrayant
Par ses bosquets profonds, ses vasques surannées.
D’être ensemble si bien deux âmes étonnées,
Étoilés, souviens-toi, de clair-obscur brillant,
Nous vîmes dans nos yeux des pleurs, en souriant,
Partageant vœux secrets, promesses devinées.
En ce jour du printemps, tous les jardins de fleurs
Firent à notre amour don de mille couleurs
Afin que nous sachions quelle grâce est la vie.
Aujourd’hui me voilà sur ces lieux retourné,
Seul, séparé de toi par la route suivie.
Pardon pour le baiser que je n’ai pas donné !
*
II
Si nul ange des cieux ne nous dit ces paroles,
Aux accents ravissant ceux qui les ont ouïs :
« L’amour est descendu dans vos cœurs éblouis
Ainsi qu’une onde pure en de blanches corolles »,
Chacun de vos regards, chastes et doux moments,
Est une effusion de tendres sentiments
Dont le cher souvenir en mes songes essaime.
Un sourire céleste a fait voler mon cœur ;
De ma timidité son éclat fut vainqueur ;
Je sais que vous m’aimez, et vous que je vous aime.
*
III
Vous me faites languir, Madame, sans raison.
Enfin ! vous qui goûtez la belle prosodie,
Vous que les vers bien faits rendent toute ébaudie,
Que des sonnets galants jettent en pâmoison,
Où sont-ils, mes rivaux en cet art d’oraison ?
S’il n’en est point, le jeu tourne à la comédie.
Et si la nation se trouve d’art grandie,
Retenir les lauriers n’est-il point trahison ?
S’il faut encourager le goût parmi nos gens,
Cultiver ce don-là, dont ils sont indigents,
Examinez l’effet de vos rigueurs extrêmes.
Votre sévérité me met au désespoir.
Soyez la volupté des cours d’amour suprêmes :
Vous trouverez la paix en ce noble devoir !
*
IV
In Pace
I
Hélas, c’est dans les cieux que sont tes lendemains
Et dans l’éternité que tu grandis encore.
Le monde t’avait vue, âme de rose, éclore
Caressant le bonheur dans tes petites mains.
Ô noble ange d’amour pourvu de traits humains,
Pourquoi laisses-tu seul l’univers qui t’adore ?
Nous souffrons, nous pleurons, chacun s’afflige, implore,
Et tout a goût de cendre, et nos rêves sont vains.
Nous n’avons plus de jeux, nous n’avons plus de joie ;
Nous tremblons au malheur que le ciel nous envoie ;
Nul de nous n’aperçoit ce qui nous sauverait.
C’est la captivité, Babylone fulmine,
C’est le désert encore où tout le peuple errait,
La déréliction, catastrophe, ruine !
II
Quoi ! la terre te voit la quitter pour le ciel,
La quitter pour toujours, sans cesser de tourner !
Et nous éprouverions le goût d’y séjourner,
Après un sacrifice aussi démentiel !
Le déluge retient son flot torrentiel !
Le noir Léviathan ne vient pas l’enfourner !
Ô le temps ne peut-il sur ses pas retourner
Et nous rendre la joie, où n’est plus que le fiel ?
La main qui te donnait sa plus tendre caresse,
Las ! se pose aujourd’hui sur un sein en détresse.
Comme saigne ce cœur si pénétré de toi !
Excuse ma révolte et reçois cette offrande ;
Que ne puis-je adoucir, d’un moins débile envoi,
En son cœur maternel une peine si grande…
III
Comme une frêle fleur par le vent détachée,
Comme une fleur qui tombe, à ses sœurs arrachée,
Et qu’appelle vers lui l’azur étincelant,
Comme une fleur qui va dans la nue en tremblant,
Que ne cueille la main, que la main n’a touchée,
Que l’averse n’a point sur la terre couchée,
Comme une fleur qui naît au ciel en s’envolant
Et que porte la brise aux nuages dorés,
Ton enfant est en Dieu ; ton enfant te regarde.
Si tu n’entendras plus ses rires adorés
En ce monde imparfait,
l’Amour divin la garde.
*
V
Quand je veux m’épancher en vers tendres et doux,
Je tremble à chaque mot, Philis, de vous déplaire ;
Je ne sais si mon cœur est pur, mon âme claire,
Ni si mes sentiments sont bien dignes de vous.
*
VI
Ô laissez-moi pleurer mes extases perdues,
Alors que la jeunesse a passé sans retour ;
Pleurer un doux émoi, plus beau de jour en jour,
Qui nous voyait unis, nos âmes confondues ;
Un sourire de sœur, ses mains vers moi tendues,
Pleurer un rêve fou de soulas et d’amour !
La jeunesse est finie et j’ai passé mon tour,
Je ne connaîtrai pas les grâces attendues.
Plus vieux de jour en jour, mon cœur n’a plus d’espoir,
Plus d’élan, plus de rêve, et lorsque vient le soir
Je vois en étranger mon passé, sa promesse.
Tant que j’aimais, j’avais encore un avenir.
Mais ce hère, si seul, éploré, sans tendresse,
Quel bien lui reste-t-il, qu’un cruel souvenir ?
*
VII
Présent trop insensé d’un Destin négligent,
Quel chagrin, quelle honte en mon âme asservie !
À qui puis-je avouer le secret de ma vie ?
L’objet de mon désir a des cheveux d’argent.
Las ! faut-il que je sois bien inintelligent
Pour que d’appas plus frais mon cœur ainsi dévie,
Et que ce crépuscule attise mon envie,
Qu’une ruine, enfin, me trouve diligent !
Est-ce d’avoir, si jeune, assommé par l’effort,
Bravé les passions, méditant sur la mort,
Que je veuille aujourd’hui d’une telle amertume ?
Ou bien que de ce corps glissant vers son tombeau
Ne montent des parfums plus forts que de coutume,
Échauffant jusqu’à la froideur de mon cerveau ?
*
VIII
Le faune
Ah, que mon chalumeau de roseau dur est triste !
Mais dès que j’aperçois au milieu de la piste
Le dessin de tes pieds, je cueille des bouquets.
Nymphe dont la blondeur est la seule tunique,
À l’affût de tes jeux, satyre des bosquets,
Je rêve à chaque instant, moi, que je te panique.
*
IX
Certes, si votre époux, comme Candaule épris,
En moi voulait bien voir un Gygès incrédule
Pour le faire témoin du joyau qu’il adule,
« Volontiers », lui dirais-je, et j’en connais le prix !
Hérodote I, 8-11
*
X
L’automne est revenu, drapé de feuilles mortes,
Et les jours sont moins longs, l’obscurité grandit,
Les gens rentrent chez eux, le froid les engourdit,
Les boulevards muets m’ouvrent leurs tristes portes. –
Saluons ton retour lugubre et diligent,
Compatissant automne aux lumières d’argent,
Ange annonciateur des funèbres étreintes !
Parmi l’or mat des bois angoissés de leur fin,
Je m’en vais, solitaire, en proie à tant d’atteintes,
Vers la nuit de l’amour, comme au fond d’un ravin.
*
XI
Nos cœurs l’un dans l’autre abîmés,
Comme nous nous sommes aimés !
Je vois encore ton sourire,
Et comme alors mon cœur soupire.
Je pense toujours à nos jeux :
C’étaient, en riant, nos aveux.
– Et les fleurs que tu m’as données
Pour moi ne se sont point fanées.
Leur parfum me rappelle à toi.
– Que j’étais heureux sous ta loi !
Mais je ne sais pas – ô comprendre ! –
Ce qui brisa ce nœud si tendre,
Ce qui m’a de toi séparé…
Qui de nous a le plus pleuré.
Je crois que des mots m’échappèrent,
Des mots fous qui me désespèrent.
Et comme si rien ne restait
Du rêve qui nous exaltait,
Chacun reprit ses habitudes.
Au lieu d’amour, deux solitudes !
C’était un jeu, n’est-il pas vrai ?
Dis-moi que non, je le croirai !
– J’ai gardé toutes ces années
Les roses que tu m’as données ;
Dans mon cœur, dans mon souvenir,
Tant de beauté ne peut finir…
*
XII
Des lanternes vénitiennes,
Une nuit de bal en été.
Je voudrais tant que tu retiennes
Contre toi mon cœur exalté.
Ne serai-je rien dans ta vie ?
Je n’ose pas me déclarer.
Toi que j’aurais partout suivie,
Tu pourras toujours l’ignorer ?
Et tu passeras sans comprendre,
Toi pour qui j’aurais tout donné,
Tout ce que je devais te rendre,
Tout ce qui t’était destiné ?
Le bonheur de t’aimer, la joie
De connaître ce sentiment
Qui m’élève quand il me ploie,
Veut mon éternel dévouement.
Et j’ai si peur de perdre l’âme
Si tu ne prends ce qui t’est dû,
Si je ne peux offrir ma flamme
Pour t’être à jamais confondu ! –
Apaise, ô nuit étincelante,
Ma trop grande fébrilité,
Accorde à mon âme brûlante
L’ombre de ton immensité !
*
XIII
Galatée lointaine
Quatrains
.
Commisération
Ô toi la compassion même,
Qui plains ceux qu’atteint le malheur,
Tu pleurerais de tout ton cœur
Si tu savais comme je t’aime !
.
Le jars
Sur un tableau du musée d’Oslo
Le jars qui voit passer son peuple migrateur
Dans le ciel automnal, lié par une corde,
N’est pas plus malheureux, plus triste que mon cœur
Soumis à cet amour pour toi dont il déborde !
.
Quand je vois que d’aucuns, en liens trop étroits
Avec vous, n’ont pas même une face pâlie,
N’ont pas l’air obsédé par une âpre folie,
Je comprends mieux comment des borgnes sont nos rois !
.
Puisque tu ne veux point de mon amour fidèle,
T’en réjouir serait signe de vanité ;
Mais moi qui chaque jour souffre par la plus belle,
J’aurai raté ma vie, et c’est là ma fierté !
.
Si j’étais un roi maure en sa cour de Séville,
Et que tu fusses mienne – on peut toujours rêver –
Mille épouses perdraient le goût de se lever,
Sûres de ne plus voir mon œil qui s’écarquille !
.
Sur un îlot comme une fleur,
Si tu m’y donnais ton suffrage
En te pressant contre mon cœur,
Que je voudrais faire naufrage !
.
Dites-moi qu’elle dort en un château dormant
Gardé par un dragon dans un hallier d’épines ;
Alors je baiserai ses lèvres purpurines ;
Mais ne me dites pas qu’elle a son jugement !
.
Il faut souffrir pour être belle ?
Et moi qui m’afflige en tout lieu !
Comme elle est à plaindre, mon Dieu !
Personne ne souffre autant qu’elle.
.
Enfant, il m’en souvient, j’imaginais longtemps
Dans un Éden lointain une parfaite idylle.
Quand parurent, plus tard, tes appas éclatants,
Pantois je reconnus l’âme sœur de mon île !
.
Le vain conseil rassis, que je crus bon de suivre :
J’ai fait le tour du monde et n’ai pu t’oublier.
Quels que soient les tourments et l’échec, mon cœur ivre
En roseau délirant ne cesse de plier !
.
Eussé-je quelque crainte envers sa chasteté,
Piqué j’entreprendrais aussitôt sa conquête,
Mais pour être jaloux elle n’est point coquette.
J’admire sa pudeur, je hais ma lâcheté !
.
Ne croyez pas mes feux endormis sous le sceau !
Mais depuis vos rigueurs mon air est si morose
Qu’une femme rirait si j’osais quelque chose.
Je finirai peut-être où commença Rousseau† !…
† Les confessions, début du troisième livre.
.
La chair est si peu triste, hélas, qu’elle me tente
Quand ta rigueur m’accable et m’ôte tout moyen ;
Les livres, j’en ai lu je ne sais pas combien,
Mais je reste en amour un pauvre dilettante.
.
Oui, je puis me flatter que tu me distinguas,
Que tu me fis entendre être fort prévenue.
Mais c’était malgré toi, bonne et douce ingénue :
Tu ne peux réparer tes immenses dégâts !
.
Bénédiction du chevalier servant
Étendu devant vous bras en croix, face à terre,
J’entendrai le latin qu’un rendu nous lira.
Béni de vous garder dans mon cœur solitaire,
Tout ce que je ferai pour vous réussira.
.
Les jours nous sont comptés. Sans doute, un beau matin,
La flatteuse vigueur aura triste visage,
Et même avant son temps, faute d’en faire usage !
La vertu qui te plaît me vaudra ton dédain.
.
Elle m’a laissé seul trop longtemps à chanter.
Quel dépit, quel dégoût pour la force caduque
Quand ma chanson finit un jour par la tenter,
Et qu’au lieu d’un amant elle embrasse un eunuque !
.
Vois, je n’eus de vertu que le temps de creuser
La fosse où s’engloutit ma misère spectrale.
Je suis cette momie avide et sépulcrale
Qui veut connaître enfin le goût de ton baiser !
.
Tu est une autre
– Votre visage hier évoquait certain conte,
Aujourd’hui vous avez un tout autre profil ;
Or laquelle des deux êtes-vous ? qu’en est-il ?
– Deux ? Attendez demain : vous êtes loin du compte !
*
XIV
Autres Quatrains
Le docteur me voyant hâve, les traits tirés,
Conseilla du repos à la montagne, en cure.
Oui, dis-je, c’est mon vœu ! bien loin, dans la nature,
Que ma peine s’exhale en chants désespérés.
Les voilà, ces sapins à la sombre verdure,
Cette gorge profonde aux nonchalants détours… (Alfred de Musset)
.
Les brahmes, véritables dieux
Sur la terre, avaient l’âme chaste ;
Mais leurs enfants n’étaient pas d’eux,
Ils ne purent sauver leur caste.
.
Qu’est donc le Taj Mahal ? La lumière du jour
Sur le sein de la mort, le tombeau d’une femme.
Son époux l’a pleurée, et de toute son âme ;
La sagesse d’Allah a permis cet amour.
.
Je suis du Languedoc : si j’ai le profil grec,
Je me sais tout de même une âme sarrasine.
De mon ancêtre Eldin† j’ai reçu, sans lésine,
Le don de m’enflammer comme du bois bien sec.
† C’est le même nom qu’Aladdin !
.
Si j’étais convaincu, quand elle s’est offerte,
Qu’une femme pût vivre en dehors de ma loi
Et se bien consoler d’une si grande perte,
Je n’aurais pas pitié d’elle plus que de moi !
.
Lourdes
C’était le vœu de qui devait changer de peau
Et, devant sa débâcle, expier, être austère.
Mais quelle place prendre au milieu du troupeau ?
Les insultes pleuvaient sur mon cœur solitaire.
*
XV
Le costume d’Ève
Ta vénérable aïeule, une attique matrone
Ou sa nièce latine, endossait, au dehors,
La calyptra, le sceau digne de sa personne,
La dérobant aux yeux du manant, des butors.
Leur fille, un peu plus tard, paraissait sous un voile
Ou bien une mantille, une mante, ou le loup ;
Eût-elle la splendeur de la plus belle étoile,
C’était assez qu’un seul en essuyât le coup.
Oui, voilà ce qu’était naguère la toilette !
Et leur petite-fille, il n’est pas si longtemps,
Ne sortait pas sans mettre au chapeau sa voilette,
Qui rendait indistincts ses attraits éclatants.
Mais toi, tu vas et viens dans le costume d’Ève
– Quasiment ! –, tous voyant ton charme ensorceleur ;
À quel danger s’expose un regard qui se lève
Quand tu passes ainsi, te l’apprend mon malheur.
*
XVI
Du mérite
la colère du rang contre le mérite (Stendhal)
Si ton ambition, jeune homme, est élevée,
Que ma plume t’enseigne une voie éprouvée :
Recours au fascinum autant que tu pourras.
Un aspect cornichon est de nul embarras
(Je ne te parle point ici de ta prestance :
Elle n’aura jamais qu’une faible importance)
Et telle asymétrie aisée à constater
Est bien normale et ne doit pas t’inquiéter.
Tu me comprends, esprit indompté, solitaire ;
Ton angoisse d’enfant ne m’est pas un mystère.
Gagne-toi les faveurs, et ta place au soleil.
Quand d’aucuns prétendront te donner ce conseil
En taisant le moyen du plus grand avantage,
Savoir en écartant les doutes de ton âge,
Tu sauras qu’ils pouvaient faire ton désespoir
Si tu n’étais vraiment certain de ton pouvoir.
–
Dans la préaucratie, où le bachoteur monte,
Recours au fascinum à chacun de tes pas !
Si tu crois que l’amour ne te le permet pas,
Ce scrupule ne peut te sauver de la honte.
*
XVII
Lex
Aldhane, fille, ayant mis au monde Merlin
Et tu devant la cour dûment instituée
Le nom du séducteur (car c’était le Malin)
Devait, suivant la loi, ou bien être tuée
Ou, parce que sa faute introduit le déclin,
Se faire sur le champ vile prostituée.
*
XVIII
Je ne vois pas comment l’on peut tromper sa femme.
Vous avez avec elle un rapport régulier –
Mettons qu’une ou deux fois par semaine elle pâme
Entre vos bras – eh bien, il serait singulier,
Si vous avez ailleurs jeté votre semence,
Qu’elle n’observât point comme la quantité
Que vous lui servez là n’a pas cette abondance
Qui la porte si bien à la félicité.
Elle voudra savoir si vous êtes malade !
À moins qu’elle ne songe à votre thème astral,
Au flux de la marée, à quelque galéjade
Que vous débiteriez d’un ton professoral…†
† La solution du paradoxe se trouve dans notre livre The Science of Sex: Psychology and Competition, de 2016. La quantité de sperme éjaculée n’est pas principalement une fonction « mécanique » intuitive mais une fonction « téléologique » dans le cadre de processus de « compétition spermatique ». (En gros, un homme éjaculera la même quantité de liquide séminal dans deux rapports consécutifs avec sa maîtresse puis sa femme, tandis qu’il éjaculera une quantité décroissante au cours de rapports consécutifs avec la même femme.) Si même le tractus féminin peut être supposé suffisamment « précis » pour faire la différence entre la quantité de deux éjaculats. On admettra que ce tractus est particulièrement sensible, pour des raisons évidentes, mais que cette sensibilité rende possible la transmission au cerveau analytique d’une information de cette nature était sans doute déjà une hypothèse hardie, même dans un modèle mécanique. Le poème est bien sûr à prendre au second degré : qui pourrait douter que les femmes sont trompées ? (2025)
*
XIX
Éprends-toi d’une femme au-dessus du troupeau
Et fais de ton serment l’aune de ton mérite ;
Opiniâtre-toi dans un rêve trop beau,
Le cœur tout dolent, l’âme expectante et contrite ;
Ne cesse pas de croire, au nez des rodomonts,
Qu’en ce monde tu vins pour t’y montrer fidèle,
Et qu’il faut récolter après que nous semons ;
Repousse tout plaisir qui ne te viendrait d’elle.
Comme ce sexe est faible, elle doit te céder
À la fin, c’est normal. Cependant ta posture
Aura d’abord fini par te déposséder
De ta vigueur. Alors ? Tant mieux. Tant pis, Nature !
*
XX
Le dieu-vampire
Le soleil dans sa chute, en diamants de feu,
En gerbes de rubis évanescents éclate
Sur le miroir stagnant du Cénote écarlate.
Le soupir des forêts s’exhale peu à peu.
En l’azur envoilé de pourpre camaïeu,
Comme après l’holocauste arde la pierre plate,
La nuit a bu le sang du jour et se dilate,
Tonatiuh s’éteint ; s’élève un autre dieu.
Gouffres cyclopéens, cavernes éthérées
Soufflent des tourbillons de stryges altérées,
Essaims silencieux, par leurs mufles béants ;
Et de l’abîme noir, du profond labyrinthe
S’enfonçant dans la terre en limaçons géants,
Jaillira Camazotz à la hideuse étreinte.
*
XXI
Les zouaves à Veracruz
Où l’aigle mord, crachant et déroulant ses nœuds,
Le serpent qui se tord en sifflements de rage,
Les zouaves français abordent au mirage
Surplombé par les pics de monts fuligineux.
D’écarlate et d’azur dans le jour lumineux,
Quel obstacle pourrait dominer leur courage ?
Non, la nuée altière, augure de l’orage,
Ne les fléchira point sous son vol moutonneux.
À travers les halliers où plane le vampire,
Les cañons colossaux d’un fantôme d’empire,
Napoléon déploie un ost en diamant.
Et Maximilien à la barbe dorée,
Ainsi que Zorrilla le grave au firmament†,
Dans la légende, en preux maudit, fait son entrée.
† Le célèbre écrivain espagnol José Zorrilla fut poète de cour sous le règne de Maximilien Ier du Mexique. Il écrivit sur Maximilien et le Mexique le long poème « El drama del alma ».
*
XXII
Magnus de la Gardie
Non, Magnus, chancelier du trône suédois,
Que tu fusses l’amant de la reine Christine,
Ce n’est point à cela que ma plume destine
Un hommage vibrant au plus grand des Audois.
– Je crains tant d’échouer que m’en tremblent les doigts –
Si Ponce, ton aïeul à l’âme adamantine,
N’avait quitté le mas de sa terre latine,
Quel Français eût reçu les vers que je te dois !
Upsal, où ta sagesse insigne l’a conduite,
A la Bible d’argent, par Ulfila traduite
En idiome goth, jadis sacramentel.
Et tu fus le soutien d’un esprit des plus nobles,
Rudbeck, qui dédia son ouvrage immortel,
Sa nordique Atlantide au fils de nos vignobles !
*
XXIII
Gargouilles à Manhattan
Surplombant la rumeur de la vaste cité
Qui telle un diamant dans la nuit étincelle
Et lance à l’univers l’éclat qui l’ensorcelle,
New-York, son grand tumulte et sa célérité,
Contienne l’air du soir tant d’électricité,
Le difforme animal dont la gueule ruisselle,
Qui domine le gouffre et jamais ne chancelle,
Atone, est accroupi, couvert d’obscurité.
Habitant des créneaux, sous la flèche gothique,
Paraissant détenir un secret fantastique,
La gargouille contemple et la foule et le ciel. –
Ô grotesques démons exhalés des ténèbres,
Indifférents témoins du malheur éternel,
Vous grimacez sur nous et nos destins funèbres !
*
XXIV
Minneapolis-sur-Seine
Voyez le billet ici.
*
XXV
La chute des Arabes du Congo
D’après The Fall of the Congo Arabs (1897), par Sidney Langford Hinde, capitaine dans « l’État indépendant du Congo », chevalier de l’Ordre royal du Lion.
Voyez le billet ici.
*
XXVI
Le rescapé d’Oman
Voyez le billet ici, où ce poème a été mis en ligne sous un titre alternatif « Le survivant du Yémen » (avec les raisons d’un tel flottement, à savoir que les faits historiques réels sur lesquels le poème est fondé se sont en réalité produits au Yémen).
*
XXVII
Les mystères de Bandar Seri Begawan
XXVIII
L’union mystique
XXIX
Mina de Batavia
Voyez « Le Diwân » ici.
*
XXX
Lesseps
C’est l’homme d’une idée, ergo c’est le grand homme.
Vous qui riez déjà, faites un peu la somme
De tous les livres lus par vous, et dites-moi
Quelle idée en jaillit dans votre tête. Eh quoi !
Que me déclamez-vous vos gloses byzantines,
Ces jeux pour écoliers, ces leçons enfantines :
On pourrit, avec ça, pendant quatre cents ans
Et puis on disparaît après deux mots plaisants.
Lesseps, c’est le grand homme, il a changé le monde,
C’est par sa volonté que cette terre est ronde !
Il a bouclé la boucle avec le feu sacré,
Avec la vision d’un esprit libéré,
Hors des sentiers battus ; de son pas solitaire,
Il a suivi la route inconnue au vulgaire.
Il avait devant lui le but, la mission,
C’était son leitmotiv, sa seule passion :
L’idée était Lesseps, Lesseps était l’idée,
Une idée incroyable et si coordonnée
Qu’il fallait qu’elle fût aussi réalité
Par l’acte de Lesseps, son organe entêté.
Que vouliez-vous qu’il fît des auteurs à la mode
Du jour au lendemain déjà plus vieux qu’Hérode,
De ces ratés contents, enflés, bavards, en toc
Qui touchent leurs cachets au ministère ad hoc,
Et de tout ce parti dit de l’intelligence
Qui n’est qu’un vil rebut, de la pire indigence ?
Intelligence, soit, mais avec l’ennemi :
L’ennemi du génie accablé, las, blêmi !
Voyez Lesseps en proie à ses tortionnaires,
Les financiers véreux, les hauts fonctionnaires,
Les politiciens, ce lugubre magma
Qui lui fait dégorger tout le sang : Panama !
Panama, Panama ! Les hâbleurs contre l’âme,
Les pets-de-loup élus et la basoche infâme,
Les crochets bien plantés dans la chair du héros,
Remplissent les égouts de leurs ventres bourreaux,
Vivant sur le génie en sales parasites !
Par d’ignobles moyens, des brigues illicites,
La nullité s’acquiert un air condescendant :
Sa pompe, c’est le trou du moustique obsédant !
*
XXXI
Je n’ai pas oublié Chaville, près des bois,
Ses pavillons fleuris de lilas et de roses,
Les jardins chatoyants de nos amours écloses…
Je n’ai pas oublié, j’y pense bien des fois.
Qui d’autre connaîtra volupté si suave ?
J’en demande pardon à la postérité,
Chaville est le pays où croît la liberté :
Celui qui n’en est pas a tout pour être esclave.
Ailleurs, qui recevra pareille élection ?
Avoir eu le bonheur de grandir à Chaville,
C’est devenir celui pour qui tout est facile,
À qui donne l’Amour sa prédilection.
Sous un ciel enchanteur, que les filles sont belles !
Ô Cassandre, ô Philis, avez-vous oublié
Que je vous fus, riant, à tout jamais lié ?
Je me rappelle, moi, ce jeu grave, ô cruelles !
Cruelles, est-ce vous qui donnez de la voix :
Il me fallait choisir, j’étais bien peu sincère !
Sincère, je l’étais tellement que la terre
Ni le ciel n’aurait pu me décider au choix.
Mais vous ne parlez pas et je m’illusionne ;
Je suis seul, loin de tout, loin de l’Éden en fleurs,
Vivant dans je ne sais quel monde sans couleurs.
Mon cœur veut s’épancher et ne trouve personne.
Que d’amis, que d’amour, de rires et d’émois,
Que de printemps joyeux, de rêveurs clairs de lune !
Que j’y retourne encore une heure, une seule ! Une !
Quelle brume m’a pris Chaville près des bois ?…
*
XXXII
Ses jours de passion sont des jours pleins d’angoisse ;
Un malaise profond le tourmente, le froisse,
L’accable, mais il rit, car il voudrait pleurer ;
Peine ou soulas, son cœur ne peut rien endurer.
Pourtant, le souvenir de ce temps a du charme !
Quand il veut surmonter ses faibles, quand il s’arme
Contre les violents délires de l’amour,
Son existence prend alors un nouveau tour :
La paix entre en son âme, il goûte une sagesse
Prodiguant à l’esprit ses dons avec largesse ;
Son mal-être prend fin, le doute est emporté,
Il conçoit cet état comme la Vérité.
Le temps passe, il est mûr, il moque ses folies.
Mais le temps passe encore, en vagues affaiblies,
Et l’attrait du désir n’est jamais bien vaincu :
Il songe et puis un jour dit qu’il n’a pas vécu.
*
XXXIII
Agir, je ne le puis sans un auxiliaire,
Mais les valets rendus il n’est plus de seigneur,
Et je dois contempler la kermesse vulgaire
Quand de géants désirs me labourent le cœur ! –
Dans son sourire, hier, que de tendres promesses !
Il faut que je sois fou pour en croire mes yeux.
Non, elles disent vrai, les hautes allégresses
Qui me chantent, depuis, des airs délicieux.
Que faire ? Que vouloir ? La fenêtre est bien close ;
La porte, sans sa clef, jamais ne s’ouvrira ;
Ses amis sont d’accord pour traverser ma cause,
Où donc est le Crispin qui me les distraira !
Hélas, elle sait bien, pourtant, ce que j’éprouve :
Tel geste imperceptible était tout à fait clair.
Et comment se fait-il alors qu’elle ne trouve
Quelqu’une à m’envoyer quérir comme l’éclair ?
Va, tais-toi, fanfaron, ces jactances sont vaines.
Mais je donnerais tout pour la voir un instant !…
Toujours tu porteras ces invincibles chaînes,
Et tu les baiseras toujours, en sanglotant !
*
XXXIV
Un sourire
Un sourire, dis-tu, décide de ton sort :
Depuis dix ans, un charme ineffablement fort
Gouvernerait ta vie, et toutes tes pensées,
Si je t’en crois toujours, avides, oppressées,
Voleraient sans répit vers l’objet singulier
Que tu n’as plus revu sans pouvoir l’oublier…
– En effet.
– Je ne sais s’il faut pleurer ou rire.
Concevoir ça : dix ans sous l’effet d’un sourire !
– Dix ans, et plus encore ! Il faut bien l’accepter
Puisque ce souvenir ne me veut point quitter.
Un sourire, oui, mais tel qu’il fit trembler mon âme
Et que, toutes les fois que j’y pense, je pâme ;
Mais tellement puissant que, s’il avait duré,
Tu n’aurais devant toi qu’un esprit égaré ;
Un souris, le plus beau des moments de ma vie :
À peine une seconde, et que n’ont point suivie
D’autres douces comme elle, à croire que mes yeux
Se sont fermés à tout ce qui vit sous les cieux
Depuis ce jour, ou bien que désormais personne
N’aura gratifié mon cœur, qu’elle emprisonne,
De pareilles faveurs, et qu’il n’est plus pour moi
De sourire en ce monde auprès d’un tel émoi !
Avoir vu ce sourire et quand même fait taire
Le désir subjuguant de me jeter à terre,
À ses pieds, aussitôt, lui jurant son bonheur,
Eussé-je dû passer pour un fou, sans honneur,
Cela reste le point dont j’ai le plus de honte.
Car je fis prévaloir sur le seul bien qui compte
De sottes vanités et des mots de néant.
Ainsi, puisque j’ai craint un geste malséant,
Il convient que j’expie, en amant solitaire
Qui ne peut décider s’il prie ou désespère.
Ce sourire, ce n’est pas de quoi se vanter,
Mais cela change tout, et je veux le chanter,
Qu’importe si l’on doit rire d’un tel spectacle.
Parce qu’un tel moment, crois-le, c’est un miracle !
Dieu n’en concevant plus de son côté – pourquoi ? –
Je vais vers ce qui peut m’affermir dans la foi.
Et je le dis bien haut : si j’avais vu les ondes
Ouvrir et refermer leurs tentures profondes,
Débusquer les démons des fous et des pourceaux,
Multiplier les pains et marcher sur les eaux,
Béat j’aurais suivi le troupeau des fidèles !
Ce qui m’a frappé, moi : d’angéliques prunelles
Effusant jusqu’au cœur leurs flammes de clarté.
Qu’elle m’ouvre le ciel de la divinité
Ou me laisse gémir dans la nuit ténébreuse,
Elle décidera si ma vie est heureuse,
Si j’ai cause de croire, ou si je ne suis rien…
– Ne voudrait-elle pas que tu fisses le bien ?
Et si ta convoitise, au fond, était mauvaise ?
– J’ai gagné de savoir, par dix ans de malaise,
Que le bien ne serait pas plus à respecter
Pour peu qu’on en jugeât sur ce qu’il doit coûter…
*
XXXV
Corps médical
J’arrivais au collège, à peine. Un bruit courait,
Dont s’amusaient beaucoup les grands. Qui le croirait :
Certain collégien de quatorze ans, non, treize,
Réglementairement avait, mal à son aise,
Subi l’inspection de ses moindres défauts ;
L’infirmière scolaire est l’objet du propos :
Il pensait cette épreuve arrivée à son terme
Quand elle demanda… Quoi ? S’il avait « son sperme ».
– Je ne sais pas. – Alors masturbe-toi ce soir.
Je pense qu’il suivit l’ordre ; il ferait beau voir
Que non ! L’autorité de la science est telle,
Il devait obéir. (En s’excitant sur elle ?)
Méconnaissant la cause, en ignorant l’effet,
Je me fis quant à moi révéler le bienfait
De la main comparée à poigne simienne ;
Son initiatrice est donc aussi la mienne.
Il ne serait pas dit que je resterais coi
À cette question si cruciale en soi.
(Espérais-je en secret que lançant, à l’épreuve,
Un oui bien net, je dusse en apporter la preuve ?)
Cinq ou six ans plus tard, nouvelle inspection :
L’infirmière me pose une autre question.
Vous me direz un jour si cela vous étonne,
Elle voulait savoir, cette brave personne,
Las ! si j’utilisais… Quoi ? Le préservatif.
De crainte de paraître un poil intempestif,
Je répondis : « Bien sûr ! » ; pour le coup, sur sa fiche
Un grand P fut porté : fraude, mensonge, triche !
Je répondis « bien sûr » mais, à la vérité,
L’instrument ne m’était d’aucune utilité,
N’ayant jamais eu l’heur d’en pouvoir faire usage !
Et je ne savais trop qu’en penser à mon âge…
Aussi, la question m’assomma, je pâlis,
Les destins sans retour se voyaient accomplis :
Malgré tous mes efforts pour séduire des femmes,
Camarades de classe et dédaigneuses âmes,
J’étais dans mon genus un cas de nullité
Que la Nature hait et repousse, un raté
Qui n’utilise pas le plastique, et pour cause !
J’aurais été Werther, ma séance était close :
Après un tel éclair révélateur sur moi,
Comment ne pas vouloir fuir le glaçant effroi ?
Dieu merci, j’en causai, pour me sauver du Diable.
Entendant mon récit, une âme charitable
Me dit que, dans son cas, il n’en fut point parlé,
Le mot « préservatif » ne fut articulé.
Ô joie ! ô quel bonheur ! La bourde prometteuse !
La question, en fait, m’était plus que flatteuse !
On avait en moi vu le beau Don Juan fatal
Que je promettais d’être, ah c’est monumental !
*
XXXVI
Nuage d’hélicoptères
XXXVII
Retour au civil, ou L’histoire d’un tueur en série
Voyez le billet « Guerre du Vietnam » ici.
*
XXXVIII
Cendre verte
Je sais que j’ai passé le point de non-retour.
Et si j’ai pu quitter ce délire sauvage,
Je sais bien qu’il faudra que j’y revienne un jour,
Car je suis l’ennemi d’un monde qui m’outrage.
Certes, je reculai, tant ce dérèglement,
Puissant dérivatif au poison de ma haine
Pour la routine absurde et son accablement,
Prit, avec l’habitude, un aspect de géhenne.
Quelles hauteurs, d’abord, dans le songe éveillé,
Dans la possession de terres inconnues,
Accueillantes ! Quels jeux pour l’esprit égayé,
Pour le moi qui s’étend à l’échelle des nues !
C’est donner, conquérant d’un plus noble univers
Enfin débarrassé de toutes ses scories,
À son morne destin des succès sans revers,
À sa soif de beauté des palmes refleuries.
La Beauté pour seul guide, être le souverain
D’un lointain paradis se donnant à notre âme,
L’Idéal embrassé si fort, d’un tel entrain
Que l’on voudrait mourir fondu dans cette flamme,
C’est la source de tant, oui ! de tant de plaisir
Que l’orgueil en devient la garde nécessaire.
Ce qui ne connaît point le rêve doit moisir
Dans l’hectique et puant pourrissoir qui l’enserre.
Mais qui voit apparaître, en un long rituel,
Une perfection de quiétude aimée,
Jouit de son idole et se montre cruel
Pour la foule profane, et comme inanimée.
Il revient du sommeil accablé par le bruit,
Par le foisonnement d’un marché qui lui crie
La médiocrité de l’humain ; il la fuit
Avec des mots secrets de franc-maçonnerie,
Méprisant, haïssant les non-initiés
Un peu plus chaque jour, certain de la sagesse ;
Quel écœurant troupeau que ces suppliciés
De l’ennui, ne pouvant aimer avec largesse !
C’est loin d’eux seulement qu’il se retrouvera,
Dans l’extase buveur d’onirique fumée,
Et dans l’obscurité douce qu’il goûtera
La pipe de jasmin en tremblant allumée.
Mais voilà, plus ce culte au bonheur est rendu,
Plus la réalité devient cauchemardesque.
Je daubai sur le monde en l’appelant tordu,
Puis j’eus peur, j’eus très peur de ma cible grotesque.
Je ne pouvais croiser personne sans frémir,
Sans voir dans les regards une flamme assassine.
Je me sentais si haut : non, l’homme, sans blêmir,
Ne pouvait endurer majesté si voisine !
Cela devenait fou ; d’ailleurs, je savais bien
Que l’on n’ignorait pas dans quel état critique
J’étais ; et chacun donc, me traitant comme un chien
Malade, de frapper son coup bas, diabolique.
C’est moi, poète, moi qu’on traita de robot,
Parce que j’errais seul dans la cité du vice !
C’est moi que l’on voulut convaincre de nabot,
Dans ce harcèlement, cet ignoble supplice !
Själakamp†, le complot des pantins contre moi :
Par la suggestion, les venimeux murmures
Dans le dos, et les mots taraudeurs, et la loi
Du plus lâche, ô le tas de viles pourritures !
Cela devenait fou, je me suis donc sauvé.
Une mystique ad hoc, un brutal ascétisme
Forcèrent le poison dont j’étais abreuvé.
Je vécus quelque temps dans un noir fanatisme.
Triomphant de mon moi, j’en tirai vanité,
Car c’était bien toujours le mépris de ce monde
Qui m’élevait plus haut, plus haut que la cité,
Vers le trône de Dieu, contre le siècle immonde !
Mais j’ai passé, je sais, le point de non-retour.
L’ambition me ronge et j’ai gâché ma vie,
J’ai perdu trop de temps, et ne suis bien en cour,
Pour glaner les honneurs que l’imbécile envie,
Et puisque cela fait qu’on me traite en laquais,
Que l’on peut se payer de la condescendance,
Et puisque je n’ai plus la foi, que je manquais
À mes vœux, que je suis pourri de décadence,
Je sais bien qu’il faudra que j’y revienne un jour…††
† Strindberg : « le combat des âmes ». Dans cette transposition au plan spirituel et paranormal de la lutte darwinienne pour la survie, l’écrivain suédois a forgé cette expression en vue de décrire les malheurs de sa vie, de manière comparable au Rousseau juge de Jean-Jacques.
†† Une certaine considération m’induit cependant à penser que ma situation, relativement à celle de mes contemporains, n’est pas si grave, car, au cas où l’abus ici décrit m’aurait « déglingué », je suis assuré qu’un autre n’a pas non plus laissé indemne les hommes de ma génération. Cette autre « abomination », que je ne prétends certes pas ne pas connaître moi aussi, est, selon l’immortel Kant, dans sa Pédagogie, irrémédiablement grave : « Rien n’affaiblit plus l’esprit et le corps de l’homme que la forme de volupté tournée vers elle-même ; elle est en totale opposition avec la nature humaine. D’elle non plus il ne faut faire mystère au jeune homme. Il faut la lui représenter dans toute son abomination, lui dire que par elle il provoque la plus grande ruine de ses forces physiques, qu’il attire sur lui une vieillesse précoce et que son esprit en subit de graves atteintes, etc. » Je ne vois pas ce qui pourrait être pire. Que ceux qui voudraient me reprocher l’abus des forces que Dieu m’a données examinent s’ils ne sont pas eux-mêmes, dans la fleur de l’âge, ces vieillards décrépits à l’esprit taré dont parle le philosophe.
*
XXXIX
Invasion
Auch könnte unmöglich, wenn diese Welt von eigentlich denkenden Wesen bevölkert wäre, der Lärm jeder Art so unbeschränkt erlaubt und freigegeben sein, wie sogar der entsetzlichste und dabei zwecklose ist. – Wenn nun aber gar schon die Natur den Menschen zum Denken bestimmt hätte, so würde sie ihm keine Ohren gegeben oder diese wenigstens wie bei den Fledermäusen, die ich darum beneide, mit luftdichten Schließklappen versehen haben. (Arthur Schopenhauer)
Tu ne peux échapper à ce grésillement
Qui franchit les cloisons et partout s’insinue,
Ce bruit qui te conduit presque au vomissement,
Cette horrible marée, insane et continue,
Ce taraudage affreux qui dégoutte des murs !
Quand tu lis dans ta chambre, il vient d’un autre étage,
Nauséeux clapotis de fruits tombant trop mûrs ;
Quand tu vas au salon, t’y poursuit le battage :
Le voisin d’à côté, vieux fou, n’éteint jamais.
La machine à palabre a des mains colossales.
Si le silence est d’or – ah, comme tu l’aimais ! –
Les paroles sans fin sont de la rouille, et sales.
Quand tu fuis aux waters, la ventilation
T’envoie un air pesant d’infernal borborygme.
Tu ne peux échapper à la pollution
Par le bruit, devenue un nouveau paradigme.
Quel placard ténébreux, clos à cet univers,
Quel humble cagibi t’ouvrira son refuge ?
Où jouir d’un repos de prés lointains et verts,
D’une sérénité de jardins fébrifuge ?
Fais toi-même du bruit, chuchote ton démon,
Couvre de décibels bien à toi ton martyre !
Mais si je me livrais à cet abus sans nom,
Si j’opposais, dis-tu, l’escalade au délire,
Je ne me croirais pas digne de vivre heureux ;
Et sans l’être aujourd’hui, tant j’ai besoin de calme
Et tant je dois subir mille voisins fiévreux,
Du moins puis-je espérer, innocent, cette palme !
« Regarde, maintenant ! car je suis un Esprit
Venu de loin et j’ai des pouvoirs insolites. »
Soudain les murs rendus lucides, il comprit
Quel cauchemar c’était que tout !
Des satellites
Habités, dans l’espace, avaient jusque chez nous
Envoyé les essaims de leurs crabes difformes
Aux pinces et suçoirs dégoûtants, aux genoux
Cagneux, aux bras ballants, aux bedaines énormes.
Qui dira le succès de leur invasion ?
Chaque crabe pouvait d’un claquement de pinces
Se métamorphoser en télévision.
Nos chances de salut aujourd’hui sont très minces.
Le pauvre hère vit, dans les appartements,
Inertes, ses voisins cloués sur des causeuses,
Le crâne perforé de hideux téguments,
D’où coulaient à grands flots leurs méninges vaseuses
Vers le cloaque noir des goulus crustacés ;
Et le grésillement infini, monotone,
C’est le bâfrement long des cancres engraissés
Qui pompent nos cerveaux de bétail à la tonne !
Non, n’ouvre pas la porte au voisin souriant :
Il vient t’assassiner, âme par trop discrète !
Il n’entend pas chez toi le son stupéfiant,
Ce bruit d’homme déchu : d’où sa haine secrète.
N’ouvre pas ! n’ouvre pas ! car il est commandé
Par les monstres ; dis-lui que d’un moment à l’autre
Doit passer le marchand de ton écran 3D,
Le même que celui sous lequel il se vautre !
*
XL
Aux supérieures intelligences extraterrestres
Sagacités supérieures,
Nous savons que vous existez.
Au juste en quoi vous consistez,
Pour être plus grandes, meilleures,
C’est ce qu’on ignore toujours.
Pour pénétrer autant de choses
Que vous, saisir autant de causes,
Nos bulbes sont bien un peu courts ;
Notre soif reste inassouvie.
Puisque vous avez le savoir,
Vous nous apprendrez comment voir
Et donner un sens à la vie.
Vous avez ce qui fait défaut
Sur la terre notre planète :
Votre conscience est plus nette,
Votre jugement comme il faut.
Apparaissez, je vous en prie !
Vous n’avez pas besoin de nous
Mais sans vous nous devenons fous,
Nous sombrons dans la barbarie.
Le pourquoi, vous nous l’apprendrez ;
Le comment, vous savez le faire ;
Votre existence m’est si chère,
Je sais que vous me comprendrez !
.
II
UNE ADOLESCENCE
.
XLI
Ce siècle avait seize ans dans le cœur de la belle.
Elle avait trop vécu, déjà, si lasse qu’elle
N’aimait plus rien. La pierre occupait tout son sein.
Sa jeune chair, empreinte à jamais du malsain
Toucher de l’être impur, rejetait l’existence.
Jeune, elle avait voulu, après la folle transe
D’une passion noire avec un chaste amant
Qui vivait de soleil, étrange immensément,
Que son passé ne fût qu’un ennui pauvre et vague.
Le cœur du mal-amant fut pour elle une vague
Qui ne lui laissa rien du rêve et du désir,
Rien du mensonge humain, du mensonger plaisir,
Rien des illusions… Non, rien que la lumière
De la vérité : jeune, elle avait la poussière !
*
Ô mes amours, ô mes néants
(Supprimé)
*
Bourgeois suants d’hypocrisie…
(Supprimé)
*
XLII
Sur le piano poussiéreux
Grincent les doigts longs d’un squelette
Qui ricane bien malheureux
D’être un pauvre fou de poète
On danse on rit on boit le vin
Sa musique vous plaît mesdames
Mais vous lui souriez en vain
Il n’a pour vos cœurs que des blâmes
Dans la chambre on éteint le feu
On entend les cris des pucelles
Qui se lamentent C’est bien peu
En se pétrissant les mamelles
La lune est comme une tumeur
Le sang jaillit de la fontaine
Et les angelots prennent peur
Et les noceurs sont pleins de haine
Les étoiles pleurent ce soir
Jusqu’à mes yeux sous la tonnelle
Sur mes lèvres le désespoir
Trempe l’amour
Elle est trop belle
*
XLIII
La belle a les yeux noir citron
Quand on la regarde on s’envole
On est marquis on est baron
La belle est triste et fait la folle
Mais elle n’aime pas qu’on l’aime
Malheur j’ai passé l’interdit
Comme elle a ri de mon poème !
Souffre d’aimer Jésus l’a dit
La belle est un peu violette
Avec ses cheveux zinzolins
Dans les ombres où tout est bête
Où tortillent des gobelins
La belle a le sein ferme et rond
Quand on la regarde on s’envole
On chute de haut on se rompt
Les os on dit la vie est drôle
*
XLIV
J’appelle. Qui me répondra ?
Je suis dans le vent des ruines
Sur les cœurs soufflant des bruines.
J’ai froid. Personne n’entendra.
Je marche. Qui m’accueillera ?
Je suis le vagabond des nues,
Mes plantes de pied sont chenues.
Je cours, mais on m’arrêtera.
J’aime, mais qui me le rendra ?
Je suis un papillon des brises,
Je hume des saveurs exquises.
J’offre. Personne n’en voudra.
Je vis, ô mon Dieu, quel émoi !
Je vais, je viens, c’est rien, c’est bête ;
Fou, je me suis nommé poète ;
Je ris mais on rira de moi.
*
XLV
Marchand d’étoiles !
Chiffons !
Navires ! Voiles !
Chiffons !
Marchand de lunes !
Paniers !
Rivages ! Dunes !
Paniers !
Marchand de nuits !
Brocante !
Vins ! Rires ! Fruits !
Brocante !
Marchand de joie !
Cartons !
Satin et soie !
Cartons !
Marchand de ciel !
Cageots !
L’essentiel !
Cageots !
Marchand d’étoiles !
Chiffons !
*
XLVI
Si douce que le sang perle sous le soyeux
Tapis blanc de sa peau comme un rubis opaque
Si brune que mes mains tremblent et que mes yeux
Ne peuvent échapper à ces longs flots de laque
Si fraîche que les fruits de l’Éden ont un goût
Moindre que celui fort de sa lèvre qui laisse
Un papillon tremblant dans le creux de mon cou
Que celui merveilleux de sa folle paresse
Si pâle que le ciel peut peindre sur son cœur
Les teintes de l’amour d’un trait sombre et d’un rose
Et d’un halo d’azur tout son être est couleur
Dès que le doigt de Dieu sur sa tempe se pose
Si belle que l’étoile a couronné son front
Pour m’éblouir Amour ! et mêle dans la soie
Au parfum de la rose un parfum de citron
Au parfum de sa peau le parfum de ma joie
*
XLVII
Embrasse
L’amour
Du jour
Qui passe.
Tout lasse !
Ton tour
De cour
La glace.
Ce pied
Qui sied
Aux lèvres
Se vend
Aux fièvres
Du vent.