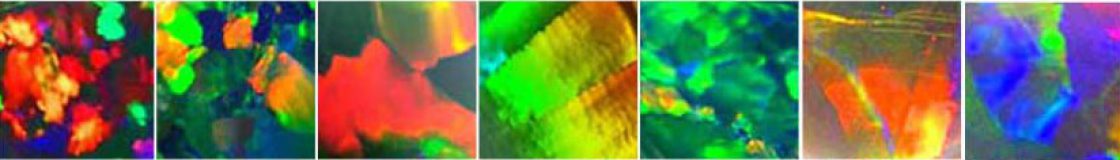Category: poésie
La Chute des Arabes du Congo: Poème historique
Ce poème, publié dans le recueil La lune chryséléphantine (Les Éditions du Bon Albert, 2013) et relativement imprégné de l’esprit de sa source, nommée en exergue du poème, comme par les lectures héroïques et impériales des romans classiques d’aventure pour la jeunesse, est un adieu rétrospectif et crépusculaire à mon enfance.
Le jeune Français qui s’éveille à la culture continue de rêver à l’épopée impériale de son pays notamment en Afrique noire, laquelle devient, dans le récit des explorateurs et des conquérants, dans les romans tels que L’étonnante aventure de la mission Barsac de Jules Verne (terminé par son fils Michel Verne) ou Allan Quatermain et She de Henry Ridder Hagard, le symbole de l’inconnu qu’il a devant lui et qui n’est autre que son propre avenir.
Puis, vient la notion que les faits et gestes de ses pères, dont il a reçu l’héritage et le sang, blessaient la loi morale, la justice. Mais, même chez un auteur comme Jack London, peut-être le dernier grand maître du roman d’aventure, malgré son socialisme et son réalisme qui le place aux côtés du Joseph Conrad d’Au cœur des ténèbres, on trouve ce désir brûlant de conquérir l’inconnu, cette soif d’aventure qui tend à fermer les yeux sur les turpitudes d’une vie de conquérant et de dominateur. Même après avoir dit que l’homme occidental a été plus barbare que les peuples « barbares » qu’il a conquis et que c’est la raison pour laquelle il a pu les conquérir, une part en Jack London restait émerveillée par l’impérialisme de sa race anglo-saxonne, sinon de sa nation, et cherchait à le disculper en distinguant ses sacrifices et ses vertus du mercantilisme exploiteur qu’il préparait.
Qu’il y ait eu chez les descubridores et conquistadores des siècles passés, à côté d’iniquités sans nom, maints sacrifices et héroïsmes est peu contestable et le récit de leurs aventures transporte l’esprit, de même que la description par Las Casas de l’envers de l’épopée émeut jusqu’aux larmes. C’est pourquoi, après avoir à mon tour loué la bravoure des conquistadores puis pleuré sur le sort de leurs victimes, des peuples entiers, après avoir écrit ce poème sur la guerre au Congo entre Européens et Arabes (ou Arabo-Swahilis, guerre de 1892-1894), j’ai donné la parole aux libérateurs de leur continent dans des traductions de poésie africaine lusophone et anglophone (voir l’index de ce blog).
La chute du poème, qui fait l’objet d’une note, est une allusion à la flamme qui ne peut être entièrement éteinte et que j’ai appelée « le désir brûlant de conquérir l’inconnu ». L’Afrique s’est libérée du colonialisme et continue de lutter pour s’émanciper totalement du néo-colonialisme économique. L’âge des « grandes découvertes » et de l’exploration du monde est révolu mais certains, comme Bernard Heuvelmans (1916-2001), cherchent encore des « bêtes ignorées », des cryptides. Peut-être existent-elles, ces bêtes ignorées, peut-être les forêts humides du Congo et d’autres pays sont-elles encore suffisamment vastes et impénétrables pour les y cacher, mais pour combien de temps, alors qu’en Amazonie et ailleurs les bulldozers rasent chaque jour d’immenses surfaces de forêt vierge ?
Nous avons besoin d’explorer l’inconnu et, notre planète étant désormais le « village mondial » anticipé par le visionnaire Marshall McLuhan, notre âme d’explorateurs se tourne vers l’espace infini qui entoure ce village et dont nous savons si peu de choses encore.
Le poème est suivi d’une note « Comment lire un alexandrin » inédite.
*
La Chute des Arabes du Congo
.
D’après The Fall of the Congo Arabs (1897), par Sidney Langford Hinde, capitaine dans l’« État indépendant du Congo », chevalier de l’Ordre royal du Lion.
.
I
.
L’Afrique, promontoire enveloppé de nuit,
Territoire inconnu, l’Afrique inexplorée,
Ainsi qu’un feu-follet sous la lune, qui luit
Et silencieux danse une chasse enfiévrée,
Tremblant, trouble mirage, Éden enseveli
Dans d’épaisses vapeurs, des brumes d’eaux profondes,
L’Afrique immense et vierge en sa gangue d’oubli,
Couvrant de ses forêts des gouffres et des mondes,
Tel était le Congo que je vais évoquer !
Et l’on verra comment l’énigmatique terre,
Que nul profanateur n’avait pu bien marquer,
Au temps voulu devint un théâtre de guerre ;
On verra Léopold, fulminant souverain,
Affronter, au milieu de débauches tribales,
Le glaive du Prophète entre des doigts d’airain
– Et les morts destinés aux rites cannibales.
.
II
.
Depuis longtemps déjà, l’Islam, à Zanzibar,
Sur la mer possédait une imprenable enceinte,
Où l’imam, gravissant le rituel minbar,
Commentant la Sunnah, prêchait la guerre sainte.
De cette forteresse à l’abri du démon
Les Arabes d’Oman pénétraient en Afrique,
Attirés par l’ivoire et l’ébène, ce nom
Que celui qui les vend aux esclaves applique.
Les Bédouins, peu à peu se mêlant aux Bantous,
Fondèrent au Congo d’ardentes dynasties,
Sans briser tout à fait mais sûrs de leurs atouts,
Créant sur plusieurs points épars des colonies.
Qui dira ce qu’étaient ces farouches sultans ?
Peut-être rêvaient-ils de Bagdads magnifiques,
D’Alhambras de palmiers au miroir des étangs
Qu’infestent les essaims de mouches pétrifiques ?
Dans de géants harems les eunuques huileux
Ourdissaient-ils des plans infâmes de traîtrise ?
Qui disait la doctrine aux peuples nébuleux ?
Cet islam avait-il la pureté requise ?
Quoi qu’il en fût, on sait qu’une prospérité
Signalée avait cours dans leurs vastes domaines.
Plus qu’un puzzle de fiefs, c’était en vérité
Un État déployant des forces souveraines.
Or, au même moment, Al-Mahdi, l’Inspiré,
S’emparant de Khartoum élevait un empire :
Le Turc anéanti, le Soudan délivré
Du clanisme ancestral, l’Anglais qui se retire,
Par le glaive et la foi voyait ainsi le jour
Un califat arabe, altéré de conquêtes.
Eussions-nous au Congo vu de même, quel tour
Aurait pris le combat pour les cœurs et les têtes ?
.
III
.
Peut-être dans le but d’imiter le Mahdi,
Les sultans du Bassin voulurent mettre un terme
À la présence belge, et par un coup hardi
Rendre leur ascendant immuablement ferme.
Ils lancèrent bientôt une âpre razzia
Contre les peu nombreux officiers à demeure,
Ennemis de la pure et sainte Sharia ;
Pour l’un ou l’autre camp avait donc sonné l’heure.
Léopold répondit immédiatement.
D’un côté, Séfou Tip, fils de Tippo ; de l’autre,
Francis Ernest Dhanis au haut-commandement.
Derrière les fusils, Prophète contre Apôtre.
Si Dhanis dirigeait quelques combattants blancs,
De fait sa troupe était une armée indigène.
Gongo, son allié, chef d’hommes violents,
Résidait à N’Gandu, capitale et géhenne.
Car c’était, entouré d’une muraille en bois
Que des têtes de mort couronnaient, inquiètes,
Un vrai donjon, avec gardes en tapinois,
Tunnels en cul-de-sac et pavés de squelettes !
Ses habitants, confie un Blanc qui put entrer,
Respiraient la vigueur, la force et jeunesse ;
Ils avaient, poursuit-il, le pli de dévorer
Ceux des leurs un peu vieux ou tombés en faiblesse.
Du reste, mécréants, ne craignant point la mort
Ni les esprits du mal ni rien, l’âme sereine,
Ils avouaient priser – sans y voir aucun tort –
Bonne sans condiments, tendre, la chair humaine.
Avec cet allié, le Belge aventureux
Avait à parcourir d’immenses forêts vierges
Pour dérouter le Maure et, sous ce dais ombreux,
Tenter de regagner le bord fangeux des berges ;
Dans un silence lourd, quasi surnaturel,
Qu’il était long d’ouvrir à sa petite armée
Un chemin difficile et superficiel,
Craignant à chaque instant les flèches du Pygmée !
Ce peuple solitaire, elfes de la forêt,
N’aime point qu’impromptu le pas d’autrui résonne.
Ceux qui passent chez eux n’y marquent point l’arrêt :
Leurs traits empoisonnés n’épargneraient personne.
.
IV
.
Ce que fut la clameur des luttes corps à corps,
Avec quelle rudesse on s’y jetait en foule,
Et quels festins s’offraient les guerriers les plus forts,
Ne sera point noyé dans le temps qui s’écoule.
Quelque deux ans après le début des combats,
L’ultime coup porté contre les citadelles
De Nangwé, d’Ujiji, les dernières casbahs
Des Maures du Congo, vainquent les infidèles !
Un peu plus tard encore, au Soudan, Kitchener
Sous le feu des canons écrasait les Mahdistes.
(Marchand s’en retournait, tremblant du revolver,
Rendre compte à ses chefs : un Parlement d’artistes.)
.
V
.
J’ai raconté ces faits nûment, sans passion,
Parce qu’un parti-pris est karmique et funeste.
Des Arabes, des Blancs hantent la région ;
Ces diables sont passés, le Chipékoué* reste.
.
*Chipékoué : Animal « cryptozoologique », monstre amphibie des immenses marais du Congo, non répertorié à ce jour. Peut-être un dinosaurien : voir B. Heuvelmans, Sur la piste des bêtes ignorées (1955) :
« S’étant livré à une enquête approfondie auprès des Noirs, Hughes a recueilli nombre de témoignages à propos du chipekwe. Le plus intéressant est sans contexte celui qui provient du grand chef de la tribu des Wa-Ushi, dont le grand-père avait assisté en personne, sinon participé, à la mise à mort d’un de ces monstres dans les eaux profondes de la Luapula, qui relie le lac Bangwéolo au lac Moëro : ‘Une excellente description de la chasse a été transmise par voie de tradition, écrit J.E. Hughes. Cela prit toute la journée à bien des meilleurs chasseurs de transpercer l’animal au moyen de leurs grands harpons Viwingo – les mêmes dont ils se servent aujourd’hui pour chasser l’hippopotame. On l’a décrit comme ayant un corps sombre et lisse, sans crins, et armé d’une seule corne blanche et unie, disposée comme la corne d’un rhinocéros mais faite d’un ivoire blanc et lisse, très fortement poli. Il est dommage que les Noirs ne l’aient pas conservée, car j’aurais donné n’importe quoi pour l’avoir.’ … L’aurai-je assez répété au long de cet ouvrage : il ne suffit pas de bonne volonté pour découvrir une bête même énorme dans un habitat qui garantit son incognito. Croire que l’on pourrait repérer à coup sûr un diplodocus dans un marais ou un lac couvrant des milliers de kilomètres carrés, c’est caresser l’espoir insensé de retrouver la classique aiguille dans un Gaourisankar de foin. »
*
Comment lire un alexandrin
La diction des acteurs de théâtre, quand ils jouent une pièce écrite en alexandrins, ne donne pas franchement à entendre qu’ils récitent autre chose que de la prose, et sans doute le public contemporain, relativement peu familier avec la versification, et ce d’autant plus que sont éloignées ses années de collège et lycée, ne pourrait-il sans impatience entendre une pièce versifiée si les acteurs scandaient les vers comme il se doit.
Or la versification n’a que peu d’intérêt si l’on ne scande pas les vers, c’est-à-dire si l’on ne donne pas à entendre leur rythme régulier, rehaussé par la rime, le rythme et la rime étant les deux éléments de régularité propres à charmer l’oreille au milieu de la diversité des tons, des vitesses d’élocution et d’intensité de la voix qu’appelle le fond du texte récité.
La scansion implique de savoir compter les syllabes d’un vers. Un alexandrin compte douze syllabes. Dans un poème en alexandrins, comme le présent poème, la rime intervient donc toutes les douze syllabes. Ici les rimes sont dites « croisées », c’est-à-dire que chaque quatrain (ensemble de quatre vers) compte deux rimes selon le schéma A-B-A-B.
Le comptage des syllabes ne poserait pas de difficultés si le modèle de versification que je suis était entièrement conforme à notre façon actuelle de prononcer le français. Or il se trouve qu’un certain nombre de mots, s’ils sont prononcés « naturellement », c’est-à-dire comme dans la langue parlée, rendent l’alexandrin boiteux, et la régularité de la scansion n’est plus respectée.
Par exemple, si la phrase « je ne sais pas » compte, dans un alexandrin, quatre syllabes, il n’est pas douteux qu’en la lisant dans d’autres contextes ou plus simplement en la prononçant soi-même on dira plutôt « je n’sais pas » ou « je sais pas », trois syllabes, voire « j’sais pas », deux syllabes. Par conséquent, quand un poète écrit l’alexandrin « je ne vois pas du tout de quoi vous me parlez », il s’attend à ce qu’on lise chaque syllabe distinctement, pour que les douze syllabes assurent la régularité de la scansion, tandis que cette régularité serait brisée si on lisait « j’vois pas du tout d’quoi vous m’parlez » car on ne prononce alors que huit syllabes ; et ainsi de suite pendant tout le poème.
C’est une règle facile à retenir : il faut prononcer distinctement chaque syllabe.
Mais il y a des cas plus difficiles, à l’intérieur de mêmes mots, notamment tout ce qui a trait à la diérèse ou découplement de deux voyelles successives, rarement prononcée dans la langue parlée mais fréquente en versification classique. Par exemple, au dernier vers du poème ici, le nom du « Chipékoué » sera articulé par la plupart en trois syllabes Chi-pé-koué (et c’est d’ailleurs conforme à la graphie originale Chipekwé), mais je l’ai écrit de cette manière pour rendre par diérèse le mot long de quatre syllabes, à savoir qu’il faut lire Chi-pé-kou-é. Alors le vers a douze syllabes et est un alexandrin :
1Ces-2dia-3bles-4sont-5par-6tis-7le-8Chi-9pé-10kou-11é-12reste
(En fin de vers, « reste » n’a qu’une syllabe ; s’il était à l’intérieur d’un vers devant un mot commençant par une consonne, il prendrait deux syllabes, par exemple « res-te-là »)
Dans le même alexandrin, « dia », dans le mot « diable », est prononcé une syllabe, comme ça se prononce, et non deux, « di-a ». C’est comme ça. Les règles, qui ont été codifiées dans les traités de versification, échappent parfois à toute logique ; à l’époque, elles devaient plus ou moins se conformer à la langue parlée. C’est devenu de moins en moins vrai. Certains, parmi les rares auteurs qui continuent à écrire de la poésie versifiée, ont renoncé à ces règles codifiées pour se rapprocher de la langue parlée actuelle. Je n’ai pas suivi cette voie dans ma propre poésie versifiée car il s’agit de toute façon d’un compromis plus ou moins boiteux ; personne n’écrira un vers où « je ne sais pas » sera lu trois, voire deux syllabes, et pourtant je sais que je ne prononce jamais, en parlant, « je ne sais pas » quatre syllabes et que, quand j’entends quelqu’un articuler de cette manière, je tique et pense : « Voilà un précieux ! »
Je fais donc suivre une liste de quelques mots où j’appelle l’attention du lecteur sur une diérèse (ou une autre particularité de prononciation) et d’autres particularités qu’il est censé connaître pour bien scander les alexandrins de ce poème. Par ordre d’apparition :
si-len-ci-eux (4)
fon-dè-rent-au-Con-go (6) (la liaison doit être audible : il ne faut pas prononcer « fondère au Congo » (5) mais « fondère-tau-Congo »)
ra-zzi-a (3)
Sha-ri-a (3)
im-mé-di-a-te-ment (6)
vi-o-lents (3)
in-qui-ètes (3)
a-vou-aient (3)
a-lli-é (3)
su-per-fi-ci-el (5)
pa-ssi-on (3)
ré-gi-on (3)
Chi-pé-kou-é (4)
Poésie maya contemporaine du Guatemala
Ce qu’il est convenu d’appeler, au Guatemala et dans les pays voisins, le « mouvement maya » a pris son essor à la fin de la guerre civile guatémaltèque (1960-1996) et en partie comme une réponse à ce qui a été caractérisé comme un « holocauste maya » : « La guerre civile récemment terminée au Guatemala a été conçue comme un ‘holocauste maya’. La majorité des plus de 200.000 personnes qui moururent dans le conflit armé et du million de personnes déplacées étaient indigènes. » (La recién finalizada guerra civil en Guatemala ha sido concebida como un ‘holocausto maya’. La mayoría de las más de 200.000 personas que perecieron en el conflicto armado y el poco más de un millón de desplazados fueron indígenas.) (Extrait de la préface à l’anthologie ici utilisée : voir les références infra).
Le rapport de la Commission nationale pour l’éclaircissement des faits historiques relatifs à la guerre civile (Comisión para el Esclarecimiento Histórico) parle de 83 % de Mayas parmi les victimes (Wkpd). L’enrôlement forcé de paysans indigènes par l’armée nationale guatémaltèque, sur le modèle des « hameaux stratégiques » créés par l’armée U.S. au Vietnam dans leur stratégie contre-insurrectionnelle, joua un rôle important dans ce résultat. Notamment, la résistance des communautés mayas à cette stratégie entraîna, même dans les cas où ces communautés n’étaient ni de près ni de loin affiliées à la guérilla, des massacres de masse contre ces populations civiles par l’armée.
À la suite de ces événements tragiques, les survivants ressentirent le besoin de réaffirmer leur culture, et les jeunes intellectuels issus de la communauté maya s’en firent l’écho en utilisant le maya dans leurs travaux littéraires. En d’autres termes, le traumatisme récent de la guerre civile donna une impulsion particulièrement forte au mouvement pour que le maya prît sa part dans le courant d’« oralittérature », c’est-à-dire de littérature écrite par des écrivains indigènes le plus souvent dans les langues indigènes de la littérature orale (par ailleurs toujours vivante dans ces communautés), courant qui s’est développé à partir de ces années-là dans différents pays d’Amérique latine. (Sur le concept d’oralittérature, voyez la présentation de mes traductions de Poésie amérindienne du Nord-Ouest du Mexique et d’Arizona ici.)
Les poèmes ici traduits sont tirés de l’anthologie Uk’u’x kaj, uk’u’x ulew: Antología de poesía maya guatemalteca contemporánea (Cœur du ciel, cœur de la terre : Anthologie de poésie maya guatémaltèque contemporaine) (Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Universidad de Pittsburgh, 2010), réunie et présentée par Emilio del Valle Escalante.
Les poèmes recueillis dans cette anthologie sont ceux de poètes mayas. Certains poèmes ont été écrits en espagnol, d’autres en maya et sont accompagnés de leur traduction espagnole dont je me suis servi pour ce travail. Sur les vingt-trois poèmes ici présentés, onze ont été écrits en maya. Dans le choix qui suit, à côté du titre du poème en français figure entre parenthèses le titre original ou le titre original et sa traduction espagnole, ce qui permet au lecteur de savoir si l’original est maya ou espagnol.
Les poètes traduits sont Luis de Lión (pseudonyme de José Luis de León Díaz, pionnier de la littérature maya au Guatemala, membre dirigeant du Parti guatémaltèque du travail [Partido Guatemalteco del Trabajo], parti qui s’unit aux autres forces de la guérilla pendant la guerre civile ; Luis de Lión, né en 1939, fut enlevé en 1984 par un escadron de la mort et porté disparu jusqu’en 1999, date à laquelle un examen des archives militaires montra qu’il fut assassiné l’année de son enlèvement) (quatre poèmes), Víctor Montejo, exilé aux États-Unis depuis 1982 (deux poèmes), Pablo García (3), Santos Alfredo García Domingo (1), Adela Delgado Pop (3), Daniel Caño (5), Rosa Chávez (1), Pedro Chavajay García (1) et Sabino Esteban Francisco (2). Ce dernier, né en 1981, a grandi dans une CPR, une « communauté de population en résistance » (Comunidad de Población en Resistencia) ; les CPR étaient des communautés mayas qui abandonnèrent leurs localités traditionnelles pendant la guerre civile pour fuir les massacres et vécurent d’une précaire économie de subsistance cachées dans les forêts, ne réapparaissant au grand jour que dans les années 1990.
Le lecteur trouvera mes autres traductions de poésie guatémaltèque à « Poésie révolutionnaire du Guatemala » (x).
*
Poème pour mon enfant (Poema para mi niño) par Luis de Lión (José Luis de León Díaz)
sous cette peau
il y a la peau douce d’un enfant
qui dort seulement,
qui porte une charge,
qui marche même en rêve :
ses pieds sont deux fruits sans gousse,
son fardeau est un volcan,
son chemin est de pierre.
et cet enfant,
comme il y a des années de cela,
dès que le jour se lève
quitte son lit
et sort avec sa mère.
en bas il y a son hameau
avec ses rues comme des serpents,
ses maisons comme des poules,
son église, grande et blanche,
comme un lapin dans l’herbe.
en haut
il y a sa propriété privée,
……son morceau de volcan,
avec quelques pêches pleines de miel pareilles à
des moineaux,
avec quelques chérimoles suspendues comme des ruches vertes,
avec sa terre à demi stérile
comme une mère à la veille de la ménopause.
cet enfant est un guerrier,
il tient dans ses mains
une fronde et une machette
pour triompher de la nature et chasser les animaux des bois,
cet enfant est un poète,
il a dans sa bouche
des centaines de mots pour nommer les choses :
le pin : pin ;
le chêne : chêne ;
le ravin : résonateur de marimba ;
les oiseaux : avions ;
les insectes : paons, petites vaches, etc.
cet enfant est un esclave,
il porte sur le front
la trace de corde du faix
comme une marque à bétail.
quand il gravit le volcan, c’est une fourmi.
tachée par le bleu et le vert.
en dessous de son hameau il y a la vallée,
grande et plane comme un lac,
et au milieu la ville,
blanche comme un bateau,
avec ses rues droites,
ses hautes églises,
ses cloches qui secouent le verre du ciel
quand elles sonnent,
avec son vieux parfum de violette entre les pages d’un livre,
avec sa bouche édentée de matrone qui attend.
l’enfant la regarde,
monte,
transpire,
trotte derrière l’ombre de sa mère.
l’enfant et la mère arrivent à leur bout de terre,
l’enfant et la mère le fertilisent de leur sueur et de leur espérance,
lui grimpe aux arbres
et se déplace entre les branches comme un écureuil,
il cueille les fruits
et elle les collecte.
plus tard,
les deux descendront, laissant le volcan derrière eux,
mais cette fois ce sera en direction de la ville,
ils parcourront la route à pied
de nouveau, écrasés, pliés sous le poids
du fardeau,
en suant comme des bœufs ;
sur le marché, en plein soleil, ils continueront de suer ;
et ils retourneront au hameau en suant.
parfois,
lui n’ira pas
et attendra sa mère dans un coin
puis se précipitera à sa rencontre
en sautant comme un ballon joyeux.
c’est une partie de l’histoire de cet enfant
qui un jour cessera de l’être
et d’être un paysan
qui soufflait à grand bruit
quand il posait sa charge dans la cour de sa maison
et se redressait digne comme un arbre.
cependant,
malgré le temps et l’apprentissage d’un autre métier,
en lui,
au plus intime de son être,
cet enfant va toujours avec lui.
*
Comme quand j’étais un enfant flâneur (Como cuando era un niño sin oficio) par Luis de Lión
Comme quand j’étais un enfant flâneur,
je me couchai sur l’herbe pour regarder le ciel
mais aucun ange, pas le moindre n’allait par ses chemins.
Ne me dis pas que tu étais cette hirondelle qui battait des ailes sur le toit de la maison.
Ou ce papillon qui se posa sur le géranium et but la dernière goutte de rosée ?
Ma petite,
de quelle taille sont tes yeux ? tes pupilles ont-elles grandi ?
quelles cloches entends-tu ? ressemblent-elles aux cloches de San Juan ?
Je t’imagine enfonçant tes pieds de petit puma dans la neige.
Ou bien te baignes-tu sous un feu-follet ?
Tu sais quoi ?
La grenade a pris la couleur qu’un potier lui donnerait
et dans ta chambre est née une violette.
Le ciel ? C’est toujours le même pleurnichard que quand tu es partie,
mais les milpas sont mères à présent.
Oui,
le toit de la maison est toujours un aéroport d’oiseaux et
l’œillet suit avec ses fleurs les filles qui passent dans la rue.
La Marie, je sais que son ventre germera bientôt.
Mon petit écureuil,
as-tu rêvé de nous ?
te souviens-tu de la table et de sa permanente exposition d’arômes ?
de la fenêtre et de sa vitre faite d’infini, qui donne sur
le bois de peupliers et la montagne ?
te souviens-tu des montagnes et de leurs pantalons et blouses de chlorophylle ?
des arbres et de leurs fruits comme peints par un enfant ?
des oiseaux et de leurs costumes de printemps, de leurs flûtes d’argile ?
te souviens-tu des villages, de leurs ruelles et placettes de poupée ?
des villes ? les villes, lampes des vallées !
Ah, j’allais oublier que le volcan d’Agua te salue bien et
que notre village a demandé de tes nouvelles.
Mon enfant,
ma petite camarade,
je voudrais t’envoyer nos matins et nos crépuscules enveloppés
dans une feuille de maïs,
nos rivières et nos lacs dessinés dans une goutte d’eau
et tout un marché avec son artisanat, ses fleurs, ses fruits,
et ses femmes et ses hommes dans le cristal d’un grain de sucre.
Mais tu sais bien que je ne peux même pas t’envoyer ce poème.
Ce poème plein de lumière est pour le compost.
Pour moi et pour personne.
Tu le sais bien, ma future patrie.
*
Quand tu reviendras (Cuando volvás) par Luis de Lión
Quand tu reviendras,
je t’attendrai avec un panier pour recevoir ta joie.
Avec ces crayons de couleur je peindrai tes paysages.
Mon amour,
si c’est l’hiver,
mes mains auront gardé la chaleur de l’été.
Mais si cela n’arrive pas,
tu sais quel sont mes devoirs.
Sûrement je serai sorti, ponctuel, pour accomplir l’un d’eux,
un devoir long de jours, de mois.
Il se peut aussi qu’on doive mourir et cela peut durer des années.
Et s’il ne suffit pas d’être mort,
il faudra se convertir en poussière et cela peut durer des siècles.
Et tu sais que l’on ne peut revenir,
que cela fait partie de la plus ancienne discipline.
Autrement
nous ne pourrons accomplir correctement notre fonction d’accoucheurs.
Ainsi donc,
pas de larmes.
Tu sais qu’ici la pluie est abondante, alors pourquoi
gonfler davantage la terre ?
Profite plutôt de son humidité, laboure-là en profondeur,
sèmes-y toutes les graines que tu portes et attends, concentrée.
Il se peut que tu perçoives ma respiration dans une de leurs germinations.
*
Le poème des héros (El poema de los héroes) par Luis de Lión
Ndt. Le poème fait le tour de plusieurs personnages de la récente culture enfantine occidentale, d’origine essentiellement nord-américaine, dont la plupart n’ont pas besoin d’être présentés. Le Fantôme est le personnage de comics The Phantom, pas tout à fait aussi connu que les autres, me semble-t-il. Quant à Kaliman, c’est un super-héros mexicain créé dans les années 1960 sur le modèle de ses grands frères gringos (Kaliman el hombre increíble). Le poète oppose à ces créations la mythologie maya du Popol-Vuh. Hunapú et Ixbalanqué sont deux jumeaux qui descendirent dans l’inframonde, Xibalbá, combattre les dieux maléfiques pour semer le maïs qui donna naissance à l’humanité.
Avant que Superman l’homme d’acier
ne volât dans le ciel comme un aigle
et que Batman et Robin, la paire,
ne se déguisassent en chauves-souris ;
avant que le premier Fantôme
habitât la Grotte du Crâne
et que Tarzan lançât son premier cri
et triomphât de son premier lion dans la forêt ;
avant que le simplet Dingo et le sagace Mickey
eussent capturé le délinquant Pat Hibulaire
et que l’Oncle Picsou épargnât son premier centime,
privant de repas un petit enfant ;
avant que Bugs Bunny
volât sa première carotte à Elmer
et que le Renard de la fable
trompât perfidement le Corbeau ;
avant que Lone Ranger
eût cessé de vivre comme les hommes
et que Kaliman l’homme incroyable
cherchât à se rendre crédible ;
avant eux tous et bien d’autres,
il y eut deux enfants, Hunapú et Ixbalanqué,
qui dans Xibalbá vainquirent la Mort,
deux enfants dont les aventures ne passent pas
à la télé ni à la radio ni ne se lisent dans les journaux,
encore moins dans les magazines de bande dessinée,
mais qui sont bien plus grands et bien plus certains
que Superman et tous ses frères ;
il y eut deux enfants dont nous devons, tous les enfants,
connaître les grandes aventures…
*
L’interrogatoire des ancêtres (Interrogatorio de los ancestros) par Víctor Montejo
Que me fait mal le silence
de mes ancêtres
qui sont devenus muets
leurs traces se perdant peu à peu
comme le vent
lointain des étoiles
incompréhensibles.
Leurs voix s’éteignent
comme le feu
que l’on cache la nuit
mais qui ensuite
est éteint par la pluie ;
et de même leurs pas
se sont presque effacés
comme d’obscures
pages de vieux codex.
Nous leurs descendants,
endormis,
les étrangers
nous ont tellement trompés
qu’ils sont devenus experts en l’art
de tout mélanger
et d’embrouiller pleins d’étonnement
nos histoires.
Et nous ne pouvons rire
ni nous résigner
car c’est nous,
les indigènes,
qu’ils défigurent,
car, enfin,
quelle sera notre réponse
à nos ancêtres
quand avec des éclairs et le tonnerre
ils reviendront
nous demander le feu
qu’ils nous laissèrent
dans le cratère du grand volcan ?
Ils diront :
« Que viennent à nous nos fils
avec le livre sacré
que nous les avons chargé
de garder et d’interpréter. »
« Ô pères ! », répondrons-nous,
« les livres sacrés
ont tous été brûlés
quand les Kaxhlanes, les étrangers
venus de l’Orient
par la mer
nous dépouillèrent de nos richesses ;
nos livres alors
furent brûlés
par ces moines maudits
aussi voleurs
que les conquistadores. »
Et ils répondront :
« Tristes fils endormis,
notre déshonneur.
N’avez-vous pas appris
à vaincre la nuit noire
comme les jaguars,
embrasant ensemble
vos fagots de pin ? »
« Nous l’avons tenté,
ô pères sages et grands !
Mais les traîtres
comme toujours n’ont pas manqué. »
« Tristes fils humiliés
et abandonnés.
Pourquoi n’avez-vous point réitéré
notre histoire
et la roue des katuns1
gravée sur les stèles
devant les temples ? »
« Ô pères sages et grands !
nos stèles
aussi ont été déplacées,
dispersées dans les musées
du monde. »
« Tristes fils endormis,
vous les abusés.
Pourquoi avez-vous cédé à l’encan
nos connaissances,
les sciences écrites
sur ces pierres indéchiffrables
aux yeux étrangers ? »
« Ô pères sages et grands !
nos stèles
ont été arrachées à la terre
et non vendues.
Encore une fois ces voleurs… »
« Tristes fils endormis,
vous les dépossédés.
Que sont devenus les livres
du culte annuel
aux symboles peints
qu’à toute heure
interprétaient les Ahb’eh2 ? »
« Ô père sages et grands,
les étrangers ont également emporté
nos codex
de l’autre côté de la mer, là-bas. »
Et ils diront :
« Tristes fils geignards
et giflés,
pourquoi les livres sacrés
sont-ils en d’autres mains, comme des ornements ?
Prétendent-ils lire leur contenu
et interpréter
nos messages occultes ? »
« Ô pères sages et grands,
personne ne peut plus, comme vous, les lire aujourd’hui.
Les connaissances du passé
se sont peu à peu
évanouies. »
« Et vous, fils,
pouvez-vous extraire
les enseignements cycliques
qui se cachent
dans nos hiéroglyphes ? »
« Non, pères !
nos peuples ont été réduits au silence
et de plus
nous vivons trop loin
de ces centres
où jadis
comme un prodige
vous érigeâtes les murs de nos grands temples
et de nos cités. »
« Alors qui
peut lire les signes
et les chemins brillants
des astres
et le Chemin du froid3
qui serpente
dans l’azur du ciel ? »
« Ô pères sages et grands,
quelques mayanistes
affirment avoir la clé
pour les lire,
et qu’ils sont les seuls à pouvoir interpréter un jour
les mystères cachés. »
Ils riront
à gorge déployée
quand ils entendront
leurs fils se lamenter ainsi,
car il faudra beaucoup de temps pour lire
et non seulement imaginer
les histoires écrites
dans la pierre taillée.
Alors les ancêtres
appelleront de nouveau leurs fils
et leur diront avec orgueil :
« Triste fils humiliés
et dépouillés,
vous devez aviver
avec beaucoup de bois
la petite flamme esseulée
luisant encore
sur le copal odorant
de l’encensoir
qui s’offre toujours à nous
dans le cœur de la colline, près de la mer.
Vous serez
à nouveau nos vassaux,
les fils illustres
qui dans les katuns à venir
ne seront plus humiliés.
Mais il vous reste encore
à vaincre la nuit noire.
Allumez vos brassées de pin
tous ensemble, tous les peuples,
et que vos pas à l’unisson
rompent aujourd’hui
le sceau de l’avenir. »
1 Roue des katuns : La roue des katuns est un monument d’astrologie maya, une figuration circulaire du calendrier. Le katun maya est une période d’environ vingt années.
2 Ahb’eh : Selon le glossaire en fin d’anthologie réalisé par E. del Valle Escalante, il s’agit de l’interprète des livres sacrés chez les Mayas.
3 Chemin du froid : Selon le glossaire en fin d’anthologie, c’est un des chemins qui conduit à l’inframonde Xibalbá, en l’occurrence à la région de l’inframonde connue sous le nom de Maison du froid. Montejo le situe, avec les étoiles, « dans l’azur du ciel » et je ne sais si c’est conforme au mythe.
*
Les Mayas s’en vont (Los mayas se van) par Víctor Montejo
Les Mayas sont un grand mystère
dira un jour, dans un futur plus ou moins lointain,
quelque archéologue encore inconnu
quand dans un cimetière à l’écart
parmi la centaine d’autres aujourd’hui clandestins
au Guatemala, au Salvador,
en Amérique latine,
il trouvera à l’intérieur d’une seule et même fosse
des dizaines ou centaines de cadavres,
les uns sans bras, d’autres sans jambes,
et de nombreux autres décapités.
Alors le chercheur expliquera
qu’il s’agit de victimes sacrificielles
pour apaiser la colère des dieux.
À nouveau on doutera
de la nature des Mayas
et il s’en trouvera même qui affirmeront
que ces Mayas étaient cannibales
comme leurs ancêtres
parce qu’ils mangeaient leurs victimes
ou parce que le rituel sanglant exigeait
de démembrer les malheureux
avant de les enfouir tous ensemble
dans une fosse commune.
L’hypothèse sera crue, bien sûr,
si ces graves mayanistes
ne prennent pas note dans leurs carnets
que ces morts innombrables
sont le résultat des grands massacres
commis par les Kaibiles surentraînés
et les commandos Atlacatl4
usurpant et profanant cyniquement
les noms de deux caciques héroïques
qui contre les avides envahisseurs
mal-nommés conquistadores
luttèrent avec ténacité, corps à corps
et non avec des fusils israéliens
ni des M16 de gringos
mais avec des armes nationalistes :
leur sang, leurs flèches,
et leur lutte corps à corps
pour repousser les envahisseurs.
Ainsi dira l’archéologue de l’avenir
qui à présent mesure seulement des crânes ancestraux
et se réjouit d’ouvrir une tombe de plus,
tandis que le même jour,
quelque part
tout près de lui, et tous les jours,
on ouvre des centaines de tombes
de paysans pauvres, indigènes
tombés sur les hiéroglyphes.
Cela n’a pas d’importance, diront certains,
Le temps ne manquera pas
pour continuer de fouiller, de creuser
et de forger des théories
sur pourquoi les Mayas ont disparu
et où sont allés les « Indiens »
avec leurs dieux, leurs costumes bigarrés
et le pesant bagage
de leur savoir millénaire.
4 Kaibiles et Commandos Atlacatl : Selon le glossaire en fin d’anthologie, ce sont les noms d’unités de l’armée guatémaltèque (Wkpd ne connaît cependant de « bataillon Atlacatl » que pour l’armée salvadorienne) spécialisées dans la contre-insurrection (lutte contre la guérilla) et nommées d’après deux caciques indiens du XVIe siècle (ce qui, fait remarquer le poète, est du cynisme compte tenu des massacres d’indigènes dont elles furent responsables).
*
Nous chuchotons (Kuj jasjatik, Cuchicheamos) par Pablo García
Dans la tritureuse d’os de l’enfer
Jun Kame et Wuqub’ Kame6 nous rôtissent
…………………………..nous grillent
…………………………..nous pulvérisent
tandis que nous pleurons
………………..gémissons
………………..et chuchotons.
Pourquoi nos tendres visages sont-ils devenus des vieillards ridés ?
Pourquoi nous sommes-nous enfermés endormis dans la sépulture ?
Pourquoi nous sommes-nous convertis en âmes mortes ?
Pourquoi l’ambition des choses
et des charognes tridimensionnelles
nous a-t-elle changés en roseaux pourris ?
Pourquoi n’avons-nous pas travaillé avec le feu cosmique
de Jun Ajpu et Ixb’alamkej7
pour devenir une perpétuelle racine de lumière ?
Pourquoi ne ressuscitons-nous pas de l’enfer
pour retourner à nos pères et mères Étoile
…………………………………….Sirius
…………………………………….Soleil
…………………………………….et Lune Blanche ?
6 Jun Kame et Wuqub’ Kame : Deux divinités de l’enfer.
7 Jun Ajpu et Ixb’alamkej : Dans une graphie différente, ce sont les héros Hunapú et Ixbalanqué que nous avons déjà rencontrés dans « Le poème des héros » supra.)
*
Animal rationnel (Chomanel Awaj, Animal racional) par Pablo García
Sans plus de sagesse solaire
pour nous tout était réjouissance et prospérité
quand nous marchons dans l’obscurité de la Lune Noire
nous logeons un animal rationnel, penseur
entre les quatre piliers et soutiens de nos cœurs.
Aujourd’hui, là maintenant
l’animal rationnel, penseur
consomme le feu de notre essence
et transforme
en pierres ponces desséchées nos têtes
en vermisseaux ridés nos organismes
et en pantins acides nos personnalités.
Aujourd’hui, là maintenant
nous ne sommes plus que térébenthine sèche d’animal rationnel
empilés devant Jun Kame et Wuqub’ Kame
nous brûlons
et flambons en enfer.
Aujourd’hui, là maintenant
nous ne sommes que suie sèche d’animal rationnel
nous souillons Jun Ajpu et Ixb’alamkej
nous noircissons la fleur de l’étoile de la vie
avant de nous pulvériser
………………et de nous endurcir
dans le nombril du feu infernal.
*
Canne à sucre pourrie (Q’uma’r aj, Caña podrida) par Pablo García
Notre regard reflète un ciel enfumé
et un cœur nu sans tournesols
parce que nous avons été convertis en cannes à sucre pourries de l’enfer.
Nous avons perdu nos poissons et sapins de sagesse solaire
et nous suspendons des nœuds pourris d’animal rationnel
dans nos essences et organismes :
nœud d’arrogance, de croûtes sur nos yeux
nœud de colère, de luttes dans nos estomacs
nœud de larmes, de gémissements dans nos gorges
nœud de désir, d’appétit dans nos entrailles
nœud d’avarice, d’envie dans nos cœurs
nœud de connaissance, d’inquiétude dans nos cerveaux
nœud de gloutonnerie, de saoulerie dans nos intestins
et nœud de veine variqueuse dans nos genoux.
À présent
nous ressemblons à de maigres plaies
…………………………………………recroquevillées
…………………………………………et débiles
de même nous ressemblons à des plaies grasses
…………………………………………………nous purulons
…………………………………………………nous empestons
…………………………………………………et nous hurlons
par nos nœuds pourris.
À présent
avec la puanteur asphyxiante de nos nœuds pourris
nous engraissons Jun Kame Wuqub’ Kame
nous endormons Jun Ajpu Ixb’alamkej
et nous calcinons l’air
…………………………………………….l’eau
…………………………………………….la terre
…………………………………………….et le feu.
*
Hiver attendu (Nhab’il echmab’ilxa, Invierno esperado) par Santos Alfredo García Domingo
La pluie reviendra caresser ton visage
Ô terre martyre et stérile !
Elle viendra par ses gouttes d’eau
étancher ta soif et tu seras
la mère reconnaissante de toujours.
Les fleuves et les mers se réveilleront
de leur rêve éternel de liberté
et la rage assassine de l’homme
perdra sa force un jour.
Les peuples crieront dans leur joie
un hymne de grâce et d’harmonie
quand ils porteront les fruits de ton sein
à la chaleur de leur foyer,
feu du foyer béni.
*
Notre seigneur Obsidienne (K’awá Tijax) par Adela Delgado Pop
Aujourd’hui, par une chaude
et somnolente soirée,
K’awá Tijax a brisé
ce sentiment
que chérissait mon cœur.
Obsidienne à double tranchant
coupant à la racine ce sentiment malsain,
cette plaie toujours ouverte
que j’avais crue être le bonheur.
Médecine ancestrale
et définitive
arrachant à la racine
la pourriture occulte
que je craignais de toucher.
Mes os se brisèrent
avec mon cœur
et mon âme s’emplit
d’obsidiennes coupantes, cruelles
qui la saignent sans pitié.
Mes jambes pouvaient à peine
me porter,
je serrai les dents et courus.
Ah, l’amère médecine
pour me guérir de toi !
*
J’aime (Me gusta) par Adela Delgado Pop
J’aime la nuit
parce qu’elle
apporte le son du silence
que l’on ne peut écouter en plein jour
à cause de tant de bruit stupide.
J’aime l’obscurité
parce qu’elle me montre
les choses comme elles sont et
non comme mon imagination
voudrait les voir.
J’aime l’aube
parce qu’elle a coutume d’être froide
et cohérente
même si le jour doit être
une canicule d’enfer.
J’aime la lune
parce qu’elle teint tout d’argent,
comme si tout était
également précieux,
également superflu.
J’aime la nuit
car elle est intemporelle
parce que c’est l’heure des âmes
et des autres formes de vie
Nezahualcoyotl
J’aime la mort
car elle est définitive
parce que
c’est l’unique partage des eaux
que j’ai appris à respecter.
*
Nous (Nosotras) par Adela Delgado Pop
Nous qui supportons la violence
à fleur de peau
car ainsi le voulut
le dieu blanc.
Nous qui pleurons par devers nous
en serrant les dents
car ainsi le veulent
ses maudits héritiers.
Nous qui crions d’angoisse
dans l’obscurité
parce que nous barrent tous les chemins
ces infâmes gendarmes.
Nous sommes aussi celles qui rient
sans demander la permission
et chantent des berceuses
aux siècles.
Nous sommes aussi celles qui sèment
des fleurs dans le désert
et font mettre bas des épis de maïs
à la terre aride.
Nous sommes aussi celles qui aiment
en liberté
et dansent joyeuses à la pleine lune
car nous sommes la vie.
*
Paradis acheté (Manb’il xewb’al kamichej, Paraíso comprado) par Daniel Caño
Nos anciens racontent
qu’à l’époque coloniale
quand un latifundiste
était enfin fatigué
de voler tant de terres
et d’exploiter les Mayas,
il faisait de pieuses donations
non aux Mayas
mais aux moines pansus
afin que ceux-ci
disent des messes pour son âme
quand il serait mort.
Quand je serai mort
je n’aurai rien à donner,
j’espère seulement ne pas me retrouver
en enfer
avec tous ces connards.
*
Oraison sauvage (Stxaj no’ anima, Oración salvaje) par Daniel Caño
Son oraison favorite
était de gravir les montagnes,
qui lui révélaient
un sens profond de la vie.
Il contemplait l’herbe, les fleurs,
les arbres, les pierres, les fourmis,
les abeilles, les papillons, les oiseaux
et tout ce qui l’entourait
avec une passion indéchiffrable.
Cela fascinait mon grand-père
d’écouter la voix de l’air,
le chant des oiseaux et des grillons
et les milliers de sons
que seule la nourrice nature
pouvait lui offrir.
Il était silence dans le silence,
voix entre les voix,
air dans l’air,
nuage entre les nuages,
lumière entre les lumières et les ombres.
Il est clair que tout cela lui donnait
une plus grande tranquillité d’esprit
qu’entrer dans une somptueuse église.
C’est pourquoi ils l’appelaient « sauvage ».
*
Sensibilité perdue (Kamnaq el sk’ununihal, Sensibilidad perdida) par Daniel Caño
Un enfant parle avec son chat et son chien,
il parle avec les papillons, les abeilles,
les plantes et les fleurs,
il parle avec la lune et les étoiles.
Quand il devient grand,
tout cela lui semble ridicule.
Je m’interroge :
où, quand et comment
a-t-il perdu cette sensibilité ?
*
Les enseignements de ma grand-mère (Skuyb’anil hinchikay, Les enseñanzas de mi abuela) par Daniel Caño
Maïs rouge :
……………bon pour ton sang.
Maïs noir :
……………bon pour tes cheveux.
Maïs blanc :
……………bon pour tes os, tes dents et tes ongles.
Maïs jaune :
……………bon pour ta peau.
Et maïs tacheté :
……………bon pour discerner les conneries
……………qu’ils te fourrent dans le crâne
……………à l’école.
*
Seulement en enfer (Asannej b’ay xol infierno, Sólo en el infierno) par Daniel Caño
Ils viennent nous chasser de notre village
armés de fusils et de bombes,
affirmant que la terre
que nous habitons depuis des milliers d’années
ne nous appartient pas.
Et quand nous émigrons à la ville
ils ne nous acceptent pas.
Il n’y a ni terre ni travail pour nous.
Où pourrons-nous vivre en paix ?
Peut-être en enfer seulement.
*
Ut’z Baby par Rosa Chávez
Ndt. Ce poème, écrit en espagnol, est intéressant entre autres pour le mélange qu’il fait de mots mayas et anglais, comme le montre le titre, Ut’z Baby, avec le mot maya ut’z, bon (Good Baby). Tout comme on parle de spanglish (ou espanglish), l’équivalent de notre franglais, il semble inévitable que les locuteurs mayas éduqués et travaillant à la ville, confrontés à la culture de masse mondialisée d’origine nord-américaine, développent ce que l’on pourrait appeler un « mayanglish » ou « mayaspanglish », notamment dans la capitale « Guatemala city » (plutôt que Guatemala ciudad, voir la fin du poème).
Kaxlan, au vers 2, désigne une personne non maya (on l’a déjà rencontré dans « L’Interrogatoire des ancêtres », avec la graphie Kaxhlan : les Kaxhlanes), et nojim (vers 9) veut dire « doucement ».
Ci-dessous je donne d’abord la version originale, avant ma traduction.
Ut’z baby
así kaxlan
el amor en medio de la locura
aunque el mundo diga
que todo es frontera
lágrima rota
mala vida y mala muerte
besame en la calle más amarga
nojim baby nojim
besame en la calle más amarga
veamos juntos el atardecer
en Guatemala city
Ut’z baby
comme ça kaxlan
l’amour au milieu de la folie
même si le monde dit
que tout est frontière
larme brisée
mauvaise vie et mauvaise mort
embrasse-moi dans la rue tellement amère
nojim baby nojim
embrasse-moi dans la rue tellement amère
regardons ensemble la nuit tomber
sur Guatemala city.
*
Poème de Pedro Chavajay García
1 rue
peut te conduire
2 rues
peuvent t’égarer
3 rues et tu oublies ton nom
Si tu ne trouves pas
les rues
inventes-en une au hasard
Le chemin
sera ton cadavre
*
Le cadeau de la pluie (Ssab’ejal Nab’, Regalo de la lluvia) par Sabino Esteban Francisco
Le vent
peigne les arbres
les oiseaux
chantent l’invitation
et quand le tonnerre
annonce la fête
les nuages arrivent
– vêtus d’eau –
avec notre cadeau de pluie.
*
Pleine lune (Xajaw, Luna llena) par Sabino Esteban Francisco
Il y a des nuits
où la lune a
la rondeur
d’une tortilla
de maïs jaune.
– Odorante
et chaude –
comme sur
un comal de terre cuite.