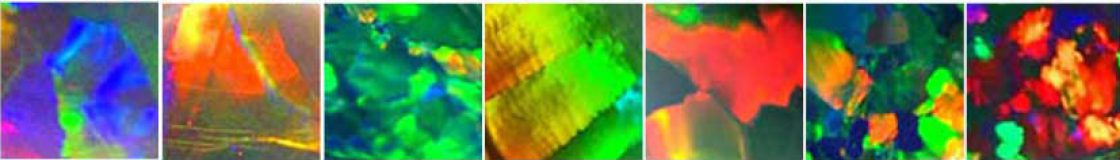Tagged: Chevaliers teutoniques
Les dieux dormants et autres ballades d’Agnes Miegel
Agnes Miegel (1879-1964) fait partie des poètes qui renouvelèrent le genre de la ballade en Allemagne au vingtième siècle. C’est d’ailleurs le pionnier de la renaissance de la ballade allemande, le poète Börries von Münchhausen (1874-1945), qui la lança dans les milieux littéraires, après qu’elle lui eut envoyé ses écrits.
Ce qu’on appelle Ballade en allemand n’est pas la même chose que la ballade comme forme poétique en français, « poème formé de strophes égales terminées par un refrain et d’un couplet final plus court appelé envoi », telle que la Ballade des pendus de François Villon. En allemand, le terme ne renvoie pas à une forme mais à un genre, un genre entendu de façon particulièrement large puisqu’une définition y voit « un poème (ou un chant) dans lequel une histoire est racontée » (ein Gedicht [oder ein Lied], in dem eine Geschichte erzählt wird) ; d’autres ajoutent que c’est généralement un poème plutôt long et que le thème en est le plus souvent tragique. Les ballades ci-dessous montrent que la longueur n’est pas forcément un critère. On pourrait définir la ballade allemande comme un poème narratif, relevant d’une esthétique impersonnelle, parnassienne. Les histoires qu’elles racontent s’appuient souvent sur des épisodes historiques, la mythologie, l’histoire sainte, les contes et légendes.
Les poèmes qui suivent sont tirés de l’anthologie Wie Bernstein leuchtend auf der Lebenswaage: Gesammelte Balladen (Comme de l’ambre qui brille dans la balance de la vie : Ballades complètes) (Rautenberg im Verlagshaus Würzburg, 2002, avec une postface d’Ulf Diederichs). Les thèmes des ballades d’Agnes Miegel sont variés. Elle a notamment chanté les terres et le peuple de Prusse-Orientale (elle était née à Königsberg) ; c’est le cadre de quatre ballades ici traduites : Les femmes de Nidden, Henning Schindekopf, Duc Samo (ces deux dernières évoquant des épisodes de l’histoire des chevaliers Teutoniques) et Le sacrifice.
L’anthologie est organisée suivant des thèmes ; nous donnons nos traductions dans l’ordre où les ballades y figurent.
*
Les dieux dormants (Schlafende Götter, 1953)
Ce sont les dieux dont les noms sont oubliés.
Sur des nuages d’argent, haut au-dessus des ramures et du vent,
dans une pâle lumière ni jour ni crépuscule,
ils trônent en silence, endormis et jeunes éternellement.
Un sommeil d’airain a fermé leurs larges paupières
mais leurs cœurs sont restés éveillés. Ils espèrent, écoutent
si depuis les profondeurs du malheur une voix
désespérée n’appelle point leur nom.
Et ils attendent : ne va-t-on pas les célébrer
avec gratitude, dans le plaisir et la joie, en bas sur la terre en fleurs ?
Alors se réveillera la cohorte des Immortels.
Dans les salles du ciel résonnera leur rire ;
couronnés de fleurs nouvellement écloses,
ils descendront auréolés de leur propre éclat,
enjoués et fiers, prêts à donner leur amour,
miséricordieux ils tendront les bras à la vie expectante.
Les dieux sourient en rêve, comme si soufflaient
sur leurs fronts les prières de cœurs timides,
les bruits de l’air leur semblent un chant de prêtre,
ils le respirent comme une fumée de sacrifices et le parfum du nard,
leurs têtes bouclées s’enfoncent plus profondément dans le rêve.
Les nuées étincelantes sont caressées sans bruit par l’ourlet
du manteau des années vagabondes, par milliers.
Des étoiles éparses effleurent en chantant
les pointes dorées de leurs diadèmes, filantes et chaudes, –
ils ne le voient pas. Ils attendent patiemment le cri
qui les réveillera pour la joie du don généreux.
Mais l’appel de la vie n’animera plus
ceux qui rêvent dans le crépuscule.
En bas sur la terre en fleurs,
leurs derniers autels tombent en poussière.
Depuis tant de siècles que les hommes ne les scandent plus,
les noms des dieux dormants sont oubliés.
*
Ys (Ys, 1901)
Voici ce que raconte l’ancienne légende
qui parcourt la Bretagne dans la brume
et se repose à l’âtre des maisons de pêcheur.
Naguère était au bord de la mer, grandiose
et resplendissante dans l’éclat de ses tours d’argent,
la ville d’Ys, maîtresse altière de la Bretagne,
Ys opulente et merveilleuse.
Au-dessus d’Ys, sur une falaise abrupte,
se dressait fièrement, comme une citadelle des dieux,
puissant et de tant de créneaux, le château du roi.
Le roi avait sept filles,
de sept belles gemmes était sertie
la couronne posée sur son front blanc.
Six topazes couleur d’or
mais la septième, la plus belle,
un rubis étincelant, rouge sang.
Le vieux roi dit à ses filles :
« Il vous est permis de jouer partout dans le château
mais n’ouvrez jamais la porte
couverte de pampres dans le mur du jardin ! »
Et elles dansaient dans les salles froides,
leurs balles volaient à travers la cour,
au jardin elles tressaient des couronnes de fleurs,
elles avaient oublié la porte.
Un jour, elles interrompirent leurs jeux
car le chœur ample de la vie
à leurs oreilles montait depuis la cité.
À l’ombre des châtaigniers,
elles regardèrent en bas dans la chaleur de midi,
leurs paupières devinrent lourdes
et elles tombèrent en un profond sommeil.
Seule la plus jeune resta éveillée.
À travers la pelouse,
en chantant doucement elle poussait sa balle du pied,
quand elle vit dans le mur du jardin
ladite porte entr’ouverte,
et sa balle s’en alla rouler par l’interstice.
Retroussant sa robe de satin,
la jeune princesse suivit le ballon,
pénétrant dans une cour silencieuse.
De grands buissons de sureau en fleur
penchaient leurs blanches ombelles
au-dessus d’un vieux puits de grès
que scellait une pierre circulaire en marbre.
La princesse chercha longtemps
dans l’herbe où les grillons chantaient
sa balle dorée, mais ne la trouva pas.
Soudain, de l’intérieur du puits
elle entendit une voix de jeune garçon :
« Princesse, ouvre-moi ! »
Elle resta figée d’une douce frayeur.
Et la voix redit les mêmes paroles,
si suppliante que son cœur battit plus fort.
Et la troisième fois que la voix parla,
ce fut d’un ton de commande : « Ouvre-moi ! »
Du sang de ses mains blanches
la dalle de marbre fut rougie
quand la jeune fille avec peine la délogea.
Alors monta des sombres profondeurs du puits,
clair et froid, un panache blanc
et deux bras se tendirent vers la princesse
qui tremblait de peur et de plaisir
et ferma les yeux à leur approche.
Ses sœurs se réveillèrent avec effroi,
entendant comme un battement d’ailes de rapace.
De la porte dans le mur du jardin
à grand bruit un torrent se précipita,
dont le déferlement couvrit leur cri d’agonie.
Croissant toujours, il se jeta de la falaise
comme une mer aspirant à rejoindre la mer,
tandis que sur la plage les flots montaient.
Et les deux vagues géantes, mugissantes
coururent impétueusement l’une vers l’autre
et dans un bruit de tonnerre se rencontrèrent.
Sous leur blanche écume elles engloutirent
la fière maîtresse de la Bretagne,
Ys l’opulente, la merveilleuse.
*
La belle Agnete (Schöne Agnete, 1905)
Ndt. Il s’agit d’une évocation du conte scandinave Agnete et l’ondin, traité en littérature par les romantiques danois Baggesen, Oelenschläger, Hans Christian Andersen (« Agnete og havmanden »), de même que par Ibsen au théâtre (« La dame de la mer »).
Quand la veuve de sieur Ulrich dans l’église s’agenouilla,
on entendit une chanson sur l’aître.
L’orgue en-haut s’arrêta,
les prêtres et les enfants de chœur s’immobilisèrent,
les ouailles, vieillards, femmes, enfants, écoutèrent,
la voix dehors chantait comme le rossignol :
« Chère mère, dans l’église où sonne le carillon du sacristain,
chère mère, écoute chanter dehors ta fille.
Car je ne peux entrer avec toi,
car je ne peux m’agenouiller devant l’autel de Marie,
car j’ai perdu la béatitude éternelle,
car je me suis mariée avec l’ondin, noir comme la fange.
Mes enfants jouent avec les poissons du lac,
mes enfants ont de la peau entre les doigts et les orteils,
le soleil ne peut sécher leur habit de perles,
leurs yeux ne se ferment ni dans la mort ni dans le rêve.
Chère mère, ah je t’en prie,
chère mère, ah je t’en supplie,
veuille prier avec les tiens
pour mes enfants aux cheveux verts,
veuille prier les saints et notre Dame
en chaque église et devant chaque croix au bord des routes !
Chère mère, ah je t’en prie de tout mon cœur,
pauvre de moi, je n’ai le droit de venir ici qu’une fois tous les sept ans.
Dis sans attendre au prêtre
d’ouvrir grand les portes de l’église,
que je puisse voir la lueur des cierges,
que je puisse voir l’ostensoir doré,
que je puisse dire à mes petits
de quel éclat de soleil brille le calice ! »
La voix se tut.
L’orgue repartit,
les portes furent grand-ouvertes, –
et pendant toute la messe
une eau blanche, blanche écumait devant les portes.
*
Grisélidis (Griseldis, 1901)
Ndt. L’histoire de Griselda ou Grisélidis est tirée de Boccace. Charles Perrault en fit une version dans ses Contes de ma mère l’Oye : La marquise de Sallusses ou La patience de Grisélidis. Grisélidis, bergère épousée par un prince, est le symbole de la femme patiente.
Avec des baisers, des mots d’amour
elle se pendit à son cou. Il la repoussa.
« Fille du travail, qui partages ma couche,
je me suis dégoûté de toi.
Mon amour a pâli comme un ruban perd sa couleur,
ta voix est à présent de mon cœur haïe,
tes cheveux dorés me sont devenus odieux,
ternes comme les seigles de ton père.
Ta main brune parle de travail –
retourne aux champs où je te trouvai,
oublie que le roi prit pour femme
une paysanne – hélas !
Avec la houe et le râteau, les semences et la charrue,
oublie que ton ventre a porté un duc ! »
Ainsi parla le roi ; de Grisélidis
les mains, la bouche tremblèrent.
Contre le pilier du lit en chêne
elle s’appuya, frissonnante, angoissée.
De sa main libre, elle caressait le matelas,
lissait le drap éclatant.
Elle regarda le roi, qui se détourna.
Alors elle descendit l’escalier en silence.
La lanterne de couleurs se balançait au vent,
la porte sculptée claqua contre le chambranle.
La nuit froide scintillait d’étoiles,
le vent du nord souffla dans les cheveux de Grisélidis.
Le chien du garde endormi, près de la grande porte
vint à sa rencontre en grognant sourdement.
Quand il la reconnut, il s’inclina
et affectueusement lécha sa main glacée.
Les yeux du dogue brillaient verts
dans la lumière qui ruisselait des fenêtres.
*
Chronique (Chronik, 1900)
Une bergère était au pré,
gardant ses moutons ;
elle chantait au vent d’été,
ses cheveux tombant jusqu’au sol.
De son château s’en vint
le jeune prince de la contrée ;
depuis le chemin avec sa suite
il vit voler ses cheveux d’or.
Elle chanta une vieille romance
au jeune fils du roi,
qui se mit à genoux
et lui offrit sa couronne.
Par tout le pays la renommée
de la princesse voyagea,
mais la jeune reine
plus jamais ne chanta.
*
Agnès Bernauer (Agnes Bernauerin, 1900)
Ndt. Agnès Bernauer est une figure historique servant de source d’inspiration à plusieurs œuvres classiques de la littérature germanique. Épousée par le futur duc Albert de Bavière malgré l’avis de la famille de ce dernier, après un procès en sorcellerie elle fut condamnée en 1435 à mourir noyée dans le Danube.
Ils chantaient près de l’âtre, la flamme s’éteignant :
« Une rose est éclose ! »
Quand la chanson fut finie, ils demandèrent :
« Pourquoi n’as-tu pas chanté avec nous ?
Pourquoi es-tu si pâle, Agnès Bernauer ?
Que regardes-tu ainsi devant toi ? »
Elle parla comme en sommeil,
fermant ses paupières lourdes :
« La nuit de la Saint-André, je rêvai
que je me trouvais au bord du Danube.
Les cieux luisaient d’un éclat sanglant
et la houle rouge chantait.
Sa danse ondoyante m’apporta
un diadème éclairé par les étoiles, –
mais quand je le pris c’était une couronne mortuaire
de romarins fanés. »
*
L’épouse du meunier (Die Müllersbraut, 1920)
Les cloches sonnaient dans le beffroi
quand le cortège nuptial sortit sur l’aître de l’église.
Avec son voile, sa couronne et sa robe de soie,
la belle mariée marchait aux côtés du meunier.
Et quand ils arrivèrent à la porte de l’aître,
trois blêmes convives les approchèrent.
Trois enfants nus, main dans la main,
tirèrent la mariée par sa robe.
Et le premier parla : « Ô ma mère,
enlève, enlève ton beau voile.
Enlève, enlève ta couronne de myrte !
Ton enfant pourrit parmi les pierres des champs.
Prends une pelle en main
et creuse-moi une tombe au bord du cimetière.
Je repose trop près des champs
où la faux et la faucille vont et viennent.
Je fus conçu là où les épis ondulent au vent
et j’aurais voulu tenir la charrue.
Si j’avais vécu, dans tout le pays
on n’aurait trouvé meilleur garçon de ferme ! »
Et le deuxième, une fille, parla : « Ô ma mère,
descends cette rue, descends le chemin entre les champs
et la prairie jusqu’au radeau, près de l’étang ;
jettes-y un filet de fines mailles,
et quand l’eau l’agitera
ta fille se trouvera dedans.
Je suis née dans le pré au linge, au clair de lune,
et tu me noyas comme un chaton aveugle.
Ô si j’avais vécu – dans la lumière d’été
je ferais blanchir mon drap dans le pré.
Mon drap serait si blanc et lisse
que nul dans le royaume ne tisserait un drap pareil.
Ô si j’avais vécu, dans tout le pays
on ne trouverait de servante plus gaie ! »
Et le troisième parla : « Ô ma mère,
prends ton petit enfant dans tes bras !
Quand tu me portais dans ton ventre, pleine de frayeur,
le fardeau muet sentit ta misère.
Ta peur, ta honte, ta secrète détresse,
je les bus avec le sang rouge de ton cœur.
Et quand tu me mis au monde en secret dans l’étable,
je vis comme tu étais pâle et fatiguée.
Je fus épouvanté par cette vie lugubre
et me recroquevillais dans la paille comme une bête.
Tu couvris de ta main ma bouche pleine de sanglots –
alors je m’endormis. Le repos est si doux !
Chère mère, embrasse-moi, cajole-moi,
je t’aime tellement ! »
Et quand le plus jeune eut ainsi parlé,
la mariée, blafarde, tomba à genoux.
De sa tête elle retira la couronne de myrte,
en para le premier enfant.
Elle ôta son voile des épaules,
en enveloppa sa petite fille.
Et son fils et sa fille disparurent ;
deux roses poussèrent à leur place.
Alors elle prit son dernier enfançon,
tendre et chaud, et le berça dans ses bras.
Quand elle baisa sa petite bouche rouge,
il s’envola comme une colombe – et elle tomba morte.
*
Les femmes de Nidden (Die Frauen von Nidden, 1907)
Les femmes de Nidden étaient sur la plage,
leurs mains brunes au-dessus des yeux,
et les bateaux approchaient en hâte,
des fanions noirs sur leurs mâts.
Les hommes arrimèrent les embarcations
et crièrent : « La peste là-bas fait rage !
Dans la plaine de Heydekrug jusqu’à Schaaken
les gens vont en linceul ! »
Les femmes dirent : « Qu’est-ce que cela fait ?
La mort guette à nos propres portes,
chaque jour que Dieu fait
nous devons lutter pour notre vie,
la dune mouvante nous cause un assez grand souci.
Dieu nous épargnera, après nous avoir frappés ! » –
Mais la peste vint pendant la nuit
avec les élans qui traversèrent le bras de mer à la nage.
Pendant trois jours et trois nuits,
la cloche sonna flébile dans le beffroi.
Au matin du quatrième jour, stridente,
sa voix se brisa de détresse.
Et dans le village, des huttes, des maisons
sept femmes sortirent.
Elles allaient pieds nus et voûtées,
en habits noirs brodés de couleurs.
Elles grimpèrent la dune raide,
mirent leurs bas et leur souliers
et dirent : « Dune, nous que voici
sommes les derniers vivants.
Il n’y a plus de menuisier pour faire nos cercueils,
plus de fils ni de petit-enfants pour nous pleurer,
plus de pasteur pour tendre le calice,
aucun servant n’a conservé la vie. –
Blanche dune, prête attention :
les portes te sont ouvertes,
tu vas entrer dans nos chambres,
couvrir nos âtres, nos jardins, nos granges.
Dieu nous a oubliés, nous laisse disparaître.
Tu vas hériter de sa maison abandonnée
et recevoir la croix et la Bible pour tes jouets. –
À présent, petite mère, ensevelis-nous !
Enveloppe-nous dans le suaire silencieux,
sois notre grâce après avoir été notre malédiction.
Vois, nous attendons tranquillement. » –
Et la dune vint et les recouvrit.
*
Henning Schindekopf (1900)
Ndt. Ce poème et le suivant évoquent l’histoire de la Baltique au temps des chevaliers Teutoniques, qui y fondèrent un État théocratique, le Deutschordensstat (1230-1561). Il ne nous a pas semblé pertinent de multiplier les notes s’agissant de notions historiques certes assez mal connues des Français en général mais qui peuvent être aisément trouvées sur internet (toponymes, personnalités, etc.).
Henning Schindekopf (†1370) était un chevalier Teutonique de haut rang, grand maréchal de l’ordre et commandeur de Königsberg. Le poème le décrit comme étant d’origine roturière et proche des paysans, notamment à l’aide d’un leitmotiv : « Öck sülvst! » (pour « Ich selbst! », c’est-à-dire « Moi-même ! ») en dialecte bas-allemand qui rend à la fois sa volonté jamais en défaut de servir l’ordre (« Moi-même le ferait puisqu’il le faut pour l’ordre »), sa fierté (« Moi-même ait accompli cela ») et ses racines.
Pour quelques éléments historiques sur l’ordre des chevaliers Teutoniques, notamment sur sa présence en France, on pourra consulter notre essai sur « Les chevaliers Teutoniques dans le Midi », dans notre billet Gnostikon mis en ligne en 2016 (ici).
Marienburg
Autour de la citadelle des chevaliers Teutoniques
grondait comme un cri de guerre le chant printanier de la Nogat,
tandis que Winrich von Kniprode, le jour de Pâques,
pour les frères disait la prière sur la lice.
Un messager s’avança par la grande porte :
« Grand maître, les autres m’envoient
pour annoncer que l’ordre Teutonique
s’est rendu maître du duc Kynstudt.
La Lituanie est pacifiée. Celui qui impétueusement
avait meurtri les flancs de sa monture de l’éperon de la sédition,
le duc Kynstudt a les chaînes au pied. »
Winrich dit alors : « Nous donnerons à ce barbare
un profond cachot sous les eaux murmurantes.
Mais dis-moi, qui mit à bas ce mangeur de chrétiens,
quelle main assez calleuse pour que la morsure
du loup enragé ne la déchire point ?
Parle, frère Henning, quel est cet homme ? »
Henning Schindekopf regarda le grand maître,
Henning Schindekopf répondit :
« Öck sülvst ! » [Moi-même !]
Königsberg
Dans le château de l’ordre à Königsberg,
qui est maître des chevaliers et de la troupe,
qui s’assied à la place d’honneur au réfectoire,
avec l’armure d’acier sur ses membres de fer,
front de paysan et tête rouge ?
C’est le maréchal Schindekopf,
le maréchal Schindekopf devant qui en silence
commandeur et commissaire s’inclinent avec respect.
Le grand maître Winrich Kniprode et lui
dirigent le pays, conduisent l’armée.
Le maréchal Schindekopf porte le bâton pacifiquement.
La Prusse a connu neuf années bénies.
Sur les champs que foulait la jument de Kynstudt,
les semailles d’hiver à l’approche de Walpurgis ondoient haut.
Dans les prairies de Werder paissent les chevaux,
les troupeaux avancent au son des sonnailles, –
le maréchal va lentement sur sa monture,
les laboureurs chantent et son cœur chante avec eux :
« C’est avec fierté que je me choisis une devise héraldique
quand Winrich, mon maître, m’adouba chevalier,
avec fierté que je pris alors la parole près du grand autel
devant l’assemblée des frères nés gentilshommes,
mais c’est avec plus de fierté encore que je me dis aujourd’hui :
Qui a donné à ce pays la bannière de la paix ?
Dis-le, Henning Schindekopf !
Moi-même ! »
……….
Un même cri s’entendait sur toutes les routes :
« La Lituanie se soulève ! Elle nous attaque,
le duc Kynstudt conduit de nouveau son peuple à la guerre,
le duc Olgerd à ses côtés.
Sur de bruns coursiers, armées de flèches rapides
s’approchent la faim et la mort. Fuyez ! »
Parmi le rougeoiement des villages incendiés,
le peuple se pressait aux portes de la cité
et c’étaient des centaines d’âmes
qui dans la cour du château parmi les braseros
apportaient leurs fléaux et leurs faux,
pliant le genou devant le maréchal :
« Maréchal Schindekopf, fils de paysan,
tu as une fois vaincu le loup-garou
mais il revient dévorer le pays,
un autre est né de la même portée.
Ils ont soif de sang comme des épées neuves
et chantent ta mort dans leurs chants.
Maréchal, quand tu iras les combattre,
les paysans seront à tes côtés. »
Rudau
La nuit s’épaississait sur le champ de Rudau,
les vagues de la bataille s’amenuisaient comme feu déclinant,
la neige doucement tombait, blanc, lourd manteau,
sur la mourante armée lituanienne.
Mais le camp des chrétiens ne résonnait point
du chant des soldats, de musiques triomphales.
Les dignitaires de l’ordre demeuraient silencieux
autour du maréchal Henning, blessé à mort.
Son manteau, rouge, battait au vent,
il avait le front ceint d’un bandage empourpré.
En reprenant conscience il s’écria : « La bataille est-elle finie ? »
Alors Winrich Kniprode, détournant les yeux :
« Elle est finie. La nuit tombe. »
Le mourant à mots lents demanda :
« Maître, à qui appartient la victoire ? » et le vieillard :
« Nous avons gagné. » Il le dit doucement.
Et plus haut : « Cher Henning, regarde,
des nuages de neige sont venus vers midi,
couvrant la bataille d’une épaisse nuée noire.
Les frères là-haut ne savent pas encore
que l’ordre a bâti la paix pour toujours.
La chevauchée jusque là-bas est difficile et longue.
Qui préviendra Hermann von Salza1
qu’Olgerd et Kynstudt sont battus ? »
« Moi-même ! »
1 Hermann von Salza : Grand maître de l’ordre Teutonique jusqu’à sa mort en 1239, fondateur de l’État de l’ordre. Le grand maître Kniprode demande à Schindekopf mourant d’annoncer la victoire aux chevaliers défunts (« les frères là-haut »).
*
Duc Samo (Herzog Samo, 1900)
Chant funèbre
Le chagrin a donné son bois à mon luth,
des fils de larmes en ont formé les cordes,
et les souvenirs ont produit le chant
qu’il chantait à l’ombre des bouleaux
sur cette colline de brande.
Jadis penchaient les ramures des bouleaux
sur le romarin, la rue et la rose.
Les sveltes filles du duc Samo allaient,
maniant le fuseau et chantant, à travers les jardins,
allaient aux portes donner la bienvenue
à leur père rentrant avec ses fils
à travers la lande dans la pourpre du soir.
Sept enfants à son époux
avait donné la compagne de sa couche,
sept enfants d’une amour heureuse.
Des perles brunes d’ambre baisaient
avec grâce la gorge rose des jeunes filles ;
à travers leurs chemises de lin blanc
brodées de couleurs par l’industrieuse main de leur mère
le vent de la lande et le soleil d’été
caressaient les cœurs des garçons, qui battaient joyeux.
Un jour ensoleillé de mai,
le duc Samo demanda à ses fils
qui de verts rameaux odorants de bouleau
ornaient les crânes de cheval du portail :
« Mes fils, aimez-vous votre vie ? »
« Oui, mon père, j’aime la vie,
répondit le plus âgé, autant que mon arc. »
Le second répondit, « autant que ma canne à pêche. »
Le troisième, « autant que mon couteau brillant. »
Le quatrième, « autant que mon alezan. »
Et le duc à ses filles demanda :
« Mes filles, aimez-vous votre vie ? »
« Oui, mon père, j’aime la vie,
répondit la première, autant que mon collier de perles,
que ma ceinture d’apparat, rouge comme les fraises. »
La seconde : « J’aime la vie,
autant que les fleurs de mes plates-bandes. »
Et la plus jeune : « J’aime la vie,
autant que les enfants que j’aurai un jour ! »
Le vent froid d’automne souffla parmi les bouleaux,
une lamentation se répandit à travers les terres ducales.
Avec la rapidité d’une tempête de neige, dans la lande
s’avançait un peuple guerrier en manteaux blancs.
Couverts d’airain, leur aspect était effrayant ;
contre l’acier de leurs armures frappaient sans force
la flèche prussienne et la lance de saule.
Ils allaient terribles comme la grêle
à travers les champs d’orge et les prés.
Ils agitaient des boucliers brillants
marqués d’une grande croix noire,
et une grande croix sur laquelle était un homme
dominait sinistrement leur troupe.
Se jetant devant lui, ses guerriers dirent au duc Samo :
« Cède, ô duc ! Cet homme sur la croix,
cet homme nu au front sanglant,
c’est l’image de ton pauvre peuple. »
Et les étrangers envoyèrent au duc des émissaires :
« Duc Samo, écoute nos paroles.
Incline-toi devant notre épée et notre Dieu,
jure fidélité à notre vénérable chef,
à l’autel de qui nous Le prions !
Il récompensera ce difficile aveu
comme un chrétien récompense la foi du chrétien,
comme le prince du monde un autre prince
qui brise au combat son bouclier avec lui.
Sur les chevaux blancs que nous amenons,
tes fils seront conduits vers l’ouest,
à l’auguste cour de l’Empereur d’Allemagne.
Ils danseront avec des filles de roi,
s’assiéront à la table des sages conseillers de l’Empereur,
iront à la messe avec des prélats.
Nos parents viendront
de leurs châteaux du Rhin et de la Saale
épouser tes filles blondes.
Tes petits-enfants seront comtes
et porteront couronne. »
Et ils dirent : « Veuille nous faire réponse
demain à l’aube, duc Samo. »
« Je vous répondrai, répondit le duc,
quand rougira le ciel à l’est.
Reposez-vous dans la paix de ma demeure,
sur la paille odorante de vos chambres. »
Quand les émissaires allèrent se coucher,
le duc, visage sombre, entra dans la grand-salle.
Son épouse, assise près de l’âtre entourée de ses enfants
et qui en le voyant avait pâli, lui dit :
« Mon époux, tu nous viens en linceul ? »
Plus blanc que le lin du suaire,
le duc parla, tenant une coupe
ciselée dans de l’ambre
qui rutilait à la flamme rouge de l’âtre :
« Oui, ma femme, je viens en linceul
avec le douaire de ton amour,
le cœur lourd et tenant la mort dans ma main.
Souriante compagne de mon bonheur,
ma noble joie dans les mauvais jours,
penche-toi sur tes enfants
et baise leurs fronts une dernière fois.
Toi qui entras avec moi dans la vie,
aujourd’hui tu entres avec moi dans la mort. »
La duchesse se mit à genoux :
« Laisse-moi baiser ta main avec gratitude
pour les joies de ces vingt années.
Tout comme je te suivis heureuse à la couche nuptiale,
dans la mort ce jour je te suivrai. »
Et elle se tourna vers ses enfants,
mais ceux-ci se détournèrent.
« Mes chers enfants, dit-elle,
vous que je mis au monde dans la douleur,
n’aurez-vous pas un regard pour votre mère,
n’aurez-vous pas un mot d’adieu pour votre père ? »
Les enfants restaient silencieux, détournant le regard.
Alors le plus âgé d’entre eux éleva
la voix. Elle résonna d’un blâme profond
comme le vent qui hurlait dans la cheminée :
« Non, nous n’avons pas de mots d’adieu
pour celui qui nous estime si peu
qu’il ne veut point que nous le suivions,
et qui, sa dernière heure venue, offense son épouse
en reniant ceux qu’elle mit au monde et lui donna.
Tous les chefs de notre vénérable peuple
commandent à leurs serviteurs de mourir avec eux,
font tuer les chiens qui les aimaient,
poignarder les cavales qui les portaient –
mais le duc Samo s’en va et nous commande de rester ! »
Ainsi parlait l’adolescent. Le duc Samo
baissa le front, accablé de chagrin :
« Je n’ai pas voulu blesser votre fierté, dit-il.
Je pensais aux paroles pleines de joie devant la vie
que vous m’avez dites un jour de mai.
Cette vie de vous tant aimée,
je voulais la laisser à votre jeunesse épanouie,
fruit de ma semence.
Car vous connaîtrez la gloire et la fortune
au pays des blonds chevaliers chrétiens :
vous irez à la chasse avec des arcs en or,
à la pêche avec des cannes d’argent,
vous porterez des poignards sertis de pierres précieuses
et chevaucherez des coursiers comme des fils des dieux.
Mes filles porteront des manteaux
aux plis amples, comme la déesse de ces étrangers,
se promèneront en de vastes jardins
que colore de teintes multiples le soleil d’Occident,
elles berceront des enfants de roi. »
« Jamais, dirent alors sombrement ses garçons,
jamais, dirent en tremblant ses filles,
il n’en sera comme vous dites !
Si cela devait être, les luths
qui chanteront dans notre pays
le duc Samo et son épouse
verraient leurs cordes rompre en sons stridents
quand on voudrait célébrer nos noms ! »
Ils se jetèrent à genoux : « Duc Samo,
nous vous en conjurons !
ne nous laissez point voir mourir la vie
à qui nous devons la nôtre : laissez-nous plutôt mourir ! »
Et ils s’inclinèrent et baisèrent longuement,
pleins de respect, avant de boire à la coupe d’ambre,
le pied de leur noble père
et l’ourlet de la robe de leur mère.
Quand le ciel à l’orient se colora,
les émissaires des chevaliers se levèrent
et entrèrent dans la grand-salle
pour recevoir la réponse du duc Samo. –
Ils trouvèrent près de l’âtre froid
le duc mort, morte son épouse,
et morts leurs enfants, comme des graines gelées.
Quand le duc Samo mourut, quand moururent
avec lui ceux qui lui étaient nés,
il emportait, comme font les morts,
le meilleur de son peuple dans la terre.
Sur ces tombes passa la route des chevaliers,
leurs forteresses furent édifiées sur les tumuli
où gisent les guerriers de notre peuple.
Peu d’entre nous sont encore là
pour pleurer dans les nuits de lune
ceux qui sont morts,
pleurer le sort du duc Samo.
Sept années on doit pleurer les morts
qui furent nos amis et nos compagnes,
vingt années on doit pleurer ceux
qui sont nés du même sang que nous,
mais un peuple doit lamenter cent ans
la mort de son dernier roi.
Cela fera bientôt cent ans que dort le duc Samo.
Bientôt contre le tronc de ce bouleau
je briserai ma lyre.
Jamais plus je ne chanterai l’histoire
de la noble mort du duc Samo ;
ma bouche se taira et, avec moi,
le peuple qui lamentait sa mort.
Avec le nom du duc va disparaître
l’idiome qui l’a pleuré.
*
Le sacrifice (Das Opfer, 1920)
Le magistrat siégeait quand ils entrèrent à pas lents,
crachant et ôtant leurs bonnets ; ils venaient par deux, par trois,
trapus, courts, tannés par le soleil, cent hommes.
Ils se rangèrent devant l’estrade et regardèrent le magistrat.
Ils sentaient le sel et le vent marin, la fumée de pin et le goudron.
Le magistrat taillait sa plume : « Willem Pönopp, approche,
toute la Sambie2 est traversée par un cri d’indignation contre toi :
Willem incite les pêcheurs à des sorcelleries païennes.
Je ne suis pas un curaillon ni une vieille femme, et ne me récrie point,
de surcroît le bois est rare pour les malfaisants depuis l’invasion des Suédois3 ;
je t’ai fait fustiger de la baguette de bouleau,
mais à présent fais-moi un rapport précis de tes diableries. »
« Monsieur le magistrat sait comme nous que les Suédois
campaient devant Dirschkeim sur le Wachbudenberg jour après jour.
Nous vîmes leurs feux fumer, et sur la mer
leurs grands bateaux balancer, et nous nous lamentâmes.
Nous courûmes à l’église et chantâmes, bouleversés.
Mais Dieu et son fils Jésus ne nous ont point entendus.
Le Suédois prenait notre poisson dans ses filets
et se reposait, repu mais toujours avide, sur la colline.
Alors nous parlâmes entre nous : ‘Il n’ose encore s’aventurer dans les terres ;
mangeant du poisson comme un héron, il ne quitte la plage.’
Je leur dis : ‘Je connais quelqu’un qui sait mener le poisson.
Alors les pillards bleu-jaune se débrouilleront comme ils peuvent.’
Les autres dirent : ‘Qui est-ce ?’ Ils se turent et se regardèrent,
mais quand le soir fut venu nous étions cent hommes,
et peu avant minuit nous allâmes sur la lande vers Rantau,
conduits par Samel Suppit. Raconte, toi, Samel. »
Le vieillard fit un pas. Il avait quatre-vingt-dix ans, un corps émacié, des cheveux en bataille :
« Dans le noir je reconnus l’entrée du souterrain cachée par la bruyère.
Quand j’y posai le pied, mes aïeux se réveillèrent dans mon sang
et bredouillèrent des mots étranges par ma bouche.
Je tendis les mains et les posai sur la pierre sacrée.
Puis nous jonchâmes le sable autour de rameaux de pin
et scrutâmes dans l’obscurité en appelant, pour savoir si nulle femme n’observait,
car, devant Celui qui remplit la lune suintante, la femme est impure.
Je jetai sur ma veste l’habit blanc,
le feu de pin dardait ses langues, nous nous agenouillâmes dans le sable
et je dis :
‘Ô dieu de nos pères, pour qui brûle ce feu,
seigneur des eaux salées que nul nom ne nomme,
Toi à qui appartient tout ce qui remue des nageoires scintillantes,
Toi qui sur le chef portes le miel figé de la mer,
Toi de la semence de qui proviennent ce pays et nous-mêmes, –
vois, le Suédois ennemi est venu en nageant sur tes flots.
En pillard il se rassasie de notre poisson.
Il a suivi le saumon puissant le long des côtes au printemps.
Ta faveur lui a donné le flet blanc, la morue grasse,
pour lui ont bouilli les vagues de rut laiteuses du hareng argenté.
Tu as longtemps eu soif. Sur ta pierre
coule à nouveau le sang fumant du jeune bouc.
À nouveau nous y versons la bière et l’hydromel,
porte secours à ton peuple dans le besoin qui t’implore,
mets un terme aux succès du pirate altéré.
Notre père, ramène le poisson sur nos côtes !’
Nous criâmes de chagrin, étendus dans le sable,
et quand avec appréhension nous nous relevâmes, le vent avait tourné.
La lune était claire et la brume se répandait sur la mer
comme le blanc filet que jette le pêcheur – et le filet était lourd.
Alors nous nous en retournâmes.
Tu sais bien ce qui se passa ensuite,
comme les Suédois au septième jour firent voile vers le nord.
Les mouettes les suivirent telles une tempête de neige,
car la mer était comme les dunes – dépouillée de toute vie. »
Le magistrat parla : « Elle l’est toujours.
Demain est le Dimanche des rameaux et les greniers sont vides.
Les derniers pois ont pourri, la faim frappe aux fenêtres,
comme en l’an soixante nous pétrissons du bouleau dans notre pain.
Vos filets, vos corbeilles, vos sacs sont vides,
aucun marchand n’est venu de Königsberg depuis des semaines.
Si vous ne voulez pas tout perdre avec femme et enfants,
faites en sorte d’apporter du poisson et vite.
Mais, Willem Pönopp et Samel Suppit – je le dis à tous les deux –,
si je vous trouve sur le parvis de Sankt Lorenz
ou à l’intérieur, quand bien même ce serait Vendredi saint,
le jour même vous regarderez la mer depuis le gibet de Rantau. »
Dans l’église de Sankt Lorenz, le dimanche de Pâques suivant,
monsieur le pasteur parlait devant vingt vieilles femmes.
Les brebis galeuses n’étaient pas là, mais les bonnes ouailles non plus ;
même l’orgue, ce jour-là, gardait le silence.
Il n’y avait pas une barque sur la plage dans la clarté printanière,
toutes les voiles étaient sorties, de Dirschkeim jusqu’à Cranz.
Elles suivaient le puissant saumon le long de la côte
et leurs filets crevaient tant la pêche était bonne.
Les mouettes criardes volaient en cercles lumineux,
devant elles nageait le flet blanc comme le lait.
Alors les fours enterrés fumèrent jour et nuit dans le pays,
de longues rangées de pieux se dressaient dans le vent et séchaient sur le sable.
Et puis vint la morue grasse, nombreuse comme un essaim d’abeilles.
Sa graisse dégoulinait le long des bras tannés des femmes
dont les tabliers paraissaient raides comme des armures d’écailles.
Et puis les hommes regardèrent vers la mer.
Willem Pönopp dit : « Nos éclaireurs sont partis depuis plusieurs jours,
le hareng argenté s’approche d’heure en heure,
bientôt nous laisserons éclater notre joie par des salves de fusil. »
Mais le hareng argenté ne revint jamais.
2 Sambie : Péninsule de la mer Baltique, en Prusse-Orientale.
3 L’invasion des Suédois : Schwedennot, un terme qui littéralement exprime une période de calamités due à la présence des Suédois dans le pays, pendant la guerre de Trente ans (1618-1648). Le contexte historique du poème est dévoilé par ce vers. Dans les mots « le bois est rare », le bois en question est celui du bûcher pour les hérétiques. Plus loin, « les pillards bleu-jaune » sont les soldats suédois, désignés par les couleurs de leur drapeau.
GNOSTIKON (français)
Militia Templi Salomonis Jherosolomitani
La Milice du Temple dans ses relations avec le Languedoc
Nulle autre région, en France ou ailleurs, n’a accueilli autant de commanderies des Templiers que le Languedoc. Anciennement territoire du royaume wisigothique de Septimanie, premier démembrement de l’Empire romain, le Languedoc, dont le nom serait d’ailleurs une altération du germanique Land Goten, ou pays des Goths, a été fortement marqué par l’apport germanique. La noblesse du Midi se montra particulièrement généreuse envers la milice, contribuant à son expansion matérielle en Languedoc et au-delà.
À l’époque du procès des Templiers, qui dura de 1307 à 1314, l’ordre, en France, était partagé entre quatre grandes circonscriptions : Provincia, Aquitania, Francia et Arvernia. La première, provincia Provincie, qui comprenait la Provence et le Languedoc, était la plus étendue et celle où demeurait la majeure partie des Templiers du royaume. Le siège de l’ordre était toutefois situé à Paris, après avoir été à Saint-Jean-d’Acre pendant les Croisades. Le trésorier de la province de Francia était également trésorier du roi, de même que le trésor du royaume de Majorque, dont la capitale était Perpignan, était gardé dans une commanderie templière roussillonnaise.
Par leur implantation européenne, les Templiers nourrirent l’esprit de croisade à travers l’Occident. Les revenus des commanderies leur permettaient de financer leur mission d’assistance aux pèlerins et croisés en Terre sainte. Outre les revenus de leurs activités agricoles, industrielles et financières, les Templiers recevaient les dotations de familles pieuses, particulièrement généreuses en Languedoc, comme on l’a dit. La milice du Temple étant l’instrument majeur de la guerre sainte en Palestine, les chevaliers séculiers prirent l’habitude de lui léguer, à leur mort ou bien lorsqu’ils quittaient l’état de chevalier et leurs autres devoirs mondains, leurs armes et chevaux.
Les Templiers contribuèrent à diffuser l’imagerie de la croisade, en faisant réaliser différents Beati illustrant, par exemple, les versets de l’Apocalypse sur la Jérusalem céleste par des scènes tirées de la lutte contre les Maures. Un autre exemple de cette pensée tournée vers la Terre sainte apparaît dans le fait que les Templiers reproduisirent, dans la construction d’églises, le modèle architectural du Saint-Sépulcre ainsi que du Temple de Jérusalem, où ils avaient initialement leur résidence (d’où leur nom). Enfin, les Templiers, protecteurs des chemins de pèlerinage, comme celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, contribuèrent de manière décisive au développement des routes et autres infrastructures de communication sur le continent.
Malgré sa forte implantation dans le Midi, la milice prit peu de part à la croisade contre les Albigeois. Certains l’expliquent par le fait que les Templiers du Midi étaient plus occupés par la gestion des biens de l’ordre que par la guerre sainte, d’autres par cela que le pape Innocent III avait en 1199 ouvert la porte du Temple aux chevaliers excommuniés, transformant ainsi l’entrée dans la milice en une forme d’expiation, et que l’ordre aurait donc servi de refuge ou de pénitence aux familles de l’aristocratie qui avaient été séduites par le catharisme.
Toujours est-il que le roi Philippe le Bel et l’Inquisition de France menèrent contre les Templiers le procès en hérésie qui devait conduire à la destruction de l’ordre. Le pape Clément V tenta de s’opposer à de telles menées, en exigeant notamment le transfert du procès des tribunaux de l’Inquisition à la Curie. Clément V rejetait l’accusation d’hérésie pour ne retenir que celle de déviation du rituel, laquelle n’aurait dû conduire selon lui qu’à une réforme de la règle et, éventuellement, à la fusion de l’ordre des Templiers avec celui des Hospitaliers. Les Archives vaticanes contiennent un document privé dans lequel le pape expose la nature de la déviation dont les frères se seraient rendus coupables : ceux-ci auraient pratiqué un cérémonial secret d’entrée dans l’ordre (ritus ordinis nostri) consistant à simuler les violences que les Sarrasins infligeaient aux Templiers capturés en vue de les contraindre à abjurer la religion chrétienne et à cracher sur la croix.
Les accusations du roi et de l’Inquisition, beaucoup plus graves, devaient finalement prévaloir. Les Templiers furent accusés d’idolâtrie et d’outrage à la croix. Les griefs complémentaires diffèrent selon que l’enquête fut menée dans le nord de la France ou dans le Midi. Si, dans le nord, le grief de sodomie fut retenu, celui-ci est totalement absent des actes de l’Inquisition dans le Midi, qui consigne, quant à elle, des actes de sorcellerie : des sorcières se seraient matérialisées par invocation dans les lieux de cérémonie des Templiers, où elles auraient pratiqué des orgies avec ces derniers.
L’ordre anéanti, l’organisation économique et sociale qu’il avait établie sur l’ensemble de l’Europe disparut avec lui. Les Templiers survivants furent toutefois intégrés dans les ordres militaires ibériques, qui jouèrent peu de temps après un rôle fondamental dans les grandes expéditions maritimes des royaumes du Portugal (voir ci-dessous) et de l’Espagne.
Bibliographie (partielle) : Les Cahiers de Fanjeaux n°4, E. Delaruelle, « Templiers et Hospitaliers pendant la croisade des Albigeois » ; Les Cahiers de Fanjeaux n°41, B. Frale, « Du catharisme à la sorcellerie : Les inquisiteurs du Midi dans le procès des templiers »
*
Note sur la justice du Temple
L’ordre des Templiers exerçait le pouvoir judiciaire dans le domaine des commanderies. Ce pouvoir lui avait été transféré, en même temps que propriétés foncières et autres biens, par les familles nobles, dont il était une prérogative au sein du système féodal. Les Templiers furent ainsi investis de la justice seigneuriale. En tant que justice d’Église, la justice du Temple se distinguait cependant de la justice féodale traditionnelle par certains aspects qui en faisaient, entre les deux systèmes, une organisation sui generis.
Dans l’exercice de leur pouvoir judiciaire, les Templiers étaient soustraits à l’interdit de verser le sang imposé aux autres juridictions ecclésiastiques. C’est cet interdit qui, par exemple, exigeait le recours au bras séculier des rois pour exécuter les arrêts des tribunaux de l’Inquisition. L’ordre du Temple, en sa qualité de milice de moines-chevaliers, exécutait lui-même les peines corporelles qu’il prononçait, et qui pouvaient aller de la fustigation à la peine capitale, en passant par la marque au fer rouge sur le front, par exemple pour un vol aggravé, ou l’amputation, par exemple pour le viol d’une femme mariée. L’exécution des peines était publique, et visait à produire un effet à la fois dissuasif et infamant.
En raison de son origine féodale, la justice templière s’exerçait principalement dans les campagnes, bien que la domination seigneuriale des templiers pût également s’étendre à certaines villes. C’est tout naturellement dans le cadre de ces dernières que se fit d’abord jour le conflit de compétences entre la justice de l’ordre et celle des échevinages et consulats, le pouvoir judiciaire étant un privilège inséparable du mouvement des libertés communales. À ce conflit s’ajouta pour le Temple, notamment en France, celui avec la justice royale.
*
Les Chevaliers teutoniques dans le Midi
Souveraineté temporelle des Chevaliers teutoniques
Si le Saint-Siège, au Vatican, possède toujours les attributs d’un État souverain et indépendant, cela fut aussi le cas, par le passé, de certains ordres, comme celui des Chevaliers teutoniques. L’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean a longtemps exercé la souveraineté temporelle sur l’île de Malte et conserve encore aujourd’hui, sous le nom d’ordre de Malte, certaines prérogatives souveraines : il possède cent représentations diplomatiques bilatérales, et, de manière plus symbolique, son dernier Grand-Maître, décédé le 7 février 2008, portait le collier de l’ordre équestre pontifical Piano, remis par le Vatican et réservé aux seuls chefs d’État.
En Prusse et dans les actuels pays baltes, l’ordre teutonique exerçait la souveraineté sur un territoire autrement plus étendu que celui de l’île de Malte. Connu sous le nom d’« État de l’ordre » (Ordensstaat), cette organisation politique a duré deux siècles, de 1343 à 1561.
L’Ordensstaat possédait un système judiciaire spécifique, une monnaie propre, aux insignes de l’ordre, ainsi qu’un gouvernement central organisé autour du Grand-Maître, qui était à la fois prince d’Empire et membre de la Hanse. Dans ce système, le Grand-Maître (magister generalis ou Hochmeister), nommé à vie par le chapitre électoral de l’ordre, possédait l’autorité suprême. Il était entouré de cinq officiers supérieurs, le grand commandeur, le maréchal, le drapier, l’hospitalier et le trésorier, qui formaient autour de lui un conseil exécutif. En dehors de la Prusse, les provinces de Livonie et d’Allemagne étaient assignées à des maîtres de province (Landmeister). Chacune des trois circonscriptions était divisée en bailliages et commanderies, qui constituaient les échelons administratifs de l’État.
L’État de l’ordre ne préleva pas d’impôt avant 1415. Son organisation économique assura à son territoire une prospérité qui n’a de comparable, à la même époque, que celle liée à l’activité des Templiers. Une telle prospérité prit fin, dans un cas comme dans l’autre, avec le démantèlement de ces ordres.
La Prusse des Chevaliers teutoniques était impliquée dans des activités de crédit à grande échelle. Le système en question – de même que celui des Templiers – ne présentait aucun caractère usuraire. De cette prospérité économique sans précédent témoigne le développement des ports de Danzig, Königsberg et Elbing, qui devinrent à l’époque des axes importants du commerce international. Les grandes entreprises liées au commerce du grain, du bois, de l’ambre et des minerais d’Europe centrale étaient propriétés d’Etat. L’usure était interdite. Le démantèlement de l’Ordensstaat au profit de principautés et monarchies séculières dépendantes de l’usure conduisit à l’instauration progressive d’un régime capitaliste financiarisé qui s’est imposé depuis sans restriction, avec son cycle inexorable de crises globales.
La donation des fleurs de lys
Il est peu connu que les Chevaliers teutoniques portaient sur leurs armes les fleurs de lys, à l’instar des rois Capétiens. Ceci remonte à une donation de Louis IX à l’ordre, réalisée en 1250 à Acre, au moment de la Croisade. Le roi Saint Louis souhaitait ainsi distinguer le mérite des Chevaliers, et ceci est l’un des derniers actes majeurs de son règne, juste avant sa captivité et sa mort. Si certains historiens doutent – je ne sais pourquoi – de la réalité de cette donation, celle-ci est établie par les chroniques de l’ordre.
Les Chevaliers teutoniques dans le Midi de la France
L’ordre teutonique possédait deux maisons dans le Midi de la France, à Montpellier et à Arles. Constitué en Terre sainte comme ordre d’hospitaliers et de moines soldats, les Teutoniques sont une création des nobles du Saint-Empire romain germanique, confirmée par le pape Innocent III en 1199. Le centre de l’ordre était d’abord situé à Acre, en Palestine, jusqu’à la perte de cette ville en 1291. À cette date, la maison principale fut déplacée à Venise. Ce n’est qu’en 1309 que l’ordre s’établit à Marienbourg, en Prusse, où il exerça la souveraineté dans les limites de l’Ordenstaat de Prusse et de Livonie. Si ses activités dans le cadre de l’Ordenstaat et de la christianisation des pays d’Europe orientale sont les plus connues, l’ordre n’en possédait pas moins des commanderies dans le bassin méditerranéen, en Grèce, en Italie, en Espagne, ainsi qu’en France : en Champagne et en Île-de-France (province dite de Francia), comme dans le Midi.
Il apparaît que les deux maisons de Montpellier et d’Arles ne relevaient pas de l’administration de la commanderie de Francia. La rareté des documents existants, ou connus, ne permet pas de l’assurer avec une certitude absolue, mais il semblerait plutôt, en effet, que ces maisons ou bien possédassent un statut plus ou moins indépendant ou bien fussent administrées par le procureur général de l’ordre à la cour pontificale d’Avignon.
Le 15 mars 1229, la ville de Montpellier octroya à deux procureurs du grand maître Hermann de Salza, Jean de Gordone et Guillaume de Muttels, l’hôpital Saint-Martin, dans le faubourg de la ville, une donation confirmée l’année suivante par bulle papale. Cette possession était importante dans le cadre des relations, notamment commerciales, avec le centre d’Acre en Palestine. La date de création de la maison d’Arles et de ses dépendances en Camargue est quant à elle inconnue : elle a dû avoir lieu au cours de la première moitié du XIIIe siècle. L’ordre administrait également à Arles un hôpital pour les pèlerins.
La première maison fut vendue en 1343 ; la seconde est mentionnée pour la dernière fois en 1354. Cependant, les contacts entre l’ordre et le Midi ne cessèrent pas avec la fin de cette commanderie. Des liens demeurèrent ainsi avec l’Université de Montpellier, où plusieurs frères de l’ordre firent leurs études et même enseignèrent ; par exemple, Dietrich von Ole, procureur du maître de Livonie, y enseigna entre 1364 et 1366. En outre, plusieurs représentants de la noblesse languedocienne participèrent, dans la seconde moitié du XIVe siècle, aux combats de l’ordre contre les Lituaniens.
L’implantation du centre de l’ordre à Marienbourg et, donc, le déplacement du champ d’action des Chevaliers beaucoup plus à l’Est sont la raison pour laquelle les activités des Chevaliers teutoniques dans le Midi de la France ne connurent pas un plus grand développement. Cependant, leur présence n’est pas restée sans influence, puisqu’ils ont contribué tant au développement de l’Université de Montpellier qu’à celui des relations entre les noblesses languedocienne et allemande.
Bibliographie (partielle) : Thomas Krämer, « L’Ordre teutonique dans le Midi », Cahiers de Fanjeaux n°41 (K. Forstreuter, Der Deutsche Orden am Mittelmeer ; H. d’Arbois de Jubainville, L’Ordre teutonique en France)
*
Castrum peregrinorum
Le castrum peregrinorum, ou château des pèlerins, fut édifié en 1218 lors de la cinquième Croisade, à quelques kilomètres au sud d’Acre, de manière conjointe par l’ordre du Temple et les Chevaliers teutoniques. Le comte Gautier d’Avesnes, qui avait été libéré de sa captivité en Terre sainte par les Templiers, fut l’un des principaux contributeurs à son édification. Le château fut confié à la milice templière, qui en fit l’une de ses principales places fortes en Palestine. Il s’agissait pour elle de remplacer le siège qu’elle possédait à Jérusalem, dans le Temple de Salomon, dont l’Ayyoubide Saladin les avait chassés.
La forteresse subit avec succès plusieurs sièges de la part des musulmans, dont les plus notables eurent lieu en 1220, alors même que la construction du château n’était pas achevée, et en 1265. Le château fut abandonné par ses habitants en 1291, après que toutes les cités des Croisés en Terre sainte eurent été emportées par l’islam. Il fut la dernière possession non insulaire des Croisés en Palestine. Les Templiers se replièrent alors à Malte.
Le Grand-Maître du Temple Guillaume de Sonnac, gouverneur de la forteresse, fut le parrain de Pierre de France, comte d’Alençon, fils du roi Saint Louis, qui fit donation des fleurs de lys royales aux Chevaliers teutoniques par lettres patentes du 20 août 1250. C’est au château des pèlerins que résida Saint Louis après sa défaite à Damiette, sur le Nil, en 1249.
À l’intérieur du château se trouve une chapelle de forme orthogonale ; comme les autres églises bâties par les Templiers, elle reproduit, en dimensions réduites, la forme du Temple de Jérusalem.
Le castrum peregrinorum témoigne des relations étroites entre les deux ordres des Templiers et des Teutoniques.
*
A Ordem de Cristo, ressurgimento da Ordem do Templo
L’Ordre du Christ au Portugal, successeur de l’Ordre du Temple
A bula de fundação Ad ea ex quibus concedida pelo Papa de Avinhão, João XXII, em 14 de Março de 1319, proclama primeiro o nascimento da nova Ordem, denominada Ordem de Cavalaria de N. S. Jesus Cristo e institui a fortaleza de Castro Marim, situada no extremo sudeste do país, na foz do Guadiana, como casa capitular. (…)
Os historiadores consideram que a Ordem de Cristo foi o principal refúgio dos Templários que escaparam às grandes detenções de 13 de Outubro de 1307, em França. Esta nova Ordem portuguesa constituiu, pois, o ressurgimento da Ordem do Templo. A maioria dos cavaleiros templários chegou a Portugal por mar, pois uma parte da frota templária, que tinha partido de La Rochelle para evitar a sua requisição, desembarcou no Porto de Serra d’El Rei, um bastião portuário erigido por Gualdim Pais, hoje desaparecido. Por consequência, a Ordem de Cristo herdou os conhecimentos dos Templários em matéria de construção e de navegação marítima. Estes serão utilizados, um século mais tarde, pelo Infante D. Henrique, o Navegador, governador da Ordem de Cristo, para aperfeiçoar a sua famosa caravela, cujas velas ostentam com orgulho a Cruz dos Templários, e, posteriormente, por Cristóvão Colombo, genro do Grão-Mestre da Ordem de Cristo.
Paulo Alexandre Loução (voir son livre Os Templários na Formação de Portugal, 2000)
*
Vellédas chrétiennes : sainte Brigitte et sainte Dorothée
Le don de prophétie était chez les anciens Germains le fait surtout de certaines femmes. L’expression de weise Frauen pour les désigner – « femmes douées de sagesse » – n’a pas d’équivalent en français, ni le terme Salige également employé, notamment en Autriche, et qui comporte l’idée de sacralité (selig). Tacite ou encore Dion Cassius évoquent par exemple le rôle important joué chez les Germains par la voyante Velléda, du clan des Bructères.
La figure des weise Frauen, qui traverse toute l’Antiquité, présente une origine hyperboréenne. Ainsi, la Pythie était l’oracle d’Apollon à Delphes. Apollon était le dieu des Hyperboréens et Delphes devint sa capitale en Grèce. De même, les vierges hyperboréennes Opis et Argé étaient vénérées comme des saintes à Délos, l’île sacrée d’Apollon, et l’on y fêtait chaque année des fêtes en leur honneur. Le poète délien Olen, qui a également écrit des oracles et est l’auteur des premiers hymnes en l’honneur d’Apollon, a composé un chant les célébrant. Le don de prophétie était appelé le « délire apollinien » ; Hérodote rapporte qu’Aristée de Proconnèse en fut saisi lorsqu’il composa le chant des Arismapées, et qu’il fut même physiquement absent, après une catalepsie, durant toute la durée de son transport.
L’autre oracle majeur de l’Antiquité grecque, la Sibylle, était également prêtresse d’Apollon. On possède aujourd’hui encore des textes appelés Oracles sibyllins, qui étaient considérés par les premiers Pères de l’Église comme sources de foi chrétienne.
Les weise Frauen se sont conservées dans le christianisme médiéval sous l’aspect de saintes telles que sainte Brigitte de Suède et sainte Dorothée de Montau, patronne de l’Ordenstaat. (La Bible connaît également ces weise Frauen : Déborah – Cantique de Déborah –, la prophétesse Anne.)
Sainte Brigitte, fondatrice à Wadstena de l’ordre du Saint-Sauveur, est la patronne de Suède, mais également des pèlerins. Elle accomplit elle-même le pèlerinage de Compostelle et celui de Jérusalem. Ses révélations et prophéties ont été consignées par écrit, et une traduction française en fut faite en 1536 sous le nom de Prophéties merveilleuses de sainte Brigitte. Sainte Brigitte est souvent représentée avec un cœur accompagné de la croix rouge de Jérusalem, ou croix des Templiers.
Sainte Dorothée de Montau est la patronne de l’Ordensstaat fondé par les Chevaliers teutoniques. Ses prophéties et révélations sont contenues dans le Septililium de Johannes von Marienwerder. La demande de canonisation adressée par les chevaliers après sa mort n’aboutit pas avant 1976 ! Mais les populations catholiques de Prusse témoignaient ouvertement leur mépris pour la bureaucratie curiale en célébrant chaque année la fête de leur sainte.
Le prestige de ces weise Frauen devait être contré au sein de l’Église par les mêmes forces qui instituèrent les ordres mendiants, et tel fut le rôle joué par Thérèse d’Avila. Les commentateurs récents, y compris chrétiens, se complaisent à souligner le caractère érotique et scabreux des effusions de cette dernière. Thérèse d’Avila institua une nouvelle règle pour les cloîtrées, dont J.-K. Huysmans écrit ceci, dans La Cathédrale : « Si la règle de sainte Thérèse, qui ne permet d’allumer le feu que dans les cuisines, est tolérable en Espagne, elle est vraiment meurtrière dans le climat glacé des Flandres. » L’écrivain impute la mort de sainte Marie-Marguerite des Anges à l’application de cette règle d’origine méridionale par les populations du Nord.
*
Shikusim & Behemoth
« Ils sont allés vers Beelphegor et sont devenus shikusim comme l’objet de leur amour. » (Osée IX, 10) Ce qu’est l’objet de cet amour, les traductions modernes de la Bible ne permettent pas de s’en faire une idée exacte, ce dont on peut se rendre compte à la lecture des passages suivants, où un même terme est rapporté tel que dans son texte original, afin de bien faire comprendre de quoi il s’agit en réalité.
« La femme ne s’approchera point d’un behemah (traduit par « bête ») pour se prostituer à lui. » (Lév. XVIII, 19)
« Que les hommes et les behemoth (traduit par « animaux ») soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » (Jonas III, 8)
« Le behemoth est la première des œuvres de Dieu. » (Job XL, 14)
Lorsque le traducteur écrit « bête », « animal », puis « behemoth », il ne permet pas au lecteur de comprendre qu’il s’agit dans tous les cas de la même chose. Dans la mesure où le behema se couvre de sacs et crie vers Dieu, comme les hommes, cela ne peut pas être un animal et, par conséquent, la transgression évoquée dans Lév. XVIII, 19 n’est pas non plus la bestialité au sens où nous l’entendons.
En réalité, compte tenu du troisième passage cité et d’autres, le behemah est une espèce quasi-humaine archaïque aujourd’hui disparue en tant que telle mais qui se perpétue sous des formes hybrides.
La méditation sur « les suites du péché originel » – sur la condition misérable de l’homme à la suite du péché originel – est caractéristique de la pensée chrétienne. C’est un fait curieux qu’elle soit absente de la pensée juive, alors que l’événement lui-même figure dans l’Ancien Testament commun aux deux religions.
*
Cagots et Gavaches
« Le mot Schratt – d’où Schrättling – est un ancien et excellent terme allemand désignant un homme-bête ou homme archaïque. Il apparaît souvent dans des noms de lieu (en particulier des localités isolées), et cela montre que des races humaines archaïques se sont conservées en Europe centrale jusqu’au Moyen Âge. Par ex. Schratten-feld, -berg, -stein, -tal, etc. » (Lanz von Liebenfels, Das Buch der Psalmen Teutsch)
Il existe également des témoignages irréfutables de l’existence, dans un passé pas si lointain encore, de races archaïques d’hominidés dans certaines parties de la France. Leurs noms se sont conservés jusqu’à nous, si nous avons oublié l’étrangeté que ces noms recouvrent. Ce sont les cagots, gavaches, cacous, colliberts et autres dont nous informe par exemple le Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France (1874, 4e éd.) d’A. Chéruel. L’embarras et la perplexité de l’auteur ressortent clairement de l’exposé qui figure à l’entrée « Cagots » de ce Dictionnaire.
« Cagots, ou agots – Les cagots, cagous, cacoux, caqueux, sont une race misérable qu’on retrouve principalement dans les Pyrénées, et sur le littoral de l’Océan jusqu’en Bretagne. Les noms varient suivant les localités. Les formes cagots, cagoux, transgots, sont usitées surtout dans les Pyrénées ; gahets, gaffets, dans le département de la Gironde ; gavaches, dans le pays de Biscaye ; ailleurs, gavets et gavots ; colliberts, dans le bas Poitou ; caqueux, ou caquins en Bretagne. Ces populations étaient jadis séquestrées comme les lépreux, et la croyance populaire les accusait de dégradation morale et physique. À l’église, on leur assignait une place spéciale. Les cagots ne pouvaient se marier qu’entre eux. Ils exerçaient généralement des métiers qui les tenaient à l’écart ; ils étaient souvent charpentiers ou cordiers. Les colliberts du bas Poitou sont encore pêcheurs. Aujourd’hui même le préjugé populaire les poursuit et les tient dans l’isolement. Comment s’expliquent le caractère étrange et la position de ces populations ? d’où viennent leurs noms ? On a imaginé une multitude d’hypothèses contradictoires. L’opinion la plus vraisemblable considère ces races proscrites comme des Espagnols émigrés en France ; le peuple les assimilant aux Goths, qui avaient occupé l’Espagne, les appela ca-goths (chiens de Goths). On place ces émigrations vers l’époque de Charlemagne. Le droit du moyen âge, si peu favorable à l’étranger, les condamna à une position inférieure, et le préjugé populaire les confondit avec les lépreux. Les progrès de la civilisation n’ont pu entièrement dissiper cette erreur et détruire ces coutumes barbares. Il paraît certain, malgré les assertions de quelques voyageurs, que les cagots n’ont rien de commun avec les crétins. » (Chéruel : Cagots)
La mention des crétins est intéressante. Voici la définition que donne le Littré du mot « cagot » : « Peuplade des Pyrénées affectée d’une sorte de crétinisme. » Les crétins pourraient être le reliquat d’une race archaïque ; toutes les races archaïques ont été contraintes par l’expansion de l’homme européen de trouver un refuge dans des lieux peu accessibles : tels sont les Schrättlinge des « lieux isolés » évoqués plus haut, les cagots des Pyrénées, les colliberts du Marais poitevin, les crétins des Alpes… Le Grand Larousse du XIXe siècle souligne que les cagots « étaient sous la protection de l’Eglise ».
Il est certain que « l’opinion la plus vraisemblable » selon Chéruel au sujet de l’origine de ces populations est fausse, car les Espagnols se servent du terme gabachos (gavaches) pour désigner péjorativement les Français. Ces cagots et gavaches étaient donc étrangers tant aux Français qu’à leurs voisins espagnols, qui s’insultaient réciproquement du nom de ces hommes-bêtes proscrits.
« Races maudites – On a désigné sous ce nom des populations de la France qui étaient condamnées à une sorte de proscription, comme les cagots, les colliberts, les gavaches. » (Chéruel : Races maudites)
Quiconque a vu le film Freaks de Tod Browning (1932) trouvera que les cagots ici photographiés auraient pu figurer en bonne place dans les cirques ambulants de l’époque (freak shows). Le nanisme et les autres singularités physiques de ces individus, si elles ne sont pas suffisamment expliquées par le milieu et/ou la consanguinité, pourraient indiquer des origines ethniques distinctes.
Deux crétins des Alpes
(Légende : « Atrophiés des Hautes Montagnes »)
*
Galates et Gaulois dans l’Ancien Testament
« Les fils de Japhet furent : Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tirac. » (Gen. X : 2)
Parmi les descendants de Japhet, les descendants de Magog furent les Scythes et les Goths, ceux de Madaï les Mèdes, ceux de Javan les Ioniens, ceux de Tubal les Ibères, ceux de Méschec les Cappadociens, ceux de Tirac les Thraces, ceux de Gomer, enfin, les Galates (commentaire de la Bible par le Jésuite Cornelius a Lapide ; dans ce passage : d’après Josèphe, saint Jérôme et saint Isidore).
« Galate » est le nom donné à un rameau des Celtes établi en Orient. Partis de Gaule sous la direction de leur prince Brennus, ils s’établirent au troisième siècle av. J.-C. en Anatolie, dans le pays qui porte leur nom, la Galatie (en rouge foncé sur la carte). Saint Jérôme écrit qu’ils y parlaient encore la langue des Gaulois au quatrième siècle de notre ère.
Les Galates se rendirent également en Galilée. Le Christ historique et ses Apôtres étaient originaires de Galilée. Ce sont vraisemblablement des Galates, des Celtes ; à l’appui de cette dernière assertion, la Bible nomme cette région « la Galilée des Gentils (ou des goys) » (galil haggoyim) (Math. IV, 16), et le judaïsme des Pharisiens proscrivait le mariage entre Juifs et Galiléens. C’est d’un tel pays que provient le Messie du christianisme, non reconnu par les juifs. D’ailleurs, quand les juifs appellent Jésus « le Galiléen », cela veut bien dire, je pense : « Pas de chez nous. »
*
Note sur le Codex argenteus ou Bible d’argent
La Bible d’argent, conservée à la bibliothèque Carolina Rediviva d’Uppsala en Suède, doit son nom au fait qu’elle est écrite, à la main, sur du parchemin pourpre avec de l’encre argentée. C’est une copie des évangiles gothiques d’Ulfilas attribuée à Wiljarith, copiste d’origine gothe exerçant au VIe siècle à Ravenne, capitale du royaume ostrogoth, où la Bible d’Ulfilas était en usage. Sur les 336 pages que comptait l’ouvrage à l’origine, seules 188 nous sont parvenues.
La Bible d’Ulfilas est l’un des rares documents en langue gothique que nous connaissions. Le principal lieu de conservation de documents théologiques en langue gothique était, semble-t-il, la bibliothèque de Narbonne, dans le royaume wisigothique de Septimanie ; la bibliothèque fut incendiée à l’instigation de catholiques orthodoxes : « [Après la conversion au catholicisme] on note des vexations regrettables, comme l’incendie du lieu de culte arien à Narbonne où brûleront les livres de théologie. » (G. Labouysse, Les Wisigoths, 2005)
La traduction d’Ulfilas en langue gothique est plus ancienne que la traduction latine de saint Jérôme, puisqu’elle date du IVe siècle après J.C. Considérant ce fait, il est regrettable qu’aucun théologien, aucun historien de la littérature ou linguiste, ne se soit servi de cette traduction à des fins d’exégèse, si l’on excepte les théologiens goths représentants de l’arianisme, dont les écrits sont partis en fumée.
Labouysse, précédemment cité, relève que « l’étude assidue de la Bible gothique à la cour de Toulouse » (p. 87) contribua à maintenir l’usage de la langue gothique en Septimanie.
*
Chateaubriand, victime ignorée du vampirisme
« Les adolescents ne sont pas tourmentés dans leurs rêves par leurs propres fantasmes, mais par ceux des autres (…) Objet du désir d’une femme, qu’il ne connaît probablement pas, l’adolescent souffre, se sent possédé, prisonnier, et peut parfois tenter de mettre fin à ses jours pour se libérer du vampire. » (Strindberg, Un livre bleu)
La science matérialiste ne dit mot des phénomènes psychiques que, suivant en cela le génial Strindberg, nous décrivons sous le nom de « vampirisme », et qui sont pourtant une réalité certaine, tant dans leurs causes que dans leurs effets, pouvant conduire les individus à la mort. Mais comment s’étonner d’un tel aveuglement de la part de ceux qui seraient censés étudier les phénomènes de cette nature, alors que le témoignage le plus remarquable d’un cas de vampirisme, par une des plus grandes figures de la littérature française, reste ignoré à ce jour, quand bien même l’œuvre qui porte ce témoignage est mondialement connue ? Je veux parler de François-René de Chateaubriand et de ses Mémoires d’outre-tombe.
Mémoires d’outre-tombe : le titre même de l’autobiographie, ce premier contact du lecteur avec l’œuvre, révèle, quelles que soient les raisons qu’invoqua Chateaubriand pour donner le change à ses contemporains, que c’est un mort-vivant qui s’exprime. L’œuvre dans son entier est plongée dans une atmosphère de profonde mélancolie, de regret de vivre, que son auteur cherche à communiquer comme sa réalité la plus vraie. Écrits à plusieurs époques de la vie de Chateaubriand, ces mémoires comprennent dans chacune de leurs parties des considérations sur la destinée humaine portant la marque de cette incurable mélancolie, de ce désespoir irrémédiable que ni la philosophie, ni la religion que l’auteur confesse et dont il se fit le champion en des temps d’athéisme, ne parviennent à consoler. Chateaubriand se sait malade, atteint ; il ignore ce qui pourrait rompre sa malédiction, et finit même par déplorer ses succès littéraires, qui donneraient à penser à une jeunesse sans repère que le désespoir est la marque la plus assurée du génie.
Or Chateaubriand était la victime d’un vampire, duquel il ne se délivra jamais et qui fit de lui le mort-vivant que sa lucidité angoissée, désespérée nous a donné à connaître comme tel.
« Un voisin de la terre de Combourg était venu passer quelques jours au château avec sa femme, fort jolie. Je ne sais ce qui advint dans le village ; on courut à l’une des fenêtres de la grand’salle pour regarder. J’y arrivai le premier, l’étrangère se précipitait sur mes pas, je voulus lui céder la place et je me tournai vers elle ; elle me barra involontairement le chemin, et je me sentis pressé entre elle et la fenêtre. Je ne sus plus ce qui se passa autour de moi. » (Mémoires d’outre-tombe, III, 9)
Ainsi commença l’envoûtement. Le contact physique avec l’étrangère eut pour effet de faire entrer dans la vie intérieure du jeune Chateaubriand « une femme » (« Je me composai une femme de toutes les femmes que j’avais vues »), dont l’image le suivait partout et l’obsédait tant qu’il en vint, après deux années de souffrances, à commettre une tentative de suicide, qui échoua. Cette femme, qu’il appelle sa « sylphide », ne le quittait plus, même après des années, un voyage dans les terres sauvages de l’Amérique, la Révolution française, l’émigration en Angleterre. Et s’il n’en fait plus mention après son mariage, c’est sans doute davantage pour des considérations de bienséance. Du reste, il faut croire que le vampire a bien dû finir par se retirer à un moment, après l’avoir vidé de sa substance psychique.
Malgré les éminentes qualités qu’il lui reconnaît, Chateaubriand ne semble guère avoir aimé son épouse d’une bien vive affection. Le fait qu’il soit resté sans enfant est sans doute significatif également. Par ailleurs, je nie que Chateaubriand ait eu un quelconque amour incestueux pour sa sœur, ce que certains se sont crus autorisés à affirmer, en interprétant et déformant ses écrits de la manière la plus absurde. J’observe, enfin, que le chapitre relatant l’événement avec l’étrangère ici rapporté – et cet événement seulement – s’intitule Révélation sur le mystère de ma vie, ce qui montre l’importance que Chateaubriand lui prêtait, et qui montre aussi qu’il en tirait des conclusions à peu près semblables à celles que nous avons développées. Une lecture plate et banale de ce titre, par laquelle on ferait dire à Chateaubriand que c’est de cette manière qu’il eut la notion de l’amour des femmes, est irrecevable car il n’apparaît nulle part dans l’œuvre de Chateaubriand que l’amour des femmes fût quelque chose comme le « mystère de sa vie », ni même, à vrai dire, qu’il lui fût quelque chose de bien particulier, si l’on excepte des œuvres de jeunesse comme René, qui renvoie d’ailleurs elle-même à ladite voisine et à la possession vampirique.
On dira peut-être qu’il est heureux qu’il fût ainsi vampirisé car il n’aurait pas, autrement, écrit les œuvres qui ont immortalisé son nom. J’affirme pour ma part que rarement un écrivain et penseur a donné de manière aussi nette le sentiment d’être resté en-deçà de ses capacités.
Chateaubriand n’a pas été victime de son imagination mais de celle de l’étrangère, dont l’esprit était vraisemblablement morne et l’existence ennuyeuse, que le contact avec le jeune homme embrasa complètement et dont le désir exacerbé s’incarna dans un spectre maudit, assoiffé.
*
Le Dédoublement de personnalité
expliqué par le swedenborgisme
Les phénomènes de dédoublement de personnalité, qui ont trouvé une expression littéraire intéressante dans les personnages du Dr. Jekyll et de Mister Hyde, peuvent être expliqués de manière satisfaisante par le recours aux concepts et à la philosophie morale de Swedenborg.
L’homme intérieur est le spirituel en l’homme, l’homme extérieur le naturel. L’homme intérieur est le réceptacle des influences spirituelles, où Dieu insuffle en l’homme l’amour divin et l’amour du prochain (sur ce qu’est au juste l’amour du prochain, voir Arcana Cœlestia ou le Traité sur l’amour). L’homme externe est le réceptacle des influences de la nature matérielle, par lequel l’homme jouit de l’amour égoïste de soi et de l’amour des choses qui sont dans le monde. Dans le présent état de l’humanité, l’homme intérieur est dit « fermé » à la naissance, des suites du péché originel, c’est-à-dire qu’il n’est pas en mesure d’être influencé par le spirituel émané de Dieu, sans une conversion.
Dans la mesure où l’homme interne est l’agent de l’amour du prochain, l’Église, c’est-à-dire la communauté des hommes, ne peut être composée de personnes pour lesquelles l’homme interne reste « fermé » à l’amour divin. L’homme naturel est ennemi de la société, comme les esprits mauvais sont hostiles à l’ordre spirituel céleste. Toute personne se voit donc investie de responsabilités et d’honneurs de la part de la communauté dans laquelle elle vit en fonction de l’amour du prochain dont elle est animée†. Ces responsabilités ne peuvent être assumées, en raison des contraintes qu’elles entraînent, que par un constant amour du prochain, donc par l’assujettissement de l’homme naturel en soi. Cependant, l’homme naturel n’est jamais complètement vaincu, dans cette vie terrestre, et représente pour l’homme spirituel une cause permanente de tentation.
Céder à la tentation est la cause des modifications de la personnalité, car l’homme naturel recouvre dans ces moments son empire. Les contraintes liées à la position sociale et aux responsabilités lui paraissent alors insupportables, écœurantes ; les personnes de son entourage deviennent l’objet de son ressentiment et de sa haine ; sa vie lui semble absurde. Il n’y a aucun moyen pour l’homme de résister aux mouvements violents que lui suscitent en cet état les mille contrariétés de son existence habituelle, et l’homme au commerce doux et affable d’hier (Dr. Jekyll) devient irritable, méchant, brutal (Mister Hyde). Dans la conscience qu’il a de cette situation, il ne peut qu’assister impuissant au déchaînement de l’homme naturel contre les conditions créées par l’homme spirituel, et attendre, en expiant la tentation et la chute, que privé de l’aliment de son amour égoïste l’homme externe se soumette à nouveau.
Telle était la conception des Anciens, exprimée dans les notions de pureté et d’impureté. En état d’impureté, l’individu se retirait provisoirement de la société, interrompant ses relations courantes. Ainsi, dans Sam. 20: 26, Saül s’explique-t-il l’absence de David au banquet par un état d’impureté : « Saül ne dit rien ce jour-là ; car, pensa-t-il, c’est par hasard, il n’est pas pur, certainement il n’est pas pur. »
† Swedenborg insiste également sur le cas des hypocrites, qui feignent l’amour du prochain en vue de l’honneur et des biens qu’ils en retirent dans l’Église (la communauté).
Swedenborg Chapel, Cambridge (Massachusetts)
*
Une bibliographie de Carolus Lundius
sur l’Amérique précolombienne
Dans le livre de Carolus Lundius sur Zalmoxis en 1684, il est dit qu’avant Colomb arrivèrent en Amérique, de l’Ouest des Phéniciens, du Nord des Scythes, de l’Est des Chinois, et l’auteur ajoute la bibliographie suivante :
Johan. Ler. Histor. Navig. in Brasil
Gom. Hist. Ind.
Brul. Hist. Peruan.
Acost. De Nat. A. O.
Freder. Lum. de B. ext.
Grot. Diss. de orig. Gent. Am. (Il s’agit d’Hugo de Groot, ou Grotius)
Joh. de Laet., sus notas sobre el previo
Marc. Lescarb. Hist. Nov. Fr.
Horn. De orig. Gent. Amer. (Il s’agit de l’historien Georg Horn, ou Hornius)
Joh. Hornbeck De Convers. Ind.
Hugo de Groot ou Hugo Grotius (1583 – 1645), escreveu um pequeno texto De origine gentium americanarum, (está online em http://digbib.bibliothek.uni-augsbur…_02_8_0242.pdf – pags 36 até final). onde concluía que os americanos tinham uma ascendência múltipla, sendo descendentes de escandinavos, etíopes e chineses. http://www.arlindo-correia.com/160207.html
& Corroboration par Ernest Renan d’une présence phénicienne en Amérique précolombienne :
« Poço do Umbu : Rio Grande do Norte. ‘Local onde há letreiros encarnados sobre as pedras. Foi Renan que, a pedido de Ladislau Neto, examinou cópias de inscrições petrográficas brasileiras, dando-lhes origens fenícias.’ (M. Cavalcanti Proença) » (Glossaire de Macunaíma, Mário de Andrade, Edições Unesco)
Les « Indiens blancs » dans la littérature latinoaméricaine (deux exemples) :
Alcides Arguedas, Pueblo enfermo (1090, tercera ed. 1936, p. 22) : « Hay mucha variedad de tipo, entre los Araonas [Indios de Bolivia], pues mientras que unos son verdaderamente zambos, otros son de un tipo muy parecido al europeo. Los hay de nariz larga y aguda, cuando el indio, en general, la tiene chata. Hay muchos barbones y alguno que otro calvo, cosa tan rara entre los indios. Existen muchos verdaderamente rubios, tanto entre hombres como entre las mujeres. »
Ernesto Giménez Caballero, Revelación del Paraguay (1967) : « Esa raza ambarina y admirable, llamada guaraní, morena clara, blanca aún antes de transculturarse con la española. » (p. 27)
« Yo creo que las razas esenciales que poblaron la América prehispánica fueron tres : (…) la andina o serrana (…), la pampeana o llanera. Y la atlántica (atlantillana, antillana, ribereña), de donde procedieran aquellos caraibes o caribes o carios de los que surgirían los guaraníes como modalidad señorial, pues ‘señor’ significa en guaraní ‘caray’, como en Europa el nombre de Arios. (…) Carios, Arios… Ya los cronistas y luego los etnógrafos habían revelado la distinción de esa etnia paraguaya. Nuestro Rivadeneyra habló de ‘mozos fuertes’ y ‘esbeltos como robles’. Como ‘muy blancos, aún más a veces que los españoles’, los vieron D’Orbigny y Humbolt y nuestro Azara. (…) Carios, Arios… Quizá está la clave de esto en aquella leyenda del dios Are o Ario, cuya sombra sagrada quedó por estas selvas vagando tras hundirse el fantástico continente de la Atlántida, que unía Europa a América. » (p. 142)
« Cariátides, porque son de la raza caria, la raza misteriosa de estas tierras, la raza que enlaza, no se sabrá nunca por qué, con la estirpe helénica, aquella de los carios, a la que perteneciera la hija de Dión, transformada en árbol por Baco enomorado y, luego, en columna para sostener los templos. Aquella hija de Dión nominada, justamente, Caria. » (p. 162)
« Los gallegos van, vienen y andan por América desde antes de Cristóbal Colón, siendo, para mí, los primeros pobladores de este continente. » (p. 227)
*
Vikings du Limousin et Amazones
Les historiens ne nient pas (encore) que les Vikings ont occupé le Limousin. Ainsi savons-nous que : “By defeating the Vikings of the Limousin, Rudolph [de Bourgogne] received the allegiance of the Aquitainians and the homage of William Longsword, now duke.” (geni.com) Et je suis porté à croire que la ville de Tulle porte, sans le savoir, un nom hyperboréen, celui de Thulé. Une autre ville au nom semblable est Tula, au Mexique, célèbre pour ses atlantes.
De même, le nom de famille Beaupoil, en Limousin – une famille comptant notamment un poète lequel, selon Voltaire, écrivit ses poèmes les mieux réussis à quatre-vingt-dix ans passés –, pourrait être nommée en souvenir du roi norvégien Harald Hårfagre ou « Harald à la belle chevelure », le mot hår, comme l’anglais hair, pouvant désigner à la fois les poils et les cheveux. Autrement dit, le nom du roi norvégien pourrait se lire Harald Beaupoil.
Les Amazones de l’Antiquité étaient les femmes des Goths.
Jornandès, Histoire des Goths (De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis):
Après sa mort [la mort de Taunasis, roi goth vainqueur du pharaon Sesostris], tandis que son armée, sous les ordres de son successeur, faisait une expédition dans d’autres contrées, un peuple voisin attaqua les femmes des Goths, et voulut en faire sa proie ; mais celles-ci résistèrent vaillamment à leurs ravisseurs, et repoussèrent l’ennemi qui fondait sur elles, à sa grande honte. Cette victoire affermit et accrut leur audace : s’excitant les unes les autres, elles prennent les armes, et choisissent pour les commander Lampeto et Marpesia, d’eux d’entre elles qui avaient montré le plus de résolution. Celles-ci voulant porter la guerre au dehors, et pourvoir en même temps à la défense du pays, consultèrent le sort, qui décida que Lampeto resterait pour garder les frontières. Alors Marpesia se mit à la tête d’une armée de femmes, et conduisit en Asie ces soldats d’une nouvelle espèce. Là, de diverses nations soumettant les unes par les armes, se conciliant l’amitié des autres, elle parvint jusqu’au Caucase ; et y étant demeuré un certain temps, elle donna son nom au lieu où elle s’était arrêtée : le rocher de Marpesia. Aussi Virgile a-t-il dit : Comme le dur caillou ou le roc Marpésien.
C’est en ce lieu que, plus tard, Alexandre le Grand établit des portes, qu’il appela Pyles Caspiennes. Aujourd’hui la nation des Lazes les garde, pour la défense des Romains. Après être restées quelque temps dans ce pays, les Amazones reprirent courage ; elles en sortirent, et, passant le fleuve Atys, qui coule auprès de la ville de Garganum, elles subjuguèrent, avec un bonheur qui ne se démentit pas, l’Arménie, la Syrie, la Cilicie, la Galatie, la Pisidie, et toutes les villes de l’Asie : puis elles se tournèrent vers l’Ionie et l’Éolie, et soumirent ces provinces. Leur domination s’y prolongea; elles y fondirent même des villes et des forteresses, auxquelles elles donnèrent leur nom. A Éphèse, elles élevèrent à Diane, à cause de sa passion pour le tir de l’arc et la chasse, exercices auxquels elles s’étaient toujours livrées, un temple d’une merveilleuse beauté, où elles prodiguèrent les richesses. La fortune ayant ainsi rendu les femmes de la nation des Scythes maîtresses de l’Asie, elles la gardèrent environ cent ans, et à la fin retournèrent auprès de leurs compagnes, aux rochers Marpésiens, dont nous avons déjà parlé, c’est-à-dire sur le mont Caucase. (…)
Les Amazones, craignant que leur race ne vînt à s’éteindre, demandèrent des époux aux peuples voisins. Elles convinrent avec eux de se réunir une fois l’année, en sorte que par la suite, quand ceux-ci reviendraient les trouver, tout ce qu’elles auraient mis au monde d’enfants mâles seraient rendus aux pères, tandis que les mères instruiraient aux combats tout ce qu’il serait né d’enfants de sexe féminin. Ou bien, comme d’autres le racontent différemment, quand elles donnaient le jour à des enfants mâles, elles vouaient à ces infortunés une haine de marâtre, et leur arrachaient la vie. Ainsi l’enfantement, salué, comme on sait, par des transports de joie dans le reste du monde, chez elles était abominable. Cette réputation de barbarie répandait une grande terreur autour d’elles ; car, je vous le demande, que pouvait espérer l’ennemi prisonnier de femmes qui se faisaient une loi de ne pas même épargner leurs propres enfants ? On raconte qu’Hercule combattit contre les Amazones, et que Mélanès les soumit plutôt par la ruse que par la force. Thésée, à son tour, fit sa proie d’Hippolyte, et l’emmena ; il en eut son fils Hippolyte. Après elle les Amazones eurent pour reine Penthésilée, dont les hauts faits à la guerre de Troie sont arrivés jusqu’à nous. L’empire de ces femmes passe pour avoir duré jusqu’à Alexandre le Grand.
Or, si le fleuve Amazone et l’Amazonie, dans le Nouveau Monde, ont été nommés d’après ces femmes, c’est que le conquistador Francisco de Orellana, lors de son expédition sur le fleuve, rencontra un groupe de femmes « de haute taille et à la peau blanche » (chronique du père Gaspar de Carvajal) qui décochèrent quelques flèches sur ses hommes avant de disparaître. Interrogés, les Indiens racontèrent aux Espagnols qu’il s’agissait d’un peuple de femmes vivant dans une cité bâtie en pierres (cette cité dont le Dr Michael Heckenberger a, je pense, retrouvé la trace, associée à des terrains fertiles de « terra preta », terre noire, d’origine humaine).
Pour Jacques de Mahieu, ces Amazones étaient le reliquat de Vikings installés en Amérique du Sud, les « dieux blancs » des peuples précolombiens, dont le vénérable Quetzacoatl, représenté avec une barbe blonde (Thor Heyerdahl rapporte des mythes similaires dans les îles du Pacifique). Pensez à la manière dont le Brésil a été « découvert » au XVIe siècle : le Portugais Pedro Alvares de Cabral se rendait au Cap, en Afrique du Sud, lorsque les vents firent dériver son bateau jusqu’au Brésil ! Et une telle chose ne se serait jamais produite auparavant, dans l’histoire de la navigation, en particulier pour des Normands dont la colonie du Groenland entretenait des liens constants avec l’Islande et l’Europe au Moyen Âge ? (Pour en savoir plus, lire Ingeborg, A Viking Girl on the Blue Lagoon ici)