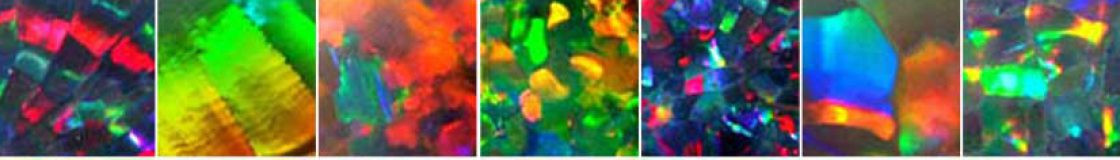Tagged: Alexandrins
La Louis-le-Grandiade : Poème épique
Table des matières
I/ La Louis-le-Grandade
II/ Galion des Indes
III/ Garrigue
1
La chanson du gueux
N’ayant pas eu l’honneur comme Jean Richepin
De passer ma jeunesse à l’École Normale
En sortant d’un lycée à Paris, droit chemin,
Pour faire La chanson des gueux route normale,
Je ne puis vous chanter que La chanson du gueux…
Chaville fut le bourg où je grandis, sauvage.
Chaville au bois dormant, c’est dire Périgueux,
C’est dire Tombouctou, c’est dire… un marécage.
J’ai bien connu les fils du chauffeur, du postier !
Quand de boulevardiers Jean Richepin s’entoure,
L’enfant de l’infirmière occupe mon plumier.
Quand je m’épris, ce fut de la fille d’un bourre.
(Croyez bien cependant que je n’en savais rien :
Elle ne disait mot de son père, et pour cause !)
Je grandis sans savoir ce que c’est que le bien,
Ce que c’est que le mal, en sous-urbain morose.
La télévision pourtant nous distinguait :
Chez nous Roland Garros annonçait les vacances.
Malgré mon bon vouloir le sport me fatiguait,
Je m’étonnais parfois de quelques dissemblances.
Mais je suis de tout cœur avec les Chavillois
Dans la haine sans fard des lettrés bureaucrates.
Notre école est sans doute un peu trop près des bois
Pour lever de futurs poètes hydropathes.
*
2
Ulrique-Élisabeth, ange de Swedenborg !
Toute femme, après vous, est une hydre, un cyborg,
Chimérique robot dont Frankenstein allume
Les ampoules des yeux, coud la noire amertume
De son cœur sous le sein d’écailles d’un lézard,
Et crible d’électrons le visage blafard
Que la bouche grenat d’une escarre fissure.
Vous seule éblouissez mon rêve, qui s’azure
Aux feux élyséens de vos yeux cérulés.
Je vais parmi les rocs de temples écroulés,
Ne voyant que les fûts d’une sylve nouvelle,
Et dans ces bois j’entends la voix célestielle
Dont vous dites un jour, pour moi : « Comment vas-tu ? »…
Je vais tellement bien, sur le monde abattu !
Ulrique-Élisabeth ! au nom de qui je chante,
Au nom de qui je prête au songe qui me hante
Des aspects de féerie et d’arbres enchantés
Où vit emmi les fleurs des rameaux apprêtés
Une cité d’amis au-dessus de la terre,
Ils disaient à l’enfant que j’étais « Crois, espère ! »
Et leur voix dans le vent qui murmure, si bleu,
M’accompagne et me dit : « L’Amour affirme Dieu. »
.
I
La Louis-le-Grandade
.
3
D’un regrettable malentendu
Tout était raté dans le cours
De ma vie : études, amours,
Projets, objectifs quels qu’ils fussent.
Les badauds, trop intelligents,
Ne pouvaient me voir sans qu’ils n’eussent
À frémir des appels urgents.
Ma nullité si manifeste
La faisait fuir comme la peste,
Comme si je tendais la main.
Je ne sais quel sens magnanime
Rendait autrui sur mon chemin
Soudain tyrannique et sublime.
Quelque affreuse difformité
Donnait le droit, d’autorité
Car cette leçon m’était due,
Aux inconnus de se saisir
De l’occasion de ma vue
Pour exprimer leur déplaisir.
2
quand on est jeune c’est pour la vie (Philippe Soupault)
Oui, si j’avais mieux réussi,
Moi-même alors, dans l’insouci,
J’aurais exprimé ma très forte
Désapprobation, aigreur,
En manifestant de la sorte
Mon irrécusable hauteur.
En effet, nous vivons en foules
Et les hommes étant des poules
Il faut qu’ils picotent du bec.
Si j’avais aussi le diplôme
Qui m’aurait rendu pâle et sec,
Comme je serais ignivome !
Si j’étais de Louis-le-Grand
je ne serais pas ignorant,
Et si j’étais de Henri-Quatre
Ou bien à Stanislas connu,
Je ne serais pas comme un pâtre
Du Péloponnèse ingénu.
Hélas, je lisais des poèmes
Qui se riaient des anathèmes
Lancés par de vieux professeurs.
J’ignorais encore, ô Candide !
Que leurs beaux, leurs divins auteurs
En étaient, de ce club splendide.
*
4
Si j’étais de Louis-le-Grand
Si j’étais de Louis-le-Grand,
Je ne serais pas ignorant.
Je me connaîtrais de l’élite,
Je pourrais me dire écrivain
Qu’on recherche, que l’on édite,
Je ne penserais pas en vain.
Et si je clamais : « Plus de rime ! »,
Cela ne serait pas un crime
Car ce serait la nouveauté.
L’élégance la plus baroque
Semblerait la modernité
Et nullement de basse époque.
Je serais un nouveau Claudel
Au Mystère donnant du sel.
J’inventerais la négritude
Comme Aimé Césaire ou Senghor.
Dans ma profonde solitude
J’aurais tout un état-major.
Je serais comme Baudelaire
Un poète très solitaire
Apprécié du Tout-Paris.
Le tribunal serait la scène
Où seraient en mon nom flétris
Les vils pourfendeurs de l’obscène.
Comme Théophile Gautier,
Je ne ferais pas de quartier
Aux ennemis du romantisme.
Sortis eux de l’on ne sait où,
Les Anciens, suiveurs d’un sophisme,
Seraient aussitôt mis au clou.
Je pourrais être Jean-Paul Sartre,
Jaunâtre, louche, atteint de dartre,
Philosophe et cabaretier,
Et l’on viendrait me voir au Flore
Sur des liasses de papier,
Où l’éclat des cuillers me dore.
Ou si je n’étais pas « Jean-Paul »,
Je serais « Paul », Bourget, moins fol
Sans doute, moins philosophique,
Malheureusement oublié
Après avoir mis en musique
Ceux dont il fut déifié.
Autrement, la grande virile,
Robert Brasillach à la ville,
Qui, sachant qu’on l’allait punir,
Peignit Hésiode en Gribouille
Et fut le premier grand Vizir
À traduire ὄρχις avec « couille ».
*
5
Hernani, ou La bataille de Louis-le-Grand
Dans la salle guettant tout ce qui rage ou bouge,
Théophile Gautier avec son gilet rouge !
Pour son ami Victor Hugo, poulain cabrant,
Au vers tumultueux de déclive rivière.
Et pour l’honneur aussi de leur Louis-le-Grand.
C’est ainsi que se fait la valeur littéraire.
*
6
De l’influence de Rimbaud sur Louis-le-Grand
Avant lui nos auteurs venaient de ce lycée ;
Après lui, tout autant. Notre Gaule effacée,
Des provinces où règne un silence de mort,
Se laisse diriger par une cour d’école :
La richesse n’est rien en cas qu’elle n’en sort.
Tout le pays croupit devant cette coupole.
Rimbaud vint à Paris, sépulcre de Musset
(Henri-IV), pour voir Verlaine (Condorcet).
« J’aimais un porc », dit-il, qui tenta de l’occire.
Le porc était bien vu, Rimbaud un Africain
Qui ne demanda point son reste de délire,
Le Voyant quasi mort aux mains d’un Arlequin.
Fermons la parenthèse. Étoile consacrée,
Il donne à Charleville une palme sucrée.
« On n’est pas sérieux quand » à Louis-le-Grand,
D’où le Français béat apprend sa patenôtre,
On prétend que Rimbaud est sublime, inspirant :
Ils parlent des « Assis » comme de quelqu’un d’autre !
*
7
Nom de l’assassin : Paul Verlaine
Car il était de Condorcet,
Se croyait Alfred de Musset,
Écrivant des arlequinades
Qui sentaient leur dégénéré
D’après Lombroso, ce taré
Devint l’auteur de pistolades.
On a parlé de passion
Amoureuse : déception !
Quel autre exemple d’homophile
Tirant sur un de ses amants ?
Ce n’est là qu’un de ces romans
Qu’on sert au public imbécile.
Non, sous les guêtres d’Arlequin
Se mussait un loup, un requin,
Un sadique irrécupérable,
Un criminel congénital
D’après Lombroso ; ce brutal
Bouffon, de tout était capable.
Or Paul Claudel (Louis-le-Grand),
En critique toujours errant,
Convaincu l’appelle un poète
Chrétien, tandis que Mauriac,
Qui pour ça mérite le sac,
Nous fait Rimbaud analphabète
(Rimbaud serait un « blouson noir » !).
La victime du « désespoir »
De l’Arlequin de bon lycée
Serait ainsi le singe affreux,
Alors que c’est ce malheureux
Dont la main gauche fut blessée.
Écoutez les faits à présent !
Le clown faunesque et malfaisant
Haïssait à mort le génie
De l’innocent provincial,
Lui cachait son fiel glacial,
Son homicide vésanie.
Rimbaud jeune, encore naïf,
Aux yeux bleus de contemplatif,
Ignorait ce que nos élites
Ont de haine dans un cœur froid,
Lui-même étant pur, simple et droit,
Si loin de ces vapeurs maudites.
On a parlé d’amour : c’est beau,
Si beau, comme un roman-photo.
On a parlé de jalousie :
C’est vrai ! celle de l’écrivain
Pour un rival sublime et fin
Haï jusqu’à la frénésie.
Sous les dehors de l’amitié,
Le fourbe serpent sans pitié
Dans le noir fourbissait son arme.
En se faisant le picaro,
Le Triboulet, le Figaro,
Il paralysait toute alarme.
Oui, cette tête-là de bouc
Vendeur de beautés dans un souk
Voulut tuer le plus céleste
Ange de notre panthéon.
– Va jouer de l’accordéon,
Ægipan, vieux satyre agreste !
Tu l’as dégoûté d’être roi.
Il était prince, lui, pas toi,
Digne produit de ton école !
Tu n’étais, toi, qu’un tueur né,
Ton noir amok était inné,
Ta cervelle endurcie et folle.
Lui se couronne de lauriers,
Vous n’êtes que des écoliers.
Et toi, la criminologie
Nous a fait ton portrait-robot :
Ton citron fêlé comme un pot
À Sainte-Anne est d’anthologie.
*
8
École
Car nous ne sommes pas égaux
Devant l’école, que de maux
Sous silence passés par elle.
Avant la grande école il est
Plus petite école, c’est celle
Dont il faudrait sucer le lait.
La petite mène à la grande,
Le reste est une vaste brande
De genêts, fougères, chardons.
Plus petite encore s’impose
Pour accéder aux nobles dons
De la petite, grande chose.
En un mot, si vous n’êtes né
Sous le chambranle suranné
De cette école ou bac à sable,
Voie étroite du devenir,
Votre destin est lamentable,
L’on n’aura de vous souvenir.
Cette opinion n’est point neuve
Mais du fait j’apportai la preuve,
Chiffres à l’appui, mes auteurs !
Que ne le disiez-vous, misère !
Que vos délires enchanteurs
Avaient Louis-le-Grand pour mère.
Hélas ! que ne le disiez-vous.
Nous n’aurions alors, pauvres fous,
Cru devenir un jour des vôtres,
Puisque nous étions de Clamart
Où les fortunes sont tout autres.
Nous eussions connu notre part.
Sous-urbains ou de la province,
Que notre balourdise évince,
Nous sommes vos commentateurs
Tout au plus, louons vos prouesses
À des enfants de travailleurs
Qui n’auront jamais vos richesses
(Immatérielles s’entend).
Vous celiez ce fait important
Que si nous l’avions su naguère
Nous vous aurions dit « M*** alors ».
Surtout nous ne nous fussions guère
Lancés vers d’impossibles ports.
*
9
Dignes fils
Dignes fils de Louis-le-Grand !
Quand l’un à la rime s’en prend,
Un autre aussitôt à sa suite,
S’en faisant le commentateur,
Dit que la rime périclite,
Que c’est, rimer, trop réducteur.
Est-ce le chemin de la gloire ?
Un conseil : méditez l’Histoire,
Ce sont moyens de charlatans ! –
Les plus sublimes pyramides
Jaillissent dans les premiers temps
Sur des plateaux venteux, arides.
Puis, avec la prospérité
Se répand la facilité :
Les monuments portent la marque
D’une paresse sans recours,
L’Art se décompose, la barque
D’Osiris navigue à rebours.
Plus le terme fatal approche,
Plus le ciseau mordant la roche
Produit de chétifs avortons.
Ces tristes efforts lamentables,
Hideux des derniers pharaons
Sont moins courageux que coupables.
Aussi, dans le tombeau scellé
De la rime et du vers ailé
Qu’est aujourd’hui la poésie,
Ne vois-je que le remuement
D’une instante paralysie,
Un funèbre aboutissement.
Et c’est vous, les intelligences,
Le plus grand soin de nos dépenses,
Accueillis en de sacrés murs,
Qui désappointant nos attentes
Promouvez les cultes impurs,
Les corruptions décadentes.
*
10
Du mandarinat considéré comme un des beaux-arts
Poètes d’un régime éclairé, quel lycée
Que celui qui nous vaut votre âme policée !
Savez-vous bien qui sont les poètes « maudits » ?
Ceux que Louis-le-Grand n’a jamais dégourdis.
Vous êtes donc, messieurs, plus que la bourgeoisie,
La malédiction de notre poésie.
Si vous n’étiez point morts dans le mandarinat,
Tous vous mériteriez qu’on vous assassinât.
Pauvre de qui se crut digne de Castalie !
C’était le robinet de votre plomberie.
Ô vous que l’on forma maîtres de l’intellect,
Chiffes ! vous n’avez su garder le vers érect.
Vous étiez mandarins avant que gens de lettres,
Des chefs surnaturels sans la vertu des prêtres.
Le public n’entend plus cette forme d’exploit ?
Depuis quand le public lit-il quoi que ce soit ?
Vos ouvrages, messieurs, me laissent l’amertume
D’avoir voulu pour moi l’encens qui vous enfume.
Le temple était gardé par un géant dragon,
Ce bon M. Durand, concierge à Fénelon.
*
11
Aimé Senghor
Adepte de l’exactitude,
Je définis la négritude
Dans la cour de Louis-le-Grand
Où la pensée est à son comble,
Plaignant un peu le fils errant
Qui n’invente que le candomble.
La négritude, apport inné,
En latin : negritudine,
Aurait pu naître à Henri-Quatre
Comme à la Chambre des débats
Mais je ne crois pas au théâtre
Où s’engendrent les macumbas.
Je lisais, digne, solitaire,
Comte, Victor Cousin, Voltaire,
Fumais avec Thierry Maulnier,
À qui j’ai rendu quelque hommage,
Souffrant qu’à l’Opéra Garnier
Un jour il dît : « Anthropophage. »
J’augurais au pensionnat
Que pour moi le mandarinat
Ne serait pas toute l’Histoire ;
Et quand je vis tomber du ciel
La neige, je me mis à croire
À mon moi présidentiel.
Surtout j’aime la poésie,
Cette olympienne ambroisie
Comme dit Catulle en ses vers.
J’ai chanté des Éthiopiques
Sonores comme des pics-verts
Sur des fromagers séraphiques.
Et j’ai chanté les baobabs.
Dans mon respect pour les toubabs,
J’enrichis la littérature
Avec des mots rares, savants
De botanique, de nature
À charmer les êtres vivants.
Sans jamais oublier ma dette
À Napoléon, à Colette,
Au général, à Diderot,
À Charles IX, à Louis XVI,
À Clovis et Sadi Carnot,
À Danton et sainte Thérèse.
*
12
Hommage
À un écrivain, pourvu qu’il soit de Louis-le-Grand
Quand je vous vis à la télé,
Comme un albatros esseulé,
Parmi des spots publicitaires
Pour de la soupe et des savons,
Je sus ce que sont vos lumières
Et la chance que nous avons.
Car je la regardais encore
En ce temps, mais l’esprit s’essore
Un jour pour voler dans l’azur.
Quand je vous vis, tête banale,
Sans élégance, je fus sûr
De votre beauté cérébrale.
Et j’entendis des mots si plats
Qu’enchanté je ne doutai pas
De votre succès littéraire.
Vous parliez de rébellion
Et me rendiez si réfractaire
Envers ma télévision !
Vos propos grêles, emphatiques
Avaient le ronron des moustiques.
Vous étiez si hors du commun,
Du sens commun, que l’évidence
S’imposait que vous êtes un
Homme à hanter avec prudence.
Vos propos de salon de thé
Taquinaient la vulgarité.
Avec vous, merci ! comment croire
Qu’une ambition d’écrivain
Est une douloureuse histoire
Pour le gros du troupeau sans fin ?
Si j’avais été femme, ô maître !
Je vous eusse écrit une lettre
Avec deux ou trois haïkus.
Je sais que vous m’auriez reçue ;
La femme en moi, si près de vous,
N’eût été rien moins que déçue.
Si j’avais été moins huron,
Quel plaisir d’écrire au luron
Fameux que vous êtes mes rêves
Et mes souffrances d’incompris !
Devenir l’un de vos élèves,
N’étant même pas de Paris !
*
13
Littéraire provincial
Littéraire provincial,
Aussi célicole et royal
Que soit ton verbe poétique,
Il n’intéresse point Paris.
On n’y saura rien de tes cris
Quand tu deviendras lunatique.
Là Mistral est le nom d’un vent,
Le félibrige un mot savant
Connu d’aucun dictionnaire.
Tes brandes, tes palmiers, ton bourg,
N’étant pas dans le Luxembourg,
Ne connaissent point la lumière.
Tu seras le commentateur
Du loustic et du riboteur
Qui sortiront de Henri-Quatre
Ou rien : connais-toi donc toi-même,
Pour exister dans ce système
Ne cherche point d’autre théâtre.
Ton intellect colonisé,
Même de tous chez toi prisé,
Que vaut-il pour la capitale ?
C’est ta métropole, mon Noir !
Mets tes olives au pressoir,
Donne ton huile, sans chorale.
Si dans ta médiocrité
Une femme, ange de bonté,
Te donne un chiard, lui peut-être,
Dans la cour de Louis-le-Grand
– Tance-le, bats-le ! –, s’il comprend,
Peut penser devenir un maître.
Tu restes au bord du chemin,
Où ton oranger, ton jasmin
Aspirent l’odeur de la terre ;
Cela, devant notre public,
N’a point le bon ton ni le chic
Indispensables pour lui plaire.
Ta vie et tes produits locaux,
C’est tout un pour eux, tes égaux
Qui te ne voient qu’en indigène.
Les Parisiens sont le sel,
Le parangon universel,
Leur monde une étoile lointaine.
*
14
Trois dizains réalistes
Isambour, voulez-vous savoir
Pourquoi je gardai le silence ?
Puisque j’étais au désespoir,
Il me fallait tenter ma chance ?
Hélas ! je ne sais que trop bien
Que vous parler ne pouvait rien !
Vous m’auriez écouté trois, quatre
Minutes puis, en soupirant :
« Sans être de Louis-le-Grand ?
Sans être au moins de Henri-IV ? »
2
Si vous me demandez pourquoi,
Isambour, je fus si timide,
La réponse est qu’en cet émoi
Vous paraissiez une sylphide
Aérienne au noble essor
Dont les boucles de flamme et d’or
De bougainville étaient coiffées,
Et dans mon lot vous adorant
Où voyait-on Louis-le-Grand
Pour y croire, au conte de fées ?
3
Ah je ris ! Avoir publié
Chez un éditeur de province,
Agreste, pour être oublié
Sans attendre… Je ris ! ça grince !
Isambour, je vous aurais dit,
En main l’opuscule maudit :
« Adorez-moi, je suis poète ! »
De rire vous eussiez pleurant,
En pensant à Louis-le-Grand,
Compris que je suis une bête.
*
15
Paul Durand
À genoux il était tombé
Devant le trésor de son âme,
Et son torse s’était bombé
Quand ils s’avouèrent leur flamme.
Mais il s’appelait Paul Durand.
Elle avait fait Louis-le-Grand
Et lui n’était qu’un réfractaire.
Quand il l’apprit, c’était trop tard,
Son visage devint blafard,
Son amour s’éboula par terre.
La haine remplaça l’amour,
Il sombra dans le nihilisme,
Pensant qu’elle avait dit oui pour
« Faire peuple » dans son snobisme,
Le bon ton du Quartier latin
Qui va trouver Félix Potin
Pour s’encanailler, triste folle,
Tout en montrant sa vanité
Avec la magnanimité
D’un choix en dehors de l’école.
Dès lors il n’eut plus à l’esprit
Qu’un sombre projet homicide.
Elle ne vit pas qu’il s’aigrit
Car il l’appelait sa sylphide
Et la mignardait comme avant,
Lui faisait des cadeaux souvent.
Quand elle décéda, personne
Parmi les parents, les amis
Ne dit qu’il pût avoir commis
Un crime : son âme était bonne.
Ce fut pour tous un accident
Et lui dissimula sa joie.
Il lui paraissait évident
Qu’il pourrait suivre cette voie
Et débarrasser le pays
D’autant de ces êtres haïs
Que possible : les sottes fières
Que nous devons porter sur nous
Pour avoir, sur les bancs des fous,
Lu deux ou trois dictionnaires.
Mais combien en séduisit-il,
Combien déborda-t-il de portes,
Ce Durand un peu trop subtil ?
Combien dans sa toile sont mortes ?
C’est ce dont les autorités
Privent les curiosités
Du public au goût trop morbide,
Par respect de Louis-le-Grand,
Que fit ce scandale atterrant
La victime d’un scolicide.
*
16
Le Don Juan de Louis-le-Grand
Il se voyait premier de sa promotion
Et dans la cour aimait se mirer dans les flaques.
Quel est le sens final de cette expression,
Le Don Juan de Louis-le-Grand ? C’est « tête à claques ».
Qu’un marquis séduisît des femmes en tous lieux,
C’est propre à fasciner nos frivoles bas-bleus.
Que le voyou se range avec une vérole,
C’est la loi naturelle, ignoble des faubourgs.
Mais qu’un littérateur de la meilleure école
Joue à ce jeu, c’est trop présumer d’un concours.
*
17
Tchandâla
De tous ces écrivains, notre élite, incubés
Dans quatre ou cinq préaux moisis en vain prestige,
À qui des rêves bleus dans leurs berceaux tombés
Leur montrèrent la Muse aimante et callipyge
Sommer leurs toupets chauds de laurier immortel,
Aucun n’a pu sauver le vers sacramentel.
Tous ont suivi l’obscure et tchandâlesque pente
De la facilité, du remous plébéien.
Un tel dénigrement de l’héritage ancien
Montre qu’était inné leur goût pour la fiente.
.
II
Galion des Indes
.
18
Ulrique-Éléonore
Ulrique-Éléonore ! en bateau, d’Elseneur
Tu passais comme un ange, et depuis ma fenêtre
Je vis tes cheveux d’or, je contemplai ton être.
Ton bateau ce jour-là me prit tout mon bonheur.
Car depuis ma fenêtre, où je fumais la pipe
En suivant dans le ciel des nuages huileux,
Je ne pensais à rien qu’à des sapajous bleus,
J’étais un Hollandais tulipier sans tulipe,
Et je vis ton bateau traverser lentement
Le bras de mer, tes yeux plus beaux que tout au monde,
Que tout dans l’univers et que tout à la ronde.
Ce fut de ma fenêtre un éblouissement.
Tu passais comme un cygne au milieu des nuages,
Tu souris sans me voir, mon âme s’exalta ;
Et ton bateau passé, ma fenêtre resta,
Moi dedans, prisonnier de vertiges sauvages.
Ulrique-Éléonore ! en quel burg, quel château
T’emporta loin de moi ta frégate cruelle ?
Je voulus me jeter dans le grau derrière elle.
Plût à Dieu qu’il changeât ma fenêtre en bateau.
*
19
Ulrique-Éléonore II
Ulrique-Éléonore ! à vous je pense épris.
Votre bateau passa quand je fumais la pipe
À ma fenêtre, un jour où les toits vert-de-gris
Se reflétaient dans l’eau, trémébonde tulipe.
Je voulus être alors le Hollandais volant
Pour vous suivre au château d’Helsingborg en Scanie.
Du moins un sapajou pour sauter pétulant
Dans les haubans du mât, mon audace impunie.
Un pirate batave, un singe capucin,
Tout mais pas ce moi-là ! Je ne voulais plus être,
Voyant votre bateau passer dans le bassin,
Cet homme qui fumait la pipe à sa fenêtre.
Les balcons cependant s’ornent d’un garde-fou !
L’horizon vous prenait à moi, vous que j’adore,
Et ma main qui tremblait se tendit, geste fou,
Dans le vide. Un soupir : Ulrique-Éléonore !…
*
20
Ulrique-Éléonore III
Ulrique-Éléonore ! épris je pense à vous
Dans mes jours sans couleurs et mes nuits, toutes blanches.
Ma vie est un désert : Les Palmes sans les Guanches
Ou Ponta Delgada sans ses bouvreuils jaloux.
D’avoir vu votre nef passer dans l’estuaire
Comment pourrai-je, aussi, me remettre jamais ?
Et vous, que voyiez-vous, quand au loin je fumais
Ma pipe ? Vîtes-vous ce pauvre solitaire ?
Vous n’avez pas, ô non ! vu se brouiller mes traits
Au moment où je vis vos mirages sublimes,
Vos yeux à l’horizon zinzolin, vers les cimes
De la Dalécarlie aux nivéens attraits !
Mais vous étiez pour moi la montagne dorée
Dans les rayons tremblants d’un destin radieux –
Le bonheur avec vous ! – quand je posais les yeux
Sur vous par qui la bouque était toute éclairée !
Ulrique-Éléonore ! ah, si vous aviez vu
Mon faciès, révélant que me perçait la flèche,
Ma douleur eût peut-être en vous fait une brèche,
Et l’Histoire eût changé, d’un atome imprévu.
*
21
Louise-Ulrique
Louise-Ulrique ! où donc votre nef s’en va-t-elle ?
Allez-vous découvrir, via le Groenland,
À nouveau l’Amérique, entendez le Vinland
Tout peuplé de skrælings cagneux, vous en dentelle ?
Et si votre vaisseau, drossé comme Cabral,
Débouchait au Brésil sur le bord de ses jongles,
Vous dont une servante a poli, peint les ongles
Des mains, à votre teint ne serait-ce fatal ?
Majesté, laissez donc ces folles odyssées
Aux peuples dont les rois sont dits « Navigateurs » ;
De votre sang viking modérez les ardeurs
Pour le sel de la houle et les voiles hissées !
Vous avez bien déjà le Noir Gustav Badin
Pour page et chambellan, voulez-vous donc un Jaune
Une plume en travers du nez auprès du trône ?
Quel est en vous ce goût pour l’étranger, soudain ?
Mon Dieu, que direz-vous quand un roi cannibale
Voudra vous convier au plantureux festin
Qu’il doit à Votre Altesse, assis sur du rotin
Et nu, la peau rongée à moitié par la gale ?
De grâce, accoutumez votre âme à vos alleux.
Le poète attitré que je suis peut le dire,
On n’est bien qu’à la cour, et pour tout un empire
Je ne donnerais pas nos loisirs précieux.
*
23
Louise-Ulrique II
Ayant dompté Pégase en preux Bellérophon,
Je suis, Louise-Ulrique ! en votre cour poète,
Et malheureusement de même un peu bouffon.
Je ne sais pour quel rôle on coiffera ma tête.
Ainsi, j’osai parler des ongles de vos pieds !
Mais il ne nous sied point de vous croire ce membre
Que jamais l’on ne vit, vous croire des souliers,
Et, même chambellan, de vous croire une chambre.
Ce n’est point inspiré des Muses que ce terme
De ma bouche sortit, non : c’est en Triboulet
Absurde, extravagant, jouant au pachyderme.
Moins sot, j’eusse reçu plusieurs coups de stylet.
À présent le poète a droit à la parole.
Louise-Ulrique ! qui s’imagine savoir
Qu’un pied sur vous termine une jambe frivole
Est, quand il voit un ange, incapable de voir.
*
24
Louise-Ulrique III
Louise-Ulrique ! Reine absolue en mon cœur,
Vous n’avez point de pieds, vous n’avez point de jambes,
Vous planez dans l’éther, l’azur de nos iambes,
N’avez d’autre séant que le trône vainqueur.
Dieu fasse qu’en pinçant les cordes de ma lyre
Je ne la tienne point pour marotte de fou
Et ne parle en bouffon ! Vous n’avez point de cou,
Vous avez en dentelle un collet, que j’admire.
Ce qui tient le bâton ne peut être une main,
La couronne n’est point sise sur une tête,
C’est ce que je comprends, en l’état de poète.
Vous n’avez point de pieds, vous montrez le chemin.
Vous n’avez de cheveux, c’est votre diadème.
Vous n’avez point de dos, étant le Souverain
Que l’on ne peut surprendre, infiniment serein,
L’image conservée en soi lorsque l’on aime.
*
18
L’ami d’Ulrique
Mon Ulrique ! adorer ta beauté bavaroise
Est le sens de ma vie, alors écoute un peu.
Qu’on m’invite à choisir entre une bavaroise
Et ton baiser, je dis : L’amour n’est pas un jeu !
Bien des fois n’ai-je point témoigné que je t’aime ?
Que l’on daigne épargner à qui t’aime vraiment,
S’il goûte tes baisers et les choux à la crème
Par ailleurs, les lazzi d’un mauvais sentiment.
Ah, regarde à quel point est écumant, est aigre
Le sourire jaloux de ces piteux Don Juans
Quand j’avale à ton bras une tête-de-nègre
En passant devant eux, ces yeux de chats-huants !
On peut apprécier le sucre en digne barde !
Et s’il est dans mon goût d’aimer l’apfelstrudel,
Le baba, le kouglof, le flan et la flognarde,
Ne puis-je aussi trousser pour ma belle un rondel ?
Qu’ont-ils à mépriser le läckerli de Bâle,
Dont je sais qu’on en sert au sultan au harem ?
Et je ne me sens pas dépourvu du teint pâle
D’un dévot, en mangeant un pastel de Belem.
*
25
Ingeborg-Amélie
Mon château sur le fjord, Ingeborg-Amélie,
Se réfléchit dans l’eau quand la glace a fondu,
Comme ton regard bleu dans ma mélancolie,
Ainsi qu’un oiselet sur l’océan perdu.
2
Nous aurions visité les pays de la vigne
Et du soleil à deux, cœur exceptionnel,
Si le tumulte affreux d’une canaille indigne
N’avait tout recouvert, insurrectionnel.
3
La fortune, l’amour, le bonheur, illusoires.
Mon château sur le fjord a sombré dans le feu,
Sa ruine fumante exhale en loques noires
Un cri de mendiant vers le ciel et vers Dieu.
*
26
Ulrika
In memoriam Jacques de Mahieu
Par l’historiographe de Louise-Ulrique
Fille d’Ullman, Normand qui fut le dieu toltèque
Nommé Quetzalcoatl, la petite Ulrika
Fût devenue avec le temps princesse aztèque,
N’eût été la noirceur de Tezcatlipoca.
Ce rebelle, versé dans la nécromancie
Indigène, adoptant un culte souterrain,
L’âme de rituels sanguinolents farcie,
Fomenta le chaos contre son suzerain.
Le feu tourbillonnait autour des pyramides
À têtes de serpent ; la petite Ulrika
Vit, muette d’effroi, les luttes fratricides
Anéantir son monde, et puis l’on s’embarqua.
Les fidèles d’Ullman allèrent au rivage
Pacifique, lançant des bateaux sur la mer.
Le perfide ennemi les vit depuis la plage
Atteindre l’horizon et se fondre dans l’air.
Longtemps, longtemps les naufs sur leurs planches fragiles
Bravèrent l’océan, la petite Ulrika
Fut la première à qui firent signe les îles :
C’est sur O-Tahiti qu’enfin l’on débarqua.
Devant les naturels saisis, ces têtes blondes
Bâtirent un village ensemble sur l’atoll.
Et le Normand pêcha dans ses eaux peu profondes
Et la nuit se remplit de chants de rossignol.
Et quand vint Bougainville à ces lagons pervenche
Envoyé par Louis des Lys, il remarqua
Que les chefs étaient roux, qu’ils avaient la peau blanche,
Et ne le comprit point, ô petite Ulrika !
*
27
Ingeborg
Sans vous je n’ai plus d’yeux pour la beauté du monde.
En partant sans un mot, vous m’avez pris ma voix.
Pourtant j’allais vous dire : « Ingeborg, quand je vois
Votre beauté, je tombe en extase profonde ! »
Oui, j’allais tout vous dire, avouer devant vous
Mon extase transie, en surmontant l’obstacle
De mon trouble muet, en portant au pinacle
Votre beauté de lys qui me met à genoux !
En me voyant si gauche, et mes saluts moroses,
Pouviez-vous concevoir en moi la passion
Dont j’étais labouré ? cette dilection
Qui me crucifiait sur un jardin de roses ?
J’allais vous dire : « Prends ce stylet, occis-moi ! »
J’étais crucifié sur un petit nuage,
L’amour le plus brutal, délirant et sauvage
Me rendait devant vous un agneau plein d’effroi.
Sans vous qu’est-ce, le monde ? Un sinistre appareil
Servant à Dieu sait quoi, grinçant et phosphorique.
Une maison hantée, ingrate, chimérique,
Où n’entrent plus jamais les rayons du soleil.
Car vous étiez ma joie en ce monde profane
Et j’allais tout vous dire, amour, rêve, Ingeborg !
Si vous ne m’aimez pas, envoyez un cyborg
Anéantir ce cœur qui trop longtemps se fane.
*
28
Ingeborg II
Prêtez attention à ces mots, Ingeborg :
Si vous n’envoyez pas sans tarder un cyborg
Des lasers de ses yeux tournants, électroniques
Me réduire en poussière, en atomes cosmiques,
Je vais, écoutez bien, ordonner posément
L’organisation de votre enlèvement.
Kuslir Agha Brahim, le chef de mes eunuques,
Vous accompagnera dans mon boutre aux Moluques
Et si vous résistez devra dans des liens
Vous serrer, ajustés par ses bras nubiens,
Rugueux pour vos appas, ce qui serait dommage.
Là-bas mon avion, prêt pour le décollage,
Vous conduira tous deux jusques à mon harem,
Un peu loin – désolé – du moûtier de Belem,
Le harem où j’attends avec impatience
Que vous et moi fassions plus ample connaissance.
Fatma vous enduira d’onguents délicieux,
Zineb mettra du khôl sur le tour de vos yeux,
Après que Rachida vous aura bien massée
Et Zulaïka peinte au henné, damassée
Comme un rare tapis de Bagdad ou de Fez,
Et Jasmine enrobée en bijoux d’Agadez,
Et Loulou, ce qui veut dire « perle » en arabe,
Tâchera de chasser de vous le spleen souabe
Que vous ressentirez dans les premiers moments.
Alors nous serons, vous et moi l’Émir, amants !
Si vous n’agréez point cette idylle recluse,
Si vous trouvez que c’est moins conquête que ruse,
Je vous le dis, lancez sans tarder, Ingeborg,
Pour me désintégrer au laser un cyborg !
*
29
Ingeborg III
Un cyborg accosta, cherchant à me tuer.
Or, bien que nous fussions en pleine canicule,
Il était incapable, Ingeborg, de suer,
Ce qui me le rendit suspect et ridicule.
Si bien que j’assénai sur sa tête un coup tel,
De ma plus longue et belle et plus tranchante alfange,
Que le robot s’ouvrit en deux et que le ciel
Est témoin que ce corps n’était point d’homme ou d’ange
Mais un tas de ferraille et de boulons, de fils
Électriques faisant sauter des étincelles,
Et les yeux, de petits canons noirs sous les cils.
Fendu, le tout faisait un bourdon de crécelles.
En fouillant, je trouvai dans les poches du mort
Une photo de vous, Ingeborg, à la plage
Et je sus que son cœur monté sur un ressort
Avait été saisi d’un captivant mirage.
Il vous aimait, ce tas de circuits performants !
Et mourut en jaloux sous ma lame effilée.
Ne devant rien sentir, il connut les tourments,
Comme moi, d’avoir vu votre splendeur ailée.
*
30
Ingeborg IV
Raconte ton histoire, Ingeborg ! la romance
« Le robot qui m’aimait » et que j’anéantis
Car il avait voulu, prônant la violence
De ses lasers, changer l’émir en confettis.
L’émir sut recevoir un céladon de tôle !
Il crut, sous des dehors ma foi peu singuliers,
S’approcher près de moi suffisamment, le drôle,
Mais la sueur manquait à ses traits réguliers !
Le baron Frankenstein doit revoir sa copie :
Il sied non seulement que ruissellent les fronts
Mais aussi – c’est plus fort que la nyctalopie –
Que résistent les cœurs aux appas doux et blonds !
Car j’ai su que la pauvre, inane créature
Sans ordre avait agi, que c’était un jaloux !
Comment dès lors compter sur une joint-venture
Si c’est pour qu’en Pierrots soient investis les sous ?
Et je ne voudrais pas, de grâce ! qu’une armée
De ces loyaux amants, de l’atelier surgis,
Parce que nous aimons la même Dulcinée
Se présentent fâchés ensemble à mon logis !
*
31
Ingeborg V
Ingeborg ! en français ton nom est Isambour,
Nom que tu recevras aussi dans mes poèmes.
Isambour ! si je peux espérer que tu m’aimes,
Sache que j’ai pour toi le plus fervent amour.
Ton nom dans le silence est comme une parole.
L’écouter me transporte au-delà de la mer
En un pays de brume et d’armures de fer,
Et je quitte le bisht d’un émir du pétrole.
Nom si beau, bien français, doux comme ta beauté,
Ton nom est Isambour, ton nom est Ingeburge,
Nom de reine de France étonnant qui me purge
De chagrins atavaux, d’étrange hérédité.
Sois Isambour, aimée au sommet du Parnasse
De tous les troubadours les plus parnassiens,
D’elfes de la forêt verte, magiciens,
De licornes mirant leurs traits dans une glace.
*
32
Isambour
La Danoise Isambour fut de Philippe Auguste
La noble et digne épouse, et jetée en prison
Le jour suivant l’hymen, de manière un peu fruste.
Le « nouement d’aiguillette » en serait la raison.
Le pape fulmina contre le roi de France :
Expresse injonction d’honorer Isambour.
Mais quelque effort, dit-on, qu’il fît avec vaillance,
Il restait sans moyens, même au son du tambour.
Isemberge resta vingt ans sa prisonnière
Avant de remonter sur le trône : c’est tard.
De ce rapprochement je ne sais la matière,
Philippe se trouvait sans doute plus gaillard.
*
33
Isambour II
Belle était Isambour, nous assure Étienne,
Évêque de Tournai ; Philippe, cependant,
Fut noué d’aiguillette, en conçut de la haine.
Ceci changea la face à jamais d’Occident.
(« Philippe n’eût pas eu l’aiguillette nouée,
La face de la terre aurait changé » : Pascal)
Se peut-il qu’Isambour ne fût guère douée ?
Vierges, apprenez donc le talent capital !
Votre beauté pourrait vous nuire, à Dieu ne plaise :
Veillez à conjurer l’injurieux nouement !…
Je mets fin, Isambour, à cette parenthèse.
Plût au ciel que j’en fusse à craindre un tel moment !
*
34
Je voulus rêver à la brune
De vous, plus belle que le jour,
Dans l’insouci, sans peine aucune
Fouler l’herbe, mon Isambour !
Je voulais rêver sous la lune
Au milieu des coquelicots,
Cette nuit lyrique, opportune…
Mais j’écrasai deux escargots !
*
35
Quand je vous vis, mon Isambour,
Je crus tomber à la renverse,
Et je sus que c’était Amour
Qui me blessait, âme perverse.
Rappelez-vous ! j’allais tomber,
Avec un soupir, sur la tête.
Mon cœur s’était mis à flamber,
Je dus vous paraître une bête.
Et j’ai soupiré chaque nuit,
Chaque jour depuis ma culbute
Dans vos rets si doux, comme un fruit
Faisant sur l’herbe un bruit de chute.
J’allais voir les coquelicots
Dans la prairie ensoleillée,
Parlais de vous aux escargots
Sous la lune d’or émaillée.
Je chantais à la tourterelle
À Versailles, voyant poudrée
Votre image dans la dentelle,
Sur la pelouse diaprée.
Enivré de votre beauté,
Je visitais la tour Eiffel
Où je tendais surexcité
La main vers vous mais dans le ciel.
Puis je volais aux Invalides,
Mais pardon si c’est trivial,
Comme à de blanches Argolides
Baiser votre péplos fatal.
Sous des piliers marmoréens,
Je discourais à l’Assemblée
De vos seuls appas cycnéens
Et de votre splendeur ailée.
Brûlé par cette passion,
Je sautai dans un bateau mouche
Où je croyais qu’en papillon
J’approcherais de votre bouche.
Mais je revins au Champ-de-Mars
Où je courus à perdre haleine
Et m’enrhumai – c’était en mars –
Vous pourchassant, nymphe, en Silène.
C’était non loin du quai Branly
Où la Seine aux ondes verdâtres
Emportait mon cœur apâli
Vers l’océan aux eaux saumâtres.
Et je sus que c’était Amour
Qui me blessait, âme perverse.
Quand je vous vis, mon Isambour,
Je crus tomber à la renverse…
*
36
C’était non loin du quai Branly,
Mes ans y furent solitaires.
Mon courage était amolli
Par des façons célibataires.
Arrivé fat de mon bel air,
Je connus la mélancolie,
Été, printemps, automne, hiver,
Tout l’an, d’aimer à la folie.
Sachez-le, j’aimais Isambour,
Plus belle que toute autre femme !
Voulais lui jouer du tambour
Pour lui communiquer ma flamme.
Mais je ne pus, tel est mon dam,
En fat dénué de bravoure,
Figurer plus qu’un nul quidam,
Qu’un paillasse rempli de bourre.
Elle ne sut pas mon malheur,
Isambour que j’avais élue !
Sentit-elle que ma pâleur
Venait de fureur absolue ?
Et me voilà moulu, perclus,
Sourd, aveugle, chauve à cette heure.
Seigneur, ne la verrai-je plus ?
Sans elle faut-il que je meure ?
*
37
Quai Branly
C’était non loin du quai Branly.
Sourd à la voix intérieure,
Je couvris d’un voile d’oubli
Toute raison supérieure.
J’avais jeté mon dévolu
Sur Ingeburge, cycniforme,
Me disant : « Puisque tu m’as plu,
Attends que je te chloroforme ! »
Je ne vis pas d’autre moyen
De parvenir à sa conquête,
Ne chantant pas l’italien,
Ne maniant point la raquette,
Ne sachant danser le tango,
Étant mauvais joueur de dames,
De whist, de crib, d’échecs, de go,
Ne sachant rien qui plaise aux dames.
Au sujet de ma passion
Je ne me fis aucun reproche,
J’implorais que l’occasion
Se présentât, la fiole en poche.
J’étudiais son agenda,
Sa routine, ses habitudes,
Patient comme le Bouddha
En ces travaux et servitudes.
Je négligeai mon entretien,
Mes fréquentations, le monde,
La mise en valeur de mon bien
Et ma vocation profonde,
Mes devoirs les plus absolus,
Les hommages à d’autres belles,
Ma garde-robe, enfin les plus
Indispensables bagatelles.
Il me fallait déterminer
L’instant qui conclurait l’affaire,
L’angle où me positionner
Sur sa route pour bien méfaire.
Je me disais : « Attends un peu,
Il doit venir une minute
Où nous serons en même lieu
Seuls, cachés, vaine toute lutte. »
Un acharnement surhumain !
J’identifiai l’heure exacte,
Le point précis de son chemin
Où je pourrais passer à l’acte.
J’y fus, j’attendis Isambour
Dans l’ombre, palpitant, avide.
Elle passa… Je dis bonjour
Et retournai chez moi, livide.
*
38
Gros-Caillou
C’était non loin du Gros-Caillou,
Dans la paroisse ainsi nommée.
Les touristes criaient « Oh you ! »,
Belles sur ma route acclamée.
Mais je restais indifférent,
Devant ces émeutes barbares,
À ce délire sidérant,
À ces amoureuses fanfares.
Car j’étais trop plein d’Isambour,
N’avais à l’esprit que le crime
Que je ruminais chaque jour,
Chaque moment, crime sublime.
Et sous les baisers qui volaient,
Parfois les murmures obscènes,
Les pleurs qui dans mon dos coulaient,
Je me passais les mêmes scènes :
C’était Isambour avec moi,
Abruptement chloroformée,
Près du Gros-Caillou pour la foi,
Dans la paroisse ainsi nommée.
Lecteur qui blâmes mon désir,
Réponds : était-il admissible
Qu’elle eût éprouvé du plaisir
Et fût vertueuse ? Impossible.
Si j’avais son consentement,
J’en perdrais toute mon estime.
Je ne devrais donc ce moment
Qu’à l’exécution d’un crime.
Tant, lecteur, j’attache au respect
Du sexe faible une importance
Prééminente ; cet aspect
Du cœur, je le dois à la France.
Et ma flamme pour Isambour
Provoqua ma déconfiture :
Le monde me châtia pour
Cette monogame aventure.
À présent c’est sous les lazzi
Que va ma route mal famée,
Non loin du Gros-Caillou, saisi,
Dans la paroisse ainsi nommée.
*
39
Arts premiers
Quand, toute ma science usée,
Mes feux pschittaient sur des glaciers,
Transi, je courais au Musée
Jacques Chirac des arts premiers.
Comme Ingeburge, cycnoïde,
Planait trop haut dans l’éther pur
Et je manquais d’un androïde
Qui me la remît en lieu sûr,
Je plongeais dans la Préhistoire,
Au trente-sept du quai Branly.
Mais ce n’était point pour la gloire
De tout savoir du spath poli :
Je voulais au dieu crocodile
Des Papous de l’île Bismarck
Chuchoter l’oraison utile
Pour l’amour et le tir à l’arc.
Je voulais des têtes réduites
Des Jivaros, dans mon chagrin,
Connaître le secret des rites
Qui me ferait aimer sans frein.
Je demandais à la déesse
Poisson des nus Andamanais
Les mots qui provoquent l’ivresse,
Comme aux vieux totems javanais.
J’épluchais les notes savantes
Des kangourous momifiés,
Des déités et des atlantes
En bois, des dieux scarifiés,
Pour découvrir les protocoles
Partageant le pouvoir divin
De tant de puissantes idoles
Et gagner Ingeburge enfin !
J’aurais consacré les prémices
De mon traitement mensuel,
Accompli mille sacrifices
Aux esprits des eaux et du ciel
Pour, toute ma science usée,
Baiser à genoux ses souliers !
C’est pourquoi j’allais au Musée
Jacques Chirac des arts premiers.
*
40
Musée
Par mon amour trop apâli,
Transi, je courais au Musée
Jacques Chirac du quai Branly,
Comme d’autres vont en fusée.
Et je me souvenais alors
D’une visite électorale
Que Chirac, exhumé des ors
De son alcôve sépulcrale,
Fit dans des quartiers peu cossus
Pour des jeunes là-bas rejoindre,
Et qu’il se fit cracher dessus.
Cela faisait ma peine moindre.
2
Et je me rappelais de même
L’espèce d’ardent hallali
Qu’ils criaient dans leur joie extrême :
« Chirac Branly ! Chirac Branly ! »
3
Touché par cet encens flatteur,
Je n’ai jamais bien pu comprendre
Qu’on entendît « Chirac menteur ! »
Qui ne se pouvait guère entendre.
Parmi les plumes, les atours
Des totems cannibalistiques,
Je méditais : « Êtes-vous sourds,
Commentateurs journalistiques ? »
*
41
Rococo
Enfant je vécus au Mexique,
Loin de mon Hurepoix natal,
Et j’appris d’un savant cacique
Cette histoire d’amour fatal.
.
Au temps de la Nouvelle-Espagne
Et des églises rococos,
Don Pèdre de Bellemontagne
Était la fleur des hidalgos.
Au Zocalo de mille lustres
Arriva de l’Escurial
Madrilène, d’aïeux illustres,
Done Ulrique, cygne ducal.
Quand elle quitta la calèche
En son grand panier chaloupé,
On eût dit, la voyant si fraîche,
La Vierge de Guadalupe.
Au milieu de son long cortège
De reîtres et minnesingers,
Les yeux d’Ulrique étaient un piège
Pour les cœurs bien nés, tous les cœurs.
Don Pèdre en perdit l’étiquette
Tant son esprit fut ravagé,
Se crut à la bonne franquette
Dans les ors, le teck ouvragé.
Sa façon de hanter Ulrique
Déplut fort, jusqu’au Vice-Roi.
Il lui disait « Ich liebe Dique »,
« Mein Harz », « Ongel », n’importe quoi.
Quand un burgrave de la suite
Vint le souffleter, l’hidalgo,
Son honneur lavé, prit la fuite,
Dut s’exiler de Mexico.
On raconte dans la campagne
Depuis ce temps qu’un justicier
Nommé Zorro, de la montagne
Descend parfois justicier.
Mais on dit aussi qu’un évêque
Envoya Don Pèdre accablé
Dans une guerre chichimèque,
Et qu’il fut de flèches criblé.
Apprenant sa fin, Done Ulrique,
Pressant une flor-de-mayo
Sur son bavarois sein féerique,
Pâle, soupira : « Le quiero !… »
*
42
Done Ulrique
Mon ange gardien, mexicain,
M’a donné tout bien réfléchi
Non le costume d’Arlequin :
Un habit de Mariachi.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Velours noir et boutons d’argent,
Arabesque, volute, orfroi,
Un blason de jais réfulgent,
Cet habit grandit avec moi.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Entendez le son de cristal
Des guitares, son de jasmin,
Le long de votre piédestal
Entouré de roses carmin.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Vous montrerez-vous au balcon
Pour un harmonieux amant ?
Ce soir la lune est un jargon,
Vous êtes le seul diamant.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Je suis le chantant rossignol
Qui trille à la brune transi.
Prendrai-je cette nuit mon vol
Avec celle qui m’a choisi ?
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Me lancerez-vous un baiser
À travers le ciel étoilé ?
Vous seule pouvez apaiser
Ce pauvre cœur inconsolé.
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Je vous promets mille trésors
Et des îles de tant de fleurs
Et des oiseaux de tant d’essors,
Des clartés de tant de couleurs
Done Ulrique, Done Ulrique !
Done, Done, Done Ulrique !
Que ce sera le Paradis
Sur terre, Ulrika, pour nous deux
Et pour tous les cœurs, ablandis
Par un dévouement gracieux.
Ô Done Ulrique, Done Ulrique !
Ô Done, Done, Done Ulrique !
*
43
Don Pèdre
Clarice, unique objet qui me tiens en servage (Corneille)
« Ulrique, unique objet de mon gros sentiment,
De ce féal amour et pieux dévouement !
Exhalant mon chagrin au milieu des pastèques
Et des maïs, faisant la guerre aux Chichimèques
En châtiment d’avoir occis un chevalier,
Qui vous était hélas ! parent et familier
Et dans la nuit profonde entendit mon aubade,
Qu’épris je vous donnai, dans le ton de Grenade,
Sous le balcon fleuri de rose et de jasmin.
Notre explication me barre le chemin
De la cour enchantée où vos yeux servent d’astre,
Dont m’exile un forfait achevant mon désastre.
Voici pour vous, Ulrique, un bleu vergiss-mein-nicht.
J’ai perdu mon soleil, ma lumière, mein Licht !… »
Ainsi divaguait sous un cèdre,
Blessé sans plus d’espoir, Don Pèdre,
Nous dit le père Mendoza
Qui dans la mort le confessa.
*
44
Baroque
La chapelle churrigueresque
Où Done Ulrique allait prier
Mêlait l’extase à l’arabesque,
Tournait la tête au marguillier.
Sous une couronne hispide,
Les gouttes de sang presque noir
De la sainte face livide
Disaient le divin désespoir.
Le Dieu fait homme, à l’agonie,
Au terme enfin de sa douleur
Allait fermer sur l’infamie
Du monde des yeux sans couleur.
Une Vierge miraculeuse
Avait pleuré des larmes d’eau
Sur la bûche à peine rugueuse
De son visage triste et beau.
Et Done Ulrique, teutonique
Vierge aux agréments impollus,
S’absorbait dans cette mystique
Image aux célèbres vertus.
Or, dans un recoin de l’église,
Caché par des rangs de piliers,
Don Pèdre qui la divinise
Couvre de larmes ses colliers.
*
45
Loulou-garou
Avec le loulou-garou (Robert de Montesquiou)
Don Pèdre, dans son désespoir
D’amour transi pour Done Ulrique,
Voulut consulter un cacique
Versé dans l’art funeste et noir.
À cette rencontre honnie
Voici ce qui fut résolu.
Pour chien Ulrique avait élu
Un loulou de Poméranie
Nommé Gunther, qu’en son giron
Elle prenait le soir assise,
À qui Pèdre enviait l’exquise
Proximité de son jupon.
Le magicien autochtone
Conçut un breuvage maudit
Par les conciles interdit
Qui mettrait Pèdre sur ce trône,
Le giron d’Ulrique, en loulou,
En remplacement du navré
Gunther kidnappé, séquestré
Par Don Pèdre loulou-garou !
Prenant son chien, quelle surprise
Reçut Ulrique l’entendant
Crier « Ô joie ! » en se tordant
Comme une palme dans la brise.
Ordinairement compassé,
Gunther n’avait point l’habitude
De manquer à la rectitude
De mœurs d’un monde policé.
Alors les duègnes s’emparèrent
De Pèdre poméranien,
Gémissant pauvre petit chien
Que les duègnes désespérèrent
En le présentant au prélat
Pour sacramentel exorcisme
Par application du chrisme,
Privation de chocolat.
On claustra la bête bavarde,
On manda l’Inquisition…
Le bourreau muni d’un tison
Me réveilla : « Je cauchemarde ! »
*
46
Loulou
Done Ulrique avait
Un sourire d’ange.
Don Pèdre éprouvait
Des frissons, rêvait
Un heur sans mélange.
Gunther le loulou
D’Ulrique était drôle,
C’était le chouchou,
Tendre, un peu foufou,
Goûtant fort son rôle.
Sous les bananiers
Que le soleil dore,
Parmi les paniers
Les cœurs prisonniers
Aiment la mandore.
Le bon Vice-Roi
À l’aimable règne,
Appui de la loi,
Garant de la foi,
Badine la duègne.
Quoi ! tu viens chanter
Une sérénade,
Pèdre ? C’est tenter
Le fer de porter
Une estafilade.
Tu saisis ton luth
Quand monte la lune
Versant son bismuth
D’argent : et ton but,
Dans cette nuit brune ?
Tu parles d’amour
À la belle Ulrique ?
N’osant pas de jour
Lui faire ta cour,
Ta voie est oblique.
Entends donc son chien
De Poméranie,
Comme il entend bien
Ajouter du sien
À ton harmonie !
Il éveillera
Trois ou quatre rues
Et ton opéra
S’éparpillera
En coquecigrues !
Ah loulou méchant,
Gâcheur de tendresses,
Tu veux, empêchant
Ce fébrile chant,
Toutes les caresses !
*
47
Sa duègne à Done Ulrique :
« Votre charme angélique
Est un puissant attrait
Pour les chevaleresques
Galants churrigueresques
Qui s’enflamment d’un trait.
Et sous nos vertes palmes
Quand les brises sont calmes,
L’orage et ses éclairs
En sauvage ruée
D’une sombre nuée
Recouvre les cieux clairs.
Craignez, quand vous ennuie
La cour un jour de pluie,
De céder aux appas
Qu’ont de sombres pupilles
Suggérant des quadrilles :
Ne les écoutez pas.
On me dit qu’à la brune
Il s’entend, quand la lune
Est dans le firmament,
Comme une symphonie,
Les sons d’une harmonie
S’élever doucement.
Que ces notes conspirent,
Quand les brises expirent
Un parfum sans pareil
De jasmins et de roses
Enveloppant les choses,
À troubler le sommeil.
Dieu sait quelle folie,
Quelle mélancolie
Ces musiques de nuit
Peuvent bien faire naître
Si vous laissez paraître
Du trouble à ce doux bruit !
C’est pourquoi Don Garcie
Qui de vous se soucie
Veut apprendre ce soir,
Armé, sous votre grille
S’il entendra ce trille,
Bien caché dans le noir.
J’éprouve tant de crainte
Et j’exhale une plainte,
Me sens clouée au sol !
Faudra-t-il que la ruse
Maniant l’arquebuse
Abatte un rossignol ?… »
*
48
Marbella
Mon cœur était blessé, mon aile
Aussi, la nuit n’était plus belle,
Les jours étaient trop longs, et gris,
Un goût d’échec et de misère
Pesant rendait ma vie amère,
Tous les filons étaient taris.
Et je la vis. Sa chevelure
Irradia sur ma blessure
Les rayons d’un soleil d’avril,
Ses yeux, comme la scintillante
Vague d’une mer accueillante,
Étaient un murmure subtil.
Fuyant les clameurs imbéciles
Pour l’horizon émaillé d’îles
D’un asile où tout échanger,
Nous déposâmes nos bagages
Dans un hôtel au bord de plages
Aux parfums de fleurs d’oranger.
Je voulais marcher avec elle,
Suivre notre route, laquelle ?
Espérant au soleil couchant,
Sur le gouffre étale des ondes,
Hors de l’espace, hors des mondes,
Monter et finir, comme un chant.
*
49
Marbella II
J’avais perdu l’envie
De vivre cette vie,
Je ne voyais qu’affronts,
Acrimonie, injures,
Infâmes impostures,
Haine sur tous les fronts.
Et puis, dans un sourire
Elle gagna l’empire
De mon sang, de mon cœur.
Sa beauté supernelle,
Comme la citronnelle
Épandait sa fraîcheur.
Nous fûmes où les terres
En plages solitaires
Se bercent au respir
Des vagues scintillantes,
Aux brises larmoyantes,
Ce cristallin soupir.
Je voulais avec elle
Contempler l’éternelle
Nuit vaste et sans contours,
Où dans cette étendue
Nous fondre, âme éperdue,
Pour nous aimer toujours.
*
50
Belle Marbella
C’étaient les orangers, la mer,
Les palmes dans le ciel si clair,
Le parvis des blanches églises
Sur le bord de plages sans fin,
Les jardins à l’odeur de pin,
Le soupir des vagues, des brises.
C’étaient nous deux main dans la main,
Que te semble de ce chemin ?
Près des jasmins ma renaissance.
C’était le jour après la nuit,
Des baisers donnés sans un bruit,
De mon cœur la convalescence.
C’était la rose avec l’œillet,
C’était la main qui les cueillait,
Mon âme qui pleurait de joie,
Tes mots comme un vin andalou,
Un trotte-menu de loulou
Dans l’après-midi qui poudroie.
C’était dans la sublimité
Mon rêve fait réalité,
Nous deux pour nous deux, la tendresse.
Et parfois, comme d’un lointain
Nuage au-dessus du destin,
Un long roulement qui m’oppresse…
*
51
Marbella la douce
Je l’avais emmenée au bord
D’une mer lapis sur un port
Embaumé par la fleur d’orange,
Marbella : son fidèle amant,
Je lui montrai le diamant
Du cœur, moins beau que son cœur d’ange.
Ses yeux s’emplirent d’un bonheur
Qui me ravit par sa douceur,
D’étincelles de mer turquoise.
Le temps s’arrêta, je compris
Que sa main n’avait pas de prix.
Je suis son âme siamoise.
Le temps arrêté, cet instant
Je fus éternel et pourtant
Je sentais tout l’amour possible
D’une vie en dehors de soi
Attachée en acte de foi
À plus que soi, son cœur sensible.
Ce rêve sera mon linceul.
Dans cette vie où je vais seul,
Je dois avancer sur la route
Où je m’engageai sans savoir
Qu’elle conduit au désespoir…
Au désespoir mais non au doute.
.
III
Garrigue
.
52
Célimène
Je contemple la mer seul depuis la garrigue,
Pensant à Célimène, ondine aux cheveux d’or
Que dans un pin me chante un enjoué becfigue.
Dans l’étincellement des flots est mon trésor.
Célimène, reviens ! dis-je dans ma détresse,
Sors à nouveau de l’onde, humide, les bras nus,
Car je n’ai plus de goût ni pour la bouillabaisse
Ni pour le cotillon aux hameaux biscornus.
La pinède peut bien retentir de cigales,
Je n’entends que ta voix, sourd à tout autre son.
Je t’aime tant ! Qu’importe aux âmes provençales
Que les sirènes soient mi-femme mi-poisson ?
Le Papet m’a conté que les écumes blanches
Dissimulent des mas grands comme des châteaux
Où vivent les ondins, habillés des dimanches,
Parmi des champs de vigne à longueur de coteaux.
Mais je t’aime pour toi, Célimène, toi seule :
Non pour tes pampres lourds de bumaste et jacquez,
Ni pour la tapenade écrasée à la meule,
Non plus pour tes palais comme de Saint-Tropez.
À la mer je descends par le chemin des chèvres,
Vers Célimène, ondine aux yeux d’indigo clair,
Et j’implore un baiser suave de ses lèvres,
Dût-il, ce doux baiser, me noyer dans la mer…
*
53
La sylphide
Ma sylphide à tous yeux cachée,
Des bras vous empêchez le roc,
Le colossal, énorme bloc
D’écraser ma tête penchée.
Le monde tomberait sur moi
Et je ne pourrais m’y soustraire
Si de votre aile de lumière
Vous ne moquiez sa dure loi.
Ne seriez-vous même qu’un rêve,
Je crois au pouvoir souverain
Qu’il a sur le glaive d’airain
D’imposer bienveillante trêve.
Fée invisible du chemin,
Je crains même votre colère
Contre le fou, le pauvre hère
Qui sur moi lèverait la main ;
Oui, je crains les peines sanglantes
Dont votre impétuosité
Fustigerait l’iniquité
Des ignorances violentes.
Car il vous plaît d’accompagner
Ma déréliction morose
De votre étincellement rose,
Il vous plaît de tout m’épargner.
*
54
Pour la première fois cette nuit, au matin,
Plein de respect profond je vis vos seins en rêve.
Puis – en y repensant un sourire m’enlève –
Vous laissâtes mes yeux approcher d’un tétin,
Penché sur vous ainsi qu’au bord d’une fontaine…
Vous ne souriiez pas mais vos yeux m’appelaient,
Comme des flots d’azur et d’or étincelaient,
Et mon âme adorante était claire, sereine.
Dans la simplicité de ce don lumineux
Je vois, linéaments de formes adéquates,
Plus de réalité qu’en mes jours disparates
Et comprends que je suis grâce à vous bienheureux.
Vous avez tout pouvoir sur l’onde tourmentée !
Depuis que vous servez d’étoile pour ma nauf,
J’ai la conviction de rester sain et sauf.
Quelle vague pourrait me couler, Galatée ?
*
55
Vénus paléolithique
Nous à qui le clinquant de la société,
Les chinés oripeaux de la haute culture
Semblent comme à Rousseau servage, impiété,
Un bouillon nidoreux de blême pourriture,
Nous aimons Célimène à la taille de sphinx !
Nous la vîmes entrer dans l’oasis subtile,
Des roseaux exondée au son de la syrinx.
Nous avons chanté l’eau dans le croissant fertile !
Son âme de cristal ameublit nos poings durs.
Et dans une caverne où nous l’avons suivie,
Nous avons adulé son ombre sur les murs
Et soumis au limon de ses pieds notre vie.
Ô blonde comme un champ sauvage de blés d’or,
Comme sable infini sur l’océan ô blonde !
Nous avons chanté l’eau, chanté l’alligator,
Sa beauté sans savoir que la terre était ronde !
*
56
Écrivains combattants
À Suzel
Je ne vous parle pas des Résistants,
Qui vont nous assommer encore un temps,
Mais de nos grands auteurs de la Première,
« La der des der », de ces illustres morts
Qui passèrent quatre ans sur le derrière
Au fond d’un trou de fange avec les porcs.
Je parle des Poilus dans les tranchées,
Grâce à qui nos Suzel sont revanchées.
Non contents, fiers soldats, d’un tel honneur,
Il vont par le menu dire la soue !
Hélas ! malgré leur dette au parfumeur,
Leur cervelle restait pleine de boue.
*
57
Président du Panthéon
La lettre de la loi suprême
En faisait un signe passif.
C’était, de l’aveu de lui-même,
Un président décoratif.
Jusqu’au jour où son équipage
Croisa Sante Geronimo
Caserio : ce bon nuage
Alors fut nimbé d’un halo.
2
Le poignard panthéonisa
Cette fonction avachie.
Sadi Carnot s’intronisa
Saint laïque par l’anarchie.
3
Carnot, entre donc ! La Patrie
Reconnaissant l’épanchement
De ton sang dessus la voirie
Te doit le plus pur monument.
Entre donc et sois un grand homme
Pour la coite postérité,
Rejoins notre Panthéon comme
Martyr de l’inutilité !
*
58
Ami, si tu vas à Porto,
Tu verras mainte belle église,
Comme l’on n’en voit guère à Pise,
Guère plus à Sacramento.
N’eût été la guerre civile,
L’Espagne en aurait tout autant.
Le bolchévisme serpentant
A tout ravagé, l’imbécile.
L’or des Incas est à Moscou
Depuis ces actions barbares,
Ce qui prouve que les Tartares
Entendaient nous tordre le cou.
Ami, si tu vas à Lisbonne,
Blanche terrasse au bord de l’eau
Où l’on écoute du fado,
Tu sauras que la vie est bonne.
*
59
Une couronne
Notre nom à tous est personne ;
Paris, nous sommes ta couronne.
Nous sommes, Paris, tes faubourgs.
C’est là que nous vivons, farouches,
Nos désespoirs et nos amours
Que sans les voir jamais tu touches.
Vers toi nous sortons de nos trous
En domestiques ou voyous
(« Les voyous des faubourgs » : poète
Philippe Soupault, tu vois bien !),
Le propos toujours déshonnête,
Pour tout dire : faubourien.
Vers toi nous sortons de nos antres
Non pour nos esprits : pour nos ventres
Si nous sommes des travailleurs,
Ou comme des oiseaux de proie
En sombres essaims querelleurs
Si te nuire fait notre joie.
Qui dira « Paris, à nous deux ! »
Sans passer pour sot outrageux
Chez nous ? Qu’à ces marivaudages
Se délasse un provincial,
S’il peut te présenter des gages
Sur son bien patrimonial.
Quand nous n’avons pas trop de haine
Pour ton ignorance hautaine,
C’est que nous sommes des niais.
Mais nous avons la suffisance
De nos miettes : si tu savais
Comme nous méprisons la France !
*
60
Kremlin
Isambour rencontra quelqu’un
Qu’elle n’eût jamais dû connaître.
Voyou de faubourg importun,
Aux Barnufles, Kremlin-Bicêtre,
Sur je ne sais quel boulevard
Lénine, Khrouchtchev, Gagarine,
Il n’eût point semblé trop pendard,
Mais Isambour fut sa voisine
Dans le quartier du Gros-Caillou :
Comment cela fut-il possible ?
Ce pays deviendrait-il fou
Et plus rien n’est inadmissible ?
La belle Isambour au grand cœur
Doit-elle souffrir que des mufles
Se méprennent sur sa valeur ?
Qui l’a fait sortir des Barnufles ?
Qui l’a fait sortir des faubourgs
Gagariniens de non-êtres
Où l’on a de banals amours
Et le linge pend aux fenêtres ?
Comment peut-on, c’est sidérant,
Approcher d’elle en ce bas monde
Sans avoir fait Louis-le-Grand ?
Depuis un faubourg ? C’est immonde.
C’est qu’il possédait quelque argent,
Me dites-vous : La belle affaire !
Cela rend-il intelligent
Et sachant ce que l’on doit faire ?
Sa présence la dégradait,
Il sentait son Kremlin-Bicêtre
Et son attitude gardait
Un air de linge à la fenêtre.
*
61
Musette
Comment, moi banlieusard, me suis-je cru poète !
J’aurais peut-être été chanteur, à mon sommet,
Ou de variétés ou, mieux, de bal musette
Sous la boule miroir d’un moite estaminet
Inélégant, aux murs exsudant le salpêtre,
Au milieu des radis en un site champêtre.
C’était là le piton de ma vulgarité
Puisque je n’étais pas un produit d’hypokhâgne,
Et qu’entre la banlieue et la verte campagne
Le Tout-Paris connaît la similarité.
*
62
Ma vulgarité
Dans ma vulgarité les diplômes sont vains.
Dans ma bassesse ont droit à leur apologie
L’alexandrin, les vers que nos grands écrivains
Ont voulu dépêcher vers l’archéologie.
Jamais je ne serai l’ami de ces félons,
J’appelle ce qu’écrit un goujat des flonflons.
Sans état d’âme ils ont trahi leur héritage,
Disant qu’il n’était plus pour cela de lecteurs,
Quand c’était leur devoir de sauver ces hauteurs
Car, de Louis-le-Grand, ils pouvaient davantage.
*
63
Ma goujaterie
Dans ma goujaterie, affirmer qu’un public
Décide de ce qu’est la valeur littéraire,
Que le ravin doit dire au célestiel pic
Ce que contemplera l’aigle depuis son aire,
C’est triste quand on sort d’un établissement
Qui produit quasi tout le divertissement
De la société du meilleur ton en France,
Quand à Louis-le-Grand on s’est imbu de soi,
Élevé pour dicter à la plèbe sa loi
Et régner sur « le Tout-Paris » sans concurrence.
*
64
Katmandou
Je vous aurais suivis, amis, sur vos chemins,
Car quel espoir avais-je, issu de ma banlieue
Où mon âge heureux fut embaumé de jasmins
Dans les jardins où croît la clématite bleue,
De me faire une place au milieu de serpents
Choisis pour leur venin, écailleux et rampants ?
L’internationale humble des barbes blondes
Et des cheveux au vent m’aurait vu militer
Dans ses rangs vagabonds, sur la route chanter,
Et tomber à la fin parmi les chiens immondes.
La roseraie du tête-à-tête : Recueil de poèmes
I/ Les chauves-souris du beffroi
II/ La roseraie du tête-à-tête (i), (ii), (iii), par le marquis de Bouchavannes
III/ Poèmes pour Hécate (i), (ii)
*
1
Quand la lune apparaît sur les bois fongineux,
Entre les noirs vaisseaux délabrés des nuages,
Dans la clairière glisse en troupeaux moutonneux
Un peuple saugrenu de gnomes lotophages.
Ils viennent pour danser, difformes et bossus,
Ivres des roses d’eau dont leurs âmes sont folles.
Les chats-huants cachés dans les vieux troncs moussus
Se taisent, affolés par ce raz d’aspioles.
Le long bourdonnement des tambourins brandis
Éprend le lumignon des yeux gais ; les grimaces
Qui leur servent d’appas les rendent ébaudis ;
Leur teint blême a l’aspect de la peau des limaces.
Dans le château de nuit, ce soir a pénétré
Le peuple des luitons par de brunes poternes.
Sur le ballet cornu s’est épandu, doré,
Un vol de vers luisants, comme un fil de lanternes.
*
2
À Dame Galatée
À votre majesté dont je suis fanatique
Je lève cette coupe ambrée, où le vin d’or
Comme un lac de montagne en combe selvatique
Miroite et l’on entend monter le son du cor.
C’est le vin d’or du Rhin : loin de vous je m’enivre,
Madame Galatée aux chatoyants cheveux.
Je bois ce vin, je bois car l’ivresse délivre,
L’ivresse oppose aux maux des beaux yeux d’autres feux.
– Raisin né pour ma soif, si bon, si bénévole,
Quand tu trempes ma lèvre altérée, entends-tu
Tout mon être qu’un long, triste automne désole
Vibrer comme une lyre et chanter, retendu ?
– Je ne suis qu’un grillon sur un pampre de vigne.
Madame, à votre auguste et belle majesté
Je lève cette coupe, en un poing trop indigne,
Et déclame, inconnu des rives du Léthé.
.
1/
LES CHAUVES-SOURIS DU BEFFROI
.
3
Pour l’Art
Perdus en un désert infini, sans chemins,
Plein de serpents siffleurs et de cactus humains,
Les bardes exaltés !
Plus devenaient hostiles
Les citrons épineux, les venimeux reptiles
Et plus la Muse avait pour mon chant de faveurs,
Plus s’envolaient mes vers ailés, altiers, meilleurs.
C’est comme si la pluie en ce tombeau de sable
Ne tombait que pour moi, cascade délectable.
Et la tourbe disait : « Écris tant que tu veux,
Nous ne te lirons pas ! Quand nous avons des yeux
En bon état, voilà, nous ne savons pas lire.
Et quand nous l’avons su, nous le perdons pour rire.
Et s’il fut parmi nous quelqu’un d’intelligent
Qui savait ses leçons, il gagne de l’argent,
Ce qui rend ta chanson pénible à son oreille.
Cette perte de temps, Pierrot, est sans pareille ! »
Ô toi, le maître aimé que je n’ai jamais eu,
Comme tu fusses fier si tes yeux m’avaient vu
Braver dans les déserts ces foules de babouins,
Pour l’Art ! À bas l’argent et ses vils baragouins.
*
4
Vermillons contre Zoulous
« Vermillon (s. m.) : Anglais, à cause de l’habit rouge des soldats de la Grande-Bretagne. »
Le Drakensberg ouvrait des ailes de cristal,
Andriaque éployé sur l’immensité nue
De la steppe, où son ombre omineuse et cornue
Heurte contre l’éclat du soleil, au Natal.
De quel héros le crêt sera le piédestal
Cependant qu’un python vermillon s’insinue
Dans le veld, enroulant la cuirasse inconnue
De canons sur le flanc du roc monumental ?
Le dira la fumée en tourbillons farouches,
Quand le cri de la guerre à leurs sanglantes bouches
Aura résonné, dure, immense explosion.
Les boucliers de peau voleront en lanières,
Et la lance clouera, dans la confusion
Du choc, le taffetas contre les étrivières.
*
5
Marquise
Si vous saviez les maux que j’endure, Marquise,
Depuis que mes serments envers vous, absolus,
Parce que je suis fou ne me permettent plus
De rien trouver de beau que votre mouche exquise,
Vous pleureriez, je crois, plus que je ne le fais !
Tant de larmes alors, en cascades limpides,
Couleraient de vos yeux, qu’y viendraient les sylphides
Au bord s’émerveiller hautement de ces faits.
Je suis le prisonnier d’un monde qui m’offense.
Et bien qu’il soit altier de suivre son devoir,
De tenir un serment, quand c’est sans nul espoir
La moindre haleine impure est une violence.
Et quel recueillement, d’un tel astre éclairé,
Pourrait ne point souffrir comme d’une estocade
D’un contact importun, fait à rendre malade,
De son attention sans égards séquestré ?
Car ma joie est aussi volatile qu’un souffle,
Cette extase, aussi grande et fugace que l’air.
Comme le souvenir est un sublime éther,
Il s’envole emporté par le nez d’un maroufle.
*
6
L’obstacle
Cet obstacle entre nous, Madame Galatée,
Cause que notre amour ne put être fêtée,
Ne fut point un discord entre des Montaigu
Et des Capulet, non, même le plus aigu :
C’est, ce fatal barrage, une haine de classe
Dont en mon cœur ému demeurait une trace.
Car vous avez poussé, las ! dans les beaux quartiers,
Sans palmes et plus froids que les sombres glaciers
D’Islande, sans appas pour l’âme sensitive,
Qui sont un bastion crénelé, gris, livide,
Une épaisse muraille où loin d’herbe et d’oiseaux
On couve, dans une ombre exsangue de préaux
Prestigieux, les fils de vaine bourgeoisie,
Comme si l’on pouvait semer de l’ambrosie
Dans un obscur dédale écrasant, caverneux.
C’est ce donjon qui fut l’obstacle entre nous deux.
Et le jardin, français hélas, enceint de grilles,
Où pompeusement vont dix ou douze familles
Se saluer, foulant un sable au peigne fin,
En tournant tout autour d’un filet d’eau, sans fin,
Est l’emprisonnement final de la Nature.
C’est là qu’avoir vingt ans me fut une torture.
Et si votre beauté, ce parfait diamant,
Emporte un cœur saisi soudain au firmament,
Baissant les yeux je vis sur votre tête blonde
L’ombre vaste d’un mur : ce masque est votre monde,
Je plaignis mes bosquets, mes rêves, ma chanson…
Un invincible ennui m’insufflait son poison
Devant la vision de cette barbacane
Au loin, monumental berceau de votre arcane,
Depuis les verts taillis de mes bois contemplé.
Le plus beau souvenir qui me reste, appelé
D’une page tournée, est quand, sous une arcade
Près de chez vous, auguste et sombre colonnade
– Je ne connaissais pas encore vos beaux yeux –,
Avec un bon ami poète, insoucieux,
Nous fumâmes du kif en riant : quels gens d’armes
L’auront vu, je ne sais, mais aujourd’hui ces charmes
Ont plus d’appas pour moi, hélas, que la froideur
Poussant, fruits corrompus, en funeste Elseneur.
Je ne sais si c’est moi, si c’est vous ou ma race,
Mais vous a condamnée une haine de classe.
*
7
Sous l’arcade
Après avoir fumé le kif sous une arcade,
Effrontément assis contre une balustrade,
Sans savoir où j’étais, suburbain sans crédit,
Causant avec l’ami poète que j’ai dit,
Riant comme fumeurs de kif en ont coutume,
Cinq ou six ans plus tard je venais en costume
Sur le lieu transcendant que j’avais outragé,
Et je ne riais plus, s’il était inchangé :
Le plus beau souvenir que je garde en mémoire
Fut ce jour où le kif le rendit dérisoire.
C’est pourtant là qu’était « la plus belle qui soit ».
Mais l’amour malheureux ne nous donne aucun droit
De se targuer de beaux souvenirs de jeunesse.
Mon plus beau souvenir est celui de l’ivresse.
Je reste convaincu qu’elle possédait tout
Ce que peut désirer le cœur s’il a du goût.
Mais elle était née, elle, au bord de cette arcade.
Mon meilleur souvenir : une bonne bravade.
Je ne l’ai plus revue, elle s’est fait un nom ;
Suburbain sans crédit, elle bien sûr, moi non.
J’ai perdu mon amour et la solde coquette,
Mais j’ai perdu surtout un vieil ami poète.
Suburbain, je n’avais droit qu’à ce qui m’est dû,
Le costume et l’amour sont un malentendu.
Mais un bon souvenir de franche rigolade,
C’est ce qu’un sous-urbain peut rêver, sous l’arcade.
*
8
Haine de classe
Quand Hécate souffrit à mes yeux sans pitié
De son moindre statut dans la société,
Vous-même, à votre tour, Madame Galatée,
La grandeur à mes yeux vous a désargentée :
Les beaux quartiers, ces murs pétrifiques, osseux,
Ont sur vos cheveux blonds mis leur sable glaceux,
Et la perfection qu’évidemment j’admire
Suscite contre vous, invincible mon ire.
Car je ne comprends pas que ces lugubres toits,
Qui paraissent bâtis sous de funestes lois,
Aient pu laisser pousser une si douce plante
Et non quelque roncier ou broussaille sanglante…
Et comment ce sourire éclatant peut-il bien
S’être ainsi conservé, dans l’antre chtonien
Où jamais je ne vais que de glaçants murmures
N’attestent le cœur froid de damnés et lémures ?
Comment, si ce sourire est vrai, le milieu
Ne l’a-t-il congelé, peut-il voler un peu ?
Quels sont donc les lotus qui font votre régime
Pour qu’un esprit décent ne tombe dans le crime,
Entouré de bassesse infâme, sans honneur ?
Le fait est que jamais sans un remous d’aigreur
Je ne posai le pied sur le seuil écarlate
Où, comme un médaillon sur le velours éclate,
Vous fûtes, vaporeuse, une apparition.
Un délire hanté de macération
Me maintint quelque temps, pour vous, dans la caverne,
Mais je ne trouvai point aux eaux de cet averne
Un élixir d’oubli pour plonger en vos yeux
Et rouler dans les bras d’un flot torrentueux.
Je fus chassé.
Jardins, bosquets, ô belles sources
Et ruisseaux cristallins, baignez-moi dans vos courses !
*
9
Haine de classe II
Un instinct plus puissant que toutes les carottes
Opposait mon dégoût fatal, droit dans mes bottes,
Au succès qui promet d’être de ces bourgeois
Responsables des plus dégradantes des lois.
J’avais le sentiment de leur hypocrisie
Avant que de savoir, grâce à la Poésie
Qui hélant m’emporta loin de leurs beaux quartiers.
Et j’aurais, sans scrupule, avec les cordonniers
Conspiré pour monter une ou deux bombinettes,
Si la Muse n’avait gréé les goélettes
Où je voguais, épris de brise et d’océan.
Car occupé toujours à chanter le péan
D’Apollon sur la lyre agreste de mes odes,
À peaufiner un style homérique de laudes,
Gardant sur le métier l’ouvrage de mes vers,
Je ne voyais plus rien de ce pauvre univers
Abandonné des dieux.
Que dans la solitude
Je ne trouve, assailli par quelque inquiétude
De vulgaires bourgeois, le loisir de chanter,
Je jure de tout faire aussitôt éclater !
*
10
Suburbaine Romance
J’avais une Lucinde à Sèvres
Mais c’était la fille d’un flic.
Si, prononcé du bout des lèvres,
Ce mot ne vous parle du hic,
Ne vous dit mon destin tragique,
Vous ne me comprendrez jamais.
J’ignorais le fait, pathétique,
Et j’ai souffert, car je l’aimais.
Si mes parents, plus raisonnables,
Ne m’avaient produit sous-urbain,
J’aurais aimé de délectables
Filles de banquier, de robin.
En aimant la fille d’un cogne
Sans savoir, je fus dégradé ;
Je mettais de l’eau de Cologne
Mais pour la fille d’un condé.
Ah comme je hais la banlieue,
Où cela peut vous arriver !
Moi je rêvais à la fleur bleue
Et ne peux cesser de rêver.
Or cette fille-là de bourre
Un beau jour voulut bien de moi,
Même si ma folle bravoure
Me faisait violer la loi.
Car je fumais alors de l’herbe
Et d’elle ne m’en cachait pas.
Comme le dit un vieux proverbe,
L’Amour se moque des papas.
C’est après la peine et les larmes
Que je sus que son paternel
Était roussin, fils de gendarmes,
Pour mon traumatisme éternel.
Pourquoi pas la fille d’un juge,
D’un grand d’Espagne ou d’un milord ?
Ah que m’emporte le Déluge !
Fille de flic, bougre de sort !
La fille du flic est « sortie »
Avec un poète, un rêveur…
Et corrompu sa modestie
Par des propos de débardeur.
Elle avait ce qui manque aux mièvres
Et sut me produire un déclic.
J’avais une Lucinde à Sèvres
Mais c’était la fille d’un flic !
*
11
Carte scolaire
Je suis le Sous-urbain – le Bœuf
– L’Inconsolé… De ma patrie
Je ne porte point l’habit neuf
Mais la loque la plus pourrie.
Quand les mignons des beaux quartiers
Sont payés sur leur bonne mine,
Je dois de volumes entiers
Emplir ma cervelle chagrine
Afin qu’une croûte de pain
Contente ma panse concave.
Que me fait le mauvais lopin
Que j’ai, puisque je suis esclave ?
Tout ce que j’ai ne sert à rien
Du fait que la Carte scolaire
Me marque au fer « Béotien »
Et « Prolétaire héréditaire ».
Sur cette Carte mon pays
C’est Pur-Néant, Sables-des-Âmes.
Les meilleurs chez nous, ébahis,
Ne voient que les valets des Dames.
Ils montent quartier Saint-Germain,
Assurés que leurs bonnes notes
Les y conduiront par la main,
Mais on leur fait cirer des bottes.
Ils sont, tristes humiliés
Que tant d’offenses rendent blêmes,
Par les cognes crucifiés
Leur donnant du « bourgeois bohèmes ».
(ii)
Dans la mixité sociale,
Pourquoi sont-ce les miséreux
À qui l’amitié cordiale
Me joignait et non les heureux ?
Quand elle fait que chacun pue,
Comment le gibier de prison
Ne rendrait l’âme corrompue,
Puisqu’on l’invite à la maison ?
Quand l’école est celle du vice,
Pour qui Racine est à fumer,
Quel espoir que l’on réussisse,
L’objectif étant d’assommer ?
Et tandis que l’on s’acoquine
Avec ses voisins délinquants,
Sans savoir on a pour copine
La fille de flics… trafiquants !
*
12
Sous-urbain
Paris, pour moi le sous-urbain,
C’était d’abord un délétère
Monde grouillant et souterrain,
Le métro puant sous la terre.
Ou des trains sales, cahotants,
De longs trains de gares fantômes
Dont la moins vieille avait cent ans,
Fleurant l’urine. Quels royaumes !
Et ce fourmillement hideux
Vous oppressant dès l’arrivée !
J’aurais dit « Paris, à nous deux ! »
N’eût été ma tripe éprouvée.
Ma fenêtre sur un jardin
Me manquait dans ces avenues.
C’est toujours en eau de boudin
Que partent les déconvenues.
Je n’ai jamais su quels plaisirs
À Paris se donnent les riches.
Que je remporte mes soupirs,
Je les laisse avec leurs fétiches.
Ce que j’y trouve de bon, moi,
C’est une immense solitude.
Hélas, ma voisine est – pourquoi ! –
Mégère et c’est la Multitude.
*
13
Les souterrains
« me consoler des minutes misérables qu’il faut vivre dans une voiture publique » (François Mauriac)
Un sous-urbain dans le métro,
Quelle sera sa contenance ?
Il ne peut plus comme au bistro
Cracher de la fumée en transe.
Et même accompagné d’amis,
Les oreilles sont indiscrètes,
Il sent un fardeau, s’est soumis,
N’a que des phrases toutes faites.
Car il n’est plus dans son milieu.
Inerte pantin dans un gouffre
Avec une foule sans lieu
Qui fleure l’urine et le soufre.
Et c’est pire quand, haschiché,
D’infimes détails le taraudent ;
Il voit son horizon bouché,
Des monstruosités qui rôdent.
Et l’ennui d’être là-dedans
S’exacerbe en folle épouvante :
Il claquerait presque des dents.
C’est là le progrès qu’on nous vante ?
Ne sachant même plus pourquoi
Il s’inflige cette torture
– Un livre, un film, un café, quoi ? –,
Fait violence à sa nature.
Cet entassement inhumain,
Bétaillère expérimentale,
Ce calvaire sur le chemin
Vers un peu de la Capitale !
Que n’allait-il, après les cours,
Retrouver la fille du cogne
Et d’autres, vivre ses amours
Au bord du zinc avec l’ivrogne ?
*
14
La fille du cogne
Quand j’étais sous-urbain, j’aimais
Ô j’aimais la fille… d’un cogne !
À Sèvres, non loin de Boulogne.
Je n’en savais rien, n’en peux mais.
Moi chavillois, crépusculaire ;
Tout cela devait tourner court.
C’était plus près de Billancourt,
De fait, le versant populaire,
Avec son bloc utopien,
Sa dalle « Orange mécanique »,
À quoi, pour être bucolique,
Manquait de n’être martien.
Tel fut le cadre aborigène
Où notre amour se consuma
Pour terminer dans le coma.
Je ne lui garde point de haine.
Elle fumait comme un pompier
Mais c’était la fille d’un bourre.
Fallait-il donc qu’elle se fourre
Avec un artiste… pompier ?
Je l’ai plusieurs mois fréquentée
Sans qu’elle ne dît jamais rien
De la carrière de gardien
De la paix, la grande éhontée !
Quand je pense qu’elle voulait
– Évidemment –, fille de cogne,
Le cadeau que fait la cigogne
De moi, la fille d’un poulet !
C’est la mixité prolétaire.
Je l’aimais, étant sous-urbain ;
Elle m’aimait, son chérubin,
Je suis resté célibataire !
*
15
Quand vous lirez de moi ces lignes,
Je sais bien que vous m’aimerez.
Mais vos mœurs sont tellement dignes :
Jamais vous ne m’acclamerez.
Pour me rendre ce témoignage,
Vous attendrez que je sois mort ;
Et c’est le pasquin du voyage
Que moi vivant vous louerez fort.
Sa bêtise monumentale
Vous évoque le Panthéon.
Sa verve un peu sentimentale
Vous jouera de l’accordéon.
Ce n’est pas un naïf, ô foule
Qui te perds de naïveté !
Moi-même je l’ai, cette boule
Dans la gorge, à voir la Beauté ;
Et quand j’étais épris de Claire,
C’est Gisèle que j’embrassai.
Si Claire avait tout pour me plaire,
Je n’osai lui dire… et passai.
*
16
N’était la prison sans attraits,
Je voudrais prêcher le suicide.
Au vieux qui n’est plus assez frais,
Au jeune à la vie insipide.
Mais la prison est sans appas
Et ma chanson sera donc brève.
Surtout ne vous suicidez pas :
À la fin, après tout, on crève.
.
2/
LA ROSERAIE DU TÊTE-À-TÊTE,
PAR M. LE MARQUIS DE BOUCHAVANNES
.
(i)
.
17
Suivant nos entretiens, apprenez qui je suis,
Madame, dont l’empire est celui des sultanes
Et qui m’adorerez, vos silences instruits,
Car je suis Florimond, marquis de Bouchavannes.
Les femmes, qui souvent sont folles, me voyant
Le sont toujours, Madame. À cause de mes boucles.
Ma perruque a du chypre, et son blanc chatoyant
S’illumine au pourpoint émaillé d’escarboucles.
Sous un déguisement diapré d’Arlequin,
Je vous sus faire voir vous-même en Colombine.
Que ferez-vous, m’aimant sous les traits d’un faquin,
Quand vous saurez que j’ai des châteaux jusqu’en Chine ?
Je connais le beau monde et chacun à la Cour,
Et vous y veux conduire en voiture à ses fêtes.
Nous n’aurons plus enfin qu’à sceller notre amour
Par le descellement de vos bras sur nos têtes.
.
(ii)
.
18
Trésor des roses
Lidye, as-tu glané le trésor dans les roses ?
Ta main est délicate et blanche, tu ne l’oses
Car les épines font un hallier de couteaux
Sur les pétales blancs et jaunes les plus beaux
Et ta main saignerait dans les blanches corolles,
Tes larmes couleraient en noyant tes paroles…
Prends ma main, à la place, et je jure qu’alors
Je cueillerai pour toi sous les feuillages morts
Les fleurs dont une abeille indigète affairée
Saupoudra le pollen en terre consacrée
Aux dieux des jours bénis et des nuits de clarté,
Le pollen sur des doigts d’arc-en-ciel emporté…
Au ciel j’élèverai dans la coupe, Lidye,
Le philtre étincelant dont l’éclat irradie
En halo de rosée au fond de ton regard
Et qui sur ta peau claire et douce est le seul fard.
*
19
Nuage
Ô Lidye, assieds-toi sur ce nuage rose !
Je t’apporte, si jaune, éclatante, une rose
En traversant le ciel sur mon tapis volant,
Où je nous servirai du thé chinois brûlant.
Je te jouerai du luth sur les cordes nacrées
Des rayons de la lune, et tes lèvres ocrées
De rouge pompéien s’ouvriront sur tes dents
Qui sont, sortant de l’eau, des feux-follets ardents.
La vois-tu, cette rose aux flamboyants pétales ?
Rouges sont tes cheveux lorsque tu les étales
Sur ton dos pâle et nu, dans mon livre illustré
Où je lis ton histoire et ton nom est entré
Au milieu de tant d’ours débonnaires, de singes
En livrée améthyste et de fidèles sphinges
Qui servent dans les bains de tes riants loisirs,
Étoile, qui te fais belle pour quels plaisirs ?
Je ne veux plus fermer ce beau livre d’images :
Tu danses dans la ronde allègre avec des mages
Aux turbans scintillants et des oursons velus
Qui roulent-boulent, bonne amie ; et chevelus
Des elfes sont venus de la forêt profonde
S’incliner devant toi pour te bailler un monde.
Je ne veux plus quitter ce parchemin des yeux…
Si je pouvais t’avoir avec moi dans les cieux…
*
20
Jardin des faunes
Ô Lidye, acceptez ces quelques roses jaunes
Que pour vous je cueillis dans le jardin des faunes
Où pleurait une nymphe au pied d’un marronnier
Car son Panite ingrat voulait la renier :
Ses larmes en tombant dans l’herbe avec sa marche
Faisaient croître des lys et, passant sous une arche,
Elle devint glycine éclatante aux rameaux
Rouges comme la vigne et les sombres ormeaux
De l’automne…
Ô Lidye, aimez comme ces roses
La brise qui répand le pollen sur les choses,
Leurs délicats parfums dans les cœurs affligés.
Les blessures d’amour, les mépris infligés
Par les belles qui vont sans penser que leurs charmes
Inondent les chemins de rivières de larmes,
Tel est le conte ému qu’éveille ce bouquet
Cueilli dans l’épaisseur du plus profond bosquet
Quand riait la syrinx moquant ma solitude,
Mon cœur plein de soupirs et plein d’incertitude…
Je rêvai qu’un sourire à vos lèvres monté
M’ouvrait les portes d’or d’un palais enchanté…
*
21
Le dragon à la rose
Ô Lidye, acceptez de moi ces roses jaunes !
Placez-les dans de l’eau, sentez-en le parfum :
Vous entendrez couler, dans la flûte des faunes,
Un ruisseau volubile emmi l’ample nerprun.
Vos yeux illuminés de chatte, dans l’ivoire
D’un songe au crépuscule étincelleront verts,
Verts en la toison rousse iridescente et noire,
Métal de scarabée – ô vos yeux grands ouverts !
M’aimantez-vous, Lidye, à qui j’offre des roses
Pour m’avoir envoûté de sourires si bleus ?
Ô ne déclinez pas, de grâce, mes névroses
Sans un baiser, qui pleure avec moi dans les cieux !
Un baiser triste et long, long comme une rivière,
Long comme un parchemin, comme un chemin planté
De charmes, un baiser de volcan aurifère,
Un baiser dans la nuit de mon château hanté !
Hanté par tout un cirque étonnant de clowns pâles.
Un baiser d’amour jaune et la clef d’un trésor
De pirate caché dans une île aux pétales,
Et pour bain sur ta peau toutes ces pièces d’or !
Je te place, arc-en-ciel de lune, apothéose,
En un cristal magique où tangue, distendu,
Un dragon dans sa gueule apportant une rose
De toutes les couleurs du paradis perdu !
*
22
Revenant
Quand je mourrai, Lidye, amoureux sans espoir,
Moi qui vis à vos pieds, moi qui suis idolâtre,
Je ne pourrai quitter la terre, et dans le noir
J’infesterai vos nuits, fumerolle verdâtre.
Minet, dans la chambrette, affolé grondera
Quand mon pâle ectoplasme effrayant, en silence,
Agrégé lentement se réchafaudera ;
Il fuira sous le lit ma lugubre présence.
Et vous verrez alors mon fantôme flotter
Sur place comme un feu fétide de tourbière.
D’un coup vous redressant, vous que je viens hanter,
Le froid vous saisira devant cette lumière.
Vous vous rappellerez le poème angoissant
Qui vous avait trahi la noirceur de mon âme
Et ne saurez que dire au squelette glaçant
Qui sans espoir voulut que vous fussiez sa femme.
*
23
Roses jaunes
Lidye, en ce bouquet de roses printanières
Jaunes – ce sont, je sais, celles que tu préfères –,
Regarde l’arc-en-ciel de mes larmes monter
Vers le ciel où je veux avec moi t’emporter
Pour enlacer ton corps léger comme un nuage
Et te donner mon cœur lourd de soupirs et sage,
Dénouer tes cheveux roux d’ambre et de clarté
Aux parfums de halliers profonds, à la beauté
De cuivre étincelant de bouclier antique
Et, tombant en cascade auburn, en dalmatique
D’enchanteresse parthe habitant les ajoncs
Pleins d’étoiles, d’oiseaux moirés tels que plongeons,
Sarcelles et colverts, canards branchus, tadornes,
Et de taureaux pointant vers la lune leurs cornes
En meuglant outragés par les cris dans le ciel
Des vanneaux migrateurs vers les pays de miel
Et de lait sillonnant les brumeux crépuscules.
Dans l’onde un Waasensteffl amoureux fait des bulles :
Il a vu tes grands yeux dans le miroir de l’eau
Et pleure car il sait qu’il n’est pas assez beau
Pour que tu viennes vivre avec lui dans le sable
Au fond du fleuve glauque, et qu’il n’est point capable
Non plus de t’entraîner de force dans son trou
Plein d’algues ; et transi d’amour, il devient fou…
Si tu n’as point pitié de cette créature
Infortunée, au moins que ta noble nature
Ne reste point de glace en voyant un bouquet
De roses citron : viens, siège à notre banquet !
*
24
Roses blanches
Ô Lidye, acceptez de moi ces roses blanches !
Ô si vous préférez la teinte vermillon,
Je verserai mon sang en chaudes avalanches
Sur le bouquet que boit un heureux papillon.
Pour vous je viderai de leur sève mes veines,
Pour vous dont les cheveux sont des flammes d’airain,
Les yeux des diamants de volcan dans leurs gaines,
Je viderai ces poings de leur sang saphirin.
Vous convoitez les fleurs aux coupes de topaze
Qui donnent à vos yeux des reflets smaragdins
De panthère, la nuit, aux bois de chrysoprase,
Des éclairs d’œil de tigre aux immenses dédains.
Acceptez ce bouquet candide et vos prunelles
En s’opalisant d’eaux souterraines luiront
Comme un glacier caché de macles éternelles
Où gît le corps des dieux qui demain renaîtront.
*
25
La rose noire
Ô Lidye, acceptez cette rose, elle est noire
Car je suis un vampire exhumé du tombeau
Et pour ma soif d’amour il n’est rien de plus beau
Que votre cou si long et blanc au pur ivoire.
Quand mes crocs effilés y perceront deux trous,
Vous serez en mes bras une amante pâmée,
Je boirai votre sang de blonde parfumée,
Votre âme trouvera ce long baiser si doux.
Puis se lisèreront vos yeux perle d’un cerne,
Votre bouche prendra le pigment violet
Des voluptés d’onyx et le goût aigrelet
Des sucs ferrugineux dans l’ambrosie interne.
J’immortalise ainsi notre amour, tout est noir
Et vous me presserez contre vous, ténébreuse
Ainsi qu’au bord du Styx une rose lépreuse,
En goûtant les beautés blêmes du désespoir.
*
26
Roses prune
Ô Lidye, acceptez de moi ces roses prune
Car je suis un vampire exhumé du tombeau
Et je veux contempler votre corps au flambeau
En sa nudité vierge et brûlante de lune.
Que rien ne couvre plus cet ivoire veiné
De bleu cobalt et blanc marbre de sépulture
Que le sang rouge et chaud pulsé sous la texture
Irrigue et rend, au feu du brandon, satiné.
Mon sourire devant ces formes floconneuses
Trahit mon appétit délirant de nectar.
Oui, je veux vous vider de tout le coaltar
Qui comble, magma lourd, vos failles caverneuses !
Que j’aime ce volcan : votre beauté qui bout !
Tendez ce cou d’albâtre, ô fulve néréide,
Tendez aux crocs sanglants la blême chrysalide
De ce corps convulsé qui me doit donner tout !
*
27
Roses sarcelle
Ô Lidye, acceptez quelques roses sarcelle
Car je suis un vampire exhumé du tombeau.
Mon âme est noire comme une aile de corbeau,
Et ma denture blanche, éclatante étincelle.
Vous dites ne pouvoir m’aimer car je suis mort
Mais cette mort, Lidye, est pourtant bien vivante
Et j’aime les cheveux de flamme que je chante,
Et j’aime vos yeux paon qui m’ont jeté leur sort.
Dénudez-vous, j’ai froid ! ou dans la chambre mauve
Où vous rêvez le soir penchée au fenestron
Vous sentirez passer un souffle d’aquilon
Et j’entrerai soudain, volante souris-chauve !
Alors je glisserai sur mes griffes vers vous,
Mes yeux vous darderont de flammes phosphoriques…
Vous pousserez des cris de canette hystériques
Quand je me suspendrai dans votre chanvre roux !
*
28
Roses puce
Ô Lidye, acceptez de moi ces roses puce,
Couleur de sang séché : leur capiteux parfum
Évoque un souvenir de vampire qui suce
La vie ardente au cou, potion rouge-brun.
Et vous défaillirez, yeux charbonnés de cernes !
Vous courez la forêt dans une épaisse nuit
Au milieu d’un sabbat de citrouilles-lanternes
Qui jacassent, gueulant, crécellent, font du bruit.
J’ai vu les saules morts, suintants du marécage
Sur vos galops étendre un lacis de doigts gourds,
Et l’assassiné vert dont l’épave surnage
Tenter de vous séduire avec des couplets sourds.
Alors je vous ouvris, délecté de ma proie,
Et déchirai le drap vous cachant, noir onyx.
Cependant, vous gardiez dans les plis de la soie,
Pour que nous explosions tous deux, un crucifix.
*
29
Roses citron
Acceptez un bouquet de ces roses citron,
Car c’est votre couleur, je le sais, préférée !
Et moi je ne suis pas richissime baron,
Mon âme est cependant par vos yeux sidérée.
Ô Lidye, acceptez ces roses, on dirait
Des têtes de magots chinois décapitées !
J’ai dû chercher partout dans la ville, il paraît
Que la plupart du temps ces roses sont ratées :
Il y faut du soleil méditerranéen,
Du terreau frais, du vent, de l’eau bien minérale,
Cristalline, un travail, dit-on, herculéen.
La moindre mouche bleue est pour elles fatale,
Le moindre puceron tout poisseux, tout velu
Peut ruiner le teint, avarier la robe
De ces riantes fleurs du bonheur absolu
Promis au cœur fidèle, au cœur loyal et probe.
Je dus chercher longtemps et me suis endetté
En signant de mon sang un pacte avec le diable :
Il possède mon âme et mon éternité
Mais ces roses, Lidye, iront sur votre table.
*
30
Roses mimosa
Ô Lidye, acceptez ces roses mimosa
Car c’est votre couleur, je le sais, préférée.
Je suis allé cueillir cette gousse dorée
Dans une forêt sombre au cœur bleu d’Ibiza.
Puis je pris l’avion de Mayorque à Sarcelles.
Hélas, un enchanteur funeste avait caché
Dans ces fleurs un serpent qui, tout effarouché
Par le bruit de l’engin, mordit trois demoiselles.
Si bien que la police en plein aéroport
Voulut me séquestrer et confisquer ma gousse,
Mais elle avait poussé sur une étrange mousse
Et pour la retenir il faut aimer bien fort.
Les fligolos, marris par l’inouï prodige
De roses mimosa qui ne se laissaient choir
Dans leurs bras pollués, perdirent tout espoir
De saisie : « Elles sont pour une autre ! », leur dis-je.
Cette autre est vous, Lidye, ange venu du ciel
Et dont je vis un jour le pied par aventure.
Depuis lors je n’ai pu refermer la blessure :
Je saigne mais pour vous, et c’est l’essentiel.
*
31
Roses topaze
Ô Lidye, acceptez ces sept roses topaze
Car c’est pour vous, je sais, la plus belle couleur.
En plaçant dans de l’eau cette blonde splendeur,
Vous goûterez, dit-on, de purs moments d’extase !
Je suis allé chercher ce bouquet merveilleux
Dans un jardin magique où vivent des vipères
Volantes dont les nids stridulants et prospères
Regorgent de joyaux, de trésors fabuleux.
Pour enlever ces fleurs, d’abord il faut résoudre
L’énigme d’une sphinge aux ailes de corbeau :
La réponse correcte ouvre un ancien tombeau,
Une flamme sinon réduit l’intrus en poudre.
Dans le sépulcre attend un sarcophage d’or,
Dedans une momie avec ses bandelettes
Et tout autour un grand appareil de squelettes.
Il faut trouver la clef d’un long, long corridor.
Ce long boyau conduit vers un lac sous la terre
Au fond duquel se trouve un abîme immergé
Où réside un vieux poulpe affreux qui, dérangé,
S’enfuira, qu’il faut suivre au volcan solitaire.
Dans le volcan l’on plonge en s’éclairant de rocs
Phosphorescents ; au fond, au milieu de la lave
Et des vapeurs de soufre, on pénètre une cave
Qui sert de garde-robe aux géants oiseaux rocs.
Quand vient un volatile, il faut pour le séduire
Lui jouer un morceau de balalaïka ;
Alors on peut sur lui voler vers la Volga
Où pour être empereur nous attend un empire.
C’est là que grâce à mille éléphants a poussé
Un bouquet merveilleux de sept roses topaze.
Les voici.
Quoi, Lidye ! est-ce vrai ? Votre vase,
Quelqu’un en mon absence est venu, l’a brisé ?
*
32
Roses parme
Ô Lidye, acceptez de moi ces roses parme,
Ce mélange de rose et bleu comme vos chairs,
Ces calices mousseux et comme vos yeux clairs
Qui veulent s’épancher baumes sur votre charme.
Qu’elles vont bien avec le blond vénitien
De votre chevelure opulente, onduleuse,
Qui dans une légende ossète fabuleuse
Servirait de tapis volant, qu’elles vont bien !
Si vous m’aimez un peu, vertueuse Lidye,
Laissez-moi vous jouer un air de bandoura,
Cet instrument magique : advienne que pourra,
Qu’éveilleront les doux sons de ma mélodie ?
Lidye, on m’a parlé du vin d’une chanson
Quand, la corde pincée, une voix en ruthène
Loin du périphérique aboli nous entraîne
Dans les vastes forêts où vit Michka l’ourson !
*
33
Roses rubis
Humons à deux l’odeur de ces roses rubis,
Lidye, et nous serons transportés aux Moluques
Où vous me danserez, au milieu des eunuques,
Des pas voluptueux avec des bonds subits.
Vous me faites pâmer dans la danse du ventre
Lorsque je vois le lait épais de votre peau
Comme la mer au vent, un flamboyant drapeau,
Ondoyer, maelström dont rayonne le centre :
Une gemme de feu cache votre nombril
Et pulse dans la houle immense des remous
Avec les battements de coquillages mous
Sous le voile hyalin, éthéré vent d’avril.
Et ce voile est stellé de tant de papillotes
Par milliers clignotant, aveuglantes clartés,
Que je pousse des cris langoureux, hébétés,
En roulant sur les poufs blonds comme des carottes.
Vous dansez et je roule, et vous vous trémoussez
Et je roule si bien que j’en perds mes babouches
Et bave en suppliant que s’unissent nos bouches,
Je défaille, les poils du nez tout hérissés.
J’effeuille les rubis d’une touffe qui musque
Mes doigts et les répands fiévreux à pleine main
Sur le tapis moelleux où les ongles carmin
De vos doigts de pied font de moi ce gros mollusque.
*
34
Roses nankin
Humons à deux l’odeur de ces roses nankin,
Lidye, et nous serons portés par une jonque
Le long du fleuve jaune, ou dans un palanquin…
Ô je vois ton oreille éclatante de conque.
Et dans le ciel j’entends les oiseaux migrateurs
Qui, traversant le monde, éventail grandiose,
S’encouragent l’un l’autre en fendant les hauteurs.
C’est nankin que pour nous se doit vêtir la rose. –
…On dit que tu n’as plus ton vase en kaolin,
Qu’un jour il s’est brisé, l’eau s’en est répandue ;
Si c’est vrai, si n’est plus ce saxe zinzolin,
Je veux sur ce bouquet te voir toute étendue :
Sur mes roses nankin tu seras sans habits,
Tu seras blanche, nue et belle… Et tu regardes,
Leurs épines piquant dans ta chair, les rubis
De ton sang dessiner sur tes flancs des lézardes.
*
35
Roses corail
Respirons le parfum de ces roses corail,
Lidye, ô leur éclat est celui de vos lèvres.
Mains jointes je vous vois figure de vitrail,
Figure qu’ont voulu ciseler des orfèvres.
Comme la perle au fond de la mer vous brillez,
Invitant le plongeur dans la longue froidure
Où les coraux emmi le sable éparpillés
Ceignent le palanquin de votre diaprure.
Quand l’irisation de lune le retient
Trop longtemps, il blêmit, perdant son oxygène,
Il succombe un sourire aux lèvres et devient
Une épave où chérit ses œufs bleus la murène.
Mais avançant la main sans attendre plus long,
Il s’enlève avec vous vers l’air et la lumière.
C’est comme, dans le gouffre indistinct et profond,
Dans l’abîme insondable, un vol de montgolfière.
*
36
Roses zinzolin
Ô Lidye, acceptez ces roses zinzolin
D’un cœur que tout afflige à présent, solitaire
Et malade, trop près, en son asile austère,
Encore de ce monde inepte à son déclin.
Ces roses ont poussé sur un mont, dans la neige,
Et si vous les touchez, vous sentirez le froid
D’une occulte splendeur qui toujours seule croît
Et dont éclôt en vain le triste sortilège.
Depuis longtemps je vis enveloppé de nuit,
Et si je rêve encore à votre beauté fauve,
Si je la vois danser au crépuscule mauve,
Je suis trop près d’un monde abject qui se détruit
Pour goûter de ce rêve inouï la tendresse,
M’abandonner en paix à son embrassement,
Mais aussi bien trop loin de tout ce remuement
Pour espérer ce dont la carence me blesse.
Tout doit finir un jour, elle revient au port,
L’âme dans son désert, sur la glace engourdie.
Comme je n’attends plus vos caresses, Lidye,
Oui, comme je n’attends plus rien, j’attends la mort !
*
37
Roses brou de noix
Ô Lidye, acceptez ces roses brou de noix.
Je ne fus pas toujours un sombre misanthrope :
Dans le temps je savais faire entendre ma voix,
Ma peau ne m’était pas si fragile enveloppe.
J’ignore quelle étoile a guidé mon chemin
Dans la plus hermétique et morne solitude,
Où malgré moi j’éprouve envers le genre humain
Un dégoût véhément, et tant de lassitude.
De mauvais choix fatals m’ont privé des moyens
D’être moi-même avec autrui, je porte un masque
Et ne sais même plus qui je suis, ni les biens
Que pouvait espérer ma nature fantasque.
Et quand je ne demande à ce monde bourreau
Que la paix, qu’un asile à ma peine muette,
Atrocement il rit et me montre un tombeau.
C’est là que finira cette errance inquiète.
Une course sans but au fond d’une prison,
Ô le sépulcre en est la seule délivrance !
Voilà tout ce qui s’offre à ma vaine raison :
Le terme de nos jours, terme de la souffrance.
*
38
Roses chartreuse
Aspirons le parfum de ces roses chartreuse,
Lidye, et que j’oublie ainsi le cauchemar
De vivre en ce bas monde, et que saoul de nectar
Je puisse imaginer vous rendre plus heureuse.
Était-ce d’un penseur, d’un héros, ou d’un roi ?
Je ne sais plus de quoi je crus avoir l’étoffe.
La vie est un désastre, est une catastrophe,
Et le pire de tout : vous vous moquez de moi.
Quelle vertu gravée avec vos tatouages
Sur votre peau de neige oppose sa froideur
À mon ultime espoir, infime, de bonheur,
Quand je n’espérais plus qu’en ces derniers mirages ?
Quand je vous avais crue encline à mon désir,
Le capiteux bouquet de ces roses chartreuse
Vous devait occulter ma main cadavéreuse,
Un sourire fané qui commence à moisir…
*
39
Roses sang de bœuf
Ô Lidye, acceptez ces roses sang de bœuf.
Quand je vous vis un jour assise – en Italie –
Sur un banc, je connus qu’à nouveau la folie
Me prenait, que c’était un grand amour tout neuf !
Longues jambes ! j’aurais été votre carpette
Si vous l’aviez voulu, votre tapis de chair,
Un tapis rouge sang parallèle à la mer
Sur un Lido de fleurs, un sable de Croisette.
Lunettes d’obsidienne et ceinturon en or,
Pour vous j’aurais été le Lido de Lidye !
Les palmiers d’un Plaza, sa piscine ébaudie,
L’arène où j’aurais mis mes bas de matador,
Mon habit de lumière, étincelles et flammes,
Avec la muleta, le cul jacaranda,
Le bonnet de Mickey : je hais la corrida
Mais ne sais bien comment sans cela plaire aux femmes.
Acceptez ce bouquet de triomphe galant,
De roses couleur sang fumant de Minotaure
Au Labyrinthe occis, des roses en pléthore
Vous disant mon amour sauvage, violent.
.
(iii)
.
40
Roses lophophore
Adieu, Lidye ! Assez de cette comédie.
Vous n’avez eu pour moi qu’un faible sentiment
Mâtiné d’intérêt, fourbe cupidement,
Et je ne veux plus rien de vous. Adieu, Lidye !
Adieu… Mais si c’était de ma part une erreur ?
Si j’interprétais mal quelque coïncidence
Qui ne devait avoir aucune conséquence ?
Si vraiment j’occupais vos pensers, votre cœur ?
Non, comment ne pas voir dans vos façons étranges
Et dans cette froideur, vos refus répétés
Le témoignage sûr de vos duplicités ?
Elles ont présidé toujours à nos échanges !
Mais si je m’abusais… Mais non… Lidye, adieu !
Mais si… Je plongerais les mains dans cette amphore
Pour combler vos appas de roses lophophore
Qui près des yeux feraient un si beau camaïeu !
*
41
Roses céladon
Adieu, Lidye ! Assez de tous ces faux-semblants,
Depuis bien trop longtemps je vis d’une caresse
Qui ne procédait point d’un vrai fond de tendresse
Mais du fard qu’employaient vos comptes vigilants.
Ô troublé d’un espoir que vous saviez futile,
Je vous fis de grand cœur mille affabilités,
Chaque jour prévenant vos moindres volontés.
Si tout vous était bon, tout me fut inutile.
Du jour où je cessai, par quelque événement,
De vous servir ainsi de commode accessoire,
Vous me fîtes sortir et de votre mémoire
Et de l’humanité, cruelle, indignement.
Las ! tous ces jours bercés de fantasques chimères,
Où je me figurais de vous un autre don,
Sont un vase garni de roses céladon
Au parfum dissipé, sont des feuilles amères !
*
42
Rose aurore
Adieu, Lidye, assez : mes suppliques sont vaines.
Sitôt que je n’eus plus pour vous d’utilité,
Vous payâtes d’abus mon assiduité
Et me poussez à rompre, enlacé dans vos chaînes.
Continuer serait augmenter mon tourment.
Quand on a comme vous de la délicatesse,
Montrer irréfléchie un peu de gentillesse,
C’était faire espérer ce que le cœur dément.
Si vous croyez, aussi, que vous fûtes sans faute,
Pour la civilité qu’affichaient nos rapports,
Et n’êtes responsable en rien de mes transports,
Il faut que de l’esprit cette erreur l’on vous ôte.
Car vous savez fort bien qu’à cause des appas
Qui sont vôtres, « merci » veut dire « mais encore ? »,
Que j’attendais de vous, comme une rose aurore,
Ce qu’il vous égayait de ne me donner pas.
*
43
Roses magenta
Adieu, Lidye ! Adieu, pour la dernière fois.
Votre masque est tombé, je vois la perfidie
Dont vous m’avez voulu circonvenir, Lidye.
Je vais me libérer de vos fers, de vos lois.
Adieu, m’entendez-vous ? La tempête vous montre
À quel point mon honneur fut par vous bafoué,
Sans respect, sans égards mon feu désavoué,
Et combien mon courroux s’enflamme en ce rencontre.
Pour la dernière fois, m’entendez-vous, je dis
Que vous n’entendrez plus jamais les témoignages
De mes préventions pour vos appas volages :
Plutôt la nuit sans vous que ce faux paradis !
Ah craignez les remords d’une âme pénitente
Quand vous vous souviendrez des roses magenta
Que ma main dans le parc aux faunes collecta :
Que vous serez de vous, Madame, mécontente !
*
44
Roses champagne
Adieu, Madame ! Assez, assez de rebuffades,
D’humiliations gratuites, de rebuts,
D’affronts, de camouflets et d’onéreux tributs
À des appas de marbre, à des glaçons maussades.
Assez de rabrouements à mon urbanité.
Puisque vous n’êtes point sensible à mon prestige,
Au monde je vous laisse emporter le vestige
De l’intérêt pour vous de ma capacité.
Je censure les jeux de la coquetterie
Qui s’oppose aux faveurs qu’il en devrait venir
Et ne sert d’aiguillon que pour gêner d’agir ;
Ce sont bien moins des jeux que fourbe et que rouerie.
Fi donc, Madame ! à moi, ce cruel traitement ?
Avec tout le respect, c’est battre la campagne,
Quand vous avez reçu de ces roses champagne
Par un homme du monde, épris si galamment.
*
45
Roses nacarat
Adieu, Madame ! ici prennent fin mes tourments,
Vous me donnez congé, je reprends ma franchise,
Et cette liberté n’en est pas moins exquise
Si je couvris mes fers de baisers véhéments.
Sans doute, les beaux jours de notre badinage
Paraissent aujourd’hui bien loin : depuis longtemps
Je ne reçois de vous que rebuts insultants,
La moindre privauté vous cause de l’outrage.
L’occasion toujours est bonne désormais
Pour me morigéner de la belle manière.
Je ne sais quelle mouche obstinément altière
De la sorte vous pique ; aussi n’en puis-je mais.
De façon à contrer ce diptère incommode
J’eusse aimé de sentir que mon lustre opérât.
Mais vous n’agréez point mes roses nacarat,
Vous piquant beaucoup d’être une belle à la mode.
*
46
« Je ne puis partager, Monsieur, vos sentiments. »
Eh quoi ! si vous pensez régimenter la chose,
À quoi bon discourir de mes seuls mouvements ?
Dites qu’à tout l’Amour votre décret s’oppose.
« Nous ne pouvons avoir d’autre relation,
Point d’autre absolument. » À l’absolu, je gage,
Jamais nul n’est tenu, mais mon intention
N’est guère de sortir des mœurs et de l’usage.
« Quand il vaut ce qu’il vaut, épargnez votre temps. »
Certes je vous sais gré de la sollicitude ;
L’homme de qualité, de précieux instants
Est prodigue : ôtez-vous de cette inquiétude.
Madame, tout ceci ne sont que des raisons,
Et mon amour n’a point pour ce fiduciaire
De traité permettant encaisse et livraisons.
Parlons du principal et non du secondaire.
.
3/
POÈMES POUR HÉCATE
.
(i)
.
47
Nous sommes-nous si mal aimés ?
Ce triste amour de la jeunesse
Mord dans les rêves affamés
De mon avide sécheresse.
Si tout pouvait recommencer,
Je ne te ferais plus de peine ;
En gouaillant te renoncer,
C’était manie âpre, malsaine.
Si tu m’as bien aimé, j’ai mal,
Ô si mal de t’avoir meurtrie !
Que soit détruit cet anormal
Orgueil de ma sombre folie.
Quand tu m’as oublié, te voir
En l’impossible plénitude
D’un grand amour ! Mon désespoir
Te nomme dans la solitude.
Oublié mon mépris, tu vas
Dans la vie avec assurance ?
Je veux retourner dans tes bras,
Immobile dans la souffrance.
Cet amour frivole, imparfait,
C’est ma jeunesse et mon désastre.
Je t’implore, car tu m’as fait
Tragiquement te voir en astre…
Je fus celui qui part. Amer,
Chaque jour de mon existence,
Quand je pense à nous, est l’enfer
D’avoir méconnu ta puissance.
Ma jeunesse fut un gâchis,
Mon âge mûr une brimade.
De ton sein je ne m’affranchis
Jamais ! et tout me rend malade.
.
(ii)
.
48
Hécate
La tendresse reçut en toi son châtiment
Par le mépris d’un fou, devenu lycanthrope
Et qui hurle à la lune, aloubi, son tourment
Et sa rage, jusqu’à la stase et la syncope.
Te mépriser, ce fut un suicide brutal,
Un reniement pervers du destin, dans la chute,
Un empoisonnement du miracle total,
Ce fut un désaveu du rêve par la brute.
Par cette déchirure a coulé tout mon sang.
J’avançais sans le voir épandu sur la route,
Et plus je m’éloignais plus je devenais blanc,
Plus je m’éloigne encore et plus marcher me coûte.
Vaincu, je suis au bout de mon triste chemin.
Tout le mal que j’ai fait, gagnant la solitude,
En elle m’assassine : un jour sans lendemain
Pour moi se lève au bord du gouffre où je m’élude.
S’il faut que ma pensée, au moment de mourir,
Vers une forme humaine investisse l’espace,
Qu’elle te voie, Hécate, et clame mon désir
De revivre avec toi le temps que rien n’efface.
*
49
Hécate II
Hécate, as-tu connu l’amour qu’en moi peut-être
Tu croyais dans le temps avoir déjà trouvé ?
Si je pouvais mourir de façon à renaître,
Je voudrais te reprendre, en époux relevé :
Relevé par ta main de ma peine sans âge
Quand à tes pieds aimés je demande pardon,
Je n’irais plus chercher en vagabond volage
Au hasard des chemins le bonheur de ce don.
Je sais que tu ne vis rien d’autre que tes larmes
Mais, parti, je laissai ma vie entre tes mains.
Volage, j’avais tout car comblé de tes charmes.
En partant je laissai chez toi mes lendemains.
Je t’aimais, le sais-tu ? malgré mes railleries !
Mais tu le sais, Hécate, et tu me pardonnais
Dans ton cœur bon l’absinthe et les mesquineries.
Ton cœur si bon, si tendre et doux, je le connais…
Puisse un ange clément te dire que ma plume
Atteste le respect de notre souvenir.
Ton cœur bon a connu par le mien l’amertume
Sans raison… je t’aimais, et veux te revenir…
Ô si je le pouvais, si je savais la route
Pour à tes pieds enfin sans fard m’humilier,
Je le ferais, Hécate, et te donnerais toute
Mon âme qui ne peut ni ne veut t’oublier !
*
50
Hécate III
Quand j’étais si content, je partis sans raison…
Hécate, tes baisers avaient un goût de rose
Et j’en étais comblé… Quelle bien douce chose
Que d’être dans tes bras à la belle saison.
Sans raison je partis, sourd à tes pleurs d’amante.
Qu’allais-je donc chercher que tu ne donnais pas ?
Je l’ignore ! et l’asphalte ébranlé par mon pas
Se tait : qu’allais-je donc chercher dans la tourmente ?
Où me suis-je perdu, solitaire et glacé ?
Hécate, bonne amie à mon cœur toujours chère,
Montre-moi dans ces bois assombris la lumière,
Ne me laisse pas seul, par le froid terrassé !
J’ai peur, je suis perdu, comme un enfant qui pleure
Je ne sais où trouver du secours dans la nuit :
Montre-moi le chemin sablonneux qui conduit
Vers ta maison où flambe un bon âtre à cette heure !
Je ne sais où je vais, je vais choir dans un trou,
Dans des sables mouvants : que ta bonté me sauve !
À mes cheveux se prend un vol de souris-chauve,
Mon cœur bat la chamade et je cours comme un fou !
Hécate ! j’avais tout avec toi, je t’implore,
Rends-nous notre jeunesse avec un long baiser.
Je ne peux plus courir, je vais agoniser…
Tout ce que j’ai, prends-le, prends puisque je t’adore !
*
51
Hécate IV
Hécate, au bord du fleuve aux ondes scintillantes,
Dans le soir d’une ville onirique d’or blond,
Nous parlions poésie, en notre âge profond,
Et je t’improvisais des rimes bégayantes.
Mais surtout nous étions l’un contre l’autre, émus.
Mon cœur, si j’avais su ce que serait ma route,
Tu m’aurais vu pleurer, sans laisser une goutte,
Toute l’eau de mon corps et des viscères mus.
Si j’avais su qu’un jour ces moments de tendresse
Seraient dans ma pensée un paradis perdu,
Tandis que, les goûtant, j’y croyais voir mon dû,
Je me serais jeté dans les flots, de détresse.
Trop naïf et léger pour saisir que nos pas
Après nous fermeraient l’huis des châteaux magiques
Et que je m’avançais vers les déserts tragiques
Où l’amour, appelé, ne se retourne pas.
*
52
Hécate V
Hécate, mon amie adorable, ma mie,
Ma seule amie, écoute, écoute ma chanson.
Si tu ne réponds pas bientôt à mon frisson,
Je n’ai plus qu’à subir une lobotomie.
Si je m’en suis allé, c’est sans savoir pourquoi !
Sans savoir que le monde immense est une eau glauque,
Un marécage où rote un borborygme rauque,
Quand ta chambrette avait tout ce qu’il faut pour moi.
Ta chambre où l’on pouvait juste mettre une chaise.
(Sans doute devais-tu pâtir de tes voisins,
Le monde étant ce trou grouillant de rats malsains,
Mais je n’en ai rien su, tant j’étais à mon aise.)
Mais je m’en suis allé, confessant en ce jour,
Quelques lustres plus tard, effondré, que j’expie
Depuis lors cet abus abominable, impie.
Écoute, si tu peux, cette chanson d’amour.
La chanson que j’ai mis si longtemps à comprendre…
Si nous ne pouvons plus retrouver la candeur
De notre âge profond, sa délectable odeur,
Laisse-moi dans l’abîme éthéréen descendre.
Je ne chercherai plus ce que j’avais en toi.
Si la vie au-delà de tout retour possible
T’a corrompue, Hécate, étoile marcescible,
Reviens me délier de la commune loi :
Dans le sang de mon cœur je tremperai ma plume
Non pour chanter une ode à mon dernier moment
Mais pour devant tes yeux signer mon testament.
Je t’aimais mais le monde est un trou plein d’écume.
*
53
Hécate VI
Discussions sans fin et baisers et volutes,
Le monde autour de nous n’existait même plus.
Et baisers mais sans fin, cymbales, sistres, flûtes,
Et volutes ; le reste, additifs superflus.
Hécate, ô je pâlis en songeant à ma perte !
Je me méprise tant d’avoir abandonné
Le lilas de ta chambre à la fenêtre ouverte
Sur un monde onirique et pour toi seule né.
Sans savoir que j’allais rouler dans un abîme,
Je quittai la chambrette où Cythère éclatait,
Pour un désert sans nom ta lèvre magnanime,
Une forêt magique où l’oiseau bleu chantait.
Où vis-tu ? Que fais-tu ? Puis-je espérer encore
Te revoir ou faut-il que, sans direction,
J’avance sans trouver où se lève l’aurore ?
Et si tu n’en veux pas… quoi de ce million ?
*
54
Hécate VII
Si tu peux pardonner, Hécate, à ton ami,
Ne lui refuse pas cette miséricorde.
Si cet amour en toi fait vibrer une corde
Encore, ne dis pas ton cœur bon endormi.
Puis-je sans vanité croire à ta souvenance ?
Je veux me prosterner devant tous à tes pieds
Et baiser leur poussière, à mes jours inquiets
Donner rémission : que ce soit ta vengeance.
Le désert sillonné depuis ton oasis
Me laisse dans les yeux un larmoiement lugubre
Et dans la solitude égaré j’élucubre,
Mais j’ai gardé pour toi des tourmentes un lys.
Que l’eau de ta tendresse irrigue son calice,
Si tu peux pardonner à qui revient des morts.
Mais si tu n’en veux pas ou si j’ai trop de torts,
Conculque ce débris d’amour en ta justice !
*
55
Hécate VIII
Depuis que je comprends tout ce que j’ai perdu,
Je ne suis qu’un fantôme affamé de ta bouche.
Je n’ai plus d’existence et plus rien ne me touche,
Des baisers dont j’ai faim et soif au sang mordu.
Puisque mon âme, Hécate, errant à ta recherche,
Ne connaît plus mon corps dépouillé de ton feu,
Conculque ma dépouille inepte, c’est mon vœu :
Sur ton épaule, noir, que mon pneuma se perche.
Ou que, si ton caprice a besoin d’un golem,
Je serve en ta maison, hagard, muet, aveugle,
Brute qui sous l’effet d’un frisson parfois meugle,
Quand sa chair réentend son lointain requiem.
Que je fonde et ruisselle à côté de ton âtre,
Forme qui fut humaine et perdit son esprit,
Ou qu’avec les objets que la nuit assombrit
Je joue un vague rôle en ton secret théâtre.
Mais si le talisman est brisé, n’attends pas
Que la lune rappelle à sa pallide ouate
Le loup que doit occire une balle adéquate :
Tire quand se feront reconnaître mes pas.
Depuis que j’ai compris l’inouï de ma perte,
Je ne vois plus les fleurs qu’avec un long frisson.
Les choses et les gens me crient à l’unisson
D’aller au diable avec cette blessure ouverte.
Mon bonheur demandait près de moi ta beauté.
Je ne sais quel venin m’a corrompu la moelle
Pour avoir fait pâlir dans le ciel une étoile
Qui prodiguait sa blanche et féerique clarté.
Quel désert fatidique et nuit de l’amertume
Que ce néant rempli d’un brûlant souvenir !
Si j’avais le chemin, je voudrais revenir
À ton si tendre amour, par-delà tant d’écume…
*
56
Hécate IX
Le dégoût de la vie après t’avoir aimée
Sans savoir à quel point et perdue en riant,
Hécate, est si profond que ma main désarmée
N’ose pas se lever sur l’attentat criant.
Je hais le monde entier pour une cicatrice
Sur ton cœur dont je suis responsable ; je hais
Le monde pour ma lâche et frivole avarice ;
Je hais tous les regards, imbéciles et laids.
Je ne veux plus marcher que dans les nuits désertes
Où geignent, souvent crient à faire peur des chats :
Le jour, dans l’avenue aux fenêtres ouvertes,
Je sais que chacun veut me couvrir de crachats.
*
57
Hécate X
Hécate, qui pourrait dire la nostalgie
Que j’ai des arcs-en-ciel de ta blanche magie ?
Et l’amertume en moi depuis, longtemps après,
D’un gâchis trop futile et triste, et les regrets ?
Quand je me reposais sur toi de ma faiblesse
Et prenais de la force en voyant ta tendresse,
Quand j’épanchais mon cœur en mots tendres ou fous,
Car l’avenir était un mystère pour nous
Et nous ne savions pas ce que serait la vie,
La colline des jours pas encore gravie,
Je voyais alors mal à quel point ton cœur bon,
Présent du ciel, était ma bénédiction.
Quel perfide serpent voulut cette infamie :
Me jeter loin de toi, loin de ma seule amie ?
Ai-je en moi ce principe infernal de tourment ?
Cherchai-je à me tuer en niant mon serment ?
Quoi m’a jeté transi dans cette solitude,
Quand j’avais devant moi l’huis de ta plénitude ?
Et ce silence noir qui dévore mes cris,
Ta voix en fera-t-elle un jour mille débris ?
Le printemps n’a pas eu de mes mains sa couronne,
Donne-moi d’encenser de myrrhe cet automne…
Si tu peux pardonner une âme au désespoir,
Veuille que mon adieu ne fût qu’un au revoir…
Hécate, du bonheur je n’ai nulle autre idée
Que celle qu’à ton cœur aimant j’ai demandée.
Je ne sais pas ce qu’est sans ta main le bonheur,
Je n’ai d’autre raison que t’aimer dans mon cœur.
*
58
Hécate XI
Dans le nectar des dieux avoir versé l’absinthe
Pour ces lèvres de rose exquises, de corail,
C’était l’œuvre d’un fou, d’une raison atteinte :
Je suis cet égaré, ce vil épouvantail.
D’autres souffrent la nuit de cauchemars horribles,
Quand ils dorment, mais moi c’est en me revoyant
Dévaster, sans égard pour ses bontés sensibles,
Notre amour que je tremble et fuis l’alp effrayant.
C’est la réalité qui me fige, me glace,
Qui me fait supplier la nuit par où sortir
D’un monde où je ne peux trouver la moindre place,
Banni pour ce méfait malgré mon repentir.
Hécate était la coupe oblongue, améthystine
Où le divin nectar d’opale étincelait,
La nymphée hiératique et chryséléphantine
Où la source des eaux lustrales ruisselait.
Et moi, dans ces clartés de cascades célestes,
Tel un empoisonneur funeste au sang rongé,
Je mélangeais les noirs ferments de traîtres pestes,
Remuais des venins de serpent enragé.
Que cherchais-je instillant ces basses alchimies ?
Quel doute affreux blessait mon âme de son fouet ?
Étais-je conculqué par d’immondes lamies ?
De quel démon pervers étais-je le jouet ?
Hécate aurait pu m’être un bouclier d’étoiles
Et nous serions montés sur l’Olympe, immortels.
Au lieu de quoi, la glu d’aranéennes toiles
Me livre aux crocs souillés et pestilentiels.
Et je ne sais comment me déboîter la tête
Pour mettre fin au sombre et sanglant châtiment,
Ah ! que la ténébreuse estrapade s’arrête.
Je suis maudit… Hécate, abrège mon tourment !
*
59
Hécate XII
Hécate, pour deux mots cruels je te pardonne.
Et pour m’avoir compris à moitié mais trop bien
– L’autre moitié pourtant était la seule bonne.
Je te pardonne tout : est-ce que ce n’est rien ?
Je te pardonne ainsi ta famille modeste
Qui me posait un cas de conscience aigu,
Car si l’amour est tout, qui peut goûter le reste
Et s’en prive, son sort est, dit-on, ambigu.
Je te pardonne aussi de t’être consolée
Sans attendre un peu plus d’autres abaissements,
Qui m’auraient fait savoir que ton âme accablée
Serait toujours à moi, même dans les tourments.
Je te pardonne enfin d’avoir cru mes manèges,
Car j’étais moins méchant que fou, mais à lier.
Je te pardonne tout car tes roses, tes neiges,
Tes satins, tes velours me font tout oublier.
*
60
Hécate XIII
Hécate, le bilan d’une vie après toi :
Néant, désert, l’abîme aux profondeurs glacées,
Lamentable plongeon sans comment ni pourquoi,
Dérive lotophage, amertumes brassées.
Car je laissai plié sur la table de nuit
De ta chambrette un nerf vital tiré du coude
Dans lequel je posai, me retournant sans bruit,
Le fil bleu qui, rompu, jamais ne se ressoude.
Et surtout mon dernier coup d’œil fut, par hasard,
Pour le verre de sang à moitié plein ou vide
– Je ne sais toujours pas – qui noya mon regard,
Posé comme une horloge au bord du gouffre acide.
Et puis mon dernier mot, en main le combiné
Du téléphone et toi quelque part endormie
Dans l’ailleurs, d’une voix de menteur étonné
Ce fut pour dire « Allô » dans la glace ennemie.
Et si je me souviens, si je me souviens bien,
Je t’écrivis pourquoi je devais sans attendre
Prendre un bus vers la fin du monde, dans le rien.
J’écrivis tout cela sur le mur jaune tendre.
C’est pourquoi j’oubliai, comme en un cauchemar,
Mes chaussures, sorti sans voir que mes chaussettes
Étaient trop jade, en plus, pour monter dans un car,
Et je ne trouvais pas non plus mes cigarettes.
Pas plus que je ne vis la moindre station.
Alors je retournai chez moi ; depuis ce triste
Et fatal terminus, je fis soumission
Au marais désolé dont je suis un lampiste.
*
61
Hécate XIV
Hécate, dans la nuit que la lune irisait
Par son ruissellement de glace étincelante,
Un sylphe sur les lys que d’or il arrosait
Voletait près de nous en notre marche lente.
Je te montrais là-bas un immense escalier
Au bout du fleuve, après un ultime méandre.
Cet escalier aux cieux d’astres, pour oublier
Les maux, montait vers où l’on ne peut plus descendre.
Tu frissonnas, pourtant ce fut notre bonheur
Que dans le ciel brillant et noir nous regardâmes,
Les portes d’un château plus haut que la grandeur
Où nous serions entrés pour y sceller nos âmes.
Je vis dans ton œil bleu des reflets d’eaux du Styx
Quand tu me le plongeas au miroir de ta grâce,
Et mon âme battit des ailes de phénix
Tombé dans la prison de nos cœurs, mer de glace.
Je comprenais hélas que ton amour vivant
Dans le tourment suivait, résigné, comme une ombre
Mes pas éthéréens, sans sourire, et le vent
Dans les feuilles du saule, et des peines sans nombre.
Amour, t’ai-je jamais, blême chauve-souris,
Fait sourire ? ai-je vu sourire ton visage ?
Un voile est sur mes yeux, épais, mais tu souris
Comme moi sous la peau, mutique cartilage !
*
62
Hécate XV
Je ne me souviens pas de ton sourire, Hécate !
Comme si j’en avais perdu le droit depuis
Qu’en passant mon chemin je tombai dans le puits
Que m’est la vie, obscure et vide et scélérate.
Ou comme si jamais tu ne m’avais souri
Car je fus ton supplice et non ton sigisbée :
Un serpent hypnotique à la voix enrobée
Avec qui tu marchais sur un humus pourri,
Et dont tu te vengeas en prenant cet air grave
Que déposait l’affront indigne sur tes traits,
Ne comprenant pourquoi tes multiples attraits
S’attiraient l’avanie et non respect suave.
Si je veux méditer sur cela maintenant,
Je vois bien que, frivole, inepte, sans largesse,
J’étais séduit ailleurs, par la vaine richesse,
Qui dans le bran roula mon habit de manant.
Pourrais-je jamais dire à ta douceur blessée
Que je te traitai mieux que l’on ne me traita ?
Mais si quelqu’un jamais pour mon âme compta,
C’est toi, ma sœur, ma chère amoureuse offensée.
*
63
Hécate XVI
Hécate, savais-tu que je serais émir,
Oui, l’émir Abdoullah, le justicier suprême ?
Que vaut-il mieux, ce mot suave « Je vous aime »,
L’entendre d’un mogol ou d’un maigre fakir ?
Un fou t’a délaissée, un prince te rappelle !
Laisse parler ton cœur dont je sais qu’il est bon !
Allah t’a tout donné pour m’en faire le don !
Allah n’a pas voulu pour rien que tu sois belle !
Allah créa le ciel, la terre et ta beauté !
Donne-moi le bonheur de baiser la poussière
De tes pieds en émir tout-puissant, ô par terre
Devant toi : me voici, pour cette volupté !
Volupté de payer ton bonheur de ce monde,
Que je tiens dans la main comme un diamant brut,
Pour ton bonheur privé dont ce monde est le but,
Et que je fais tailler en piété profonde.
As-tu pleuré ? C’est bon, le sel blanc d’un cœur pur !
Tu boiras désormais des jus ambrosiaques,
Des nectars enivrants, sucs paradisiaques
Qui sont halal car c’est mon amour sous l’azur.
Je te jure à genoux que tombera ma tête
Sous l’alfange céleste aussitôt si me prend
La folie à nouveau de fuir : Allah est grand !
Allah est grand ! Allah est grand ! Es-tu donc prête ?