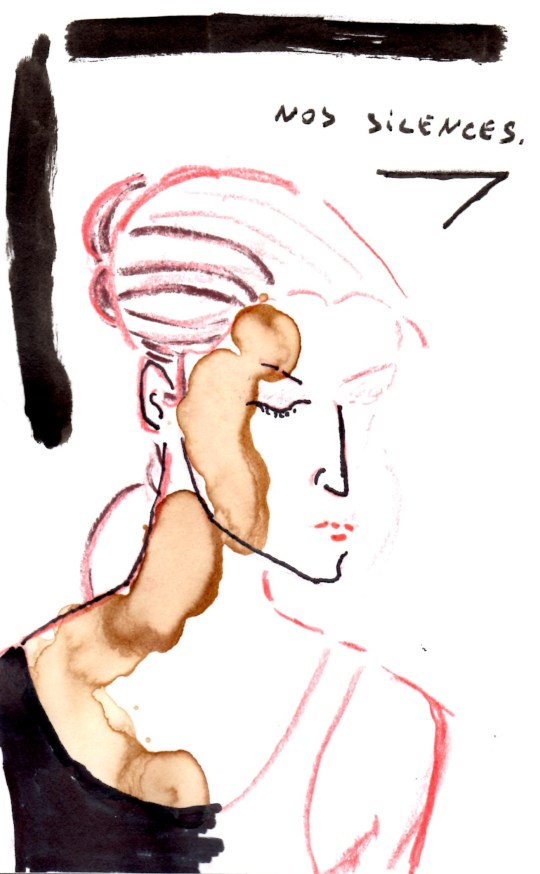Category: poésie
La halte des bohémiens : Poésie de Francisco Villaespesa VI
Nouvelles traductions d’œuvres du poète Francisco Villaespesa, avec des textes tirés à présent de trois recueils : La halte des bohémiens (1900), Le belvédère de Lindaraxa (1908), dont le titre est fourni par un toponyme de l’Alhambra de Grenade, et Andalousie (1910).
Pour la précédente entrée de cette série de traductions, voyez « Tambourins sévillans » ici.
*
La halte des bohémiens
(El alto de los bohemios, 1900)
.
Prélude intérieur (Preludio interior)
Je vivais dans un éden de chimériques amours
quand, par son langage éloquent et tentateur,
enroulé sur l’arbre, le serpent m’incita
à mordre dans la pomme de la connaissance.
Je fus esclave de la terre. Son harmonie légère
offrit une source impure à mes chants lascifs,
et dans les sillons stériles je gaspillai les semences
de ce qui fleurissait en moi.
Je fuirai seul au désert. Je vivrai dans ma caverne,
aux pieds de mon âme, l’éternelle tourmentée ;
tandis qu’elle, docile, oubliera ma noire histoire,
en un livre j’enfermerai les souvenirs dispersés,
et plutôt que d’accorder ma vie au rythme de mes vers,
j’ajusterai mes vers au rythme de ma vie.
*
La halte des bohémiens (El alto de los bohemios)
La lampe répand son éclat ténu ;
agile et nerveuse, ta main pâle
éveille sur les touches du vieux piano
une chanson de lointaines amours.
Un hymne d’hirondelles salue l’aurore,
et les préludes s’élèvent de la sérénade ;
des feuilles mortes s’envolent, une fontaine verse,
monotone et vacillante, des larmes d’argent.
Les clochettes tintinnabulent, les lévriers aboient ;
à la fête joyeuse convie la cloche ;
parmi grelots et tambours de basque
s’approchent les musiques d’une caravane…
Bohémiens farouches, rois en haillons
qui traversez du monde les vastes confins,
toujours pensifs et tristes, les yeux cernés,
sanglotant des amours sur vos vieux violons…
Arrêtez-vous un instant sous ma fenêtre
et par vos chants apaisez mon amertume,
car je veux te montrer ma main, ô gitane,
pour que tu me dises la bonne aventure !
Adieu pour toujours, visages émaciés,
barbes hirsutes, yeux assassins !…
Votre dernier chant, le vent l’emporte
avec les feuilles mortes sur les chemins !
Pâle bohémienne, errante devineresse,
qui en ce jour gémis des amours sous ma fenêtre…
Dis-moi, écho léger, fugace tourterelle :
sous quels balcons gémiras-tu demain ?…
Où vas-tu, inquiète et habile joueuse
d’une harpe qui vibre dolente derrière ma grille ?…
Quelque chose en mon âme soupire et pleure
et s’éloigne avec l’écho de ta voix !
Cheveux d’or, visage vacillant,
lèvres maladives, grands yeux clairs
que mon espoir un instant contempla,
le long de quels chemins vous verrai-je à nouveau ?…
La musique errante s’en va lentement
comme la rumeur d’une sérénade,
et l’on n’entend plus que la voix de la fontaine
mourant en un fil de scintillant argent.
*
L’ombre des mains (La sombra de las manos)
Ô maladives mains ducales,
odorantes mains blanches…
Quelle peine me donne vous regarder,
immobiles et croisées,
entre les jasmins fanés
couvrant le noir cercueil !
Main de marbre antique,
main de rêve et nostalgie,
faite de rayons de lune
et de pâleurs de nacre !
Reviens soupirer d’amour
sur le clavier oublié !
Ô charitable main mystique !
Tu fus un baume sur les plaies
des lépreux ; tu peignis
les cheveux emmêlés
des pâles poètes ;
tu caressas la barbe
fleurie des apôtres
et des vieux patriarches ;
et dans les fêtes de la chair,
comme un lys, diaphane,
tu fus entre les bras par un baiser
exténuée de plaisir…
Ô mains repenties !…
Ô mains tourmentées !…
En vous ont flambé
les charbons de la Grâce.
Sur vos doigts de neige
l’émeraude rêva d’amour,
les diamants fulgurèrent
comme des larmes étincelantes
et les rubis entrouvrirent
leurs pupilles écarlates.
Près de la couche nuptiale, fleurie,
dans une nuit d’épithalame,
en tremblant vous dénouâtes
les sandales d’une vierge.
Vous allumâtes dans le temple
les encensoirs d’argent ;
et au pied de l’autel, immobiles,
vous vous élevâtes, croisées,
comme une poignée de lys
adressant une prière.
Ô main exsangue, endormie
parmi les fleurs funèbres !…
Les splendides robes de soie,
attendant ta venue,
vieillissent parmi les ombres
de l’alcôve solitaire…
Au rouet d’argent où
tu filais des songes dorés,
à présent, mélancoliques, tissent
leurs tristesses les araignées.
Ouvert, le piano t’attend ;
et ses touches poussiéreuses
gardent encore la marque blême
de tes doigts pâles.
Dans le jardin, les colombes
sont tristes et silencieuses
et gardent la tête cachée
sous leurs ailes blanches…
Sur le tombeau le poète
incline son front pâli ;
et ses pupilles vitreuses
restent ouvertes au fond du cercueil,
espérant ta venue…
Blanches ombres, blanches ombres
de ces mains si blanches
qui sur les chemins fleuris
de ma jeunesse luxuriante
effeuillèrent l’impollue
marguerite de mon âme !…
Pourquoi pressez-vous dans la nuit
ma gorge ainsi qu’un garrot ?
Blanches mains !… Lys
par mes mains effeuillés…
Pourquoi vos ongles fins
s’enfoncent-ils dans mon cœur ?
Ô maladives mains ducales,
odorantes mains blanches !…
Quelle peine me donne vous regarder,
immobiles et croisées,
entre les jasmins fanés
couvrant le noir cercueil !
*
Le jardin des baisers (El jardín de los besos)
Nous ne marchons plus dans le jardin sombre
le long de l’étroite allée solitaire…
Le cruel vampire de l’automne s’abreuve
du sang des roses effeuillées ;
au fond du parc, cascadant
comme une caresse d’ailes subtiles,
l’écho mourant de tes baisers
chante nos impossibles amours.
Et si dolente est la chanson, que l’air
tremble, craintif, entre les branches fanées ;
les chouettes, ces yeux de la nuit,
cachent leur tête sous leur aile,
et la lune, jaune et tremblante,
glisse dans l’azur comme une larme.
Ô tes joyeux baisers !… Ils ont ri
dans la solitaire alcôve nuptiale,
sous les augustes voûtes du temple
et sur les sanglants champs de bataille.
Ô tes charitables baisers !… Ils se sont posés
sur le sein de tous les malheurs,
sur les lèvres de toutes les blessures
et sur le front de toutes les nostalgies.
Ô la divine musique harmonieuse
de tes baisers !… Elle roucoule entre les branches
des citronniers en fleur ; dans la fontaine elle jette
son panache de fraîches euphories ;
comme un essaim de rires elle bat des ailes
sur le rosier égayant ta fenêtre ;
elle dort dans l’archet du violon ; elle soupire
dans l’errante et nocturne sérénade,
et sur les blancs rideaux de mon lit
elle glisse, paresseuse et lente,
comme une rumeur de dentelles qui s’éloigne
et se dissipe sur les tapis du salon…
La lune meurt dans l’azur… La brise
s’endort trémulante parmi les branches ;
seuls troublent le silence funèbre
de l’obscure avenue solitaire
les tremblements de la mousse, où palpite
le cœur mystérieux de l’eau.
*
Tarentelle (Tarantela)
Aux timides caresses
d’une main fine et pâle,
d’une main moribonde, paraissant celle du Christ
détachée de la croix,
sur les touches de l’harmonium se sont réveillées, sanglotantes,
les cadences oubliées de la vieille tarentelle.
Alors, au rythme de l’ancienne mélodie,
de leurs lugubres toiles sont descendues les araignées,
et dans les hauts clochers, au crépuscule ont psalmodié
de leurs bronzes sépulcraux les cloches fatidiques.
Les araignées sont amies des ruines. La fatigue
se reflète dans le regard de leurs yeux languides ;
et de leur pas indolent, tristement elles reproduisent
la marche de l’errante caravane
qui rêvant aux fraîches citernes
traverse lente et fatiguée les étendues solitaires.
Ô poètes, tisserands silencieux,
mélancoliques araignées,
que dans les filets de vos vers se mêlent prisonniers
tous les rêves traversant l’azur de vos âmes !
Chantez le mobile, l’errant,
ce qui passe fugacement !…
Les joues qui rougirent
quand se croisèrent les regards,
les yeux qu’en passant nous vîmes
briller derrière une fenêtre !…
Vibrations fugitives, mélodies passagères
de chants et de baisers, de musiques lointaines,
qui au détour d’un chemin se perdirent à jamais
parmi l’écho des fontaines et le murmure des branches…
Où sont allées vos notes ? Sous quel balcon fleuri
entonnez-vous à présent, bohémiens, votre vagabonde sérénade ?
Triste chanson qui par une nuit
de lune, gémissant placidement,
retint mon pas erratique
devant une grille entrouverte…
Reviens troubler le repos
des rues solitaires !
Rouges violons des tziganes,
qui évoquiez mes nostalgies
en ce soir joyeux
de souvenirs et d’espérances…
Revenez gémir des amours
sous ma fenêtre !
Ô voix miséricordieuse, voix clignotante,
voix de cristal et de larmes !…
Pourquoi tes rires n’égayent-ils point
le silence de mon âme ?
La blanche main du Christ disparaît dans l’ombre ;
l’harmonium gémit et se tait ;
et parmi l’or du crépuscule une pâle bohémienne
en chantant et dansant passe sous mon balcon
et se perd, en même temps que le sanglot lyrique des violons,
le long du chemin que parfument les acacias !
Il y a dans l’air une sonore efflorescence de colombes ;
et, au battement argentin des cloches,
sur les blancs rideaux de mon lit solitaire
– doux nid que défit la fureur de la bourrasque –
dans leurs filets d’or tissent, tremblantes, les araignées
un poème de caresses et d’éphémères amours.
*
Le belvédère de Lindaraxa
(El mirador de Lindaraxa, 1908)
.
Le belvédère de Lindaraxa se trouve à l’Alhambra de Grenade. Le recueil fait donc fond, en partie, sur l’inspiration arabo-andalouse chère à Villaespesa, que nos traductions ont soulignée. Le document ci-joint, tiré de la préface aux œuvres poétiques complètes du poète par Federico Mendizábal aux éditions Aguilar (1954), est intéressant de ce point de vue. La légende de la photographie indique : « Francisco Villaespesa aux côtés du ‘calife’ (jalifa) Muley Hassan lors de la cérémonie d’inauguration d’une stèle à la mémoire d’Alhamar, fondateur de l’Alhambra, stèle sur laquelle l’inspiration de l’illustre poète a inscrit l’une de ses plus belles pages. » (Le jalifa était un haut responsable du protectorat espagnol du Maroc, exerçant son autorité par délégation du Sultan et avec le haut-commissaire espagnol.)
.
Kassidahs (Kasidas)
I
Je suis comme un rêve qui vient d’Orient
sur un dromadaire chargé d’aromates et de perles d’Oman.
Le soleil d’Arabie a bruni mon front large
et je chemine ébloui de magnificence et de lumière.
Ô vierge brune ! sous le lin fragile
de la tente nomade, je t’ai vue mourir de passion entre mes bras !…
Les grelots tintinnabulants d’une caravane passaient,
les astres scintillaient, et l’on entendait au loin le lion rugir.
Mon chant ressemble à la chanson dolente
qu’entonnent les Bédouins à dos de chameau,
cherchant une source parmi les sables :
elle est toute sensualité, sang, amour et jalousie, et fatalité.
Les chacals ont vu mon ombre sous la lune,
lance à la main et mon blanc burnous flottant au vent,
voler au combat à travers les dunes,
mon noir coursier au galop, la crinière ébouriffée.
Tandis que sous la lune s’ouvre le nard et chante la fraîche fontaine,
sultane, je viens, sourd d’harmonies, aveugle de lumière,
rythmer avec toi mes rêves d’Orient
sur les jets d’eau et les myrtes d’un patio andalou.
J’apporte sur les bosses de mes dromadaires
des joyaux fabuleux : tous les trésors du ciel et de la mer.
Mes vers dorés sont comme des encensoirs
qui brûlent leur myrrhe, leur encens et leur ambre au pied de ton autel.
Je suis de cette tribu de nobles guerriers
dont les alfanges sèment la terreur dans la bataille acharnée
mais qui, s’ils se voient prisonniers d’une paire d’yeux,
pâles et tristes meurent d’amour.
II
La fortune ? Que d’autres érigent sur le sable
des palais que le vent ou le temps emportera !
J’ai répandu prodigue l’or à pleines mains.
Mon affection donne tout, sans savoir ce qu’elle donne.
C’est un palmier dressé sur les chemins arides,
offrant l’ombre de sa fécondité ;
son fruit assouvit la faim du voyageur,
son tronc est un refuge contre la tempête.
La rumeur des nids fait vibrer sa frondaison,
sous son ombre les chameaux font la sieste ;
et quand la foudre le touche, ses gémissements tragiques
rythment les formidables strophes d’un chant.
Un soir, l’ont vu, grinçant, échevelé,
les lentes caravanes qui vont jusqu’à Damas
lutter dans un nuage de sable calciné,
jusqu’à étouffer entre ses bras la voix de la tempête.
Parfois, dans la brise il aspire les effluves
d’un autre palmier dressé dans une autre solitude,
alors l’amour bourdonne sur sa chevelure blonde
et frémit de volupté !
*
La tristesse du soleil (La tristeza del sol)
II
L’ardeur d’un rouge soleil d’été
dessèche mes jardins d’Orient.
Le jet d’eau des fontaines reste muet, de soif,
et les rosiers, de soif, perdent leurs feuilles.
Même le rossignol dont les chansons
parfumaient de rêve mes veilles,
hier je l’ai trouvé mort, couvert de fourmis,
entre les herbes noires et calcinées.
Pas un seul écho errant de voix n’égaye
la torpeur infinie du paysage…
Tout meurt et, en même temps, tout s’oublie…
Seule l’ombre d’une araignée noire
file parmi le squelette des ramures
l’ennui fatigant de la vie.
XI
Sous le soleil boitant éteinte,
un œil bandé, l’oreille languide,
autour de la noria qui geint
tourne lentement la vieille jument.
Les ferrures disjointes grincent,
ses sombres naseaux fument,
et sur les sanglantes blessures du harnais
bourdonne un essaim de mouches voraces.
Parfois elle renifle, dans l’air immobile,
une lointaine odeur d’avoine
fraîchement coupée… Elle s’arrête un instant.
Son ventre squalide frissonne dans les sangles,
elle agite sa queue flasque, hennit,
et se remet à tourner lentement.
*
Les jardins tragiques (Los jardines trágicos)
I
Vieux jardin, ton atmosphère est attristée par un mystère
inexorable comme la tristesse de la vie.
Tu ressembles, dans le crépuscule, à un vieux cimetière
où résonne encore un ultime adieu.
La lumière de ta beauté fatale nous domine…
Tout, en toi, est oubli… Et le cœur se sent
feuille morte sur l’arbre, rosier le long du mur
et goutte d’eau de ta mauresque fontaine.
Tu es, dans l’enchantement de la lumière d’or et de rose,
comme une vieille musique odorante et chaude
à laquelle chacun donne ses propres paroles.
Et quand s’avance l’énigme noire de la nuit,
celui qui pénètre tes solitudes taciturnes
s’abandonne sur le seuil, tout espoir perdu.
IV
Lente comme le soir, je sens en cette heure
perdre son sang ma vie dans le jardin obscur.
Une lointaine douleur pleure dans ma pupille
et quelque chose fait pâlir mon corps de froid.
Je ne sais quel souvenir me revient à la mémoire.
Pour baiser un songe ma lèvre s’ouvre,
tandis que le pied vagabond tout à coup s’arrête
et l’âme s’envole, errante, ainsi qu’une feuille morte.
Ce fut ici. À cette heure, sous la verte ramure,
nous avions rendez-vous. Je devais être son captif ou son page ;
elle, une sultane du vieil alcazar maure.
Nous nous embrassâmes… Alors mes cheveux se dressent sur ma tête,
comme si je sentais soudain contre mon cou
le coup aigu et froid d’une alfange d’or.
V
Dans le jardin endormi flotte quelque chose d’indéfinissable
et un cri d’agonie en déchire le silence,
comme l’éternel adieu d’un amour impossible…
Une âme pleure d’amour avec la mienne.
Où es-tu, mon âme sœur ? Peut-être qu’à présent
la destinée t’enserre dans l’une de ces formes ailées
qui passent fugaces, sans laisser sur la terre
que l’ombre triste de leurs noirs regards.
Un frisson parcourt ma chair mortelle…
Cœur, dis-moi : qu’espères-tu ? Il me semble entendre
un cœur battre à l’intérieur du mien…
Je me perds dans les labyrinthes du passé,
avec la somnolence de ceux qui aimèrent beaucoup
et ne peuvent plus aimer qu’en souvenir.
XI
Vieux jardin obscur, si triste est ta beauté,
il pèse sur toi une sentence tellement inexorable
qu’elle paraît nous dire : « N’espère pas, car il n’existe
aucun remède à tes maux : ta blessure est incurable.
Tout est inutile. Souffre la loi de ton destin,
La consolation est un mythe et ton espoir est vain…
Aveugle, pourquoi donc t’arrêter en chemin
si bien plus qu’aujourd’hui tu dois demain souffrir ?
Sois inconscient comme une feuille qu’emporte le vent.
Ton pire ennemi est ta propre pensée.
Étouffe tes sentiments de ta propre main
de crainte qu’ils ne viennent dans leurs griffes t’étrangler,
et pense à cela, qu’en toi tu portes, vivants, les vers
qui demain dans la tombe doivent te dévorer. »
*
Les élégies de Grenade (Elegías de Granada)
I
Humaine grandeur :
orgueil, beauté,
pouvoir, sentiments,
tout, tout est du vent,
de la fumée qui passe…
Sur les vieux murs,
en traits sûrs,
un jour ancien
le grava une main
aujourd’hui poussière…
Le savent les fleurs
ainsi que les rossignols ;
le cyprès le sent
et la fontaine le dit :
« Il n’y a de Dieu qu’Allah ! »
C’est en vain que voulut planter
le chrétien sa croix
sur tes tours… Rien…
Grenade est Grenade…
Et le sera toujours !
Le savent les fleurs
ainsi que les rossignols ;
le cyprès le sent
et la fontaine le dit :
« Il n’y a de Dieu qu’Allah ! »
*
Andalousie
(Andalucía, 1910)
.
Gloses d’amour et de jalousie (Glosas de amor y de celos)
III
La pureté est comme la neige ;
si la moindre tache y tombe,
personne ne peut l’enlever
car cela ne se lave point.
Et ta pureté est plus pure
que la pureté d’un ange !
Je voudrais être un rayon de soleil
pour entrer par ta fenêtre
te donner un baiser sur le front
sans te briser ni salir !
IV
Ni bonne ni mauvaise… Tu es
la fille des circonstances ;
une girouette de clocher,
prétentieuse et hautaine,
qui tant que dure le vent
tourne, tourne sans s’arrêter !
Aujourd’hui tu tournes comme ça… Dieu sait
comment tu tourneras demain !
Plume qu’on a jetée au vent
et que le vent emporte dans son vol
sans savoir sur quel chemin
il la laissera oubliée…
Aujourd’hui ici, là demain…
C’est ainsi que tu passes ta vie,
passant de main en main
comme de la fausse monnaie !
V
Un pauvre aveugle, un pauvre aveugle
appuyé contre le mur
ou demandant de porte en porte,
c’est ce que je suis à présent, à cause de toi…
Mais bien que je meure de faim
et que la soif me tue,
ne viens pas m’apporter
les miettes que d’autres ont laissées…
Pourquoi voudrais-je de tes champs
si d’autres en ont fauché les blés ?
VI
Goutte après goutte, petit à petit,
l’eau casse les pierres.
Mais moi, j’ai beau le vouloir,
je ne parviens pas à te rendre bonne…
car le poison naît mauvais
et c’est sans le vouloir qu’il empoisonne.
Parmi mes moissons tu as poussé
comme une mauvaise herbe,
et tout ce qui naît près de toi
se dessèche à ton ombre.
VII
Tu rends amer le pain que je mange,
saumâtre l’eau que je bois,
et jusqu’à l’air que je respire,
tu l’empoisonnes de ton souffle.
Tu envenimes ma joie ;
quand je suis content
et veux porter à mes lèvres un verre
de vin mousseux,
comme une mouche, y tombe
au fond ton souvenir,
alors j’écarte le verre de ma lèvre…
et répands le vin au sol !
XI
« Mon âme ! Mon âme ! »
Je ne connais de parole
plus douce ni qui soit
si profanée.
« Mon âme, mon âme ! »,
nous dit toujours l’infamie
quand elle nous tend les bras
pour nous frapper dans le dos.
Ne m’appelle pas ton âme…
Pourquoi me donnes-tu ce nom
puisque tu sais que je te connais
et que je sais que tu n’as point d’âme ?
Si, moi, j’étais ton âme,
de ton corps je m’échapperais,
parce que je ne pourrais habiter
une maison si mal famée.
Ton corps est beau, très beau…
N’est-ce pas pitié
qu’une si jolie maison
ne puisse être habitée !
« Mon âme, mon âme ! »
Je ne connais de parole
plus douce ni qui soit
si profanée.
XIX
Chevelure noire, comme
les ailes de Lucifer,
qui dans l’obscurité brilles
d’être si noire,
et rends son visage plus pâle
et plus brun son teint,
donne-moi une poignée d’ombres
car je veux me faire une corde
pour l’attacher à mon cou
et me pendre avec…
Chevelure noire comme
les ailes de Lucifer !
*
Dits et sentences (Sentencias y decires)
V
N’envie point celui
que le sort élève ;
plus haute est la tour,
plus vite elle doit tomber.
Celui qui possède quelque chose à garder
a des nuits sans sommeil ;
quand il s’endort,
le moindre bruit l’éveille.
Tandis que celui qui n’a rien,
comme il ne se méfie de rien,
il dort la nuit en paix, même quand
sa porte est grande ouverte.
*
Nouveaux chants (Nuevos cantares)
XII
Tu me parles si peu
mais même ce peu de paroles,
je ne peux t’en être reconnaissant
car tes paroles sont fausses !
XVI
Où sont tombées tes larmes
un rosier a poussé,
et celui qui en respire les roses
pleure sans savoir pourquoi.
XXXVI
Sur cent qui traînent une chaîne au bagne,
quatre-vingt-dix-neuf au moins
la traînent sans être coupable
mais à cause d’une femme !
*
Journal onirique 27 : The cop killer is a killer cop
Cette suite tardive à notre journal onirique (précédent numéro ici) en est sans doute aussi la dernière entrée, avant longtemps. Les rêves qui suivent datent en effet d’octobre 2022, sauf pour les deux derniers, qui sont de décembre 2022 ; autant dire que nous avons cessé de retranscrire nos rêves. Nous ne faisons donc ici que présenter le reliquat de notre journal qui n’avait pas encore été mis en ligne.
Une remarque générale, a posteriori, faute de l’avoir faite plus tôt. Puisqu’il s’agit d’un journal onirique, d’aucuns ont pu se dire, légitimement, que c’était pornographique. Or nous avons délibérément écarté de ce journal les contenus les plus sexuellement explicites de notre activité onirique, afin, justement, que ce journal ne soit pas de la pornographie. On trouvera sans doute çà et là quelques passages plus ou moins érotiques, quand le rêve dans lequel ces scènes avaient lieu imposait qu’elles figurassent dans le journal, mais, dans l’ensemble, les rêves à caractère principalement sexuel n’ont pas été retenus. Pour les passages plus ou moins érotiques restants, nous sommes également d’avis qu’une reprise de ce journal (par exemple à des fins de publication en livre) appellerait quelques autres suppressions à cet égard, surtout vers les débuts du journal où nous n’avions pas encore adopté cette politique éditoriale avec toute la détermination d’une véritable politique. – Le journal n’est donc pas fidèle de ce point de vue, cela soit dit en passant à l’attention de ceux qui, le lisant, se seraient fait la réflexion que l’auteur n’a pas, étrangement, de rêves sexuels. Ce malentendu dissipé, nous assumons pleinement cette « censure », au nom de l’idée que nous nous faisons de la littérature, une idée juste et à contre-courant de la politique des maisons d’édition occidentales contemporaines, dont l’activité n’est qu’un témoignage parmi d’autres d’une décadence irrémédiable et qui n’a de conception de l’activité littéraire que celle d’un rêve éveillé (appelé parfois autofiction).
*
Octobre 2022
À la rue depuis peu, je vois au bout d’un quai de gare, couvert par une colossale structure métallique rendant le quai très sombre, un groupe de clochards auxquels je décide de me joindre. Certains sont sur assis sur le même banc, d’autres par terre. En m’approchant, je constate que plusieurs d’entre eux ne sont en fait que des têtes sans corps – des têtes vivantes. Ils paraissent accepter de faire ma connaissance mais je ne suis pas complètement rassuré par la découverte que je viens de faire sur la véritable nature de certains d’entre eux.
À un moment, l’une des têtes sur le banc se lève sur ses entrailles, que je n’avais pas vues sous elle – ou sous lui –, à la manière d’un krasseu thaïlandais ou d’un léak malais, sortes de fantômes ayant l’aspect d’une tête volante d’où pendent les intestins. Je recule, craignant qu’il ne se serve de ses entrailles comme de pattes d’araignée pour se précipiter sur moi et m’attaquer. La tête vivante se sert en effet de ses intestins pour se mouvoir mais c’est pour quitter le groupe. Elle traverse la voie ferrée et se met à escalader le mur de l’autre côté, avant de disparaître en le franchissant.
Je me tourne alors vers un jeune clochard assis par terre et l’appelle « Routledge », croyant que c’est que j’ai déchiffré sur son tee-shirt. Il me détrompe à ce sujet : sur son tee-shirt est écrit « Knapp », ce qui veut dire, m’explique-t-il, quelque chose comme de la chair à saucisse, mais en plus spécifique, dans le jargon de la boucherie. Car, avant de tout quitter pour faire la cloche, il était apprenti boucher.
*
The cop killer is a killer cop
Un policier véreux pense avoir été pris en photo par un collègue dans une situation compromettante. Plus précisément, il croit se trouver, par un malheureux concours de circonstances, dans l’arrière-champ d’une photo prise par le policier, qui travaillait sur une affaire. Le soir, le policier véreux se rend donc au domicile de l’autre policier, où ce dernier vit avec sa femme, également de la police. Il les assomme tous les deux, s’empare du matériel compromettant puis met le feu à la maison de manière à faire croire à un incendie accidentel. Alors qu’il a quitté les lieux, peu après que les flammes ont commencé à se propager, une voiture de police passe par là. Son occupant, voyant de la fumée et des flammes, sort de son véhicule et se précipite vers la porte d’entrée de la maison afin de prêter assistance aux personnes en danger. Mais le policier véreux a fermé la porte à clé derrière lui, pour parer à cette éventualité. Le couple de policiers à l’intérieur de la maison ne peut donc être sauvé ; le temps que les pompiers arrivent, il est trop tard. Cependant, l’assassin a commis une erreur. Si la porte avait été fermée de l’intérieur, on aurait pu croire à un suicide, mais comme elle a été fermée de l’extérieur on sait que c’est un crime. Car la police a les moyens de savoir si une porte a été fermée à clé de l’intérieur ou de l’extérieur. (Ce qu’il faudrait lui demander pour savoir ce qu’il en est dans la réalité.)
*
C’est la finale dames du tournoi de Roland-Garros ; cependant, le sol n’est pas en terre battue, c’est un sol de couleur verte comme à Wimbledon. Les sièges du public, en cuir, sont également de couleur verte mais d’une nuance plus foncée. Il y a des sièges de plain-pied avec le court, et ce sont les plus chers car on y est toujours devant les caméras. Le public est très peu nombreux pour cette finale ; surtout des femmes. Je suis assis par terre devant deux sièges de plain-pied sur un bord latéral du court, sièges occupés par deux amies dont l’une se sert de mon épaule pour appuyer ses jambes croisées et nues. Je ne vois presque rien du match, si ce n’est que, quand sert la joueuse se trouvant de notre côté, elle se trouve au milieu des jambes du public occupant les sièges de plain-pied au fond du court, ce qui me paraît tout à fait ridicule.
Quand le match est terminé, tout le monde se lève. La jeune femme qui se servait de mon épaule pour allonger ses jambes me dit que la finale hommes a lieu dans la foulée ailleurs. Les gens sortent et se dispersent dans les rues de Paris. Je perds de vue mes deux compagnes et décide de suivre un vieil ami venu avec moi, qui prétend savoir qu’il faut traverser la Seine ; d’autres personnes suivent d’ailleurs cette direction, qui n’est donc pas forcément mauvaise. Après avoir marché quelque temps, les spectateurs de Roland-Garros ont formé un groupe cohérent qui marche à peu près comme un seul homme. Je retrouve entre autres F., élégamment habillé de blanc ainsi que la plupart des autres personnes venues assister au tournoi. Je lui demande si c’est une nouveauté que le public s’habille de blanc, car je n’ai pas le souvenir que ce fût une tradition. Il refuse de dire que c’est une nouveauté, même s’il ne peut non plus prétendre que ce soit une tradition. Je réponds alors que le public s’habille de blanc, avec élégance, depuis que les joueurs s’habillent, eux, à leur guise, c’est-à-dire comme des clowns.
Nous arrivons dans une grisâtre banlieue traversée par la Seine. Le public prend position au bord du fleuve et attend ; nous attendons en fait des nageurs, nous avons fait ce chemin pour voir de la natation. Avant l’arrivée des sportifs de haut niveau, les membres d’un club local barbotent dans l’eau, principalement des femmes d’âge mûr. La pratique de la natation leur permet d’avoir des mollets bien galbés, comme je le remarque quand certaines d’entre elles sortent de l’eau, mais cette remarque reste dominée par le fondamental défaut d’attraction que représente leur qualité de secrétaires, fonctionnaires, ou autres occupations professionnelles que je leur suppose.
Fatigué d’attendre, j’entre dans la maison de Jean Cocteau, qui vit dans cette banlieue. Il va et vient sans faire attention à moi. Dans des cahiers que je feuillette, je remarque que Cocteau apprend la langue thaïlandaise. Il a même écrit le mot « porte » en thaï sur une porte près des cahiers : le mot a été gravé à la pointe brûlante sur un petit écriteau de bois apposé sur la porte. Pratiquant un peu le thaï, je lie conversation avec lui sur le sujet ; il paraît intéressé, sans doute plus, me dis-je, que si je lui avais dit que j’écris moi-même de la poésie. Mais je crains que sa motivation pour apprendre le thaï ne soit pas très pure.
*
Plongeur, je m’enfonce dans les profondeurs inconnues d’une mer sombre. C’est une plongée dans l’angoisse, avec des paliers indéfinissablement inquiétants. Quand je parviens au fond de la mer, je vois des gens me tournant le dos. Entre eux et moi se trouve un poteau. Quand j’observe le groupe depuis le côté gauche du poteau, c’est une image d’épouvante : l’individu le plus proche de moi paraît être, de dos, la créature de Frankenstein. Mais quand je regarde le groupe depuis le côté droit du poteau, la sensation de peur disparaît : c’est un groupe d’écoliers en rang qui attend l’ordre d’avancer.
*
Dans le dernier film de Jean-Paul B., sa femme ourdit un complot avec son amante lesbienne pour le tuer. Il rentre chez lui le soir. Sa femme est assise sur le canapé dans le salon ; il la bise au front et s’assoit à l’autre extrémité du canapé. L’amante lesbienne de sa femme arrive par derrière, un bas de nylon tendu entre les mains pour étrangler Jean-Paul. Elle lui passe le bas autour du cou et une lutte s’ensuit. Comme elle n’a pas le dessus, elle fait finalement comme si ç’avait été de sa part une plaisanterie. La lutte les a conduits tous les deux dans une pièce voisine. Jean-Paul, qui fait semblant de croire l’amante, une amie du couple, se laisse tomber à plat ventre sur un sofa, où l’amante secrète de sa femme le suit en s’étalant sur son dos, soit que les deux soient à ce point déjà familiers entre eux, soit qu’elle cherche à présent à le séduire. Or Jean-Paul, qui n’a pas été dupe de ce qui s’est passé, se relève, la femme attachée à son dos, et, sautant en l’air, se laisse retomber lourdement sur le sol, la femme sous lui. Elle meurt sur le coup.
*
Un homme d’aspect respectable, corpulent, avec un début de barbe sel et poivre, en costume mais sans cravate, cueille du cannabis au bord de la route. Un motard de la police s’arrête. C’est une femme. Elle dit à l’homme qu’il est interdit de cueillir du cannabis au bord de la route. Celui-ci, ne se laissant pas démonter, répond que sa femme a le cancer, sous-entendu : il cueille du cannabis pour un usage thérapeutique. Cela ressemble à une excuse facile. Or la motarde de la police, qui connaît l’homme, sort de sa poche des papiers montrant que la femme de cet homme n’a pas le cancer. Elle le laisse partir pour cette fois, dans un accès de mansuétude qui n’est pas du tout du goût d’un groupe de personnes qui font le piquet au bord de la route avec des pancartes dénonçant la pratique illégale de la cueillette de cannabis au bord des routes.
Plusieurs militants de ce groupe, dont je fais partie à présent, décident de suivre l’homme, qu’ils supposent être un gros bonnet. Nous le prenons en filature jusqu’à sa maison, dont l’intérieur, vu depuis les fenêtres, ressemble au quartier général d’une organisation de malfaiteurs. Nous entrons et, dans une chambre occupée, chacun dégaine son pistolet, si bien que nous restons tous, militants et malfaiteurs, immobiles, menaçants et menacés, ce qui s’appelle une « impasse mexicaine ».
*
Décembre 2022
Cthulhu’s plancton.
*
Je regarde vers ma bibliothèque vidée de ses livres et, voyant une grosse araignée dans l’un des casiers, je m’exclame : « Elle a le corps gros comme mon poing ! » Mais je vois ensuite que la bibliothèque est en fait entièrement infestée d’araignées, dont l’une, en particulier, me fait crier : « Elle a le corps gros comme ma tête ! » Rendu passablement malade par la vue d’un tel monstre, je me trouve en train de ramper sur la terre entre d’étroites allées de buis, convaincu qu’en frôlant ces plantes je dois forcément accrocher de nombreuses toiles d’araignée sur mon passage et faire tomber sur moi leurs occupantes. Je rampe et aucune chute d’araignées ne se produit, mais l’idée en est si présente, et si révoltante, que je me réveille.
*