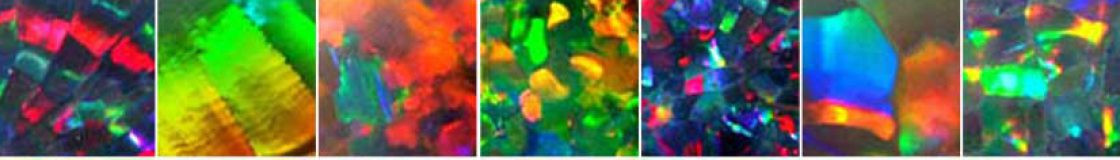Tagged: Saker-Ti
Poésie révolutionnaire du Guatemala (traductions)
La poésie guatémaltèque engagée d’inspiration sociale et anti-impérialiste s’est cristallisée dans la première moitié du vingtième siècle autour de deux mouvements littéraires et artistiques : tout d’abord, et dans une moindre mesure, le groupe Acento, puis le groupe Saker-Ti, constitué en 1947.
Cette poésie a été portée par le contexte politique de la décennie 1944-1954 qui vit la chute de la dictature du général Ubico (Révolution d’Octobre) et l’élection du président Juan José Arévalo puis, en 1951, celle de son successeur, Arbenz Guzmán. Les réformes sociales engagées sous ces deux présidences et la fin de la répression étatique des mouvements de travailleurs, dont le parti communiste, provoquèrent la réaction des intérêts oligarchiques qui, soutenus par les États-Unis et son bras économique dans le pays, la United Fruit Company (« Mamita Yunai » – Yunai pour « Uni » de United), combattirent le gouvernement par les armes. Ce conflit (semblable à ce que vivra le Nicaragua au lendemain de la victoire sandiniste de 1979, avec le même type d’interventionnisme nord-américain), prit fin en 1954 avec le renversement du gouvernement élu. Pour les intellectuels de Saker-Ti s’ensuivit alors la répression par la nouvelle dictature, l’exil.
Les années suivantes ne furent pas moins chaotiques, une guérilla révolutionnaire s’opposant aux dictatures oligarchiques successives – ainsi d’ailleurs qu’aux quelques présidents élus. Le poète Otto René Castillo, qui avait quitté le Guatemala en 1954, rejoignit la guérilla en 1966 et fut capturé et passé par les armes peu de temps après, en 1967.
Les dix-sept poèmes suivants, que j’ai traduits, sont tirés de Poesía guatemalteca revolucionaria (1969), anthologie compilée et présentée par María Luisa Rodríguez.
Les membres du groupe Saker-Ti ici représentés sont Roberto Paz y Paz (deux poèmes), Melvin René Barahona (deux poèmes), Otto René Castillo (cinq poèmes), Julio Fausto Aguilera (quatre poèmes) et Francisco Acevedo (un poème). Les autres poètes, non rattachés formellement à ce groupe, sont Otto-Raúl González, Romelia Alarcón Folgar et Manuel José Arce Leal (un poème chacun).
*
*
Résistance du peuple (Resistencia del pueblo) par Otto Raúl González (Otto-Raúl González)
Donnez
donnez mille
donnez mille coups
donnez mille coups au diamant.
Toujours
toujours il sera
toujours il sera et restera
toujours il sera et restera diamant.
Donnez
donnez mille
donnez mille coups
donnez mille coups au peuple.
Toujours
toujours il sera
toujours il sera et restera
toujours il sera et restera le peuple.
Car le peuple est comme le diamant.
Enfermez
enfermez derrière mille
enfermez derrière mille verrous
enfermez derrière mille verrous l’air ;
toujours
toujours il sera
toujours il sera et restera l’air.
Enfermez
enfermez derrière mille
enfermez derrière mille verrous
enfermez derrière mille verrous le peuple.
Toujours
toujours il sera
toujours il sera et restera le peuple.
Assassinez,
fusillez,
massacrez,
mitraillez le peuple,
il y aura toujours,
il y aura toujours un peuple.
Car le peuple est comme l’air.
Assassinez,
fusillez,
massacrez,
mitraillez la lumière ;
toujours,
il y aura toujours,
il y aura toujours de la lumière.
Car le peuple est comme la lumière.
*
Mes bœufs étaient comme ça (Así eran mis bueyes) par Roberto Paz y Paz
Ces deux-là, oui, c’étaient des bœufs ;
je te le dis, Chema,
jamais je ne trouverai
une paire de bœufs pareils.
J’ai dû les vendre,
mais qu’y puis-je ?
à celui qui naît pauvre
la vie coûte plus qu’au riche.
Ils étaient si pareils l’un à l’autre
que c’en était épatant
vingt paumes de haut
regarde ma main ;
les deux tout blonds,
comme du jaune d’œuf,
et avec de ces cornes…
Je ne t’en dis pas plus.
Quand je me rappelle
comment ils tiraient,
toujours à l’unisson,
pas besoin de la pique,
même pas besoin de crier,
je sens les larmes
qui me viennent aux yeux.
Alors je leur donnais
après le travail
un panier grand comme ça
de maïs
et du sel dans la main.
Tu les aurais vus ;
avec la charrue,
avant que les autres
aient fini de défricher
moi j’en étais au second labour
presque à semer.
Et même ils savaient
qu’avec la terre dure
il faut semer à trois bandes de terrain
et ils les calculaient
mieux que moi !
Mais ils sont loin maintenant,
des bœufs de cent pesos chacun !
j’ai dû m’en séparer
à cent les deux.
Voilà comment profitent
les richards
de l’homme dans le besoin…
Ma femme enceinte
et un gosse malade,
sans maïs ni haricots,
sans même une machette !
Et les médicaments qui coûtent
si cher ;
et il faut bien acheter des vêtements
pour celui qui vient.
C’est pour ça que je les ai vendus ;
autrement, quel espoir ?
Quand je me rappelle
comment ils grimpaient
sur la Salpêtrière
avec trente quintaux,
et comment ils allaient
sur la route
jusqu’au Rio Motagua
sans que je les guide…
Monter en charrette
avec ces bœufs,
c’était comme
s’allonger dans un hamac.
Au point que je pouvais dormir
sur les sacs de maïs
et ils me conduisaient
au mas de l’Hacienda Grande !
Mieux vaut que je me taise, va,
si ça doit me faire pleurer.
Tu ne comprends pas que des bœufs
pareils, je n’en trouverai jamais ?
*
Reconstruction de la lumière (Reconstrucción de la luz) par Roberto Paz y Paz
Les mains, oui, les mains chantent
le poème d’amour bien appris
et mystérieux est leur rythme concertant ;
elles sont nées pour les usines et les charrues ;
mais le moment est si sale et sombre
qu’elles demandent aujourd’hui le fusil.
Les mains savent défricher la terre :
la patrie se nourrit de ces mains ;
les mains savent conduire les métiers à tisser :
que ces mains donnent des vêtements aux peuples ;
les mains tracent des calculs algébriques :
que ces mains construisent les ponts ;
les mains savent sonder les douleurs :
que ces mains guérissent les peuples ;
les mains savent agencer les lettres :
que ces mains éduquent les peuples.
Mais non ; ils ne nous laissent pas…
parce qu’ils ont étouffé septembre vingt et un ;
soixante et onze a été gommé ;
mille neuf cent vingt1
trahi,
cela n’a porté aucun fruit ;
parce qu’ils ont détruit à coups de prévarication
notre octobre de quarante-quatre ;
qu’ils ont ôté aux bras sans terre
la terre sans bras que nous leur avions donnée ;
qu’ils ont réduit à néant ce que nous avons construit ;
parce qu’ils ont placé des jalousies devant la lumière
qui baigne le monde,
nous plongeant dans l’obscurité ;
alors,
de ces mains pures,
faites pour la charrue, l’atelier et le livre,
naît le désir de tout laisser tomber
pour ne se consacrer qu’à une seule tâche,
pour laquelle il n’existe qu’un seul outil :
nous reconstruirons la lumière
avec le feu lustral des fusils.
Ces mains d’abord chercheront
et en un faisceau vigoureux
ensuite fusionneront
les fragments de lumière de notre histoire,
les reprisant avec un fil indestructible
d’acier et de flammes.
Et une torche infinie
surgira flamboyante,
septembre plus octobre
avec avril et juin
– éblouissante –
pour mettre le feu aux immondices
et rénover la patrie humiliée
Et en elle
et avec elle
– nourrie du sang des martyrs,
réparée l’aile blessée du quetzal –
entonner la chanson des champs de maïs
avec le rythme heureux des usines
et la chorale harmonieuse de cent mille écoles.
Ah, ces fragments de lumière, à présent réunis,
quel torrent de clartés ils nous apportent !
1 Dans ce passage, le poète fait allusion à plusieurs dates clés de l’histoire du Guatemala : la déclaration d’indépendance de 1821, la révolution libérale de 1871 et la « Semaine tragique » de 1920 contre le président-dictateur Estrada Cabrera. Quelques vers plus loin, il est question de la chute du dictateur Ubico en octobre 1944.
*
Seconde ville martyre (Segunda ciudad mártir) par Melvin René Barahona
Zacapa, enfant ardente,
cœur de palmier vermeil.
Forge où le printemps se pare
de l’arôme irremplaçable
de ton rhum tropical, avec ton marché
odorant de légumes et de sourires
qui regardent à travers des corbeilles d’osier
offrant un mirage timide
de végétale et fantasque humidité.
Comme si ne suffisait pas le feu
transpirant de tes cactus ;
et cet autre, voluptueux et troublant,
de tes jouvencelles matinales ;
ils t’apportent aujourd’hui, Zacapa de mes ancêtres,
le feu de la mort, celui qui détruit
toute force vitale et la traite du lait.
Toujours tu demandas l’humidité pour tes plaines,
pour accroître les sillons de tes champs,
irriguer le sang de tes cactus,
rafraîchir le front de tes vierges.
Tu l’as reçue, l’humidité, à présent.
Humidité dans les yeux des mères
à la tendresse massacrée.
Humidité des enfants démembrés
anéantis sur le sein qu’ils tètent.
Tu peux maintenant t’incliner dans les plaines de La Fragua (La Forge)
pour boire ton propre sang,
ce noble sang, courageux et fort,
que je tiens au milieu de mon poing
comme un héritage du passé, de mes pères.
Feu sur feu, c’est ce que t’apportent
les immondes chiens de la nuit,
jusqu’à ce que plus aucune pierre ne reste debout.
À toi, déesse du feu, qui tendis
le sceau de ta lumière à Prométhée,
la pierre de ton feu.
*
Cela passera (Todo pasará) par Melvin René Barahona
Cela passera.
Et je serai à tes côtés au matin
de la reconstruction.
Oui. Je serai à Zacapa
et je serai à Chiquimula ;
je serai partout
où la mort est venue
chasser l’espérance.
Je serai là pour refaire
le sang naufragé des briques mortes.
Pour sécher la dernière larme versée.
Je serai là
pour balayer avec mon front les décombres
et la tristesse des souvenirs.
Je placerai une rose rouge et un sonnet
dans chaque fosse commune.
Je peindrai un rameau de ma voix, un sourire,
un tremblement de mes lèvres
sur les palmiers ressuscités,
et je baiserai les briques nouvelles et les murs
édifiés pour durer.
Oui, cela passera ;
et de nouvelles mères viendront pour les enfants orphelins,
et de nouveaux enfants pour les mères éplorées,
et un pain nouveau
plus tendre et plus savoureux
débordera des grimaces de mon peuple,
et une nouvelle espérance
débordera des poitrines reconstruites.
*
Marchons, Patrie (Vámonos, Patria, a caminar) (1965) par Otto René Castillo
Marchons, Patrie ; je t’accompagne.
Je descendrai aux abîmes que tu me montreras.
Je viderai tes amers calices.
Je me ferai aveugle pour que tu aies des yeux.
Je me ferai muet pour que tu chantes.
Je dois mourir pour que tu ne meures pas,
pour que ton visage lumineux monte à l’horizon
de chaque fleur née de mes os.
Il doit en être ainsi, c’est certain.
Je suis fatigué de contenir tes larmes en moi.
Maintenant je veux marcher à tes côtés, scintillante.
T’accompagner dans ton voyage, car je suis un homme
du peuple, né en octobre à ce monde.
Ô Patrie !
Les colonels qui compissent tes murs,
nous devons les extirper jusqu’à la racine,
les pendre à un arbre de rosée tranchante,
secoué des colères du peuple.
C’est pourquoi je veux marcher avec toi. Toujours
avec les paysans agrariens
et les ouvriers syndicalistes,
avec celui qui a un cœur pour t’aimer.
Marchons, Patrie ; je t’accompagne.
Ma petite Patrie, douce tempête,
mes pupilles élèvent un littoral d’amour
et ma poitrine s’emplit d’une joie de forêt
quand je dis patrie, ouvrier, hirondelle.
C’est que j’ai mille ans à force de me lever à l’agonie
et de me coucher cadavre sur ton nom immense,
flottant sur tous les souffles libertaires,
Guatemala, prononçant ton nom, ma Patrie, petite paysanne.
Ô Guatemala !
quand je dis ton nom je retourne à la vie.
Je quitte les larmes à la recherche de ton sourire.
Je gravis les lettres de l’alphabet jusqu’au A
qui donne sur le vent comblé d’allégresse
et je te contemple à nouveau telle que tu es,
une racine poussant jusqu’à la lumière humaine
avec tout le poids du peuple sur ton dos.
Misérables les traîtres, mère patrie, misérables !
Ils connaîtront la mort de la mort jusqu’à la mort !
Pourquoi des fils aussi abjects sont-ils nés d’une mère si tendre ?
Telle est la vie des peuples, amère et douce,
mais leur combat résout tout humainement.
C’est pourquoi, Patrie, il te naîtra des matins
quand l’homme se penchera éclairé sur son passé.
C’est pourquoi, Patrie,
quand je dis ton nom mon cri devient révolte
et le vent se libère d’être vent.
Les rivières quittent leur cours prémédité
et viennent en manifestation te serrer dans leurs bras.
Les mers conjuguent dans leurs vagues et leurs horizons
ton nom meurtri de paroles bleues, propre,
pour te conduire au cri escarpé du peuple,
où nagent des poissons aux nageoires d’aurore.
Le combat de l’homme te rachète à la vie.
Petite Patrie, humaine, et terre, et liberté
portant l’espérance sur les chemins de l’aube.
Tu es l’antique mère du chagrin et de la souffrance.
Celle qui marche avec un enfant de maïs dans les bras.
Celle qui invente des ouragans d’amour et de cerisaies
et se donne parfaite sur la paix2 du monde,
pour que tous aiment un peu de son nom ;
une vaste portion de ses montagnes
ou la main héroïque de ses enfants guérilleros.
Petite Patrie, ma douce tempête,
chant logé dans ma gorge
depuis les siècles du maïs rebelle :
j’ai mille ans, à porter ton nom
comme un petit cœur futur
dont les ailes commencent à s’ouvrir au matin.
2 Dans une version du poème que j’ai trouvée sur internet, on lit « le visage du monde », c’est-à-dire le mot faz plutôt que paz. Cette version-là n’est d’ailleurs pas sans quelques défauts typographiques, tout comme le livre sur lequel j’ai travaillé, et je ne suis pas capable de dire quel est le texte authentique.
*
Le tombeau de Dieu (La tumba de Dios) par Otto René Castillo
Il se passe des choses
si étranges
dans mon petit pays
que si réellement
il y avait des chrétiens
ils croiraient
sans doute
qu’est mort
Dieu pour de vrai.
Un homme,
par exemple,
poussé
par l’implacabilité
de sa faim
commet un vol,
parce qu’il doit
le commettre.
On le condamne
alors
à vingt ans
de prison.
Pensez
un moment à ce que coûte
rassasier sa faim :
vingt ans
enfermé
dans 4 x 4 mètres !
Mais
les actionnaires
principaux
des banques
qui perpètrent
des affaires louches
et récoltent des louanges
marchent tranquillement
dans la rue.
Pensez
un moment encore :
d’où
vient tant de richesse ?
Ils l’ont produite
eux-mêmes,
peut-être,
à la sueur
de leur front
et avec les cals
de leurs mains ?
Répondez
à cette question.
Le commerçant
de la cité
principale
qui à huit heures
se rend à la messe
et à onze heures
au bar,
exhibe,
après un dévot
« Santé ! »
son certificat d’entrée
au paradis
au cas où il mourrait
à l’improviste.
Il montre avec insistance
la signature du saint père,
ponctuant d’une voix âpre :
« Ça m’a coûté
cinq cents balles ! »
Je n’ai qu’une chose à dire :
ils ont
encore
la moitié du monde
pour voyager et faire les putes.
Mais l’affamé
principal
de ma ville
y restera
si la bombe
le surprend
à son travail.
Une chose est absolument certaine.
Jamais ne passeront
par le chas d’une aiguille
les chameaux,
mais les riches eux
ont acheté,
plutôt que de le nier,
le royaume de leurs cieux.
En vérité,
s’il y avait des chrétiens
dans mon petit pays
où se passent
des choses aussi horribles,
ils seraient convaincus
de la mort de Dieu,
sans le moindre doute.
Faux chrétiens,
le tombeau d’un dieu
est en vous !
*
La faim (El hambre) par Otto René Castillo
Tu ne la vois pas venir.
Elle est toujours avec toi.
Au plus profond,
ouvrier de mon pays,
blottie comme un souvenir.
Elle parle en gris au petit matin
sur le visage de tes enfants,
de ta pauvre femme silencieuse,
et de ton geste le plus amer
qui jamais ne cesse
de se séparer de toi.
Elle se réveille
tous les matins,
quand la nuit
a été courte pour toi.
Et quand pour toi et les tiens
vient la nuit,
le jour n’est pas encore
fini pour elle,
qui continue de se nourrir
du peu de forces
que t’a laissées le patron.
Elle ne sait prononcer
qu’un seul mot,
dans toutes les langues :
manger.
Et quand tu n’as pas de quoi,
alors cette furieuse
te mord tant qu’il ne te reste
même plus la force de pleurer.
Et tu souffres comme personne,
car les tiens
fixent leurs yeux éplorés
vers l’horizon, immobiles,
tout le temps,
comme si l’aube
des plus mauvais jours
était encore à venir.
Elle aussi a un patron,
ouvrier de mon pays,
le même que toi.
Et c’est seulement quand tu te libèreras pour de bon
que tu en finiras avec elle.
Tu la tiendras apprivoisée dans tes mains.
Et il ne se trouvera pas assez de cloches
pour sonner à toute volée ton allégresse.
Alors les tiens ne regarderont plus
au loin, ouvrier de mon pays,
comme si l’aube des plus mauvais jours
était encore à venir.
*
Rapport sur une injustice (Informe de una injusticia) par Otto René Castillo
Peut-être ne pourras-tu le concevoir
mais ici,
devant mes yeux,
une vieille femme,
Damiana Murcia, veuve Garcia,
77 ans de cendre,
exposée à la pluie
à côté de ses meubles
cassés, sales, délabrés,
reçoit
sur l’épine du dos
toute l’injustice
maudite
de ce système du mien et du tien.
Parce qu’elle est pauvre
les tribunaux des riches
ont ordonné son expulsion.
Peut-être as-tu oublié
ce mot.
Tant le monde où tu vis
est noble.
Peu à peu
les mots amers
y perdent
leur cruauté.
Et tous les jours
avec le matin
paraissent des mots nouveaux,
empreints d’amour
et de tendresse pour l’homme.
Expulsion.
Comment t’expliquer ?
Vois-tu, ici,
quand
tu ne peux payer un loyer,
les autorités des riches
viennent et te jettent
toi et toutes tes affaires
à la rue.
Et tu restes sans toit
pour la grandeur de tes rêves.
C’est ce que veut dire le mot
expulsion : solitude
ouverte au ciel, à l’œil sévère,
et misérable.
C’est ce qu’ils appellent le monde libre.
Comme je suis content que tu
ne connaisses plus
ces horribles libertés !
Damiana Murcia, veuve Garcia,
est une toute petite femme,
tu sais,
et elle aura tellement froid.
Comme doit être grande sa solitude !
Tu n’imagines pas
comme ces injustices font mal.
Elles sont normales chez nous.
Ce qui est anormal, c’est la tendresse
et la haine de la pauvreté.
C’est pourquoi plus que jamais
j’aime ton monde.
Je le comprends,
le glorifie,
abasourdi d’orgueil cosmique.
Et je me demande :
Pourquoi chez nous
les vieux souffrent-ils tant
alors que nous serons tous vieux un jour ?
Mais le pire de tout,
c’est l’habitude.
L’homme perd son humanité
et l’énormité de la douleur d’autrui
n’a plus d’importance pour lui,
et il mange,
et il rit,
oublieux de tout.
Je ne veux pas
de ces choses
pour ma patrie.
Je ne veux
de ces choses
pour personne.
Je ne veux
de ces choses
pour personne au monde.
Et je dis,
pourquoi la douleur
doit-elle avoir
son auréole bien ajustée ?
C’est ce qu’ils appellent le monde libre.
Compare ce que je suis et ce que j’étais.
Et dis à tes amis
que mon rire
s’est changé en grimace
grotesque
au milieu de mon visage.
Et que je leur dis d’aimer leur monde
et de le construire beau.
Et que je me réjouis beaucoup
de ce qu’ils ne connaissent plus
d’injustices
si profondes et nombreuses.
*
Intellectuels apolitiques (Intelectuales apolíticos) par Otto René Castillo
I
Un jour,
les intellectuels apolitiques
de mon pays
seront interrogés
par l’homme
simple
du peuple.
Il leur demandera
ce qu’ils faisaient
quand
la patrie mourait
lentement,
comme une flamme légère,
petite et seule.
Il ne les interrogera pas
sur leurs costumes
ni sur leurs longues
siestes
après le déjeuner,
ni sur leurs stériles
combats contre le néant,
ni sur leur ontologique
façon
de chercher de la menue monnaie.
Ils ne seront pas interrogés
sur la mythologie grecque
ni sur le dégoût de soi
qu’ils ressentaient
quand quelqu’un en son for intérieur
délibérait de mourir lâchement.
Il ne leur demandera rien
au sujet de leurs justifications
absurdes
grandies à l’ombre
d’un mensonge complet.
II
Ce jour-là viendront
les hommes simples,
ceux qui ne figuraient jamais
dans les livres et les vers
des intellectuels apolitiques
mais qui leurs apportaient chaque jour
le lait et le pain,
les œufs et les tortillas,
ceux qui raccommodaient leurs costumes,
ceux qui conduisaient leurs voitures,
ceux qui gardaient leurs chiens et leurs jardins,
et qui travaillaient pour eux,
et ils demanderont :
« Que faisiez-vous quand les pauvres
souffraient et que se consumaient en eux
petit à petit la tendresse et la vie ? »
III
Intellectuels apolitiques
de mon cher pays,
vous ne saurez que répondre.
Vous sentirez un vautour de silence
vous dévorer les entrailles.
Votre propre misère
vous rongera l’âme
et vous vous tairez,
honteux de vous-mêmes.
*
Nous autres, sur la Terre (Nosotros, en la Tierra) (1967) par Julio Fausto Aguilera
Il existe des passions cosmonautes,
des passions médaillées,
comme d’un scaphandrier qui a touché le fond.
Des hommes se dressent
pour atteindre la Lune ;
elle, auparavant si lointaine,
seulement princesse de contes fabuleux ;
elle, la Lune, jusqu’alors attrapée seulement
par le miroir des eaux dormantes,
a bel et bien été atteinte par les mains
de quelques hommes terrestres
qui ont planté un drapeau puis un autre dans ses steppes,
ont baptisé ses arides montagnes
et maintenant se répartissent la conquête.
Pendant ce temps,
ici sur notre planète,
sur notre vieille Terre,
c’est le désarroi.
Cette Terre,
infime et dédaignée,
est pourtant immense ;
il y a tant et tant d’hommes
qui, habitant cette planète,
n’ont point parcouru la millionième partie
de sa vaste surface.
Et des milliers, des centaines de milliers, des millions
ne possèdent, pourtant si grande notre Terre,
le plus petit terrain
où construire une maison
pour s’abriter
du soleil, qui est encore soleil et brûle,
et de la pluie, qui est encore pluie et mouille ;
encore moins nombreux ceux qui possèdent
une parcelle où semer du grain
pour faire de la farine. Et qui ont faim.
Les cosmonautes,
ambitieux poètes,
entreprennent des vols difficiles ;
ils rêvent de conquêtes transcendantes ;
ils entonnent, fascinés,
un hymne de résonance universelle.
Mais nous autres, les poètes
peinés pour cette multitude d’hommes ;
nous,
chair de leur chair souffrante,
nous devons rester ici sur cette Terre,
sur cette Terre infime
mais en même temps si grande, si vaste de douleurs ;
Terre si spacieuse
et si étrangère, héritage d’un petit nombre.
*
Pétition pour ma patrie (Petición por mi patria) (1965) par Julio Augusto Aguilera
Pour ma patrie maya,
je veux un huipil resplendissant, avec des odeurs de neuf ;
un huipil où brillent
– soleil et couleur, sans pénombres d’angoisse –
les vergers
d’un printemps infini.
Pour ma patrie, émaciée
par le châtiment et la faim,
je veux, donnez-moi un plein panier
des fruits de cette terre ;
un panier très profond
car la faim est très profonde.
Donnez-moi une cruche inépuisable
de bleus, de célestes contenus
pour la soif de mon âme.
Et que l’oiseau cenzontle
de son âme chantante
se répande en un son intense, un son
aborigène et magique
qui dans toutes les âmes du monde danse.
Pour ma patrie enfant, je veux une piñata,
je veux une piñata pleine de joies,
de joies de toutes saveurs,
pour être brisée un jour de réjouissance universelle,
au milieu des chansons, des accolades et des cris,
au milieu de tous les enfants :
parmi tous les peuples frères de la terre.

Piñata : “Pour ma patrie enfant, je veux une piñata” (Photo Enrique Núñez Mussa)
*
C’est seulement un rêve que nous rêvons… (Solo un sueño, soñamos…) (1965) par Julio Fausto Aguilera
Tout bien considéré, ma sœur,
je te dis
que nous n’avons pas de patrie.
Que cet horizon que nous embrassons
chaque jour du regard,
que ce sol que nous baisons
chaque jour de nos pieds,
sont seulement le matelas fleuri de nos rêves.
Nous rêvons, oui ; nous rêvons
quand nous parlons de patrie ;
nous ne faisons que rêver
comme le paria allongé au bord du chemin
rêve d’un lit avec draps et oreiller,
rêve d’une lampe et d’un livre sous un toit,
rêve d’une tasse de boisson chaude
parfumée par la main d’une épouse…
Nous rêvons, ma chère, en contemplant cet espace
où serait tellement belle
notre maison, la maison de tous, la Patrie…
Car la patrie, ma sœur, est une maison :
grande, confortable, propre, peinte comme il faut,
blanche à l’intérieur, et habitée
par des gens très aimables qui sourient ;
des gens rassasiés, satisfaits,
de fraternelles gens, sans procès ni condamnations ;
tous travailleurs, tous se levant de bonne heure ;
chantant à qui mieux mieux,
chantant au travail, chantant le soir,
dialoguant avec les étoiles,
tutoyant les astres…
(En un mot, quelles gens immenses !)
Mais, tu vois bien,
ici
il n’y a que cet opulent paysage de volcans,
de rivières, de vergers avec des oiseaux et des orchidées…
terre opulente, vierge,
mère fertile
qui appelle des bras mats et forts,
des bras qui la fécondent et recueillent ensuite
le fruit de son amour fait aliment…
Mais la terre n’est pas libre de se donner aux bras
ni les bras ne sont maîtres de se donner à la terre !
cette vallée a tellement envie d’accueillir notre maison
mais la maison, la Patrie, n’est qu’un rêve… un rêve !
Au pied des volcans, sur le bord de la vallée,
nous vivons, mon cœur, exposés aux intempéries ;
nous mangeons et nous dormons, frères de ces gens
aux si rudes manières, désagréables, tristes,
maltraités, furieux…
et n’est-ce pas à juste titre puisqu’ils sont maltraités,
puisqu’ils mangent si mal – puisqu’ils n’ont quasiment pas mangé ;
puisque leurs pieds dans leurs chaussures trouées,
dénudés se perdent en d’obscurs chemins
où les traînent de pesants fardeaux,
des fardeaux horribles qui pèsent quatre siècles,
qui pèsent quatre cents ères d’abjection…
Ainsi, bien sûr, nous aussi vivons-nous
maltraités, enragés, renégats…
Comme il m’en coûte de croire
que c’est en ce lieu et parmi ces gens
que je bois ma tasse de café tous les matins !
Seulement pour ne pas fracasser la tasse au sol
et m’anéantir en même temps corps et âme
en me jetant au fond d’un ravin !
Parce que je rêve qu’un jour
tes mains et mes mains caresseront
en terrestre réalité, fleuris
– comme une floraison subtile de champs de maïs et de coquelicots –
ces rêves qui sont les nôtres,
ces rêves
de paria abandonné au bord du chemin !
*
Le poète va en prison (El poeta camina hacia la cárcel) (1963) par Julio Fausto Aguilera
Je vais en prison
car je suis une voix libre.
Pour que je sois plus libre encore
c’est en prison qu’ils me conduisent.
Car j’appartiens autant à la prison
que m’appartient la liberté :
qui aime sa douce amie
doit supporter sa sœur méchante.
Si la douceur m’enivre,
la dureté ne me brise pas ;
c’est que je suis de bois dur,
de bois beaucoup frappé.
Dans l’agonie du jeûne,
dans la léthargie du froid,
c’est ainsi que je serai plus fort,
c’est ainsi que je serai plus vivant.
Là où je serai seul
dans une obscurité de cachot,
là sera la liberté
avec sa lumière collective.
Je suis redevable à la liberté,
j’ai une très grande dette envers elle ;
et comme je lui suis redevable, je dois
la payer, car je suis honnête.
Elle me donne chaque jour,
aussi est-il juste qu’à présent je la paye
en monnaie de loyauté
battue dans une prison.
Liberté, continue à me donner
puisque je te paye mes dettes.
Conduisez-moi en prison
pour que je sois encore plus libre.
*
Portrait de mon quartier (Retrato de mi barrio) par Francisco Acevedo
Dans mon quartier il y a des garçons et des filles.
Les garçons de mon quartier
jouent avec la boue.
Les filles de mon quartier
jouent avec des poupées de chiffon.
Dans mon quartier il n’y a pas d’école.
Dans mon quartier, Juan, Blas, Pedro et les autres
se saoulent pour cacher
leur peine.
Dans mon quartier coule une rivière.
Les femmes de mon quartier
tissent un rosaire d’espérances
avec les bulles de savon.
*
Épître irrévérencieuse à Jésus-Christ (Epístola irreverente a Jesucristo) (1963) par Romelia Alarcón Folgar
I
Christ
descends de ta croix et lave-toi les mains,
lave-toi les genoux et les flancs,
peigne tes cheveux,
chausse tes sandales
et confonds tes pas
avec tous ceux qui te cherchent
par les cordillères et la mer,
par monts et par vaux,
dans les airs,
le long des clôtures de barbelés des routes.
Tu résous toute chose,
pour Toi tout est facile,
alors
qu’attends-tu ?
pourquoi ne descends-tu pas à l’instant de ta croix ?
sans paraboles, avec des balles
et des pavés vengeurs
dans la main.
Et que les villages se remplissent d’hommes libres
et du soleil de midi,
de jardins, de colombes et de roses
aux corolles intactes
et que des clairons annoncent
les matins pacifiques.
Christ,
à présent descends de ta croix,
où des myriades de gens
sont crucifiés avec toi :
lave tes mains et leurs mains,
tes genoux et leurs genoux,
ton flanc et leur flanc,
lave ton front et leur front
couronnés d’épines.
Que cesse ton martyre immobile,
montre ta colère,
descends maintenant de ta croix,
mêle-toi aux hommes qui t’aiment.
II
Tu tombes comme l’aurore avec des bruits de forêt
sur toutes choses.
Ton littoral d’étoiles avec des myriades d’yeux.
Ton grand visage couché dans les airs.
Sur ta poitrine au large.
Double route de camions et de barques.
L’approche de ta barbe incendie les ronces ;
ton haleine fait ployer les montagnes.
Tu es puissant, tes mains en de lointaines époques
carbonisèrent des Sodomes,
rompirent des amarres de pluie,
et des hommes furent changés en statues de sel.
Peut-être ignores-tu, Jésus-Christ,
que s’est libéré ton ennemi le démon ?
Les ossements des hommes en hurlant
rôdent autour de fosses ouvertes.
Les hommes ferment des cercueils.
Charpentier !
depuis ta clarté tous les arbres
ont la taille de sarcophages.
C’en est fini de l’innocence de l’atome,
de la douceur du vent,
du cœur bleu de l’eau
et des harpes revêtues de ta présence.
Des clameurs de mains s’élèvent
cernées de vautours.
Des bouches sans avenir te nomment.
Descends de ton trône céleste
prisonnier du ciel,
parcours la boue de la terre.
Peut-être
qu’à l’ultime Cène du monde
Judas te baisera la joue.
III
Vaste silence d’améthystes,
présente stature quotidienne.
Ta couronne d’épines, la lance de Longin,
sans diamètre ni pause,
dans le flot humain répétées.
À l’ordre du jour,
seulement des cœurs pendus aux branches,
le cri des villes fusillées,
et la sueur des visages sans suaire
et Toi jouant sur des harpes
sans usage pour les oreilles terrestres.
La lumière pend de ton habit,
le long de ta peau descend le jour,
le blé pousse sur la trace de tes pas.
Il est si simple d’emmagasiner le plaisir dans les granges :
d’engranger les fruits éblouissants,
de brandir les poings coupés,
les abeilles noires de la mort.
Au moins
permets aux enfants de t’entourer
envahissant les terrains défendus par des barbelés
et les femmes
aux yeux mangés de larmes
de toucher ton vêtement.
Que se posent tes paroles – rosée –
sur les parcs et les champs ;
perpétue le Sermon de la Montagne
sur la place semée de poignards.
Fais taire le chœur des saints,
ordonne aux oiseaux de faire silence
pour écouter les hommes pleurer ;
les ossements qui disent ton nom
brisés dans la poussière ;
parcours ainsi que Dante
les enfers de l’homme.
Fais vite un miracle au nom du Père,
confirme que tu existes
par une nouvelle Résurrection.
*
Du sang au paradis (Sangre en el paraíso) par Manuel José Arce (Manuel José Leonardo Arce Leal)
En somme, il ne se passe rien :
je perds mon sang.
Je sais que mon hémoglobine répandue
est comme une bave d’ivrogne face à la bombe atomique :
en somme, il ne se passe rien.
Et si je suis malade,
de même sont morts de faim des centaines de milliers de milliards
d’autres.
Et si je bataille en ce moment en mon for intérieur,
si je lutte contre moi-même,
Nasser et Ben Gourion grondent menaçants l’un contre l’autre
et ça c’est quelque chose qui fait peur.
S’ils me donnent envie de frapper mon ombre,
d’assassiner mon miroir,
de fusiller dans le dos ma garde-robe et mon fauteuil,
en réalité il ne se passe rien :
ils disent que Cuba possède des missiles,
que Mao a envie de les tirer,
que s’il les tire c’est plié
pour tout le monde.
En somme, il ne se passe rien :
je perds mon sang.
Et c’est seulement que perd son sang le citoyen
A-1 19 90 03 de la minime ville de Guatemala,
où tant de gens perdent leur sang,
perdent leur sang pour de vrai,
par des blessures légitimes,
par balle,
à cause de ne pouvoir manger,
à cause d’être pauvres et malades et de travailler.
En somme, il ne se passe rien :
je perds mon sang.
Les médecins disent que le corps contient
plus ou moins six litres de sang en tout,
que si l’on en perd trois,
rien,
on meurt.
En somme,
il ne se passe rien :
de vingt-quatre millions cinq cent mille six cent quatre-vingt-quatre litres
trois petits litres seulement ont été versés :
en somme, il ne se passe rien.
Il ne se passe rien,
non,
il ne se passe rien.
Je me dis qu’il ne se passe rien.
***
Pour des traductions de poésie révolutionnaire cubaine et nicaraguayenne, cliquer sur les liens.