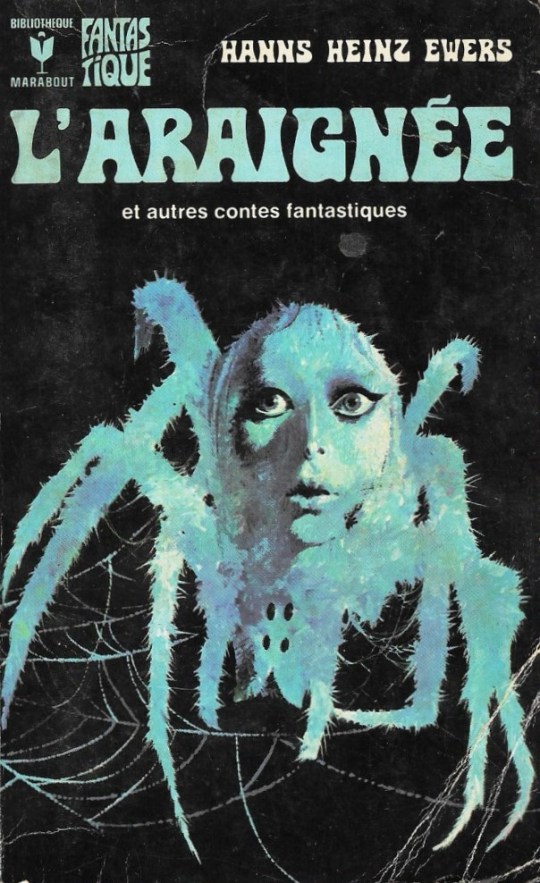Tagged: poésie
Moganni Nameh : La poésie de Hanns Heinz Ewers
L’écrivain allemand Hanns Heinz Ewers (1871-1943) est surtout connu pour ses romans et nouvelles fantastiques, traduits dans de nombreuses langues, dont le français. Dans ce genre, il fait figure de classique, avec des romans célèbres tels que Mandragore (Alraune). À notre connaissance, il n’existe cependant pas de traductions de sa poésie dans la langue de Molière à ce jour, sauf pour les poèmes tirés de ses romans.
Sa poésie a été réunie en 1910 dans un recueil intitulé Moganni Nameh, complété en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, par son éditeur, qui ajouta quelques chants de guerre écrits dans ces années-là. Nos lectures de Paul Déroulède ne nous laissaient pas attendre grand-chose d’un tel ajout, mais nous avouons avoir été surpris par l’intérêt et la qualité littéraires de ces pièces ; nous n’en avons cependant pas retenu dans le présent billet (peut-être plus tard). Il ne semble pas que H. H. Ewers ait écrit d’autres poésies par la suite.
Un mot sur le titre du recueil. Ce titre en persan est emprunté au poète Hafiz via le Divan occidental-oriental de Goethe, dont le premier livre s’appelle « Moganni Nameh », ou « Le livre du chanteur ».
Dandy balafré (voir photo), peut-être à la suite d’une Mensur, c’est-à-dire un duel traditionnel au sein des fraternités étudiantes, H. H. Ewers fut un écrivain à succès, que ses travaux comme scénariste et co-réalisateur placent également parmi les pionniers du cinéma allemand. Peu satisfait, cependant, des conditions sociales de la République de Weimar, il adhéra en 1931, donc relativement tôt, au parti national-socialiste et servit un temps la propagande de ce mouvement, avant de présenter cette étonnante particularité d’être un national-socialiste dont l’œuvre fut interdite par les autorités du Troisième Reich, en 1934. Il passa les dernières années de sa vie à contester cette censure et parvint à publier un dernier recueil de nouvelles peu avant sa mort, en 1943.
*
J’ai cueilli des fleurs
(Blumen brach ich)
.
Iris
Ndt. Iris est, en allemand comme en français, la personnification de l’arc-en-ciel, et la fleur est ici décrite de façon qu’elle puisse être perçue aussi comme un arc-en-ciel.
Brume du matin, brume déliée du matin
qui tout autour flotte encore,
couvre encore le soleil, à peine sorti,
d’un halo humide,
quand le vagabond marche
d’un pas léger
dans l’haleine de la terre jeune,
quand énergique il va
à travers les prés mouillés,
quand il va,
va toujours,
d’un pas léger.
Ainsi pousse l’iris couleur bleu de flamme
solitaire et silencieux
à travers l’humide
brume du matin,
ainsi pousse-t-il
à travers les prés
mouillés – –
Demande au vagabond où il va,
demande-lui pourquoi il va solitaire –
silencieux, il haussera les épaules
et continuera de marcher
d’un pas léger,
sans s’arrêter.
– Cette marche est sans raison, sans objet, sans but,
sans fin :
n’est que mouvement, impulsion, élan
à travers l’humide
brume du matin
et les prés
mouillés – –
Tu entends encore au loin le pas léger
du vagabond,
tu vois encore au loin l’iris
briller – –
Connais-tu donc ce voyageur
là-bas dans la brume ?
Connais-tu, bleu de flamme,
cet iris ?
Ô tu le connais,
puisque c’est toi-même !
*
Orchidées (Orchideen)
Quand le diable devint femme,
quand Lilith
noua ses cheveux noirs en lourdes torsades
et coiffa sa tête pâle
de boucles pensées par Botticelli,
quand, lasse et souriante,
à ses doigts minces elle passa
des anneaux d’or sertis de pierres de couleurs,
quand elle lut Villiers de l’Isle-Adam
et goûta fort Huysmans,
quand elle comprit le silence de Maeterlinck
et baigna son âme
dans les couleurs de Gabriele d’Annunzio,
– – elle rit.
Et comme elle riait,
la petite princesse des serpents
sauta hors de sa bouche.
Alors, la plus belle des diablesses
frappa le serpent,
frappa la reine des serpents
d’un doigt qui portait un anneau.
Si bien que le serpent se convulsa, siffla,
siffla, siffla
et cracha.
Mais Lilith rassembla les gouttes
dans un lourd vase de cuivre
et dessus jeta
de la terre humide,
de la terre humide et noire.
Sans réfléchir, ses grandes mains
caressèrent les flancs
du lourd vase de cuivre ;
sans réfléchir, ses lèvres pâles
entonnèrent leur vieille malédiction –
Sa malédiction ressemblait à une comptine pour enfants,
douce et lasse, lasse comme les baisers
par lesquels sa bouche
but la terre humide.
Mais la vie leva dans le vase,
et attirés par ses baisers las,
attirés par sa douce mélopée,
lentement, hors de la terre noire rampèrent
des orchidées –
Quand ma bien-aimée
dans le miroir coiffe ses traits pâles
des couleuvres de Botticelli,
des orchidées
rampent le long des flancs du vase de cuivre –
Fleurs du diable, que la vieille terre,
unie par la malédiction de Lilith
à de la bave de serpent, a poussées à la lumière,
orchidées
– fleurs du diable.
*
Les jacinthes (Hyazinthen)
Je cueillis des centaines de jacinthes
et posai mes jacinthes de couleurs
sur un drap de soie blanc –
grandes jacinthes rouges,
grandes jacinthes violettes,
jacinthes jaunes, blanches, bleues.
Alors je penchai ma tête au-dessus d’elles,
j’y enfonçai mon front et mes tempes,
plongeai dans les jacinthes de couleurs.
Et je baisai mes grappes de couleurs,
toutes ces grappes blanches, rouges, jaunes,
me baignai dans le parfum des jacinthes.
De merveilleuses et délicates mains de femme
me caressaient –
et sur de merveilleux seins de femme
ma tête reposait –
Des baisers de femme me fermèrent les yeux,
et ma gorge était pressée par de merveilleusement doux
et tendres bras de femme.
Ô je sens ces baisers légers
pénétrer ma peau avec d’imperceptibles tremblements,
peu à peu dissiper ma grande souffrance.
Ô je sens ces mains si fines
caresser, charmeuses, mes boucles humides,
refermer peu à peu des plaies profondes.
Et de ces mains de femmes et baisers de femmes
s’exhale le parfum de corps délicats de femmes,
le merveilleux parfum de corps de femmes.
Doux parfum qui m’enveloppe comme une brise d’été
sur de blancs battements d’ailes
et dont l’harmonie, en vagues tendres,
traverse chaque fibre de mon corps.
Doux parfum ! Contre une fraîche poitrine de femme
se blottit ma joue chaude comme une forge ;
et dans le crépuscule chancellent mes sens
dans le doux parfum de poitrines de femmes.
– – Des jacinthes, j’ai cueilli des jacinthes,
des centaines et des centaines de jacinthes,
j’ai plongé ma tête dans les jacinthes de couleurs.
Et j’ai nagé dans des baisers de femmes,
dans le parfum de doux seins de femmes,
dans le doux parfum des jacinthes.
*
Les châtaigniers (Kastanien)
« Kathlin Mac Murdoch !
Tel est mon nom ! »
– Et de seulement l’entendre dire son nom,
tu penses :
inassouvie1 !
S’il te plaît,
regarde
la façon dont elle écarte ses longs doigts –
regarde
comment ces lèvres de magnolia
restent ouvertes,
tandis que, humide haleine de Satan,
entre les dents serrées
rampe son souffle.
Et maintenant
regarde
comment les minces narines
s’enflent en aspirant –
voilà : cette sorcière
boit voluptueusement
l’haleine de phallus
des fleurs de châtaignier.
– – Oui, je te le dis, mon ami :
Kathlin Mac Murdoch,
qui affamée d’amour a traversé des mondes, échevelée,
a servi Aphrodite et embrassé Sappho,
s’est livrée aux turpitudes à Sodome – –
Kathlin Mac Murdoch,
qui aux messes de Satan
– Philopygos2 !
fut prêtresse – –
– elle – –
boit du parfum – –
dans les fleurs – !
Vois !
Elle est assise immobile à sa fenêtre,
et immobile
dehors se dresse le géant,
le châtaignier – –
Large, fier, immobile
il étend ses branches puissantes,
dont chacune
porte des cierges sacrificiels en fleur.
Et maintenant tu vas entendre le plus inouï :
cette femme,
Kathlin Mac Murdoch,
fornique avec cet arbre !
Aspires-en le parfum – toi aussi !
Qu’est-ce que cela sent ?
– Tu comprends à présent ?
C’est l’éternel parfum triomphal,
le parfum sauvage,
l’unique, le parfum bâtisseur de mondes,
dont la source est le phallus !
Elle est assise là,
Kathlin Mac Murdoch,
enveloppée par la pluie,
qui est vie pour elle – –
elle est assise et boit
par tous les pores de sa peau
l’haleine voluptueuse d’un homme,
elle, femme, femme,
sexe seulement
de la tête au pied !
Incline-toi si tu es artiste !
Car ce que tu peux voir là,
c’est un relent rare de cet effroyable feu
qui brûla Salomé, consuma Salammbô :
– Inassouvie1 !
1 inassouvie : En français dans le texte (deux fois).
2 Philopygos : Qui aime les fesses.
*
Les baies du frêne (Eschenbeeren)
Ndt. Le poème fait manifestement allusion à une croyance populaire relative à l’ombre de certains arbres, sous laquelle on ne se reposerait pas sans être saisi de visions. Le poème – tableau de la vie des steppes d’Europe orientale – oppose la réaction d’une paysanne rejetant le mélancolique vague à l’âme provoqué en elle par ces visions à celle du poète, qui réclame leur présence douce-amère.
Ce frêne rouge
pousse en Orient,
entre les cinq fleuves,
mais encore là où la fille
du grisonnant cosaque
aux jambes arquées, à la barbe de bouc
aide son père à descendre de l’alezan fourbu
quand il revient le soir
de ses chasses à travers la steppe ukrainienne.
– Elle rompt la branche,
jetant les baies rouges
aux oiseaux piailleurs,
mais les feuilles
en sont mangées de sa main par la chèvre blanche.
– Qu’y a-t-il, jeune fille ?
Ta poitrine frissonne
et sur tes mains bronzées
l’amie barbichue lèche des gouttes salées –
– Qu’y a-t-il, femme des champs ?
As-tu perdu un chevreau ?
ta chère mère est-elle tombée malade ?
ou bien ton céladon t’a-t-il insolemment frappée de sa cravache ?
– « Je n’ai pas perdu de chevreau,
ils sont là tous les sept
à gambader gaîment dans le trèfle bigarré ;
ma mère n’est pas tombée malade,
à l’intérieur de la chaumière
elle emperle les souliers de sa chère fille ;
et dans la steppe
le plus fringant des hommes vole,
zébrant le crin de sa cavale :
c’est là qu’il frappe allègrement de sa cravache,
jamais sa brune amie !
– Dans la Volga jaune
j’ai lancé des baies rouges ;
dans le frêne
bruissent, murmurent les feuilles,
il y a des bourdonnements dans l’air ;
ce qui me dilate la poitrine,
je ne sais, je ne le connais pas :
ce sont des rêves confus !
– Laissez-moi en paix, attrayantes images,
je ferme les yeux :
Jamais plus je ne me reposerai à ton ombre,
frêne rouge ! »
Frêne rouge aux branches tombantes,
lourdes branches pleines de baies rouges,
jette sur moi ta grande ombre fraîche ! –
Je t’en suis reconnaissant –
– Bruisse, murmure,
il est doux d’avoir de nouveaux rêves,
et plus doux encore d’oublier les rêves anciens.
*
Les heures de l’âme
(Stunden der Seele)
.
Tat tvam asi !
Ndt. « Tat tvam asi » est une formule sanskrite, signifiant « Tu es cela », popularisée par Schopenhauer, qui résume avec elle sa philosophie selon laquelle, par-delà l’individuation à l’œuvre dans le monde des phénomènes, nous appartenons tous à la même nouménalité, nous sommes tous la même chose en soi, si bien que le sujet pensant, devant toute chose peut se dire : « Tu es cela. » Le poète reprend la formule selon une acception personnelle.
La nuit tombant,
mes regards se portent sur la campagne :
je vois un homme,
presque un géant,
marcher d’un pas vigoureux,
cependant courbé
comme si sur ses épaules
pesait un lourd fardeau
le ployant vers le sol.
Mate et nue
sa chair brille dans le soleil couchant,
son poing serre
un fouet massif
avec lequel, frappant les nuages et le brouillard,
il les réduit en flocons, en lambeaux.
Sourd et creux
résonne le pas de sa marche
vers le soleil,
chaque pas,
sourd et creux.
Parvient-il à son but ?
À quel homme il ressemble,
je ne le sais que trop !
Derrière lui tu vois
une traînée rouge
sur la verte campagne.
C’est le sang de larges plaies
que des mains invisibles
lui ont ouvert dans le dos,
aujourd’hui comme hier, à toute heure –
Purulentes, elles creusent dans le cœur
des trous sanglants, profonds –
– La souffrance qu’elles causent,
je ne le sais que trop !
Toi, l’artiste,
tu dois me peindre comme cela :
la victoire au front, mais dans le dos
de rouges, de sanglants
tourments insoutenables.
– Nostalgie de soleil dans le regard brillant,
et sur la nuque
la mort.
*
Destruction (Vernichtung)
– – As-tu vu
la souffrance sans bornes de mon âme – ?
– maudite !?
As-tu vu, reine rouge de la mort,
les convulsions de mon cerveau ?
Lentement la louve blanche enfonçait
dans ma gorge le feu brûlant de son poison,
– plomb fondu…
lentement elle répandait de ses mains fines
le sel et la poussière sur mes plaies à vif ;
– – puis violemment elle m’arracha
les ongles –
elle arracha mes yeux
de leurs orbites sanglantes !
Amusant ! amusant ! – Oui, la louve blanche
fit suer mon corps sang et larmes,
cependant mon âme fière en riait !
Mais toi, maudite fée de la mort,
tu souffles sur moi avec tes lèvres maudites,
tu caresses mon cerveau avec des doigts humides :
– – et la matière à l’intérieur de mon crâne fond, gluante,
fermente, et se répand, et pue, par la bouche et le nez !
Cependant, mon âme, mon âme fière,
pourrit et meurt dans des affres lamentables,
pourrit et meurt – – et dans cette décomposition avancée
te voue ses oraisons, ô déesse de la pourriture.
*
Galehaut (Galeotto)
Noi leggiavamo, un giorno, per diletto,
di Lancialotto, come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
Dante, l’Inferno V. 127 ff.
Ndt. Traduction de L’Enfer de Dante par Marc Mentré : « Nous lisions un jour par plaisir comment amour saisit Lancelot ; nous étions seuls et sans aucune crainte. … Galehaut fut le livre et celui qui l’écrivit. » Galehaut servit d’entremetteur entre Guenièvre et Lancelot ; dans le récit de Dante, Francesca da Rimini appelle Galehaut « le livre » lu à deux avec Paolo Malatesta car ce livre, décrivant un baiser, fut l’occasion, de même, forcément, que l’auteur du livre. Dans son poème, H. H. Ewers conclut en disant que c’est le monde tout entier qui est entremetteur entre deux personnes qui s’aiment.
Nous lisions un jour – – qu’était-ce donc, Iseult ?
Un jour d’été parmi le chèvrefeuille –
le petit livre était rouge à tranche d’or –
sur ton épaule reposait la docile tourterelle –
nous étions seuls, et tout autour de nous était
silencieux comme une tombe, aucun souffle d’air ne remuait les feuilles –
nous lisions – était-ce le tourment d’amour
du couple de Rimini, transpercé par une lance ?
Était-ce la chanson du rêve de Lancelot ? –
Qu’était-ce donc ? – Était-ce le chant sans joie,
d’un cœur lourd, qu’écrivit Echegaray ?
Était-ce le voyage de Tristan sur une mer ivre d’amour ?
Je ne sais ce que c’était, mais j’ai gardé
à l’esprit comme était douce, sur ma main,
ta main quand tu l’y posas, mon amour.
Et mes doigts dénouèrent tes tresses
– tu me regardas dans les yeux, et dans ce regard
était, tout au fond, le mot magique, et vrai.
Le mot juste, au moment propice.
Nos cœurs battaient et le soleil brûlait
et le destin requérait nos âmes.
– Dense était le feuillage enveloppant notre amour ;
nous étions seuls sous cette tente verte –
transportés par une chère fée au pays des contes.
Tu étais la reine et moi le héros ;
le prince entremetteur connaissant notre amour,
Galehaut – ce fut le monde entier !
*
Le rubis (« Gioia ») (Der Rubin [„Gioia“])
Cardan : De vita propria cap. XLIII
de somniis cap. IV
de somniis cap. XXI
de subtilitate p. 338
« Porte à tes lèvres le rubis rouge,
place-le doucement sous ta langue,
penche-toi en arrière et ferme les yeux ! »
Les flammes lécheuses dévorent,
mordent le cœur, le cerveau fatigué,
flammes claires, flammes chaudes,
flammes de feu du calvaire du Fils –
« Baise le rubis,
le rubis rouge,
baise-le, baise-le ! »
C’était un empoisonneur, le très-cher, le bien-aimé ;
de douloureux parfums, blessés parfums,
tournoient dans le feu autour des bûches,
verts parfums dans les flammes rouges –
« Baise le rubis,
ferme les yeux ! »
Poète de la fumée ! Un brouillard épais
trouble le regard,
couvre la pièce.
Brume volatile
qui rafraîchit les tempes fiévreuses,
caresse le cerveau.
– – Des images s’élèvent, images bariolées,
des formes minces en robes blanches ;
elles répandent des fleurs, répandent des feuilles,
onduleuses feuilles de pavot rouge.
– Des harpes jouent,
des sons apaisent,
des parfums t’enveloppent ;
l’air s’anime :
À ta paix !
« Baise le rubis ! »
*
Les chansons de la blonde Katie
(Die Lieder von der goldenen Kätie)
.
Toi depuis la droite… (Du von rechts…)
Toi depuis la droite et moi depuis la gauche,
nous marchions sur le chemin,
sans nous connaître et – pourtant nous connaissant,
au diable cette incroyable histoire –
tu venais de droite et moi de gauche
sur le même chemin.
Ma sphinge blonde marchait à petits pas
sur l’étroit chemin –
nous nous aimâmes et – ne nous aimâmes point,
nous nous serrâmes la main, bonjour, ça s’est passé comme ça,
toi depuis la droite et moi depuis la gauche
un bout du même chemin.
Nous sommes fous et des fous tout autour
nous accompagnent sur le chemin.
Nous rions d’eux et – nous ne rions pas.
– Nous regardons voleter le papillon ;
il va de droite, il va de gauche,
folâtre sur le chemin.
L’or scintille dans la coupe – trinque et bois :
vive notre petit bonhomme de chemin !
Nous nous reverrons sans doute – ou nous ne nous reverrons pas –
Qu’est-ce que ça peut faire ? Sois folâtre, sphinx blond,
bise-moi sur la droite et bise-moi sur la gauche
sur notre petit bonhomme de chemin !
*
Ce matin, avant de me séparer de Katie… (Eh ich diesen Morgen mich von Kätie trennte…)
Ce matin, avant de me séparer de Katie,
elle me dit : « Écoute bien, si tu veux
que je t’ouvre ma porte ce soir
quand tu frapperas et m’appelleras, ‘Katie, Katie’,
si tu veux que je t’embrasse sur la bouche,
que je dorme avec toi cette nuit,
mes bras passés autour de ton cou,
Hanns – – ce matin il faut
t’asseoir à ton bureau, de même que l’après-midi
et jusqu’au soir – pour composer des chansons,
de jolies chansons à ta blonde Katie ! »
Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère –
Dans la maison d’artistes au bord du cher Rhin perfide3
il y a sur un épais tapis un vieux fauteuil
à côté de la cheminée.
Et dans ce fauteuil tu es assise,
devant toi je m’agenouille –
que signifient ces larmes sans raison ?
Mais dans le crépuscule brille ton œil las –
il comprend mes larmes.
– Elles coulent lentement sur les veines bleues
de tes mains,
comme une nostalgie de paix éternelle :
mes larmes – –
Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma mère.
Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.
Là où près du bleu Léman murmure le Rhône bleu,
sur la petite île où Rousseau rêva,
où des ormes séculaires couvrent l’azur rayonnant du ciel
et le soleil riant de l’après-midi,
mon enfant est assise sur mes genoux.
Ma petite fille écoute murmurer le Rhône,
écoute bruisser les feuilles des ormes
et ma voix roucouler
en racontant des contes bruissants – –
Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma fille.
Blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme.
Sur Ravello brille la lune, la toute-puissante lune,
illuminant la cité sarrasine.
Et les nuages brillent
ainsi que la montagne
et la profonde mer italique.
Nous sortons de notre palais
sur le haut balcon
et regardons cette imposante
et mystérieuse splendeur – –
Ton bras se sépare du mien
et se pose sur mon épaule,
mais du fond de ta poitrine
viennent les mots :
« Je t’aime. » – –
Ô blonde Katie, je voudrais que tu sois ma femme !
Blonde Katie, tu es ma reine.
Tu es ma mère,
qui comprend
ces larmes sans raison.
Tu es mon enfant sage,
qui voyage sur mes genoux,
écoutant mes rêves chanter,
tu es ma femme fière
qui me donne son corps et son âme
par les mots
« Je t’aime ».
Ô blonde Katie, ma reine bien-aimée !
3 le Rhin perfide : Allusion à l’opéra de Wagner L’or du Rhin. Une autre allusion à Wagner, plus bas, est Ravello en Italie, rendue célèbre, au moins pour « la tribu wagnérienne » (selon l’expression de Pío Baroja), par son maître.
*
Sensibilités
(Empfindsamkeiten)
.
Mère (Mutter)
Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !
– Vois, je m’agenouille devant toi aux heures du crépuscule
et baise les plaies profondes de ton cœur :
rêve au bonheur, ô mère, rêve au bonheur !
Mère, chère mère, ô rêve à ton bonheur !
– Pose ta tête sur mes bras forts ;
loin de la souffrance et des maux quotidiens
le pont bigarré de mes chansons te conduira.
Des banderoles enguirlandent gaîment mon voilier,
– Il se rend à Avalon, au pays des fées !
Mère, me vois-tu à la barre ?
Viens-tu avec moi ? Et – est-ce que tu ris, chère mère ?
Des nénuphars ! – Regarde comme je les cueille !
Les vagues clapotent ! – Le vent pousse la voile joyeuse !
On voit au loin de blancs oiseaux migrateurs – –
Ah, tu rêves enfin, mère, tu rêves au bonheur !
*
La jeune fille parle (Das Mädchen spricht)
Quelque part – – quelque part
loin dans le vaste monde
un jeune cœur m’attend.
Attend dans la douleur,
rouge comme la braise, gonflé d’amour –
Où ? – – où ?
Un jour – – un jour,
loin dans le cours du temps,
deux bras m’attendent.
Attendent dans la peine et le silence,
attendent longtemps, longtemps –
Quand ? – – quand ?
Un jour – – quelque part,
loin sous le dôme du ciel,
je trouverai mon bien-aimé.
Loin dans la course du temps,
loin dans le vaste monde –
Quand ? – – où ?
*
Changement (Wechsel)
J’étais un gamin de seize ans
quand elle m’attrapa
dans les rets de sa chevelure de jeune fille,
passés autour de mon cou.
Lili sifflait un air idiot
de son gosier encombré,
pourtant je crus à cette musique
comme à mon âme.
Lili sifflait ! Et solennel
je balançai les jambes,
comme un singe je dansai
fièrement au bout de sa laisse.
Aujourd’hui, c’est moi qui joue la musique,
je chante et trompette,
et les jeunes filles ouvrent de grands yeux,
gambillent selon mon humeur.
Élisabeth sautille une polka,
Ella pour moi glisse une valse,
La noiraude Grete danse le cancan,
Sténie la tarentelle.
Las ! comme je voudrais jeter
ce violon, ces bonds et ces glissades,
et danser encore comme un singe
aux couplets sifflés par Lili !
*
Andalouse (Andalusisch)
Mon amour, voilà l’orange sanguine
que j’ai cueillie au fond du jardin.
Mon amour, voilà l’orange sanguine.
Ne la coupe au couteau
car tu dépècerais mon cœur,
au cœur de l’orange sanguine.
Mon amour, romps l’orange sanguine
par le milieu avec des doigts prestes,
mon amour, romps l’orange sanguine.
Bois, bois avec des lèvres chaudes,
c’est le sang de mon cœur que tu boiras
au cœur de l’orange sanguine.
*
Sonnets caribéens
(Westindische Sonette)
.
Curaçao
Avec de la pâte d’amandes et du meilleur chocolat Lindt
un pâtissier a bâti cette centaine de maisonnettes.
Canaux de vanille, chapiteaux de nougat
et façades croquantes en sucre.
Avec un coulis rouge de framboise
il a fait les toits, puis a répandu mandarines
et raisins secs comme autant de pierres dans les jardins,
ajoutant la prune et la noisette.
Et dans ce pays enchanté de Delft4 la sucrière,
aux maisons de pain d’épices, nous nous promenons,
trois enfants blonds et sages, main dans la main.
Mais à la fin il nous faut remuer les doigts,
il faut que nous grignotions nos sucres d’orge –
devant d’étranges sourires de Noirs dans l’embrasure des portes.
4 dans ce pays enchanté de Delft la sucrière : « in den Delfter Zuckerzauberland », ce qui renvoie, selon nous, non pas tant au sucre de pâtisserie des vers précédents que, cette fois, à la culture de la canne à sucre, culture que les Pays-Bas avaient développée dans cette colonie. (Delft est une ville des Pays-Bas.) – Une photo pour montrer à quel point la description poétique de Curaçao par H. H. Ewers est pertinente.
*
Au cimetière de San Juan de Porto Rico (Auf dem Friedhof zu San Juan de Puerto Rico)
Le terrain grimpait en pente douce depuis le fossé,
des roses rouges donnaient des baisers aux bancs de marbre,
dans les lauriers résonnaient un appel et une caresse,
des anges de pierre écoutaient le doux chant des oiseaux.
Chemins sinueux, tapissés par le lierre
rampant, épais, de tous côtés –
mais, au bout, là où le chemin se perdait,
un monticule d’ossements blanchis.
Pas d’argent, pas de sépulture ! – C’est là que reposent les proscrits,
ceux que n’honore nulle croix, nulle colonne,
bohémiens, mendiants, musiciens errants.
Ô comme le soleil brille sur ces crânes !
Je lève mon chapeau et salue ces confrères
qui n’ont pas payé leur dernier loyer.
*
Forêt vierge à Trinidad (Urwald in Trinidad)
Et je devrais tirer ? – Où donc la coupe de vie
ronde et pleine déborde-t-elle à ce point ?
– Ici volent des papillons grands comme l’éventail de Margot
et des colibris aussi petits que sa bouche.
Le sol vit, arbres et fleurs vivent,
de la mer souffle doucement une brise fraîche,
chaque fourré résonne de mille voix
qui veulent s’élever de toutes parts dans l’air.
Puis-je néanmoins croire ceux qui inventèrent
une chanson de paix pour la forêt ? Ô pourquoi
faut-il que mon œil ne manque rien de ce qui se passe ?
Meurtre au-dessus de ma tête, meurtre autour de mes pieds –
suis-je le seul qui sois peu doué pour le massacre ?
– Deux yeux luisent soudain – mon coup de feu retentit.
*
Fables
(Fabeln)
.
Jésus et le chien mort (Jesus und der tote Hund)
Au temps où le Christ vivait encore parmi les hommes,
il se rendit un jour au marché d’une ville étrangère.
Quand les apôtres tournèrent au coin de la rue,
ils virent un chien mort devant eux ;
on venait tout juste de le sortir de l’eau,
la pierre encore autour du cou ; la peau gluante,
trempée, couverte de boue, les yeux répandus
hors des orbites, le corps gonflé.
– Un disciple s’exclama : « Mon Dieu !
Peut-il rien y avoir de plus répugnant ? »
Un autre se boucha le nez :
« Par le ciel, qu’est-ce que cette charogne pue ! »
Le troisième : « Pouah ! il est déjà plein de vers,
ça grouille dans ce cadavre nauséabond ! »
Le quatrième : « Oh, ça me rend malade,
j’ai envie de vomir ! »
– Chacun d’eux exprima
son dégoût du chien mort.
Quand Jésus les rejoignit,
il regarda tranquillement le cadavre
et dit : « Regardez ces dents
qui brillent comme un collier de perles. »
– Cette histoire est contée par le Persan Nizami,
élève de Ferdowsi et maître de Djami,
le plus lucide observateur des mondes sereins,
aux antipodes de Schopenhauer.
Il nous enseigne ceci : aussi repoussante que soit l’ordure,
un Dieu et un poète en voient la beauté.
*
Les saisons sous-marines : Poésie de Corrado Govoni II
Pour compléter le billet de traductions « Poésie crépusculaire et futuriste de Corrado Govoni » (ici), déjà complété précédemment par l’ajout d’un poème de Govoni dans le billet « Poésie futuriste 2 » (ici), nous venons de travailler sur d’autres textes du poète italien, à partir cette fois d’une Antologia poetica personnelle compilée par Giacinto Spagnoletti et sortie en 1953.
Ci-dessous, les poèmes apparaissent sous le titre des recueils respectifs dans lesquels ils ont paru. Spagnoletti publie à la fin de son anthologie plusieurs inédits, dont nous avons repris quelques-uns ; certains de ces poèmes ont peut-être été insérés dans les recueils publiés ultérieurement par Govoni (1884-1965) de son vivant ou figurent autrement, sans doute, dans le volumineux recueil posthume La ronda di notte (La ronde de nuit) publié en 1966.
Corrado (c’est-à-dire Conrad) Govoni, bien qu’il ait fait partie des premiers membres du mouvement futuriste italien et publié dans ce cadre quelques poèmes expérimentaux, notamment des poèmes dessinés (qui sont moins des calligrammes que des sortes de planches de fiumetto ou bédé), est cependant resté à la périphérie de l’avant-garde, préférant cultiver, sur l’ensemble de sa trajectoire, une poésie moderniste pré-futuriste. L’inspiration est, comme on le verra ci-dessous, volontiers terrienne.
*
Feux d’artifice
(Fuochi d’artifizio, 1905)
.
Promenade romantique (Passeggiatta romantica)
Un trio de moniales scrupuleuses
se sont assises parmi les roses.
Au bord de la route, elles ont mangé de la pâte d’amandes
et des figues fraîches avec du pain,
et cueilli des primevères
pour les faire sécher dans leurs livres de prières.
Elles font à présent la sieste dans la cour pavée
d’un rouge château en ruines,
non loin d’une petite ferme
où vit une jeune fille qui s’appelle peut-être Adeline.
« Ah, si elle était à nous, cette belle vache
qui nous fait du si bon lait ! Et cette courge,
comme elle doit être bonne, frite à l’huile ! »
« Ne sais-tu pas que tu pèches par convoitise ? Chut !
Allons plutôt visiter les salles
du château ! Attention en montant les escaliers ! »
Les couloirs sont pleins de boiseries fanées
et de lambeaux de tentures colorées.
Dans une salle elles trouvent une cage où fait sa toile une araignée
et des fragments de miroir encore avec le tain.
La plus jeune, à l’insu des autres,
en cache deux dans son mouchoir de batiste,
tout heureuse. Une chouette s’enfuit
au plafond. En bas, dans le pré, on entend meugler.
« Regardez : une perruque ! » « Jette-la,
tu vas attraper des maladies ! »
Les heures descendent doucement les côteaux du Carmel
du jour comme des brebis au blanc lainage.
Dans la chambre la plus abandonnée,
la poussière et les mouches ont tant corrompu l’air
que pour mieux respirer
les sœurs ouvrent une fenêtre donnant sur la mer.
*
Les fausses couches
(Gli aborti, 1907)
.
Les parfums (I profumi)
De grandes roses de couleurs éclosent
comme des feux de bengale fabuleux
allumés un soir de fête
aux fenêtres d’étranges demeures.
L’une exhale une humide et profonde fraîcheur
d’eau sylvestre au fond des bois ;
comme le noir de la nuit l’autre tombe
ou bien s’élève comme les premières lueurs du jour.
Belles comme des aérostats, singulières
comme des peaux-rouges poussant de grandes clameurs,
comme de paisibles golfes bleus de canicule.
Délicates et douces comme des chevelures,
tristes comme des fontaines sanglotantes,
passionnées comme des ritournelles.
*
Les douceurs (Le dolcezze)
Les dimanches bleus de printemps.
La neige sur les maisons comme une perruque blanche.
Les promenades des amoureux le long du canal.
Faire le pain le dimanche matin.
La pluie de mars qui bat contre les tuiles grises.
La glycine en fleur sur le mur.
Les rideaux blancs aux fenêtres du couvent.
Les cloches de samedi.
Les cierges allumés devant les reliques.
Les miroirs illuminés dans les chambres.
Les fleurs rouges sur la nappe blanche.
Les lampes d’or qui s’allument le soir.
Les crépuscules de sang qui meurent sur les remparts.
Les roses effeuillées sur le lit des malades.
Jouer du piano un jour de fête.
Le chant du coucou dans la campagne.
Les chats sur le rebord des fenêtres.
Les blanches colombes sur les toits.
Les mauves dans les casseroles1.
Les mendiants qui mangent sur le seuil des églises.
Les malades au soleil.
Les petites filles qui peignent l’or de leurs cheveux au soleil sur le seuil.
Les femmes qui chantent à leurs fenêtres.
1 Cette fleur, la mauve, est consommée et se prépare, dit-on, comme les épinards.
*
Poésies électriques
(Poesie elettriche, 1911)
.
Les vieux seuils (Vecchie soglie)
Les vieux seuils des portes vermoulues
qui ne s’ouvrent plus ; le mendiant fatigué
s’y reposait, attendant l’aumône ;
les domestiques y sommeillaient
les jours de vacances ;
les amoureux s’y appuyaient
en se mangeant la bouche
une dernière fois avant de se séparer ;
sur ces pierres était versé
le vin convivial
en l’honneur des invités,
et l’on effeuillait des roses
en hommage aux mariés.
Celui qui s’en allait au cimetière
s’arrêtait un instant pour dire adieu
à sa maison
et aux biens qu’il abandonnait.
À présent, avec leurs murs posés de champ
que le gel effrite et que pourrit l’eau
ruisselant des gouttières rouillées
tout l’automne, ils donnent sur des cours fermées,
des jardins ceints de murailles que recouvre
la verte gélatine des lichens.
Dessus, l’été, à la saison du froment,
quelque luciole lourde de rosée
fait de la lumière au triste grillon chanteur
qui ne se fatigue pas de proclamer
combien ils sont dans sa famille.
Y viennent s’abriter de la pluie
les beaux paons avec les arcs-en-ciel
de leur queue repliée et les dindes
avec leurs pesantes et rustiques
parures de corail ;
les chats s’y prélassent au soleil ;
les champignons leur ouvrent leurs ombrelles vénéneuses
et les cyclamens y étalent des couronnes de rois en exil.
Après une vie fantastique et brève,
les seuils deviennent muets et déserts ;
le compatissant Noël les recueille
dans le blanc sépulcre de la neige.
*
Voyage interrompu (Viaggio interrotto)
Ô la quotidienne illusion
de lever l’ancre avec les voiles des rideaux
vers l’azur limpide qui s’étend
comme une mer infinie au-delà du balcon !
Court mirage, car bientôt le vent retombe
et les fenêtres affalent leurs voiles ;
et la mer d’azur en un moment se couvre
de maussades nuages couleur de fiel.
Comme des échassiers rhumatismaux
perdant leurs plumes, à l’intérieur des vases assoiffés,
s’effeuillent, fleurs posthumes annonciatrices
de neige, dans l’encadrement rigide
du verre, les chrysanthèmes malades
à la triste odeur de mort et de vernis.
*
Inauguration du printemps
(Inaugurazione della primavera, 1915)
.
Rome (Roma)
Toutes les places portent un toast
au ciel d’Italie
avec la flûte levée
et pétillante de leurs fontaines.
Ironiques monuments d’eau.
Les paysannes de la Ciociaria qui disposent leurs fleurs,
foulard blanc sur la tête,
semblent les camérières
de quelque printemps
académique officiel.
Jardins publics avec étangs de cygnes
n’ayant rien à voir
avec celui de Lohengrin.
Ô la mélancolie
de ce cimetière écroulé
du forum romain !
Ossements blanchis
et caveaux horriblement grands ouverts.
Et de toutes parts des couronnes de fleurs
les plus tristes et les plus funèbres
aux inscriptions mortuaires
délavées par la pluie
qui reprennent des couleurs chaque printemps.
Je pense avec regret
aux temps bénis
où les bœufs blancs
s’étendaient mollement
sur la Voie Sacrée
ou meuglaient près du Palatin.
Alors le bohémien et sa famille
campaient sous l’Arc de Titus.
D’un violon sale qu’on accordait
sortaient des notes stridulantes et sauvages
accompagnées du gargouillement
de la marmite arrosant de vapeur
les jambes de quelque gladiateur.
Un garçon de bronze patiné
apportait un harmonium au soufflet de cuir rapiécé ;
les étincelles jaillissaient de l’âtre improvisé
tandis que le chaudronnier battait joyeusement ses cuivres.
Le soir, à la lumière économique de la lune,
une jeune fille
dansait parmi les curieux
une danse effrénée, pieds nus,
sur les pierres qui gardèrent jadis
le feu des Vestales.
Aujourd’hui tout est propre,
cimetière payant ;
on montre les squelettes
dans les tombeaux ouverts
comme des bijoux dans un trousseau de mariage ;
les colonnes en morceaux des chapiteaux
sont recueillies et défendues
comme les reliques d’un reliquaire.
Et les grenouilles ne chantent plus
dans la fontaine de Juturne.
Au fond, le Colysée s’élève
comme un gigantesque
gazomètre explosé.
Dans les thermes de Caracalla
une fresque étrange et fascinante vous frappe
comme l’entrée improvisée
de mille femmes inconnues.
Dans la campagne, autour de la Voie Appienne,
on aperçoit les trains déraillés des aqueducs.
*
Le cahier des rêves et des étoiles
(Il quaderno dei sogni e delle stelle, 1924)
.
La petite trompette (La trombettina)
C’est tout ce qui reste
de la magie de la fête :
cette petite trompette
en étain vert et bleu
dont joue une fillette
marchant pieds nus dans la campagne.
Mais dans cette note laborieuse
il y a tous les clowns blancs et rouges,
le bruyant orchestre d’or,
le manège avec les chevaux, l’orgue, les lumignons.
Comme dans les ruissellements de la gouttière
il y a toute la frayeur de l’orage,
la beauté des éclairs et de l’arc-en-ciel ;
et dans l’allumette humide d’une luciole
qui s’éteint sur une feuille de bruyère,
toute la merveille du printemps.
*
Pendant l’orage (Nella tempesta)
La porte est grande ouverte sur la nuit ;
et je suis assis, voûté, fatigué
sous le poids de nouvelles déceptions
comme un vieillard de mille ans :
l’orage me laisse indifférent,
tout comme la musique triste de la pluie ;
solitaire, étranger à ce monde
que les éclairs font une seule mer d’argent
qui brille et s’éteint silencieusement
devant le seuil de la maison.
*
Chanté la bouche fermée
(Canzoni a bocca chiusa, 1938)
Ndt. Le titre du recueil est une référence à la technique du « chant à bouche fermé », comme le coro a bocca chiusa dans Madame Butterfly de Puccini, dit chœur des murmures.
.
C’est l’heure (È l’ora)
C’est l’heure où tu entends,
depuis l’amphithéâtre de lune et de toits,
dans leurs masques de plumes
souffler les jeunes hiboux ;
c’est l’heure où font mal aux arbres
leurs racines, comme des dents.
Dans les maisons où les hommes
dorment en strates horizontales
comme les vers dans les canisses
en tissant une bave de rêves silencieux
desquels ne reste au réveil
qu’une couche de neige ridée dans le ciel,
le grillon du foyer
commence à striduler,
rossignol des cendres.
*
Pèlerin d’amour
(Pellegrino d’amore, 1941)
.
Feuilles de sang… (Come foglie di sangue…)
Feuilles de sang
d’un arbre violent en marche
furent mes paroles terribles,
que tu reçus comme une statue
marchant dans l’éblouissement d’août.
Elles me revenaient déçues et furieuses,
plus amères que l’odeur du chanvre.
Tu continuas indifférente et sombre
comme en un vent hostile
telle une jeune bête
qui ne sait qu’elle est nue
et qui dans l’éblouissement d’août
flaire seulement, avec avidité,
une âcre promesse de moût.
*
Hirondelles d’Italie (Rondini d’Italia)
Comme des ciseaux d’ébène et d’ivoire
infatigablement
découpent les hirondelles
de lumière, de pierre, d’arbres en fleurs
le doux visage de mon premier amour.
Je voudrais que soit un saule piégé de glu
cette pluie d’avril
pour vous capturer toutes et empêcher
qu’au retour de chaque printemps
dans le vent blond et fou
vous ne répandiez vos graines joyeuses
sur le monde.
*
Govonigiotto, 1943
.
Tu avais tellement peur… (Tanto fu la paura…)
Tu avais tellement peur de mes baisers
dans la maison plongée tout à coup dans le noir
que tu restas pendant l’orage,
tressaillant aux lueurs du tonnerre,
sur le seuil, les pieds dans la pluie.
Retourné à mes vingt ans par le souvenir,
je te dédie le corail de ces éclairs.
*
Gerbes, meules de foin… (Biche e pagliai…)
Gerbes, meules de foin, l’été venu,
encombrent les routes de mon pays.
Dans un nuage de poussière gris, nuit et jour,
elles vont sur des roues ardentes : haut perchées
sur les chars débordants, les paysannes
répondent par des refrains mélancoliques
aux claquements de fouet des bouviers.
On dirait que toute la Padanie émigre
vers des contrées inconnues, et d’or fulgurantes,
traînant derrière elle, dans un grand vent
docile et paresseux, le Pô, comme un cheptel.
*
Choix d’inédits
(Inedite varie)
.
Un soir au Val di Chiana (Sera in Val di Chiana)
À la vie trépidante de Rome
ne me relient plus ici que des fils ténus
et calmes : le fil
de la fraîche lumière du ruisseau là-bas
qui serpente à val
sur la poussière verte
des pins et des cyprès ;
les trilles des oiseaux, le coucou
des Apennins et le rossignol
des asiles humides ;
la fumée des toits du terroir
s’enlaçant à la fumée cavalcadante
du train silencieux qui coupe
à la base lointaine
d’une enfilade de vignes
le nuage céleste de l’Amiata ;
le bruit de cascade
que de temps en temps fait, en bas,
monument de feuilles,
reine tempétueuse,
l’yeuse centenaire du domaine.
Ces fils un à un se briseront
dans le noir silence des grillons,
quand la ronde folle des hirondelles
prendra fin tout à coup
au-dessus de la maison rouge
dans le crépuscule de sang ;
et toutes les voix, les cris d’enfants,
les sons de cloches
qui résonnent au loin
viendront mourir ici doucement
dans l’Angélus roucoulé par les colombes.
*
Poissons (Pesci)
Il cria des noms de poissons et de coquillages,
apportant le fleuve et la mer aux seuils des maisons,
le vieux poissonnier enroué
sautillant avec ses paniers dans la ruelle,
au bord d’un demi-sommeil.
Les lames des stores aux fenêtres
devenaient brûlantes de soleil, le calme revint.
Mais ce cri suffit à ce que le matin
fût plein d’odeurs de trains et de bateaux
et de lumières de perle de Venise2.
2 Les perles de Venise, artisanat réputé inscrit au patrimoine de l’Unesco, sont en verre coloré de Murano ou en verre peint.
*
Les saisons sous-marines (Stagioni sottomarine)
Peut-être qu’avec ses eaux la mer produit de la drêche
dans les profondeurs : une moisson glauque
mûrie à l’été de la lune
ou aux invisibles saisons des rayons cosmiques ?
Quels groseilliers vendange-t-elle en secret
de coquillages, de gemmes et de perles ?
Autour de vieux rochers
mousse une boisson si savoureuse qu’elle
rend ivre rien qu’à en flairer l’arc-en-ciel,
qu’à la regarder de loin.
Des moissonneurs magiques aux cheveux de méduses,
des vendangeuses aux paniers en filets
chantent alternativement leurs couplets,
berçant les rêves des marins.
Le long de la plage déserte, la mer
rejette triturés tant de débris d’algues
et un marc si pressé
qu’on en pourrait faire cent rangées de meules.