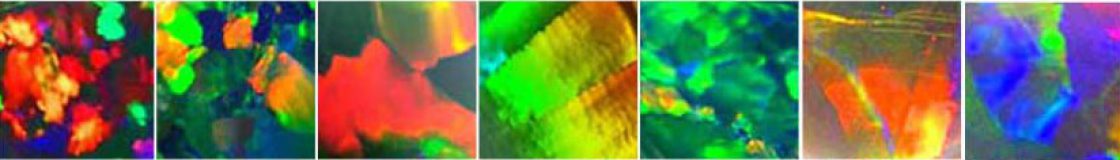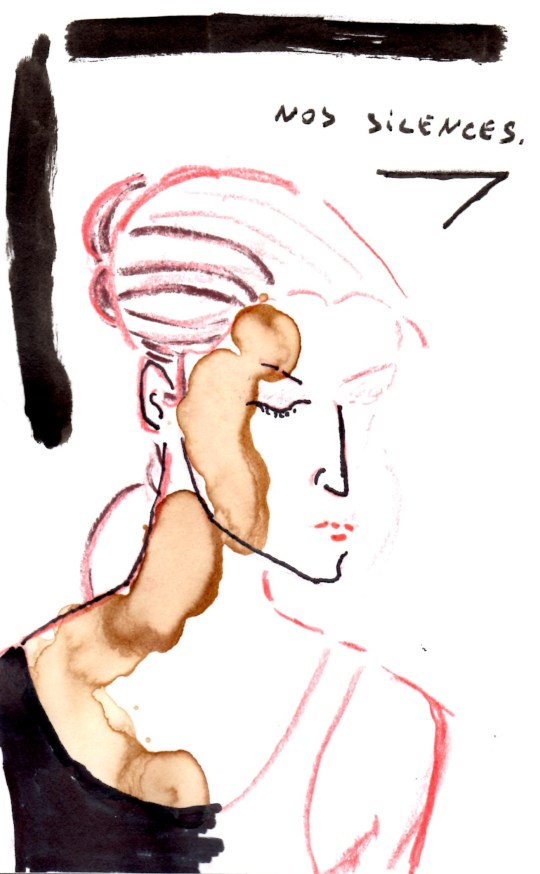Tagged: onironautique
Journal onirique 27 : The cop killer is a killer cop
Cette suite tardive à notre journal onirique (précédent numéro ici) en est sans doute aussi la dernière entrée, avant longtemps. Les rêves qui suivent datent en effet d’octobre 2022, sauf pour les deux derniers, qui sont de décembre 2022 ; autant dire que nous avons cessé de retranscrire nos rêves. Nous ne faisons donc ici que présenter le reliquat de notre journal qui n’avait pas encore été mis en ligne.
Une remarque générale, a posteriori, faute de l’avoir faite plus tôt. Puisqu’il s’agit d’un journal onirique, d’aucuns ont pu se dire, légitimement, que c’était pornographique. Or nous avons délibérément écarté de ce journal les contenus les plus sexuellement explicites de notre activité onirique, afin, justement, que ce journal ne soit pas de la pornographie. On trouvera sans doute çà et là quelques passages plus ou moins érotiques, quand le rêve dans lequel ces scènes avaient lieu imposait qu’elles figurassent dans le journal, mais, dans l’ensemble, les rêves à caractère principalement sexuel n’ont pas été retenus. Pour les passages plus ou moins érotiques restants, nous sommes également d’avis qu’une reprise de ce journal (par exemple à des fins de publication en livre) appellerait quelques autres suppressions à cet égard, surtout vers les débuts du journal où nous n’avions pas encore adopté cette politique éditoriale avec toute la détermination d’une véritable politique. – Le journal n’est donc pas fidèle de ce point de vue, cela soit dit en passant à l’attention de ceux qui, le lisant, se seraient fait la réflexion que l’auteur n’a pas, étrangement, de rêves sexuels. Ce malentendu dissipé, nous assumons pleinement cette « censure », au nom de l’idée que nous nous faisons de la littérature, une idée juste et à contre-courant de la politique des maisons d’édition occidentales contemporaines, dont l’activité n’est qu’un témoignage parmi d’autres d’une décadence irrémédiable et qui n’a de conception de l’activité littéraire que celle d’un rêve éveillé (appelé parfois autofiction).
*
Octobre 2022
À la rue depuis peu, je vois au bout d’un quai de gare, couvert par une colossale structure métallique rendant le quai très sombre, un groupe de clochards auxquels je décide de me joindre. Certains sont sur assis sur le même banc, d’autres par terre. En m’approchant, je constate que plusieurs d’entre eux ne sont en fait que des têtes sans corps – des têtes vivantes. Ils paraissent accepter de faire ma connaissance mais je ne suis pas complètement rassuré par la découverte que je viens de faire sur la véritable nature de certains d’entre eux.
À un moment, l’une des têtes sur le banc se lève sur ses entrailles, que je n’avais pas vues sous elle – ou sous lui –, à la manière d’un krasseu thaïlandais ou d’un léak malais, sortes de fantômes ayant l’aspect d’une tête volante d’où pendent les intestins. Je recule, craignant qu’il ne se serve de ses entrailles comme de pattes d’araignée pour se précipiter sur moi et m’attaquer. La tête vivante se sert en effet de ses intestins pour se mouvoir mais c’est pour quitter le groupe. Elle traverse la voie ferrée et se met à escalader le mur de l’autre côté, avant de disparaître en le franchissant.
Je me tourne alors vers un jeune clochard assis par terre et l’appelle « Routledge », croyant que c’est que j’ai déchiffré sur son tee-shirt. Il me détrompe à ce sujet : sur son tee-shirt est écrit « Knapp », ce qui veut dire, m’explique-t-il, quelque chose comme de la chair à saucisse, mais en plus spécifique, dans le jargon de la boucherie. Car, avant de tout quitter pour faire la cloche, il était apprenti boucher.
*
The cop killer is a killer cop
Un policier véreux pense avoir été pris en photo par un collègue dans une situation compromettante. Plus précisément, il croit se trouver, par un malheureux concours de circonstances, dans l’arrière-champ d’une photo prise par le policier, qui travaillait sur une affaire. Le soir, le policier véreux se rend donc au domicile de l’autre policier, où ce dernier vit avec sa femme, également de la police. Il les assomme tous les deux, s’empare du matériel compromettant puis met le feu à la maison de manière à faire croire à un incendie accidentel. Alors qu’il a quitté les lieux, peu après que les flammes ont commencé à se propager, une voiture de police passe par là. Son occupant, voyant de la fumée et des flammes, sort de son véhicule et se précipite vers la porte d’entrée de la maison afin de prêter assistance aux personnes en danger. Mais le policier véreux a fermé la porte à clé derrière lui, pour parer à cette éventualité. Le couple de policiers à l’intérieur de la maison ne peut donc être sauvé ; le temps que les pompiers arrivent, il est trop tard. Cependant, l’assassin a commis une erreur. Si la porte avait été fermée de l’intérieur, on aurait pu croire à un suicide, mais comme elle a été fermée de l’extérieur on sait que c’est un crime. Car la police a les moyens de savoir si une porte a été fermée à clé de l’intérieur ou de l’extérieur. (Ce qu’il faudrait lui demander pour savoir ce qu’il en est dans la réalité.)
*
C’est la finale dames du tournoi de Roland-Garros ; cependant, le sol n’est pas en terre battue, c’est un sol de couleur verte comme à Wimbledon. Les sièges du public, en cuir, sont également de couleur verte mais d’une nuance plus foncée. Il y a des sièges de plain-pied avec le court, et ce sont les plus chers car on y est toujours devant les caméras. Le public est très peu nombreux pour cette finale ; surtout des femmes. Je suis assis par terre devant deux sièges de plain-pied sur un bord latéral du court, sièges occupés par deux amies dont l’une se sert de mon épaule pour appuyer ses jambes croisées et nues. Je ne vois presque rien du match, si ce n’est que, quand sert la joueuse se trouvant de notre côté, elle se trouve au milieu des jambes du public occupant les sièges de plain-pied au fond du court, ce qui me paraît tout à fait ridicule.
Quand le match est terminé, tout le monde se lève. La jeune femme qui se servait de mon épaule pour allonger ses jambes me dit que la finale hommes a lieu dans la foulée ailleurs. Les gens sortent et se dispersent dans les rues de Paris. Je perds de vue mes deux compagnes et décide de suivre un vieil ami venu avec moi, qui prétend savoir qu’il faut traverser la Seine ; d’autres personnes suivent d’ailleurs cette direction, qui n’est donc pas forcément mauvaise. Après avoir marché quelque temps, les spectateurs de Roland-Garros ont formé un groupe cohérent qui marche à peu près comme un seul homme. Je retrouve entre autres F., élégamment habillé de blanc ainsi que la plupart des autres personnes venues assister au tournoi. Je lui demande si c’est une nouveauté que le public s’habille de blanc, car je n’ai pas le souvenir que ce fût une tradition. Il refuse de dire que c’est une nouveauté, même s’il ne peut non plus prétendre que ce soit une tradition. Je réponds alors que le public s’habille de blanc, avec élégance, depuis que les joueurs s’habillent, eux, à leur guise, c’est-à-dire comme des clowns.
Nous arrivons dans une grisâtre banlieue traversée par la Seine. Le public prend position au bord du fleuve et attend ; nous attendons en fait des nageurs, nous avons fait ce chemin pour voir de la natation. Avant l’arrivée des sportifs de haut niveau, les membres d’un club local barbotent dans l’eau, principalement des femmes d’âge mûr. La pratique de la natation leur permet d’avoir des mollets bien galbés, comme je le remarque quand certaines d’entre elles sortent de l’eau, mais cette remarque reste dominée par le fondamental défaut d’attraction que représente leur qualité de secrétaires, fonctionnaires, ou autres occupations professionnelles que je leur suppose.
Fatigué d’attendre, j’entre dans la maison de Jean Cocteau, qui vit dans cette banlieue. Il va et vient sans faire attention à moi. Dans des cahiers que je feuillette, je remarque que Cocteau apprend la langue thaïlandaise. Il a même écrit le mot « porte » en thaï sur une porte près des cahiers : le mot a été gravé à la pointe brûlante sur un petit écriteau de bois apposé sur la porte. Pratiquant un peu le thaï, je lie conversation avec lui sur le sujet ; il paraît intéressé, sans doute plus, me dis-je, que si je lui avais dit que j’écris moi-même de la poésie. Mais je crains que sa motivation pour apprendre le thaï ne soit pas très pure.
*
Plongeur, je m’enfonce dans les profondeurs inconnues d’une mer sombre. C’est une plongée dans l’angoisse, avec des paliers indéfinissablement inquiétants. Quand je parviens au fond de la mer, je vois des gens me tournant le dos. Entre eux et moi se trouve un poteau. Quand j’observe le groupe depuis le côté gauche du poteau, c’est une image d’épouvante : l’individu le plus proche de moi paraît être, de dos, la créature de Frankenstein. Mais quand je regarde le groupe depuis le côté droit du poteau, la sensation de peur disparaît : c’est un groupe d’écoliers en rang qui attend l’ordre d’avancer.
*
Dans le dernier film de Jean-Paul B., sa femme ourdit un complot avec son amante lesbienne pour le tuer. Il rentre chez lui le soir. Sa femme est assise sur le canapé dans le salon ; il la bise au front et s’assoit à l’autre extrémité du canapé. L’amante lesbienne de sa femme arrive par derrière, un bas de nylon tendu entre les mains pour étrangler Jean-Paul. Elle lui passe le bas autour du cou et une lutte s’ensuit. Comme elle n’a pas le dessus, elle fait finalement comme si ç’avait été de sa part une plaisanterie. La lutte les a conduits tous les deux dans une pièce voisine. Jean-Paul, qui fait semblant de croire l’amante, une amie du couple, se laisse tomber à plat ventre sur un sofa, où l’amante secrète de sa femme le suit en s’étalant sur son dos, soit que les deux soient à ce point déjà familiers entre eux, soit qu’elle cherche à présent à le séduire. Or Jean-Paul, qui n’a pas été dupe de ce qui s’est passé, se relève, la femme attachée à son dos, et, sautant en l’air, se laisse retomber lourdement sur le sol, la femme sous lui. Elle meurt sur le coup.
*
Un homme d’aspect respectable, corpulent, avec un début de barbe sel et poivre, en costume mais sans cravate, cueille du cannabis au bord de la route. Un motard de la police s’arrête. C’est une femme. Elle dit à l’homme qu’il est interdit de cueillir du cannabis au bord de la route. Celui-ci, ne se laissant pas démonter, répond que sa femme a le cancer, sous-entendu : il cueille du cannabis pour un usage thérapeutique. Cela ressemble à une excuse facile. Or la motarde de la police, qui connaît l’homme, sort de sa poche des papiers montrant que la femme de cet homme n’a pas le cancer. Elle le laisse partir pour cette fois, dans un accès de mansuétude qui n’est pas du tout du goût d’un groupe de personnes qui font le piquet au bord de la route avec des pancartes dénonçant la pratique illégale de la cueillette de cannabis au bord des routes.
Plusieurs militants de ce groupe, dont je fais partie à présent, décident de suivre l’homme, qu’ils supposent être un gros bonnet. Nous le prenons en filature jusqu’à sa maison, dont l’intérieur, vu depuis les fenêtres, ressemble au quartier général d’une organisation de malfaiteurs. Nous entrons et, dans une chambre occupée, chacun dégaine son pistolet, si bien que nous restons tous, militants et malfaiteurs, immobiles, menaçants et menacés, ce qui s’appelle une « impasse mexicaine ».
*
Décembre 2022
Cthulhu’s plancton.
*
Je regarde vers ma bibliothèque vidée de ses livres et, voyant une grosse araignée dans l’un des casiers, je m’exclame : « Elle a le corps gros comme mon poing ! » Mais je vois ensuite que la bibliothèque est en fait entièrement infestée d’araignées, dont l’une, en particulier, me fait crier : « Elle a le corps gros comme ma tête ! » Rendu passablement malade par la vue d’un tel monstre, je me trouve en train de ramper sur la terre entre d’étroites allées de buis, convaincu qu’en frôlant ces plantes je dois forcément accrocher de nombreuses toiles d’araignée sur mon passage et faire tomber sur moi leurs occupantes. Je rampe et aucune chute d’araignées ne se produit, mais l’idée en est si présente, et si révoltante, que je me réveille.
*
Journal onirique 26 : Miwatch Kultu Kulu
Suite du journal onirique, qui devient de plus en plus sporadique et s’achemine vers sa fin.
Deux périodes : I/ avril 2022 et II/ août-octobre 2022.
*
I
Mes nouvelles activités demandent que je me rende régulièrement en RER, train régional francilien, dans une banlieue défavorisée. Un jour, alors que je m’apprête, depuis le quai de la gare, à monter dans le train pour retourner chez moi, les deux enfants qui me précèdent entrent dans une altercation avec trois enfants descendant du train et qui considèrent que dans leur hâte de monter les deux leur ont rendu la sortie difficile. Au cours de l’altercation, l’un des deux lance un coup de pied. Nous montons finalement, moi derrière eux, mais au moment où la porte du compartiment se referme, l’un des trois descendus revient en arrière et bloque de son corps la fermeture de la porte, souhaitant continuer à en découdre. C’est alors que j’interviens pour calmer les choses par des paroles de raison et d’apaisement. L’enfant ayant bloqué la porte n’insiste pas mais, en voulant descendre, il tombe dans l’espace entre le train et le quai, sur la voie. Le train redémarrant, je crains pour sa vie mais vois l’enfant rouler au milieu de la voie, sous le train, en évitant les roues. Je pense donc qu’il s’en sortira. Cependant, je m’inquiète des suites judiciaires d’une telle histoire, au cas où l’enfant voudrait me tenir pour responsable de sa chute.
Un autre jour, alors que j’attends de nouveau mon train dans cette gare de banlieue, je vois un étrange manège se produire avec un train au départ. Les enfants de cette banlieue ont pour jeu de bloquer la fermeture des portes des trains en y faisant obstacle de leur corps. Ce passe-temps a pris une telle ampleur que les trains n’attendent plus la fermeture des portes pour repartir et je vois donc le train bondé quitter la gare avec plusieurs portes ouvertes (de l’une desquelles flotte au vent une longue robe jaune), avec des enfants sautant du train en marche. Les usagers sont complètement apathiques vis-à-vis de ces comportements dangereux.
Un jeune homme que j’identifie immédiatement comme un des organisateurs de ce passe-temps, avisant dans ma personne un nouvel usager de la gare, m’aborde pour me mettre au parfum et obtenir mon approbation en me présentant la chose sous un jour inoffensif et badin. Le contact avec cet individu, malgré le ton affable qu’il prend avec moi dans la circonstance, m’est particulièrement déplaisant puisqu’il s’agit pour lui de provoquer une adhésion formelle de ma part à ces pratiques que je réprouve de toute ma raison, ce qu’il ne sait pas mais est en sans doute enclin à supposer. Il me vante par exemple les exploits d’un « petit Nicolas » qui serait particulièrement habile à ce « jeu ». Je ne me dépars pas d’une réserve correcte mais romps avec lui dès que cela m’est possible sans que ce soit offensant : je dois faire attention à ne pas me mettre à dos un véritable gang régnant sur cette gare.
Je lie conversation avec un usager qui me paraît étranger à ces pratiques, à ce gang, et semble au contraire les subir dans le même état d’esprit que moi. Nous évitons d’évoquer le sujet, en déambulant le long du quai. Cependant, quand il trouve deux couteaux Opinel au sol, qu’il les ramasse et se met à les aiguiser l’un contre l’autre en m’expliquant que c’est ce qu’il faut faire quand on trouve ici deux couteaux par terre, je n’y tiens plus et lui demande si ce n’est pas malheureux de trouver de manière habituelle des couteaux sur le quai d’une gare.
*
Au moment où je dois passer en caisse pour mes courses, la caissière essaie de me faire comprendre quelque chose et je crois que c’est que je dispose d’un avoir de 25 euros sur mes courses en raison d’un avantage non utilisé par la cliente précédente. Je m’en réjouis mais il s’avère au bout du compte que j’ai seulement le droit d’emporter quelques courses laissées par la cliente si je le souhaite ; or les produits en question ne me sont d’aucune utilité. Je m’éclaircis mon erreur d’interprétation et l’explique à un autre client qui sort en même temps : un avoir tel que je le concevais n’était pas possible en raison de la défiscalisation appliquée à certains produits et non à d’autres, ainsi qu’aux subventions appliquées à certains produits seulement. Surtout ici, dans une île anglo-normande où le souverain héréditaire encore aujourd’hui se fait appeler par la population, sans connotation négative, le Tyran et n’a d’autre contre-pouvoir en face de lui qu’un certain prélat ecclésiastique ; et les deux ne sont jamais d’accord sur les produits à défiscaliser et à subventionner.
Dehors, sacs de courses en main, je dévale un beau chemin que je crois aller vers la mer, sous des arbres méditerranéens, mais au bout d’un moment le chemin s’incurve et monte ; c’est une dune qu’il faut gravir et j’ai besoin de mes mains pour terminer, ce qui, avec les sacs, n’est pas du tout commode. J’arrive sur une place de village surplombant la mer. Le maire, à qui je demande mon chemin afin de rapporter mes courses chez moi, me dit de le suivre dans un escalier descendant le long de la forteresse sur laquelle le village est bâti. Mais cet escalier est si étroit qu’il n’y a sur chaque marche de place que pour un pied et je crains donc, surtout avec des sacs de courses en main, de tomber à l’eau si je l’emprunte. Le maire engagé dans l’escalier, qui suit la circonférence de la forteresse et dont la fin est cachée à la vue, disparaît sans se retourner et je reste gros-jean comme devant.
*
Il fait nuit et nous passons le temps avec un jeu de société. I. doit compter mentalement jusqu’à ce que l’un de nous l’arrête ; elle prononce alors à voix haute le nombre auquel son compte est interrompu, nombre qui représente une lettre de l’alphabet. Comme elle dit 30, je conclus qu’il s’agit de la lettre T, la trentième lettre de l’alphabet selon mon calcul. Ensuite, I. doit piocher une autre lettre dans un sac de Scrabble mais cette lettre doit être différente de la première. Or I. tire un T. Tandis que les autres prétendent que le tour peut à présent commencer, je proteste en indiquant que nous avons deux fois la lettre T, contrairement à la règle. On répond que je me suis trompé. C’est alors que nous entendons trois coups frappés distinctement, qui me font sursauter. Nous sommes dans une pièce avec de grandes fenêtres, près de l’une desquelles remuent, au dehors, les branches d’arbres remués par le vent, mais les trois coups frappés ne peuvent selon moi être le choc de branches contre la fenêtre et révèlent plutôt l’intention d’une intelligence. Quelqu’un nous épierait-il, caché dans la nuit ? Je me réveille angoissé.
*
Dans une salle de classe, en attendant le professeur, le chanteur Stephan E. demande aux quelques personnes présentes de se rapprocher de lui pour que nous observions tous que, dans l’état normal de dispersion des élèves dans la classe, toujours un peu sombre, nous nous voyons mal les uns les autres. Nous faisons cercle – ou plutôt demi-cercle car il est assis sur une chaise contre le mur – autour de lui. Il nous fait alors remarquer que nous nous voyons bien mieux. Il dit qu’il voit mieux untel, puis untel, puis, me désignant : « Quant à Florent, on ne le voit jamais. » Ce qui se veut une allusion amusante au fait que je participe peu, voire presque pas aux discussions de cette classe. La remarque suscite un rire général. Je réponds : « Là tu m’as vu, là tu me vois », suffisamment vite pour permettre de croire – même si c’est dérisoire – que la réponse contribue elle aussi, puisqu’elle intervient avant que les rires ne cessent, à la gaîté générale. Mais la remarque, qui ne m’a pas vraiment surpris, m’est pénible, tout comme cette classe, bien qu’il n’y ait aucune méchanceté dans tout cela.
.
II
Deux femmes discutent. La première assure à la seconde qu’elle n’a plus à craindre une troisième femme qui la faisait chanter.
Changement de scène. Nous nous retrouvons dans une chambre où nous allons comprendre que la troisième femme en question est morte, et ce qui lui est arrivé. Dans cette chambre, deux personnes font l’amour, cachés sous un drap. Nous savons que l’une de ces personnes est la femme morte… L’homme parle, il vient de terminer l’acte et présente de vagues excuses pour avoir imposé cette fois encore son désir avec si peu de cérémonie. En se relevant, il écarte le drap et nous permet de les voir, elle et lui. L’homme est grisonnant. La femme, plus jeune, est immobile et, à la façon dont lui tombe le menton sur la poitrine, on comprend qu’elle est bel et bien morte. L’homme, à cause de son empressement, ne s’en aperçoit qu’à la fin de l’acte. Il est inquiet car il pense que la femme a été assassinée et que son assassin se trouve encore sur les lieux. Dans le jardin, alors qu’il fait nuit, s’est en effet caché l’assassin tandis que l’homme arrivait. Il se dirige à présent vers la porte de la maison pour tuer l’homme, après avoir épié par la fenêtre. C’est une sorte de créature de Frankenstein manchote et boiteuse, portant des lunettes, très difforme et donnant en même temps une impression de force terrible. Il pointe dans le jardin, d’une main où manquent des doigts, une souche d’arbre possédée par l’esprit maléfique dont il est le rejeton.
Au moment où il va fracasser la porte de la maison, changement de scène à nouveau : retour aux deux femmes du début. Celle qui parlait tient un boîtier de téléguidage. C’est l’appareil dont elle se sert pour contrôler la créature comme une voiture téléguidée.
*
Je me suis embarqué sur un navire sur le point de subir une violente tempête dont l’équipage n’est pas du tout sûr que nous pourrons réchapper. « Seulement la mer et nous » est la parole que répètent ces hommes pour décrire la situation. Le ciel est gris et bas. Les vagues moutonnantes deviennent de plus en plus hautes. Nous sommes frappés par l’une de ces énormes vagues. Vu de l’extérieur, comme dans un film, c’est grandiose et malgré le risque de mort je suis exalté. Mon espoir est que je survivrai comme naufragé sur les côtes d’un monde nouveau.
*
Dans le dernier film de Clint, l’acteur incarne un homme témoin de l’enlèvement d’une jeune femme. Le ravisseur est un tueur psychopathe qui tue les femmes qu’il enlève. Clint l’a suivi jusque chez lui ; s’ensuit une bagarre dans l’appartement du ravisseur armé d’un fusil-mitrailleur dont il se sert comme d’un gourdin tout en cherchant à se donner l’espace nécessaire pour faire feu. Clint, en raison de son âge, n’a pas vraiment le dessus. Soudain, le ravisseur se juche sur les épaules de Clint, prêt à faire feu dans la tête depuis cette position. Alors Clint happe le bout du canon avec la bouche et souffle dedans de toutes ses forces pour enrayer l’arme. Le ravisseur appuie sur la gâchette mais il y a deux gâchettes et c’est la mauvaise ; le temps qu’il appuie sur la seconde, l’arme est enrayée. Il saute à terre et se dirige vers la porte d’entrée. Clint lui demandant ce qu’il fait, il répond qu’il va chercher du renfort ; en attendant, Clint sera retenu prisonnier dans l’appartement. Le ravisseur lui demande de donner ses gélules à la femme et lui tend un sachet de pharmacie avant de sortir.
C’est alors moi qui remplace Clint. Avançant dans un couloir de l’appartement à la recherche de la jeune femme, je la vois sortir d’une pièce à ma rencontre : c’est une Asiatique accompagnée de toute sa famille, parents, grands-parents, frères et sœurs. Je lui donne ses comprimés. Un autre Asiatique, bedonnant, sbire du ravisseur affecté à la garde de ses proies, sort de la pièce après les captifs. Je lui demande s’il n’a pas une femme qui l’attend, avec laquelle il serait mieux qu’ici. Il répond : « Des femmes, j’en ai un peu moins qu’une et un peu plus que plusieurs. »
*
Je regarde à la télévision un clip complètement ringard, une chanson française chantée par un vieux en blouson de cuir, chanson qui s’appelle « Paris, lente écume ».
*
Après m’avoir informé qu’il me licenciait, le directeur du service réunit l’ensemble des collègues pour leur parler d’« un certain Florent Boucharel » et leur énumérer ses tares. L’expression venimeuse « un certain » vise à leur faire comprendre que je ne suis rien pour eux, qu’ils ne doivent plus me connaître, ne doivent m’avoir jamais connu. Quand il a terminé, je prends la parole : « Un certain Florent Boucharel souhaite répondre à un certain J.-F. D. » Le rêve s’arrête là, c’est cette phrase qu’il faut retenir. Que je sois « un certain » dans le service n’a relativement que peu d’importance par rapport au fait que le directeur y soit « un certain », car le directeur est censé être le plus connu de tous. Par son venin, il m’a donné le moyen de lui rendre la politesse au décuple tout en restant dans la pure réciprocité. Il est le perdant de cette passe d’armes.
*
J’accepte d’accompagner un visiteur anglais, musicien de la scène indé de Manchester que j’héberge chez moi, dans une certaine pharmacie dont il me parle et où il pourra, selon ses informateurs, acheter les cocktails de médicaments dont il a besoin pour triper. Nous nous y rendons dans une espèce de téléphérique ouvert qui suit un parcours, comme une ligne de bus, très au-dessus de la ville. Nous sommes seuls dans le téléphérique complètement automatisé. Commentant en guide touristique quelques sites que nous survolons ainsi, j’oublie presque où nous devons descendre et ce n’est qu’au dernier moment, après un crochet du téléphérique au-dessus d’une vaste structure ressemblant à un stade ou à une usine futuriste, que je demande à mon visiteur d’appuyer sur le bouton d’arrêt qui se trouve à côté de lui. À cause de ma réaction tardive, il appuie sur le bouton un peu après que le téléphérique a passé la station. Le pilote automatique fait mine de s’arrêter, ralentissant, mais en réalisant que la station est en fait dépassée il reprend de la vitesse, sans nous laisser descendre. Je dis alors à mon visiteur que nous descendrons au prochain arrêt mais non sans embarras car je ne suis pas sûr de connaître le chemin entre cette autre station et la pharmacie.
*
Un nid tombé d’un arbre est envahi par des insectes. La mère oiselle, catastrophée, essaie en vain de protéger ses petits, crevettes dénudées en train d’être dévorées vivantes par de grosses fourmis guerrières. Ce spectacle me fait dire à ceux qui le contemplent consternés avec moi : « Je hais la nature. » J. arrive avec un tuyau d’arrosage pour chasser les insectes et je lui suis reconnaissant de vouloir faire quelque chose pour ce nid, mais elle ne fait que l’inonder. Il devient un grand bassin d’eau verdâtre où rien ne surnage.
*
Miwatch Kultu Kulu
Prononcer : Maïouatch koultou koulou. C’est le titre d’un nouveau programme de télé. Miwatch est une altération de Middle Ages et veut donc dire Moyen Âge. Kultu Kulu est une altération de Cool Cults : cultes cools. L’émission porte donc sur les Middle-Ages Cool Cults. Kultu Kulu rappelant immanquablement, pour les connaisseurs, le nom de Cthulhu, je comprends que cette émission antichrétienne est la propagande cryptée d’adorateurs contemporains des Anciens.
*
Un documentaire à la télé. Une femme à la vie peu respectable, peut-être une danseuse qui monnaye occasionnellement des services de nature sexuelle, vit sous la coupe d’un homme violent. Elle raconte que ce dernier sait lui infliger des blessures qui ne font pas mal sur le coup mais restent douloureuses longtemps après. Ils ont deux enfants. On les voit lors d’une balade en forêt. L’homme est un hardos. Des mouches le suivent partout. La femme quitte le champ de la caméra et l’homme reste seul avec les deux enfants. Je me dis : « Ils ne vont quand même pas nous le montrer infligeant des sévices aux enfants… », appréhendant que ce soit précisément ce qui va suivre. Mais je suis détrompé : les enfants découvrent sous des feuilles le cadavre d’un homme, en fait seulement le tronc, en décomposition avancée. D’où la présence des mouches. La famille décide d’aller pique-niquer plus loin.
*
La rue Ramelot, dans une ville de Provence, est une création du dix-neuvième siècle des laboratoires Ramelot, qui y ont toujours leur siège. C’est une rue délicieuse bordée de jardins arborés, avec aussi un charmant petit escalier. Elle tourne sur elle-même et c’est en fait tout le quartier qui est la rue Ramelot. À l’occasion de l’un de ces détours, nous découvrons, Giorgia et moi, car je me promène en amoureux avec Giorgia Meloni, un délicieux jardin secret autour d’un petit étang. Nous nous couchons sur l’herbe au bord de l’eau, sous des arbres. Je ne sais pas si Giorgia n’a pas des choses importantes à faire ailleurs et si nous n’allons pas devoir quitter aussitôt ce lieu, mais elle me dit que nous pouvons rester jusqu’au soir. Nous sommes de tout nouveaux amoureux. Être ici contre elle est d’une grande douceur, puis je pense : « S’il lui vient à l’esprit que nous pourrions avoir ici notre premier rapport sexuel et que je n’entreprends rien, je vais perdre sa considération puis son amour. » Je tente un vague geste de la main vers ses parties, geste qu’elle paraît vaguement repousser. Rien de concluant. Je m’avise alors que nous ne sommes pas seuls, il se trouve une famille qui pique-nique un peu plus loin sur une table. En tournant la tête vers eux, je me rends bien compte que notre présence ne leur a pas échappé. Je me dis que Giorgia ne peut vouloir faire l’amour dans ces conditions.