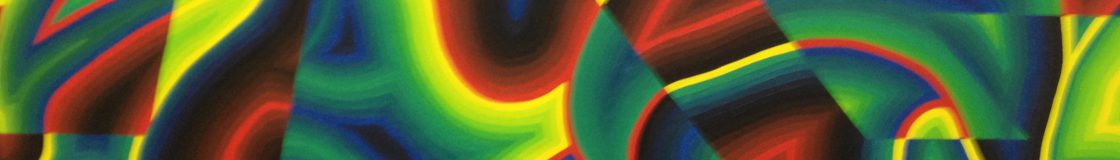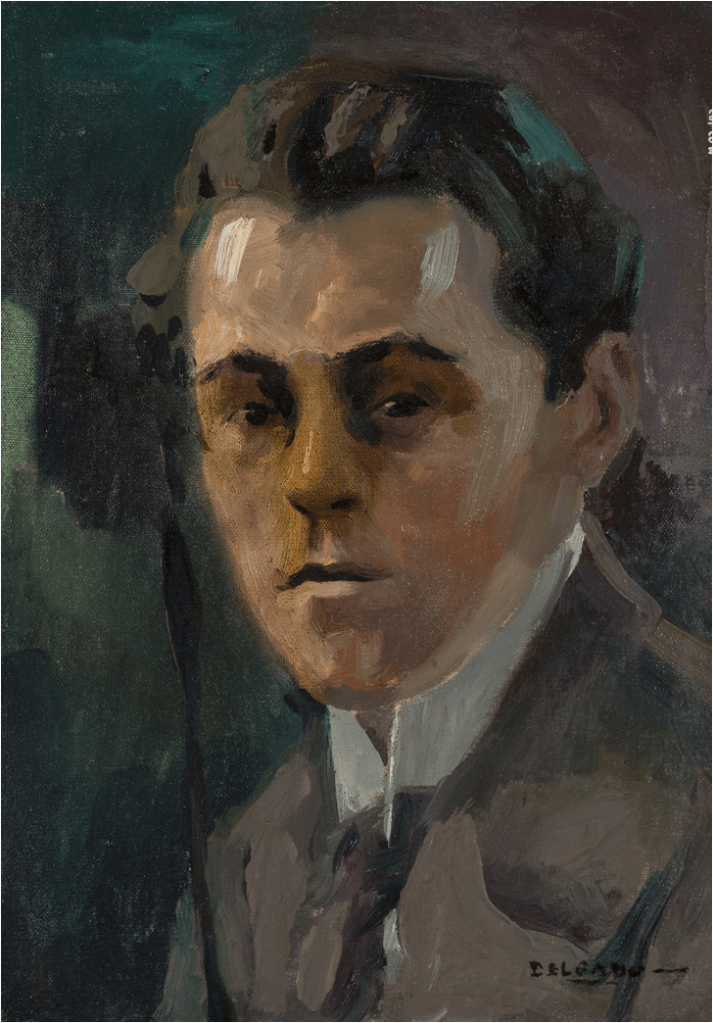Tagged: Equateur
Offrande à la Mort : La poésie de Medardo Ángel Silva
Medardo Ángel Silva (1898-1919), mort à vingt et un ans, est un poète équatorien de la « Génération décapitée » ainsi nommée car les trois autres écrivains principaux qui la composent sont eux aussi morts (plus ou moins) jeunes. Ces quatre auteurs sont les représentants, relativement tardifs même au point de vue latino-américain, du modernisme poétique en Équateur. On sait que c’est le Nicaraguayen Rubén Darío qui introduisit le modernisme en Amérique latine et même en Espagne, laquelle refusa de le recevoir de la France, sa voisine, où il était né, et ne l’adopta que des mains d’un poète américain de langue espagnole. L’Espagne avait reçu le romantisme en faisant l’économie d’un tel circuit parce que le romantisme était un mouvement allemand et que l’Allemagne c’est encore l’Espagne, mais les emprunteurs de tendances françaises ne sont jamais nommés de l’autre côté des Pyrénées que du nom péjoratif d’afrancesados.
L’Équateur littéraire a non seulement eu la « Génération décapitée » mais aussi, plus tard, dans les années soixante du vingtième siècle, le mouvement tzantique des « Coupeurs de tête » (dont nous avons traduit des poèmes dans « Poésie révolutionnaire d’Équateur : Le mouvement tzantique » ici). Tropisme singulier !
La mort de Medardo Ángel Silva n’est pas entièrement éclaircie. Dans l’anthologie dont nous nous sommes servi (Ariel Clásicos Ecuatorianos, 2e éd., 2019), qui est en fait la réunion d’un recueil, L’arbre du bien et du mal paru du vivant du poète, en 1917, et de poèmes choisis, le préfacier, Hernán Rodríguez Castelo, se montre sceptique vis-à-vis de la thèse la plus courante, celle du suicide, suivant en cela le biographe Abel Romeo Castillo (1969). Dans la mesure où Castillo rejette également la thèse de l’assassinat (dans un triangle amoureux), il en vient à émettre l’hypothèse de la roulette russe (le barillet du pistolet ne contenait qu’une seule balle, mais cela peut aussi bien indiquer une intention suicidaire purement et simplement) ou celle du « somnambulisme mortel, à la Manuel Acuña » (alors même que, dans le cas de ce dernier poète, mexicain, c’est également le suicide qui est la thèse en général retenue !). La question est sensible au plan religieux : obsédé par la mort, Medardo Ángel Silva n’en est pas moins marqué par le christianisme, or le suicide est un acte grave pour le salut de l’âme. Le rejet de la thèse du suicide – sur un certain fond de prosélytisme qui ne permet cependant pas à lui seul d’écarter ce point de vue – s’appuie sur une étude de l’évolution de la poésie de l’auteur, qui montrerait un travail interne sur l’obsession de la mort vers un renouveau de l’attachement à la vie, par la foi, ainsi que sur des questions quant à la passion amoureuse supposée qui aurait déclenché l’acte. Il est certain par ailleurs que les conditions matérielles du poète n’exercèrent pas de pression dans le sens du suicide, autrement dit le poète ne vivait pas dans la misère (qui fut la cause du suicide de Chatterton, par exemple), et il était en outre le père d’une petite fille, ce qui rend un suicide supposé d’autant plus irresponsable et critiquable moralement (ou le rend en soi critiquable, même sans autre fondement pour une critique).
Le suicide est sans doute une explication par défaut, compte tenu de l’existence d’un instinct de mort en l’homme, lequel homme pourrait bien n’avoir en revanche qu’un « réflexe » de survie. Les philosophies du pessimisme radical développent une telle conception. Chez le philosophe Philipp Mainländer, par exemple, suicidé à vingt-cinq ans, l’humanité doit finir, sinon avec l’univers lui-même, où l’entropie est un phénomène généralisé par lequel toutes les sources d’énergie du cosmos sont vouées à s’éteindre et disparaître, bien avant cela dans un suicide collectif universel par « contagion spirituelle ». Dans ce cadre, un poète caressant dans ses écrits l’obsession de la mort a sans doute quelques chances d’être le premier « contaminé » par lui-même.
*
L’arbre du bien et du mal
(El árbol del bien y del mal, 1917)
.
L’investiture (La investidura)
Si, inspiré par Hari, ton esprit se délecte de la volupté littéraire, si l’art des jeux d’amour suscite ta curiosité, alors écoute, suaves, faciles, adorables, ces paroles… (Jayadeva, Gita-Govinda)
C’était par un coucher de soleil magique de pourpre et d’ors,
avec une musique de brises dans les pins sonores ;
les heures défilaient rythmiques au crépuscule
comme une ronde grecque ciselée sur un vase ;
La pampa ressemblait à un velours vert
et ce chromo était pareil à une image d’églogue.
Les vallées écoutaient la parole infinie
avec laquelle Il parle aux choses,
aux humbles brins d’herbe, aux roses,
au lion aux griffes acérées,
au vent qui secoue la forêt orgueilleuse,
et dirige dans les ombres l’orchestre symphonique
du bosquet, en concert de demi-million de harpes.
Comment se fit-il que soudain je me trouvasse dans la forêt –
qui, lugubre et sans chemins, était sœur de la sylve obscure
que vit le Dante ?
Je ne sais. Comme un enfant je tremblais de peur ;
dans ma chair l’Angoisse plongeait ses ventouses
ainsi qu’un poulpe informe ; à mon oreille parvenait
une caricature confuse
de sanglot, de blasphème et de rugissement.
Mille insectes conversaient en dialectes nasillards
et, déployant la soie de leurs ornements,
dans la pénombre ces insectes étaient
des pierres précieuses avec des ailes.
Les fleurs exotiques imitaient de sveltes bayadères,
et de leurs pétales obscurs s’exhalait
une haleine de fragrances narcotiques
qui montait à la tête des animaux, en rêves impurs.
Dans cette chaude atmosphère,
comme un remords
se faisait entendre la reptation d’invisibles vers,
une rumeur de fermentation
sortant du sein des chênes anciens…
Les lianes s’enroulaient autour des troncs massifs,
déployant dans leurs courbes des sortilèges féminins,
donnant à leurs mouvements des inflexions perverses
et simulant en maladroites convulsions
les spasmes lubriques de la jouissance…
Et, à la lueur livide d’une lampe à huile,
tout cela prenait à mes yeux des aspects inouïs,
lorsque je vis passer des cavaliers des cavaliers,
confusément, et j’entendis les cris rudes
par lesquels excitaient dans le bosquet occulte
leurs lévriers agiles
les mânes de l’Envie et de l’Injure…
Mais mon esprit triompha de cette embuscade perfide
et je lançai, comme un lys sur une eau stagnante,
sur eux la pitié silencieuse d’un regard.
Puis, tel un Amadis de moderne épopée,
je poursuivis mon chemin, sous l’admiration muette de la forêt…
Oh ! alors mes yeux extasiés contemplèrent
la merveille sacrée du visage de la Déesse,
mes sens fous prosternés la virent,
portant un auguste diadème sur son front rose.
Elle avait tout le savoir dans ses pupilles,
de ses mains naissaient les desseins éternels,
comme un oiseau dans son nid l’Harmonie sacrée
résidait sur ses lèvres. Son regard versait
de la lumière sur les ténébreux glaciers intimes !
Oh, céleste prodige ! Le Dieu suprême
de solaires fulgurances avait tissé son habit immaculé.
Ses seins palpitaient comme des mers tranquilles
de marbre pentélique. Oh, céleste prodige !
Et dans l’air subtil son inénarrable accent,
sa voix, comme jamais mortel n’en entendit,
vibra telle un miracle d’impossible douceur
dans un badonguement triomphal de cristaux sonores :
« Lyrique adolescent, réalise ta vocation ;
que ton esprit soit un bûcher ardent ;
mets tes rêves en musique,
sois divin par le haut don de la Lyre.
Dans le calice améthystin écumant de miels dorés,
donne à boire à ton âme assoiffée d’idéal ;
Psyché est un papillon
qui dans son vol se pose
sur la chair rose des roses charnelles !
Sois ingénu, comme l’eau des pures citernes
ou de l’étang qui reflète le ciel tout entier ;
tu verras triompher l’aurore de ton aspiration,
et le royaume des choses éternelles sera tien.
Tu sauveras les dures vérités métaphoriques
de l’abîme profond de toi-même,
et tu écouteras les claires musiques pythagoriques
depuis la nuit de ton abîme…
La fontaine d’Hippocrène jaillit en toi ;
Pan sommeille dans le noble sein de l’Adamite ;
examine-toi dans la pénombre, regarde-toi, lis en toi
comme en un livre ouvert de Vérité et de Vie !
Fais taire l’interrogateur de l’Avenir, qui prive de lumière,
dresse-toi haut et serein dans la grâce du jour
rose ;
et, en toute chose,
cherche éternellement
l’Harmonie, l’Harmonie, l’Harmonie… »
Ainsi parla la Déesse…
En extase dévote,
mon esprit écoutait cet enseignement divin…
Levant les yeux, je vis que l’enchantement était rompu :
la vision se dissipait dans les lointains bleus.
La forêt paraissait un cœur immense,
les doux fruits d’or pleuraient de l’ambroisie,
la terre respirait comme un subtil encens.
J’étais plein de Toi, auguste Poésie !
Entre les arabesques des branches en fleur,
où la rosée était des larmes de diamant,
les étoiles s’éparpillaient
comme une traînée de globules d’or.
Et heurtant son impétuosité sur les pierres
pour la délectation de la forêt,
la rivière complétait cet orchestre
de ramages, de brises et de bouches… !
Depuis lors, la multitude fascinée m’a vu
– l’œil incendié par la fièvre sacrée,
le front couronné d’épines comme le Christ,
mains tremblantes d’orfèvre chevelu –
dédaignant les futilités du monde,
consacrer mon existence au rite apollinien ;
ainsi ma vie possède-t-elle l’harmonie d’un vers,
et devient sanglot rythmique ce qui naît cri.
Indifférent au temps et à la douleur,
sur la route ignorée va mon esprit pérégrin,
tandis que caché dans l’ombre assassine
l’Archer me tire en vain ses flèches !
*
Crépuscule d’Orient (Crepúsculo de Asia)
Des roses vierges inclinèrent jusqu’à
tes cheveux le réseau de leurs pistils,
au baiser des étoiles, rendues inquiètes
par tes pupilles humides de grâce.
Comme une araignée ourdissant
la perfide trame de ses fils,
l’ombre des tilleuls se projetait
sur ton balcon de vieille aristocratie…
Tremblantes devant le prodige de tes charmes,
comme noyées de larmes célestes
les étoiles fixes te contemplaient.
Et c’était un triomphe de reines diadémées
dans les Mille et Une Nuits parfumées
du monde sidéral de tes bijoux !
*
Heure sainte (Hora santa)
Les miroirs aux regards limpides
avec une voluptueuse complaisance
reflétaient ta magnificence impériale
de blondes et de soie parfumée.
Les bougies à la flamme ardente
dans le salon à l’orientale opulence
imitaient, enveloppant ta présence,
les yeux d’un animal hypnotisé…
En une rare mélodie, Chopin
versait un long et musical sanglot…
des cadences fuyaient comme de vains rêves…
Il flottait un parfum de lilas couchés,
et devant l’immensité de tes pupilles
je laissai mon cœur entre tes mains !
*
Stances (Estancias) (4/12)
Seigneur, mon pied n’a pas même encore parcouru
la moitié de la route, dont parlait le Florentin,
et je suis dans le noir complet et marche à la manière
de l’enfant qui dans une forêt ne connaît le chemin.
De profundis clamavi. Berger des cœurs,
donne à mon âme le feu qui fit de l’hétaïre une sainte ;
renouvelle les miracles des résurrections ;
comme Lazare, j’attends que tu me dises : Lève-toi !
–
Pas une volonté, pas un espoir, pas même un désir
n’agite cet étang crépusculaire qu’est mon âme.
Mes lèvres sont humides des eaux du Léthé.
La mort m’offre par anticipation son meilleur présent : la paix.
De toutes les passions je porte le feu éteint,
je ne suis qu’une ombre de tout ce que je fus,
cherchant dans les ténèbres, pareil à un enfant aveugle,
le magique chemin qui conduit à l’oubli.
–
Lassitudes d’automne… plus rien ne m’enthousiasme
de ce qui provoquait mes admirations d’enfant,
et je vais dans la vie comme un pâle fantôme
parcourant les rues d’une ville en ruines.
Mon âme, qui croyait le printemps éternel
quand elle entreprit ses fous et doux pèlerinages,
aujourd’hui, comme un lépreux dans sa caverne,
voit lentement pourrir les fruits de ses jours.
–
Pour nous qui avons, comme un poignard subtil,
à l’intérieur de l’âme un poison ;
pour nous qui voyons notre illusion d’avril
faite misérable charogne ;
c’est en vain que résonne ton histrionesque tambour de basque,
ô vie frivole et banale !
puisqu’elle n’est pas pour nos lèvres, la divine chanson
printanière et matinale.
*
Estampes romantiques (Estampas románticas) (La cinquième des cinq)
Par les salles bleues, mélancoliquement,
la lune traîne sa robe de mariée,
tandis que les brises déploient dans les parcs en fleurs,
avec une rumeur de soie, leurs ailes tremblantes…
Au clair de lune énigmatique et triste,
dans le bleu de la nuit harmonieuse
un château dressé sur le fief d’antan
dessine les finesses de sa silhouette gothique…
Aux douze coups, l’étoile versant ses fleurs d’oranger,
se répand une fragrance de lointaines légendes…
et se font entendre les pas furtifs des nobles dames…
et un grincement de gonds aux fenêtres couvertes de mousse…
*
Divagations sentimentales (Divagaciones sentimentales) (2/5)
I
Vie de la ville : l’ennui quotidien,
les beaux rêves morts et le cœur déchiré ;
vie extérieure et desséchée, vie fausse, océan
sur lequel mon âme est comme un esquif perdu !
Non, donne-moi le règne pur du silence exquis,
la solitude, fleurie de pensées blanches,
et la tour intérieure ouverte sur l’infini,
au-delà de la douleur, du temps et de la vie.
Où mon cœur – urne de mélodie –
répand en tristes vers son lyrique trésor
et dort dans ton giron – ô Poésie sacrée ! –
devant le lys, sous l’étoile, au tiède crépuscule d’or.
–
V
Comme ces moines pâles dont parlent les légendes,
spectres des noirs corridors conventuels,
je veux abandonner les chemins scabreux
où le Mal ourdit ses sept labyrinthes fatals.
Dans un cloître j’enfermerai ma douleur exquise
et seul avec mes rêves je cultiverai mes roses ;
miroir qui reflète l’Infini sera mon âme,
par-delà l’humaine limite des choses…
Ainsi, ma vie sera vie de paix… jusqu’au jour
où dans la cellule dévote les frères me trouveront
moribond au pied de la Vierge Marie,
serrant ton portrait jauni dans mes mains !
*
La libératrice (La libertadora)
De ma tour d’ivoire
je vois passer la vie.
Mon âme romantique et légère
soupire, sourit, s’ennuie.
Il y a un jardin de roses noires,
il y a un jardin de lys blancs :
roses noires sont mes tristesses,
lys blancs mes illusions.
Parfois, dans l’air bleu,
le vent sanglote un miserere,
s’enfuit un oiseau aux ailes de tulle :
c’est un lys qui meurt.
Et tellement sont déjà morts,
en silence, un par un,
que le jardin bientôt sera désert,
il n’y aura plus personne.
Déjà ne reste plus de mon printemps
qu’une odeur de rose desséchée…
et mon âme attend, attend, attend,
filant des rêves à son rouet.
Elle attend d’ouïr aux confins,
au terme doux de son destin,
la voix aiguë du clairon
de la Mort.
Les dures chaînes tomberont,
s’ouvrira la porte de fer :
et dans un parfum de lys blancs
l’âme quittera sa prison !
*
Le chasseur (El cazador)
Satan est un chasseur dissimulé dans la céleste sylve
où divague le troupeau mystique,
et, comme celle d’un jeune satyre, dans cette agreste douceur
résonne la tentation de sa flûte subtile.
Malheur à qui écoute le chant du Mal ! à qui écoute
la perverse sirène du Péché mortel :
même en déchirant sa chair possédée, il ne pourra
extirper le poison du fatal sortilège !
Et tu le sais bien, toi, mon âme mélodieuse,
hirondelle chantante dans la claire harmonie
du bosquet où les Chœurs pincent les cordes des luths,
toi qui vis le chasseur, entre ses mains lascives,
ses mains velues, emporter prisonnières
les sept colombes de tes sept vertus.
*
Offrande à la Mort (Ofrenda a la Muerte)
Mère nourricière, clef de nos cachots,
ô toi qui à nos côtés marche à pas d’ombre,
maudite impératrice des noirs empires,
quel est le mot talismanique qui te nomme ?
Porte scellée, mur où expirent sans écho
les interrogations de la tribu humiliée,
de même que la toux d’une poitrine creuse
ne peut troubler l’harmonie pérenne des constellations.
Je chanterai dans mes odes ton visage mensonger,
ton corps mélodieux comme un bras de lyre,
tes pieds qui ont foulé des Érèbes et des Léthés,
et la sereine grâce de ton regard fleuri
qui noie nos âmes, exemptes de désirs,
dans une mer de silence, de quiétude et d’oubli.
*
De profundis clamavi
Seigneur, vois nos âmes dans leurs dures prisons
où de vagues philosophies ne jettent aucune lumière,
vierges jetées nues aux molosses,
à peine allumées les roses de leurs beaux jours.
En vain nous avons cherché en différentes voies
la route bleue qui mène à l’idéale Byzance…
et maintenant nous marchons vers le havre de tes bras divins,
pauvres en volonté, par la fatigue exsangues…
Nous avons sacrifié notre amour à de folles idolâtries,
quand nous croyions éternels le plaisir et la vie…
et maintenant à tes pieds nous abandonnons ces dépouilles
attachées au ruban des rêves fanés.
*
Poème de la chair (Poema de la carne)
Chair de l’assassin, maudite pourriture
qui pend des gibets en grappes funèbres
et montre aux yeux de la multitude avide
le maléfique héritage de tous reçu !…
Oh, chair des martyrs, Gloria in excelsis Deo ;
de notre Roi le Christ divines moissons !
Oh, lèvres toujours ouvertes à la consolation d’un « Je crois » !
Divin habit transpercé de flèches !…
Oh, chair des vierges qu’hermine l’innocence,
neige, lys, étoile, iris, campagne polaire
sur laquelle n’a point posé l’Amour son pied de feu !
Hostie, chair de Dieu pour la cène mystique,
qui par le miracle de la grâce eucharistique
à notre chair immonde unit sa sainte chair !
*
Poèmes choisis
(Poesías escogidas)
.
Sonnet (Soneto)
Ô Reine silencieuse, couronnée
d’ombres et de pâle asphodèle,
dont les mythiques yeux consolateurs
ont l’infini pour regard !
As-tu brisé les rameaux funèbres
sous ton pied si léger de glace ?…
Et cette rumeur, est-ce le vol nocturne
de ton ombre désolée ?
La brise bourdonne sur la terrasse déserte
et prononce, effleurant les rideaux,
le nom d’une morte idolâtrée.
Il y a des bruits de robe sur le tapis,
et je ne sais quelles phrases sibyllines
dit dans l’ombre une voix de femme !
*
À une qui est triste (A una triste)
À sœur Marie de la Consolation (Sor María de la Consolación)
Au son vague des célestes lyres
du vent qui divague dans les frondaisons,
tu chantes, et l’on ne sait si tu soupires
ou si c’est le rossignol qui t’imite.
Tes yeux noirs au dolent regard,
je ne sais dans quel tableau de Rossetti je les ai vus,
ils me rappellent inconsciemment
les yeux mélancoliques du Christ.
J’aime, pour sa douleur, ta beauté :
ton doux visage de vierge martyre
couronné de tristesse mystique.
Et ton esprit romantique vaut plus
que tout ce qui existe, possédant
la suprême élégance de ce qui est triste.
*
Le mendiant (El mendigo)
Oh, l’angoisse de vouloir exprimer l’ineffable
quand, oiseau prisonnier, une émotion agite
ses ailes dans la prison du verbe misérable
qui jamais ne traduit en rythmes son infinie douceur !
Las ! mieux vaut le rossignol dont la gorge trille
son amour et sa peine que la langue de l’homme,
dont l’âme douloureuse devine l’Infini,
sent l’Éternité… et ne sait la nommer !
Nous sommes comme un mendiant qui, possédant un trésor
dans sa besace, supplie la terre pour des aumônes…
De temps en temps tombe une pièce d’or
dont l’éclat trahit le contenu du sac !
*
L’horloge (El reloj)
Ta jeunesse de musique, de parfums et de trilles
sent les magnolias humides, la terre après la pluie…
c’est une odeur charnelle et spirituelle, une fine
odeur que je porte en moi sans pouvoir l’oublier.
De ta blancheur me parle la divine étoile,
le rossignol connaît ta voix et l’imite,
et la divagation du vent vespéral
m’apporte le souvenir de tes cheveux de soie.
Mon cœur se vêt du deuil de l’absence…
et parce que je me souviens ma nuit est moins triste,
mais dans mon âme résonne, sinistre, agressive,
cette horloge qui compte les heures passées loin de toi,
et je l’écoute ainsi qu’un enterré vivant
qui entendrait un impossible commentaire à sa mort.
*
La mort parfumée (La muerte perfumada)
Convalescent de ce mal étrange
dont toi seule connais le remède,
le soir me vit, fantomatique et sauvage,
comme échappé de la sépulture.
Le malheur a fauché mes joies
ainsi qu’un innocent et candide troupeau,
sous la faux d’une vieille désillusion
mon bonheur fugace agonise…
Chevelure blanche dépeignée,
la pluie ondoyait derrière la vitre…
et, ce soir pâle et caduc,
je sentis dans ma douce prostration intérieure
la belle tentation de me donner la mort
en me tressant une corde avec ta perruque !
Poésie indigène contemporaine d’Équateur (révolutionnaire)
Après ma série sur le mouvement tzantique de la poésie équatorienne (ici), mouvement qui tire son nom de la culture des Indiens Jivaros, ou Shuar, d’Amazonie, je cherchai à savoir s’il existait, traduite en espagnol, de la poésie indigène shuar.
Mes recherches m’ont conduit au recueil Ñawpa pachamanta purik rimaykuna, Antiguas palabras andantes (Casa de la Cultura Ecuatoriana, 2016) (Anciennes paroles vivantes) réuni par la poétesse de langue quechua Lucila Lema Otavalo. Il s’agit d’une édition bilingue de poètes indigènes contemporains d’Équateur.
Parmi les textes de ce recueil, j’ai ici traduit huit poèmes de la poétesse shuar Raquel Antun. Les autres auteurs sont des poètes de langue quechua : Lucila Lema Otavalo (5 poèmes), Segundo Wiñachi (1), Manuel Paza (4), Achik Lema (3) et Yolanda Pazmiño (2).
J’ai traduit les poèmes à partir de leur traduction en espagnol. Il n’est pas indiqué dans le recueil qui est responsable de ces traductions espagnoles ; peut-être chacun a-t-il lui-même traduit ses textes.
*
Natem par Raquel Antun
Note. Une note de bas de page explique que le mot natem est le nom shuar de l’ayahuasca, « plante sacrée que l’on ingère pour obtenir des visions ». Sur ce mot ayahuasca, voir Americanismos I.
Des milliers de lumières allumées
Diverses formes : boas, couleuvres, tigres, aigles
c’était le monde des esprits Arutam,
et je tremblais : froid ! froid !
tu m’attendais,
épiant mes rêves
ton coup de griffe me donna le pouvoir
je te vis, te suivis, marchai jusqu’à toi, tu me reniflas, m’étreignis,
tu léchas mon visage, me mordis
J’étais la tigresse Yampinkia !
J’avais mangé du NATEM !
*
Appel au guerrier (Mankantiniun untsuamu, Llamado al guerrero) par Raquel Antun
De doux murmures s’entendaient au loin dans la bouche de la caverne, mon grand-père disait que c’était l’appel de la grotte au guerrier pour éprouver sa valeur.
*
Petite souris (Katipich’, Ratoncita) par Raquel Antun
Tu m’appris à enfanter, moi si grande et qui ne pouvais le faire.
Tous mes semis d’arachides t’appartiennent ; mange, nourris ta famille, et je ferai de même avec la mienne.
Nous continuerons de naître et de grandir grâce à toi, petite souris du potager aux arachides.
*
Femme tabac (Nua tsankram, Mujer tabaco) par Raquel Antun
Au clair de lune, tu souffles sur son ventre et elle commence à être femme.
Par tes chants sacrés tu demandes à Nunkui qu’elle soit comblée de santé, prospérité, richesse.
La fille rêve des rêves de grandeur et prospérité.
Elle rêve de poules et de chiens.
Elle rêve de montagnes et de vallées.
Elle rêve de Nunkui la terre mère.
C’est la célébration de la femme tabac !
*
Chant sacré (Anent, Canto sagrado) par Raquel Antun
Je chante quand le soleil meurt,
Ces rayons de mort insufflent de l’amour dans ma mélodie et le miracle de l’amour survient, de fines vibrations parviennent au cœur de l’aimé et insufflent la passion dans son âme.
Mon chant va jusqu’à toi et t’enveloppe de couleurs ; comme l’anaconda enveloppé en toi cheminera mon chant sacré et tu ne pourras m’oublier, je te serai toujours présente, mon bien-aimé.
*
Jaguars dans le ciel (Yampinkia nayaimpiniam, Jaguares en el cielo) par Raquel Antun
Et les jaguars monteront au ciel, transformés en étoiles.
Quand tout à coup le ciel rugit, c’est eux, à qui manque la chaleur de la terre.
Les jaguars mangent de la poussière d’étoiles, ce sont mes aïeux, qui guident mes rêves.
*
Shaman (Uwishin, Shaman) par Raquel Antun
Et sous sa longue chevelure noire il s’immergea et put respirer sous l’eau. Il alla au royaume des Tsunki pour vivre comme eux.
Il découvrit que le royaume de l’eau est merveilleux, ils lui apprirent à soigner les malades, à calmer leurs douleurs.
Il reçut des Tsunki leur pouvoir, le pouvoir qui se trouve dans la parole et dans la salive.
Il devint shaman.
*
Époque de pénurie (Naitiak, Época de escasez) par Raquel Antun
Beaucoup de pluie, de froid, de brouillard, dans la forêt tout est triste. Les grenouilles chantent croa, croa ! Les tigres errent, les perroquets volent dans les hauteurs avec leurs typiques crac, crac ! Les agoutis et les pacas, les cochons sauvages, les cerfs, tous cherchent de la nourriture mais ne la trouvent pas. C’est l’époque de Naitiak, où la nourriture se fait rare et où les animaux connaissent la faim. Tous attendent avec impatience l’arrivée d’Uwi et avec lui l’époque de l’abondance.
*
Les morts (Wañushkakuna, Los muertos) par Lucila Lema Otavalo
Les morts ne sont pas sous terre. Ils peuvent diviser le temps en deux parties : parfois ils viennent, mangent du miel et des oranges douces ; là-bas dans l’autre vie ils parlent avec les esprits qu’ils aiment, dit ma mère, qui m’embrasse encore.
*
Arrayán par Lucila Lema Otavalo
Là où pour d’autres il n’y a rien, vivent, dit-on, les esprits apus qu’aime une personne. Ce doit être pour cela que dans ces terres urbaines je te rencontre, père antique, et te nomme. Je viens avec la pluie ; j’apporte de l’eau et des fruits pour tes racines infinies. Un colibri en est témoin.
*
Nous attendons (Shuyanchik, Esperamos) par Lucila Lema Otavalo
– Notre Père qui es aux cieux –,
nous avons besoin de toi ici, maintenant.
Sur l’antique domaine de notre terre
où nous avons laissé les fleurs se faner
et où notre chemin a voulu s’effacer.
Nous t’attendons ici ;
où tout l’amour s’était fait
chanson triste.
Nous t’attendons maintenant :
où vivent les yeux des nouveau-nés
et l’odeur des mûres sauvages.
Nous t’attendons, père :
où s’immobilise la lune,
ma grand-mère.
*
Amour (Kuyay, Amor) par Lucila Lema Otavalo
Il aime ses colliers
et la magie de les enlever,
sous la spirale infinie de la nuit.
Elle aime ses cils,
où s’enroule son cœur ; et des colibris dansent
quand s’allume le soleil.
*
N’aie pas peur (Ama Manllaychu, No temas) par Lucila Lema Otavalo
Cet astre approche. Les colibris battent des ailes. Mon cœur fait plus de bruit que la cascade. Avec tes lèvres j’irriguerai la terre. Que sur nous joue le vent. N’aie pas peur : ma mère dit que même les montagnes s’aiment.
*
Questions au condor (Malkuta Tapuy, Pregunta al cóndor) par Segundo Wiñachi
Puissant condor, si c’est pécher pardonne-moi ces questions
Qui avant toi a foulé cette terre, vécu sur cette terre ?
Qui a fait présent de cette source ?
Qui a créé ce grain originel appelé maïs ?
Qui a créé cet arc-en-ciel ?
Qui a fait ce sang ?
Qui a bâti ces montagnes qui sont comme des cabanes d’où monte de la fumée ?
Qui a apporté, d’où viennent ces souris, quelle est leur origine ?
Pourquoi cette lagune s’appelle-t-elle Yawarcocha1 ?
Pourquoi ces précipices sont-ils si profonds ?
Pourquoi ce fleuve est-il un courant impétueux ?
Cascade horizontale,
Où va-t-il, où se perd-il, quelle est sa fin ?
Puissant condor, ton bec fut mon refuge
Quand les barbus voulurent m’anéantir
Tu es le seul à savoir comment se passa la création.
Et pourquoi sommes-nous aujourd’hui malades du smog pestilentiel ?
Ô puissant condor, avant que tu ne t’éteignes
Conte-moi les secrets
De ta sagesse, de ton pouvoir
Pour les transmettre à la génération future
Si tu disparais, je n’aurai plus personne à qui le demander
Quand je serai mort peut-être irai-je dans l’infinitude du ciel
Où de nombreux êtres vivent en volant comme toi.
1 Yawarcocha : ou Yahuarcocha, lac situé dans la province d’Imbabura. Il fut, avant l’arrivée des Espagnols, le lieu d’une bataille entre Incas et Otavalos, d’où son nom quechua qui signifie « mer de sang ».
*
Fille maïs (Sara wawalla, Niña maíz) par Manuel Paza
Cela me fait de la peine de te voir triste, enfant
visage souillé, cheveux au vent, emmêlés.
Regard immuable !
Tu vas par ces rues sans empreintes,
…mais tu ne pleures pas.
Reviens !
Cette faim n’est ni à toi ni à moi.
Elle va s’éteindre.
Lève-toi ! Le passé de l’éternel retour est ici.
D’autres mangent aux banquets de ta sueur ;
toi, du travail quotidien tu goûtes seulement l’odeur
de ce qui fut autrefois notre nourriture.
Tu es fille de ces terres, du rêve maternel,
de l’amour de la Terre Mère,
essence des ancêtres.
Les petites mains peau épi
blanchies par tant de travail…
Je te regarde, tu es là,
présente, mais tu n’existes pas.
Tu vas et viens, seule
avec ton chien abandonné.
Où est ta famille ?
Où est ton pays ?
Tu rêves de joie à l’horizon
et les rues ne te disent mot.
Ton regard se perd au coin de la rue.
L’horizon est au-delà du soleil !
Là-bas sur la montagne sacrée.
Tu t’interroges sur ton passé, mais
si cet autre mange ce qui est à moi et à toi !
Il n’y a pas de présent.
Silencieux le regard,
innocentes tes lèvres.
Aujourd’hui je te revois,
tu marches jusqu’aux étoiles
au-delà des montagnes sacrées.
Cours ! Ne laisse pas
les bourreaux d’outre-mer t’attraper.
Ne laisse pas la faim t’anéantir.
Le maïs est à toi,
le passé et le présent aussi,
le souvenir est à nous et l’avenir aussi.
*
Petite herbe des prés (Urku ukshaku, Pajita de páramo) par Manuel Paza
Note. Paja de páramo, Calamagrostis effusa.
Sylvestre petite herbe des prés
douce et tendre petite herbe
tu te maintiens entre les pluies torrentielles
dans l’obscurité de la brume.
Là, tu pousses à jamais avec les couleurs de la Terre Mère
pour que toujours existe la graine de l’eau.
Moi aussi, je suis comme ça
bien que les Blancs dans leur ignorance m’insultent,
ma langue quechua
je l’ai toujours parlée avec amour en tout lieu.
Pour que mon identité,
ma personnalité d’Indien,
soit comme l’arbre luxuriant.
Pourquoi devrais-je avoir honte ?
Si tu es ma mère
ma vie
mon tout.
Petite herbe des prés
nous serons pour toujours les couleurs de la Terre Mère.
Pour qu’à nouveau fleurissent la langue et les rêves de l’Indien.
*
Je pense (Yuyani, Pienso) par Manuel Paza
Il faut que tu aimes cet argile,
née à la source de l’ayllu2,
que tu portes sur tes mains
dans l’essence de la peau indienne.
Il faut que tu aimes le sable
à la folie,
sinon
n’entame pas ce chemin,
ce serait en vain.
La glaise dont tu es
construite
est le miracle.
La brise sacrée
de tes cellules indiennes,
souvenir des temps passés,
creuset forgé dans
l’ayllu.
Il faut que tu aimes le temps
avec lequel tu fus engendrée.
Sinon
ne prétends pas toucher
le certain.
Il ne t’appartient pas.
2 ayllu : la communauté familiale étendue, communauté de travail, dans le communisme inca.
*
Maudit soit le jour où ils sont venus (Kikinpa shamuyka millaymi kashkami, Maldita su llegada) par Manuel Paza
Pourquoi ?
Ils ont tué soixante-dix millions d’êtres humains d’Abya Yala3.
Pourquoi ?
Ils ont livré au feu nos connaissances sacrées et millénaires.
Pourquoi ?
Ils ont assassiné les savants et les savantes, nos vivantes bibliothèques.
Ils ont violé, outragé nos aïeules, pour que naisse le métis bâtard qui nous tue à son tour.
Ils ont pillé les temples sacrés et millénaires, uniquement pour rassasier leur appétit vorace et malade.
Pourquoi ?
Ils mentent, volent, assassinent, violent, et nous prennent la nourriture dans notre propre maison.
Hypocrites !
Vous nous avez poignardés dans le dos.
Puis
vous avez établi
le colonialisme sur nos peuples, pour célébrer la « rencontre de deux mondes » et fêter comme Caïn la mort de son propre frère.
À présent,
vous nous accusez d’être attardés, sous-développés, sauvages…
sachant que nous ne sommes pas vous.
Sachant que grâce au vol, au pillage, à l’agression que vous avez commis contre nos peuples, vous vivez comme des rois.
Soyez maudits !
Vous blessez notre sourire.
3 Abya Yala : « Abya Yala est le nom choisi en 1992 par les nations indigènes d’Amérique pour désigner l’Amérique, au lieu qu’elle soit nommée d’après Amerigo Vespucci. L’expression Abya Yala vient de la langue des Gunas, peuple indigène du Panama qui utilise cette expression pour nommer l’Amérique. … Le leader indigène aymara Takir Mamani a proposé que tous les peuples indigènes des Amériques nomment ainsi leurs terres d’origine et utilisent cette dénomination dans leurs documents et leurs déclarations orales. » (Wkpd)
*
Petite Maman Achiku (Achiku mamaku, Achikumamita) par Achik Lema
J’ouvris les yeux et tu étais là,
Petite Maman Achiku,
Amie depuis toujours,
Source de bonheur
Tu es la mère de ma mère
Je t’ai connue,
Comme si le temps ne passait pas,
Éternellement identique
Peau gercée, natte de sol tissée
Tes dents sont parties
Comme preuve de la profération de préservatrices
paroles de sagesse.
Cheveux argentés, mains calleuses
Monde infini, femme de souvenirs
Tu fus sacrifice, tu es poésie
Et bientôt tu seras libre vent…
*
Mien (Ñukapak, Mío) par Achik Lema
J’explore ton corps avec les mots
Je cherche quelque chose que je n’atteins pas
J’imagine seulement, ta silhouette dissimulée
Une douleur charnelle qui se proclame.
J’ai connu ton mystère le plus caché
Perçu ton aspiration la plus profonde
Goûté à ton plus délicieux souvenir
J’ai senti tes rêves fugaces.
Je me suis immergée en toi, imprégnée de toi
Nectar interdit, alcool de contrebande
Et mon âme tient en trois mots
Je t’aime.
*
Tu me dépouilleras (Shuwakrinki, Me despojarás) par Achik Lema
Tu me dépouilleras de mes terres, comme leur seigneur.
Tu m’enlèveras mes atours, comme s’ils n’étaient pas attestés.
Tu seras maître y compris de mes pas et de mes larmes
Mais jamais de mon instinct d’Indienne
Jamais de mon identité indigène
Jamais de ma pensée quechua
Tu seras maître de tout sauf de moi-même.
*
Femme forte Transito Amaguaña (Sinchi warmi Transito Amaguaña, Mujer fuerte Transitó Amaguaña) par Yolanda Pazmiño
Note. Transito Amaguaña (1909-2009) est une militante d’Équateur, cofondatrice en 1944, avec d’autres membres indigènes du parti communiste, de la Fédération équatorienne des indigènes (Federación ecuatoriana de Indios, FEI).
Maman Transito Amaguaña
grandes enjambées comme l’eau vive
courant de toute part
En suivant le sentier escarpé
Nous sommes davantage pieds
Que racine
La vie a fleuri
Nous sommes des êtres forts
En suivant nos ancêtres
Pour la terre pour la vie
Les rébellions
Pour une vie pleine
Une vie en communion
Avec nos forêts
Pour notre culture
Pour notre langue
Nous suivons ton cri
La voix forte
Comme un ouragan
Déborde
Annonçant le passage
Lève-toi réveille-toi
Allons à la délivrance
Te regardant aller à pied
Nous sommes à présent cela
Nous sommes ici nous sommes un seul corps
Ils n’étoufferont pas tes idéaux
Femme forte, VIVE TRANSITÓ AMAGUAÑA !
*
Voix de l’oiseau (Wakay, Voz del ave) par Yolanda Pazmiño
Au matin la voix de l’oiseau
Sautille et danse autour
D’innombrables couleurs
Qui se confondent avec les fleurs
Au soleil, brillant
Comme le miroir des eaux
Tandis qu’il vole en liberté.