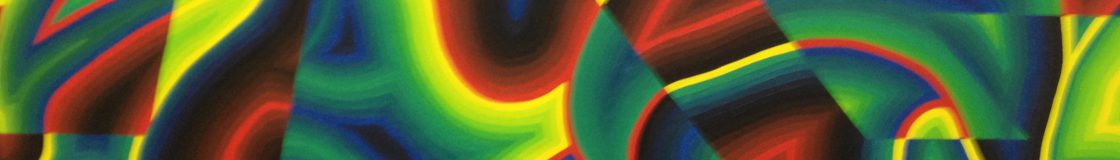Tagged: poésie
À un bouledogue et autres poèmes de John Collings Squire
Le poète anglais John Collings Squire (1884-1958) n’est guère connu en France – bien qu’il ait traduit plusieurs poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire – et sa renommée en Angleterre a de surcroît passablement pâli avec le temps. Directeur de la revue littéraire The London Mercury de 1919 à 1934, c’était un critique influent attaché à la défense du classicisme contre les tendances avant-gardistes qui se faisaient jour. Il fut ainsi la bête noire du Bloomsbury Group, qui forgea le terme « Squirearchy » (Squire-archie) pour dénoncer les tendances littéraires « conservatrices » réunies autour de sa personne, tendances auxquelles on donne autrement le nom de « poésie georgienne » (Georgian Poetry), du nom du roi George V, qui régna de 1910 à 1936.
Ses poèmes réunis en 1959 (Collected Poems by J. C. Squire, chez Macmillan) sont préfacés par John Betjeman, Poète lauréat de 1972 à sa mort en 1984. C’est de cette édition que sont tirés les textes suivants, traduits pour la première fois en français.
*
Crépuscule en hiver (Winter Nightfall)
Le vieux stuc jaune
du temps du Régent
s’écaille, s’effrite :
les rangées de fenêtres carrées
dans l’édifice jaune et rectiligne
sont vides, muettes ;
les sombres sempervirents grisâtres
gardant le portillon
se drapent d’humides toiles d’araignée,
et par-dessus cette pauvre confusion sauvage,
terne et morne,
domine le plateau de la colline.
On dit qu’un colonel
mort en ces lieux il y a longtemps
fut la dernière personne à y vivre :
un vieux colonel à la retraite,
un Fraser ou un Murphy,
je ne connais pas son nom ;
la mort vint le convoquer ici
et son enveloppe charnelle disparut
au-delà de toute spéculation ;
et le silence régna de nouveau,
le silence et le vide,
plus personne ne vint.
Était-ce humide quand il vivait,
les cieux étaient-ils gris et tourmentés,
la pluie à ce point irrésolue ?
Regardait-il la nuit tomber,
frissonnait-il au crépuscule,
avant sa mort ?
Le vent soufflait-il aussi lugubrement,
en bourrasques glacées
chargées de pluie froide ?
L’épaule levée de la colline
était-elle aussi redoutable et menaçante,
sombre et sinistre ?
Franchissant le vestibule,
entrait-il dans son bureau,
allumait-il des chandeliers ?
Fermant les volets,
remplissant de bûches la cheminée
pour combattre l’humidité ?
Et repensait-il à son enfance,
se demandant si l’Inde
fut jamais réelle ?
À la solitude opposait-il
des souvenirs de chasse exotique
et des collections de timbres ?
Peut-être. Mais il n’est plus, à présent,
lui et ses meubles
sont dispersés à jamais,
et jusqu’au dernier de ses trophées,
les bois de cerf et les photographies
sont Dieu sait où.
Et l’herbe pousse autour du portail,
pousse dans l’allée,
pousse au seuil de sa porte ;
le jardin est envahi,
la chaîne du puits brisée,
les fenêtres nues.
Et je le laisse derrière moi,
pour les lambeaux du jour
échevelés et sans couleur,
pour les collines et les murs de pierre
et une meule oubliée
de foin noirci :
la route pâle et trempée,
sillons de charrette et marques de clou†,
et des flaques frémissant sous le vent,
et le clapotis de mes pas
dans la boue cadavéreuse
de ce pays désolé.
† marques de clou : « nail-marks », il s’agit sans doute des clous de roues de charrette, si tant est que ces roues eussent des têtes de clou sur leur circonférence…
*
À un papillon blanc qui volait le long de New Bridge Street, Blackfriars (To a white butterfly seen flying up New Bridge Street, Blackfriars)
Ndt. Blackfriars est un quartier de Londres.
Un jour de grisaille uniforme,
opprimé par le ciel pesant, la foule compacte,
le vacarme des automobiles et des charrettes,
dense et confus parmi la disgrâce agitée
des immeubles laids, je suivais mon chemin vers le nord,
du fleuve à mon bureau. C’est alors que parut,
battant des ailes, triste et las,
s’élevant puis retombant dangereusement à deux doigts de la boue,
un papillon blanc perdu, dont le vol suivait péniblement ma marche,
hésitant à se percher au-dessus de chaque nouvel espace vide
puis se décidant à continuer vers le nord.
Les gens pressés le voyaient. D’aucuns se retournaient
avec des visages souriants ou flegmatiques ; chez certains on voyait brûler
le désir avide et réprimé d’étendre
une main fatale. Dans le Circus, il se posa
sur les annonces de crime d’un crieur de journaux, et ses ailes blanches, verdâtres
tremblaient à moitié ouvertes. Le garçon pointa du doigt, déridé ;
alors il repartit comme une feuille dans une brise tumultueuse,
avec une résolution lasse, à travers la rue
où se rencontrent les quatre voies.
Et je le regardai disparaître en pensant à la route qui lui restait à faire,
à son périple, à ses dangers avant qu’il puisse goûter
la rémission du bruit, la fin de la pierre, une heure
de sommeil sur une fleur,
les ailes en sécurité repliées.
Ah, Psyché ! entre les murs de ce monde errant
avec le souvenir de vertes prairies et d’un air plus pur
tu ne sais où !
*
Une nouvelle génération (A New Generation)
C’est une femme comme une graine,
c’est un homme en embryon,
dont l’esprit, le visage, le sexe même
sont inconnus de leurs propres mères.
Seul leur être est révélé.
Ils sont : tout le reste est dans le noir,
fixé par autorité mais scellé
profondément dans l’avenir et dans la matrice.
Cependant ils sont préordonnés à devenir
l’un une femme et l’autre un homme,
et ils verront la lumière
et téteront et mordront leurs poings et pleureront.
Et ils pousseront à travers l’enfance émerveillés encore
par toutes les beautés de la terre,
ils apprendront l’exercice de la volonté,
la pitié, la vérité, les larmes et la gaîté.
Saison de la jeunesse ! ils vivront dans la joie
à leur tour nos jours passés insoucieux,
mais laisseront derrière eux le petit garçon, la petite fille,
leurs secrets les plus chers toujours gardés.
Encore séparés, ils ne se connaîtront pas,
insatisfaits bien que la vie leur soit légère,
ne trouveront pas, sages ou doux,
les compagnons nés pour être leur groupe,
jusqu’à ce que la destinée, sous la forme du hasard,
fixe le moment avec une épingle d’argent,
décrète un dîner ou une danse,
une maison, un jardin, une auberge,
où ils seront seuls tous les deux un moment,
étrangers, et se parleront ; et elle le trouvera
semblable à elle, et lui trouvera que son visage
est le langage d’un esprit parfait.
Puis ils rejoindront les autres
ensemble, et se sépareront amis,
leur congénialité confessée,
chacun avec un trouble au cœur.
Encore un jour et ils connaîtront
une blessure définitive, frappés par l’amour :
le dieu enfin a tendu son arc
et décoché la flèche qui ne bougera plus.
Lui passera toute la nuit éveillé,
humilié, désemparé, cherchant ses mots,
par la violente douleur de son cœur désespérant
de demander une chose hors de portée.
Elle, toute tremblante dans son lit,
appellera son étrangeté, désirera et pleurera,
éprise, possédée par une virginale terreur,
et verra l’aube sans avoir trouvé le sommeil.
Pressés par le tonnerre ils se lèveront,
et quand quelques heures de plus auront passé
elle, par ses joues brûlantes et ses yeux languides,
lui dira que la guerre de l’homme est gagnée.
Ah, mais je connais leurs mois de bonheur,
leurs silences heureux, leurs heureux dialogues,
comment ils vagueront, s’arrêteront, s’embrasseront,
confesseront, découvriront, tout en marchant ;
comment ils seront debout près de la rivière et de l’étang
puis continueront de marcher, comme s’ils échangeaient leurs vues,
à travers des bois de jacinthes sauvages, des bosquets de primevères,
trouvant en chaque chose de nouvelles délices ;
et ils regarderont le coucher de soleil depuis un portillon,
verront le crépuscule s’effacer, et alors
ils apprendront tout d’un coup à haïr
le mal commis par les hommes…
Ainsi s’uniront-ils et ils auront
un merveilleux enfant, puis plusieurs autres,
la plus belle, forte et gaie ribambelle
que mère ait jamais portée,
et ils aimeront regarder leur nichée
grandir, bien qu’eux-mêmes vieillissent,
et riront de voir leurs premiers cheveux blancs,
car en rire est tout ce qu’on peut faire…
Chaque pensée que tu gardes, chacune de mes pulsations
s’éveilleront en eux mais ils ne devineront pas
que nous avons partagé naguère le vin immortel
de leurs bonheurs et de leurs détresses,
nous qui, sans contredit, étions aussi
les plus sages des êtres humains,
un couple simplement compréhensif,
unique, depuis les commencements du monde.
*
À un bouledogue (To a Bull-Dog)
(W. H. S., Capitaine [Commandant suppléant] de la Flotte royale auxiliaire ; tué le 12 avril 1917)
Mamie, nous ne reverrons plus Willy,
il ne viendra plus :
il est revenu une fois et bien d’autres encore
mais cela ne lui sera plus possible.
Nous regardions par la fenêtre, c’était son taxi,
comme l’éclair nous dévalions alors l’escalier,
et il disait « Bonjour, mauvais chien ! » et tu t’aplatissais au sol,
paralysé de l’entendre parler.
Et puis tu te jetais contre son visage et sa poitrine,
au point que je devais te retenir,
tandis qu’il retirait sa casquette, ses gants et son manteau,
posait son sac et son baudrier.
Nous montions à l’étage, au studio,
tous les trois, comme avant,
tu te couchais et je m’asseyais, et lui parlait
en allant et venant dans la pièce.
Dans cette pièce où, il y a des années,
avant que la vie d’autrefois prît fin,
il travaillait tout le jour pantoufles au pied, fumant sa pipe,
le voilà qui ramassait les bribes qu’il avait jetées,
caressant les dessins laissés derrière lui,
content de les retrouver tels quels,
ouvrant les tiroirs pour regarder ses affaires…
chaque fois qu’il revenait.
Mais à présent je sais ce qu’un chien ne sait pas,
quand bien même tu poses ta tête sur mes genoux
et tentes de me tirer de cette distraction
que tu trouves si ennuyeuse chez moi.
Et de toute ta vie tu ne sauras jamais
ce que je ne te dirais pas même si je le pouvais,
que la dernière fois que nous lui avons dit au revoir
Willy s’en est allé pour de bon.
Mais parfois quand, couché sur le tapis,
tu dors à la chaleur du poêle,
même à travers ton vieux cerveau confus de chien
des formes du passé reviennent.
Tu ne te souviens guère, même en rêve,
qu’un jour nous avons ramené à la maison un chiot follet
avec une petite tête carrée et de petites jambes tortes
qui pouvaient à peine le porter,
mais ta queue remue au souvenir
d’un homme dont tu étais l’ami,
qui était toujours gentil bien qu’il t’appelât méchant chien
quand il te trouvait sur sa chaise ;
qui brandissait un doigt réprobateur
et te sermonnait solennellement
au point que tu baissais la tête, l’air contrit !
Et tu rêves à tes triomphes aussi.
Aux poursuites les soirs d’été dans le jardin,
quand tu nous esquivais avec un os dans la gueule :
nous étions trois garçons et tu étais le plus malin,
mais maintenant nous ne sommes plus que deux.
Quand l’été reviendra,
dans les longs couchers de soleil
nous jouerons encore à deux ce faible jeu
que nous jouons depuis la guerre.
Et bien que chaque fois tu coures plein d’espoir
vers les uniformes que nous croisons,
tu ne trouveras jamais Willy parmi les soldats,
même sur la route la plus longue.
Ni dans aucune foule ; pourtant – étrange, amère pensée –
encore aujourd’hui si les mots d’hier étaient redits,
si je te rejouais le même tour qu’autrefois, disant « Où est Willy ? »,
tu sentirais un frisson d’excitation et lèverais la tête,
et tes yeux bruns me demanderaient si je suis sérieux,
attendant un mot pour t’élancer.
Dors en paix : je ne le dirai plus,
pauvre chose innocente.
Je dois rester muet sur le sofa
tandis que tu dors par terre ;
car il a subi une chose auquel les chiens ne peuvent rêver
et ne reviendra jamais plus nous voir.
*
Mort d’un chien (A Dog’s Death)
La terre molle tombe sur la sépulture comme une calme respiration régulière ;
trop pareille, car je fus trompé un moment par ce bruit ;
elle a recouvert le tas de fougères que le jardinier avait posé sur lui ;
la pelle va et vient tranquillement : c’est ici qu’est à présent son tumulus.
Une motte de terre fraîche sur le sol de la chambre renouvelée des bois ;
tout autour, l’herbe et la mousse et les bourgeons vert foncé des jacinthes ;
et les chênes au-dessus de ma tête qui étaient déjà vieux quand son cinquantième ancêtre était un chiot ;
et loin dans le jardin j’entends les cris des enfants.
Leur joie est distante à la manière d’un rêve. Étrange comme nous acceptons notre peine
au contact des choses périssables, passivement, les yeux ouverts ;
comme nous donnons nos cœurs à des bêtes qui mourront dans quelques saisons
et ne nous troublons pas quand nous le faisons, ni ne voulons qu’il en aille autrement.
*
Sonnet à un ami (Sonnet To a Friend)
C’est un appréciateur, pas un critique.
(A Weekly Paper)
Il aurait pu être un critique et percer des trous
dans la gaze, défaire le lit de l’Aurore,
écraser des papillons et décolorer le rouge des roses,
voler leurs auréoles aux anges.
Il aurait pu être un critique jetant avec parcimonie,
la bouche pincée, des hommages aux morts,
s’il n’avait pas choisi de rester
un de ces vulgaires idiots ayant un cœur et une âme.
Il aurait pu parler d’esprit avec affectation,
faire du mont Parnasse une morgue
d’eunuchisme et de logique et de Laforgue,
et repousser avec un amer déplaisir toute grandeur,
criaillant : « Je crains de n’être pas convaincu. »
En fait, il aurait pu être un snob tout ce qu’il y a de moderne.
*
L’esprit de l’homme (The Mind of Man)
I
Sous mon crâne, mes cheveux,
couverte comme un puits méphitique
se trouve une contrée : si tu y regardais,
tu craindrais de dire ce que tu as vu.
Toi qui restes assise là en souriant,
tu sais que ce que je dis est vrai.
Ma tête est toute petite au toucher,
je la sens entièrement de mon front à ma nuque,
c’est une boule de faible masse avec des oreilles,
des yeux, des narines, un intérieur pulpeux :
comme elle est petite, si petite !
comment pourrait-il y avoir des pays à l’intérieur ?
Pourtant, quand je regarde, les paupières fermées,
parfois sombres, parfois clairs, luisent devant moi
la cité de Cis-Occiput,
le marécage et le lac frémissant,
le pays que chaque homme que je vois
connaît en lui mais non en moi.
II
Sur les bords de la forêt
(c’est là que je vais en premier quand je reviens),
parmi les arbres verts et les champs souriants
se trouve la ville, épargnée par le péché ;
de blanches pensées et des vœux purs
vont par les rues d’un pas discret.
Dans les clairs bosquets, les halls spacieux,
les habitants aux yeux calmes
organisent d’innocents festivals enjoués
et se mêlent en danses décentes ;
les choses qui détruisent, déforment, dégradent
n’entrent pas en ces lieux adorables.
Jamais le mal ne pourrait y entrer,
il ne pourrait vivre dans un air si doux,
ici l’ombre des maux ne peut que se faner,
être réduite à néant.
Tu dirais, regardant autour de toi,
qu’en ce pays tout est beauté.
…..
Mais passe les portes,
traverse les bois et la plaine,
franchis la frontière là-bas, et tout à coup
il n’y aura plus d’arbres, plus d’herbe
et tu pénétreras dans une steppe
de bois mort, une stérilité calcinée.
L’intérieur du pays est ainsi,
un désert bistre enfoncé dans les terres,
dénué de toute forme de vie,
hormis la nuit quelques vols de vampires
qui nichent dans les marais
où toutes choses, sauf les plus viles, doivent périr.
Dans ce marécage couvert de joncs,
aux vertes mares huileuses, grouillent de gras insectes,
des oiseaux de proie, des bêtes obscènes,
toutes choses qui font trembler le voyageur,
choses rusées qui rampent et volent
pour sucer le sang de l’homme jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Rarement de ce lieu quelque chose ne s’échappe
vers la lumière du monde extérieur,
mais de temps en temps une forme sombre
jaillit soudain en un vol de fusée ;
et les hommes restent pétrifiés ou consternés
devant cet acte, cette pensée ignoble.
Mais, ah ! au-delà du marais il est
une place purulente plus vile que toutes les autres,
un lac fétide trop immonde pour en pouvoir parler,
putride et noir d’anneaux rampants,
où se tordent avec des cris de rut stridents
des horreurs qui figent le cœur.
Là, sous un ciel malade se trouve
cet étang vivant de vers visqueux,
aux perverses et terrifiantes infamies,
et des meurtres et des formes répugnantes
qui n’ont point de nom mais glissent dans ces profondeurs,
tandis que moi qui les abrite je ne dis mot.
*
Guirlande de l’amitié (Friendship’s Garland)
I
Nous nous sommes revus l’autre soir,
avec des gens ; tu fus très courtois,
serras ma main et discutas un moment
de choses indifférentes avec un sourire prudent,
payant la dette due
à ceux qu’on a connus.
Mais quand nos regards se fixèrent, tu baissas les yeux
et soudain, avec résolution, t’arrêtas,
partis en lançant des syllabes précipitées
engager quelqu’un d’autre.
Je ne les entendis pas, elles devaient dire :
« Laisse les morts enterrer les morts,
les choses étaient alors différentes,
les enfants sont idiots et les hommes sont hommes. »
Plusieurs fois au cours de cette soirée
tu fis de ton mieux pour être poli ;
quand dans la conversation
tu entendais ma voix familière,
tu faisais montre de vouloir
entendre ce que j’avais à dire ;
tu cherchas, avec quelque succès,
à couvrir la nudité de l’abîme.
Mais sur tes yeux était une dure pellicule ;
nul intérêt feint, nulle affectation
ne pouvait voiler ton indifférence ;
et tandis que les pensées venaient rappeler des choses
lointaines, lointaines, de ces anciens printemps
quand sous la lune et le soleil
nos cœurs battaient comme un seul cœur,
tendres pensées vagabondes qui demandaient
à être reçues et qui trouvèrent la porte fermée,
tu les rejetas ; quand j’eus parlé selon le cœur,
avec un rire et signe de tête tu t’éloignas
pour lancer à tes amis une plaisanterie facile
qui me frappa durement.
Aussi sot et vain que cela puisse paraître,
je ne suis pas maître de cette peine,
et quand je te dis enfin bonne nuit
j’espérais ne plus jamais te voir
et me demandais comment l’âme que j’avais connue
avait pu changer à ce point ; ai-je moi aussi changé ?
II
Un homme que j’ai bien connu
avait choisi de vivre en enfer ;
il avait des raisons pour cela,
mais je ne les connais pas.
Il vivait dans une chambre en haut d’une tour
et restait assis là, buvant jour après jour,
buvant, buvant tout seul
devant des chandelles et un mur.
De temps en temps, il redevenait sobre
et passait une soirée en ville avec moi.
S’il me trouvait au milieu de gens,
il se rencognait et ne parlait pas.
Il s’asseyait dans un coin en silence
et les autres dans la compagnie
remarquaient son visage et ses yeux singuliers,
son visage aux tics nerveux, ses yeux farouches.
Quand ils voyaient les yeux qu’il avait,
il pensait qu’il était peut-être fou :
je savais qu’il avait l’esprit clair et sain
mais qu’une horreur le possédait.
Il avait de l’argent et un ami
mais but lugubrement jusqu’à la fin.
Pourquoi choisit-il de vivre cet enfer ?
Je ne le lui demandai pas, il ne me dit rien.
*
Un poète à sa Muse (A Poet To His Muse)
Muse, tu t’es ouverte comme une fleur…
Depuis longtemps je savais que ce tégument brun,
comme une écorce morte, en lui dormant avait la vie,
et j’attendis qu’un point blanc parût
qui se fît un passage, pâle épi nu, rigide,
et poussât.
Je savais que cela n’était pas tout ;
je ne disais rien quand tu verdissais et grandissais,
mais je rêvais solitaire au jour où ton bourgeon s’ouvrirait
et montrerait enfin ta couronne,
remplissant l’air de nuages de couleur et de parfum,
vagues radieuses, odeurs d’immortalité.
Dans un pot je t’arrosais, prenais soin de toi,
brisant les mottes, imbibant d’eau la terre
qui nourrissait tes racines et facilitait ton chemin vers la lumière.
Je te donnais le soleil et la pluie
mais te sauvais des brûlures et de la noyade ;
tu es à moi, je suis le seul qui te connaisses
ainsi que les voies de ta croissance et les jours.
Mais tu ne viens pas de moi.
Je ne suis qu’une plume pour une main,
un lit pour une rivière,
une fenêtre pour la lumière.
Et je m’incline avec respect devant ce pouvoir
qui t’a faite fleur.
*
La Muse absente (The Muse Absent)
La sœur jumelle de l’Amour, enfant de l’Indolence,
m’a depuis longtemps abandonné ;
Le devoir, la routine et le bon sens
m’ont battu, m’ont enlevé.
La nécessité, qui ne connaît point de loi,
m’opprime de sa férule d’airain ;
les anciennes fontaines de l’émerveillement sont scellées,
plus aucun vent lointain ne me caresse.
Mais quand cette route inflexible sera parcourue,
peut-être que les zéphyrs souffleront pour moi
avec leur vieille tendresse enfin
et me tresseront des lauriers d’automne :
les clairons d’une ultime aurore
me réveilleront, m’appelleront peut-être ;
quand tout ce qui hait, aime ou flatte,
oublieux, m’aura laissé.
*
Ballade de la vie poétique (Ballade of the Poetic Life)
Les gros hommes vont et viennent dans la rue,
les politiciens jouent à leurs jeux,
les cauteleux évêques sonnent la retraite,
trouvent que les martyrs sont à blâmer ;
Honneur, Amour sont vils et boitent,
la Cupidité, le Pouvoir sont déifiés,
les farouches sont domptés par les soumis ;
c’est pour cela que les poètes ont vécu et péri.
Shelley est le nom d’une marque de draps ;
haut dans le ciel, en lettres de feu
nous lisons : « Quel porridge prenait John Keats ?
Le porridge Brown ! Le même depuis cent ans ! »
Arcadie est une armature de parapluie,
Milton un dentifrice ; dans les ondes
a été draguée Sappho pour maquiller Madame –
c’est pour cela que les poètes ont vécu et péri.
Pourtant, c’était pour lancer des flottes idéales
à la conquête des régions perdues dans les étoiles,
pour faire front à toutes les ruines, toutes les défaites,
pour faire honte par leurs chants à un monde épuisé,
pour maintenir les buts brillants et impossibles
au fond du cœur ; pour fièrement mourir de faim
au service de la renommée et ne jamais la connaître –
c’est pour cela que les poètes ont vécu et péri.
Envoi
Princesse, inscrivez sous mon nom :
« Il ne mendia jamais, jamais ne soupira,
il prenait son remède où il le trouvait » –
c’est pour cela que les poètes ont vécu – et péri.
Lettre à mon âme et autres poèmes de Guilherme de Almeida
Un autre poète académicien du Brésil au vingtième siècle est Guilherme de Almeida (1890-1969). Il acquit la célébrité avec une poésie classique, avant de rejoindre l’avant-garde à l’occasion de la « Semaine d’art moderne », qui lança les nouvelles tendances littéraires au Brésil en 1922. Il fut ainsi le plus connu du groupe des innovateurs au sein de la poésie brésilienne, bien que son adhésion rencontrât l’incompréhension d’une partie de son lectorat. Cela correspondait néanmoins à son caractère, à ses goûts polyédriques : Almeida est également connu pour avoir introduit le haïku japonais dans la poésie brésilienne. Il fut élu Prince des poètes en 1959.
Les textes qui suivent, dans notre traduction, sont tirés d’une anthologie Melhores poemas de 2004, chez la maison d’édition Global Editora dont nous avons déjà dit ici le bien que nous en pensions. Le compilateur et présentateur de cette anthologie, Carlos Vogt, n’a pas réuni les poèmes choisis par lui sous le titre de leurs recueils respectifs mais en trois catégories, que nous nous bornons à suivre, relatives aux périodes de la poésie d’Almeida : I) « Première période : Le dernier romantique », II) « Deuxième période : L’esprit moderne », III) « Troisième période : Maturité » (ci-dessous I, II et III).
*
I
Les derniers romantiques (Os últimos românticos)
Quitte, pendant que le clair de lune blanchit l’espace,
au moyen de l’échelle de soie ton balcon…
Et viens, légère et chaude encore de ton lit,
comme un sommeil de tulle à mon bras…
Nous sommes le couple le plus poétique et parfait
des derniers romantiques… Ton pas,
chantant dans le jardin, marque le rythme
de ce cœur qui bat dans ma poitrine.
Puis tu pars et je reste. Et, en cachette,
sur la verte volupté des pelouses
mon ombre se confond avec la tienne…
Ah ! si nos vies pouvaient se fondre ensemble
comme se fondent nos deux ombres
sous le pâle mystère de la lune !
*
Sur les routes silencieuses… (Pelas estradas silenciosas…)
Sur les routes silencieuses
marchent en rêvant les amoureux…
Les anges penchés chantent
dans le ciel, sur la terre s’ouvrent les roses…
Les amoureux marchent en rêvant
sur les routes silencieuses…
Ô amoureux, prudence,
les anges peuvent pleurer !
Ô amoureux, prudence,
les roses peuvent se faner !
Dans le silence des routes
les amants s’embrassent, au soleil couchant…
Timide, le soir se cache le visage,
et là-haut les nuages sont de couleur vive…
Les amants s’embrassent au soleil couchant,
dans le silence des routes…
Attention, amants, attention,
les nuages peuvent vous voir !
Attention, amants, attention,
le soir peut souffrir !
Dans le calme des chemins
les amoureux marchent en pleurant…
Les étoiles scintillent, fleuretant ;
pleins de paix dorment les nids…
Les amoureux marchent en pleurant,
dans le calme des chemins…
Ô amants, pleurez tout bas,
les étoiles peuvent rire !
Ô amants, pleurez tout bas,
les nids peuvent sourire !
*
Félicité (Felicidade)
À ma porte elle frappa
et me salua, souriante, en montant l’escalier :
« Bonjour, vieil arbre sans plus de feuilles ! »
Et je répondis : « Bonjour, fille morte ! »
Elle entra et ne dit jamais plus rien…
Jusqu’au jour où (quand c’était, importe peu)
il y eut des chansons dans les ramures
et des groupes d’amoureux sur la route…
Alors elle m’appela et dit : « Je m’en vais !
Je suis la Félicité ! Vis à présent
du souvenir de ce que j’ai fait pour toi ! »
Et c’est ainsi qu’au beau milieu du printemps
je réalisai qui elle était seulement quand elle partit…
Et je n’ai plus jamais été heureux !
*
Fétichisme (Fetichismo)
Je suis fétichiste, j’adore tout
ce qui est à toi : la page marquée
d’un livre ; le sommeil de velours
de ton coussin langoureux ;
un œillet splendide et rouge
qui meurt ; la vie singulière
que tu as mise dans chaque miroir
par le sortilège d’un regard ;
cet accord, cette gamme
de ton piano qui reste suspendue
dans la résonance de cette salle ;
ta lampe ; la présence
impérative d’un parfum ;
ton chapeau… – tout, en somme,
ce qui vient de toi, te résume,
possède ton prestige émotionnel !
Et ce contact voluptueux
avec tant de choses évocatrices
est si sensuel, si délicieux
pour mon âme sensitive
que j’attends plein d’impatience
le moment où tu t’en vas,
et qu’il me vient même le souhait
que tu ne reviennes jamais !
II
Abracadabra
Nuit de sortilèges.
Entre les arbres
une fontaine
élève son jet d’eau
de cristal, qui est la baguette
d’un sorcier.
Et le sabbat se déploie
dans une sarabande
fatidique
d’ailes, de feuilles mortes,
de tortes ramures
et de poussière.
Et ce sont des galopades
d’échevelés
coups de vent…
Là-haut, les nuages sales
sont comme des chouettes
errantes.
Il vague des mauvais-œils
dans les ciels délavés
et grisâtres ;
sept étoiles bigles
scintillent entre les interstices
des branches.
Tout tourne,
fantasmagorie
de Cabale…
Dans un frémissement
une aile de chauve-souris
bruit.
Et au hou-hou d’un hibou
– léger feu-follet –
tu ressurgis,
ma belle Infante,
au clair de lune de sainte
Walpurgis !
Sous le ciel funeste,
qui est un pourpoint augural
d’alchimiste
ou de saint Cyprien1,
mon œil humain
t’aperçoit.
Je te vois et, au milieu
du tumulte
qui hurle et hulule,
ton habit noir,
comme une amulette,
tremble…
Et tremble… Puis tout,
lentement et en silence,
s’évapore
– sorcières, elfes, lutins –
sous ton regard…
Et maintenant
seul mon rêve dort
dans la nuit énorme :
dort comme,
sous un champignon
flasque et jaune,
un gnome…
1 Saint Cyprien : Saint Cyprien d’Antioche ou de Nicomédie passe pour être un sorcier qui se convertit au christianisme et laissa des grimoires, connus dans le monde lusophone et hispanophone. Au Brésil, le « Livre de saint Cyprien » est employé dans les religions afro-brésiliennes telles que le candomblé et le quimbanda.
*
Quelqu’un est passé (Alguém passou)
Quelqu’un est passé. Et son ombre,
comme un manteau qui tombe
d’un geste languissant, est restée sur mon chemin.
À présent s’en est allé le soleil, et la nuit tombe peu à peu.
Et cependant
l’ombre reste,
distincte et nue,
jetée à terre comme un manteau.
Il fait froid.
Sur mon corps passe un violent frisson…
Et le désir me vient, timide et fou,
de me blottir un peu
dans ce manteau d’ombre tiède…
Mais quelqu’un
revient dans la nuit pâle :
revient chercher son ombre oubliée.
Il fait jour. Sur la route aride et mélancolique
ma vie tremble de froid…
*
Épigraphe (Epígrafe)
J’ai perdu ma flûte sauvage
dans les roseaux du lac de verre.
Joncs inquiets de la rive ;
poissons d’argent et de cuivre poli
qui vivez dans la vie mobile des eaux ;
cigales des hauts arbres ;
feuilles mortes qui vous éveillez au pas ailé des nymphes ;
algues,
belles algues claires
– si vous trouvez
la flûte que j’ai perdue, venez, le soir,
vous pencher sur elle ! Vous entendrez les secrets
sonores que ma lèvre et mes doigts
ont laissés, oubliés, dans
les silences de sable de son ventre.
*
Le feu sur la montagne (O fogo na montanha)
Les bergers avaient allumé,
la nuit, un grand feu sur la montagne.
Ils gardaient les bras croisés sur la poitrine
et restaient assis dans l’ombre incertaine,
regardant le feu, écoutant l’histoire
nocturne, étrange
que la flamme sonore,
agitée comme une langue inquiète
leur contait.
Et la flambée était comme une danseuse
aux cheveux dénoués, dansant
entre les parfums barbares de la résine
et le crépitement des taureaux de cèdre dans l’argile
une danse de voiles furieux dans les airs…
– Car elle mettait une pupille
aux yeux vides qui n’avaient point de regards.
*
Le festin – I (O festim – I)
Note du traducteur. La perle dans la coupe de vin est une allusion à la légende de Cléopâtre, selon laquelle la reine égyptienne à l’occasion d’un banquet jeta une perle d’une très grande valeur, qu’elle portait en boucle d’oreille, dans une coupe de vin où la perle fut dissoute et que la reine but ensuite, pour montrer l’étendue de sa richesse ou sa supériorité sur elle. – Les commentateurs font remarquer qu’une perle ne peut se dissoudre dans du vin, qu’elle le peut en revanche dans du vinaigre au bout d’un temps assez long ; cependant, Cléopâtre but la coupe.
« Le festin » est un poème en quinze chants, dont trois se trouvent dans l’anthologie que nous avons utilisée et dont nous avons ici traduit le premier.
1.
Moi aussi j’ai jeté dans un verre de vin une perle de mon âme.
Tous les hommes jettent leur âme, comme un joyau, dans une coupe de vin.
2.
En tombant dans le sein léger de ce vin enivrant, pesantes de la nostalgie de la mer, les perles disparaissent,
et en vérité je vous le dis, chaque homme, pour retrouver la sienne, devra vider sa coupe.
3.
Les uns laissent rouler distraitement dans le verre plein la perle oubliée.
D’autres la lancent depuis le sommet de leur vie avec de grands gestes de tragédie, théâtralement.
4.
Les uns jouent leur perle comme quelqu’un qui jette un baiser sur la bouche généreuse du calice euphorisant.
Les autres comme quelqu’un qui pour dire adieu lève sa main distante, parce qu’entre les lèvres de la coupe une fleur de désir s’est fanée.
5.
Les uns jettent le joyau en regardant dans un miroir : il y a des intentions de beauté dans leurs gestes.
Les autres, en pleurant : et le joyau tombe de leurs yeux ouverts, entre des larmes, dans le vin pourpre.
6.
Les uns avec mépris, d’autres avec colère, d’autres encore avec tendresse ; les uns, pâles, avec lassitude ; d’autres, lents, avec calme :
tous doivent lancer le joyau de leur âme dans une coupe pleine de vin.
*
Prélude n° 2 (Prelúdio n° 2)
Que ma terre est belle !
Étranger, vois comme est beau ce palmier :
on dirait une colonne droite droite droite
avec un grand paon vert à son sommet posé,
la queue ouverte en éventail.
Et dans l’ombre ronde
sur la terre chaude…
(Silence !)
…il y a un poète.
III
Solitude (Solidão)
J’ai cherché mon semblable.
J’ai parcouru la vie,
parcouru le monde,
parcouru le temps,
parcouru l’espace.
Ténèbres. Ténèbres. Ténèbres.
J’allumai ma lampe.
Voile qui se détacha de mon corps,
rythme qui se détacha de mon geste,
un crêpe en vol
se jeta par terre,
escalada le mur,
se débattit contre le toit.
Même mon ombre
ne me ressemble pas.
*
Big City Blues
Nuit. Ennui. Phonographe.
Du disque noir une spirale se déroule
et se répand dans le ciel. Et sur cette corde tendue
toute ma tristesse
se balance
et danse…
Et sans bien savoir pourquoi
je me mets à t’écrire :
– « Comme je pense à toi dans cette nuit d’insomnie !
En bas, blanche de lune, la ville ronfle :
la ville qui fut ma ville…
Qui fut. Elle ne l’est plus. Aujourd’hui c’est une pauvre saudade,
une longue saudade de moi-même,
de toi, de nous deux, de tout ce que nous avons vécu
dans ces rues tristes, parallèles,
qui ne se croisent jamais… (Ne sont-elles pas
comme nous deux maintenant ?…)
Comme je me souviens, mon amour ! Depuis cette heure
où tes yeux pâles caressèrent
les miens, et mes yeux se fermèrent
un peu, comme pour
retenir cette claire jeunesse
qui passait par eux, comme passe
pleine de grâce
la jeunesse au cours d’une vie… »
Mais ma main s’est arrêtée. De la peine endormie
sont restés, sur le papier inerte où j’écris,
au lieu de mon amour ces vers sans nerfs…
Mes « diables bleus »2,
mon pauvre big city blues…
2 Mes « diables bleus » : « Meus ‘diabinhos azuis’ », qui est la traduction littérale de l’anglais blue devils désignant la tristesse, les idées noires, expression anglaise à l’origine du nom du blues comme genre musical.
*
Lettre à mon âme (Carta à minha alma)
Chère inconnue
Nous vivons
dans un monde si petit pour nous,
ensemble – sans pourtant nous connaître.
Vous ne connaissez pas même la couleur
de mes yeux, ni l’inflexion de ma voix,
ni la chaleur humaine
de mes pauvres mains de boue,
ni le parfum bleu de ma cigarette…
Moi je ne connais même pas la hauteur de votre ciel,
ni le vol si léger du voile
de vos rêves et de vos doigts,
ni le niveau de vos distractions,
ni la profondeur de vos secrets…
Cependant, un même toit bénit et couvre
nos vies étrangères
(comme est un l’abri du croyant et de la sainte) :
nous vivons de part et d’autre d’un mur mitoyen,
comme l’homme triste qui travaille
et la jeune femme bohème qui chante…
Nous sommes deux voisins anonymes.
Et bien que nous soyons « deux » en ce monde, bien que
nous soyons seuls de cette manière,
entre notre réciproque ignorance,
entre nous deux se trouve seulement la distance
du mur commun qui nous sépare
et qui s’appelle « la Vie ».
Elle seule nous divise – l’opaque indiscrète.
Contre cette intruse, pour la masquer,
de mon côté, le long de cette pièce
j’ai tendu sur une longue, longue étagère
toute une bibliothèque anesthésiante.
De votre côté, vous devez être vêtue
d’un châle de cachemire sur lequel
ronfle le creux d’une guitare endormie,
et quelque portrait intime et ancien, au crayon, s’efface,
avec une pâle fleurette des Alpes
émiettée dans le cristal…
Ainsi vivons-nous unis
et malheureusement sans nous connaître.
Aujourd’hui, je ne sais pourquoi,
j’ai eu envie de vous écrire,
de vous demander tout bas à l’oreille :
– Dites, pour que nous nous rencontrions,
faudra-t-il qu’un cyclone
s’abatte sur nous et détruise
le mur mitoyen qui nous sépare, la Vie ?
Ou bien est-ce – ce qui pour moi sera plus encore la mort –,
mon fil immortel, ma belle âme,
que nous nous sommes déjà rencontrés, un jour,
mais que nous avons passé notre chemin sans nous voir, sans nous reconnaître ?…
*
L’invitée (A hόspede)
Il n’est pas nécessaire que tu frappes en arrivant.
Prends la clé de fer que tu trouveras
sur le pilier à côté du portillon
et avec elle ouvre
la porte basse, ancienne et silencieuse.
Entre. Tu trouveras le fauteuil, le livre, la rose,
la cruche de terre cuite et le pain de blé.
Le chien ami
posera sa tête sur tes genoux.
Laisse descendre la nuit lentement.
Les draps riches
sentent l’herbe et le soleil dans l’armoire et les chambres,
et l’huile de la lampe a l’odeur d’un âtre.
Dors. Rêve. Réveille-toi. De la ruche
naît le matin de miel contre la fenêtre.
Ferme le portillon
et va. Il y a du soleil sur les fruits du verger.
Ne regarde pas en arrière quand tu prendras
le chemin somnambule qui descend.
Marche – et oublie.
*
Seconde chanson du pèlerin (Segunda canção do peregrino)
Vaincu, épuisé, quasi mort,
je coupai une branche de ton jardin
pour en faire mon bâton de marche.
Il fut ma vue et mon toucher,
fut constamment le pacte
que fit avec moi l’obscurité.
Alors, ni fantômes ni torrents
ni bandits ni serpents
ne prévalurent sur mon chemin.
Seulement les hommes, qui me voyaient
passer seul et riaient, riaient,
riaient sans que je sache pourquoi.
Mais, une fois, m’arrêtant un moment,
j’entendis crier : « Voilà le fou
qui tient un arbre dans sa main ! »
Et levant les yeux, je vis des feuilles, des fleurs,
des oiseaux, des fruits, des lumières, des couleurs…
– Mon bâton de marche avait fleuri.
*
Alibi (Álibi)
Je n’étais pas là
quand fut commis
le crime de vivre :
quand les yeux dévêtirent,
quand les mains se touchèrent,
quand la bouche mentit,
quand les corps tremblèrent,
quand le sang courut.
Je n’étais pas là.
J’étais dehors, loin
du monde, dans mon propre monde
petit et interdit
que j’enveloppais et attachais
avec les ficelles bien serrées
de mes méridiens
et de mes parallèles.
Les vers que j’ai écrits
prouvent que j’étais absent.
Je suis innocent.
*
Invitation à la poésie (Convite à poesia)
Extrait initial
Viens, mon Âme ! Laisse cette vie arithmétique
qui additionne, soustrait, multiplie, divise ;
qui croit en soi-même et feint le scepticisme,
et qui se trompe toujours, et tombe juste seulement par coïncidence !
Voici les formes que, nuit et jour, devant les autres je prends
(oui, parce que la nuit est un tableau noir et le jour une craie)
« plus grand que », « plus petit que », « est à … ce que », « ainsi que »,
« égal à », « fraction de », « logarithme de x »…
Laisse donc ces vaines nécromancies et le cachot
de la longueur, largeur et profondeur :
la quatrième dimension, dans l’inconnu où nous la retrouvons,
a plus de distance, plus de réconfort, plus de hauteur.
Sur trois colonnes dans l’air l’homme a posé son toit :
Progrès, Culture et Civilisation.
Préfère le piédestal de l’Architecte oublié :
monte à la Sagesse et donne-moi la main !
Argent ? loi ? morale ? patrie ? machine ? science ?
politique ? famille ? art ? littérature ?…
– ce sont des choses que l’homme fait et adore dans l’inconscience
du créateur se soumettant à sa créature.
Recherche la Sombreur, le Silence et la Solitude : trois S,
trois serpents de ton Paradis intérieur.
Goûte le fruit que tu t’offres toi-même :
il s’appelle la Pensée, est meilleur que l’Amour…