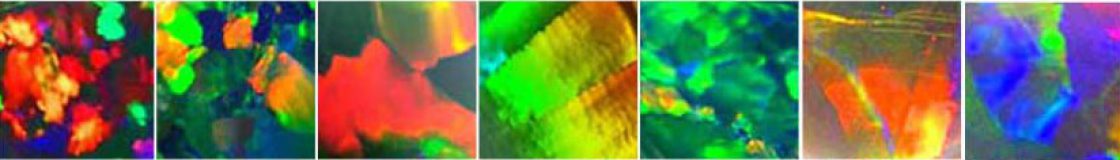Tagged: poésie du Brésil
Invocation du port natal et autres poésies de Ribeiro Couto
Rui Ribeiro Couto (1898-1963) est un poète brésilien, membre de l’Académie nationale. En même temps que la voie des lettres, il suivit la carrière diplomatique, ce qui s’exprime volontiers dans sa poésie par le mal du pays, un sentiment d’errance (voyez par exemple Lamentation du vagabond et Invocation du port natal ci-dessous). Il avait toutefois un sens aigu de la relation entre le Portugal et le Brésil et de l’unité du monde lusophone (voyez Adieu à la rue Castilho et Monocorde camonien sur un quai de Lisbonne [« camonien » est l’adjectif formé à partir de Camoëns]). Ce fut également un amoureux de la langue française, qui publia deux recueils dans notre langue, Rive étrangère (1951) et Le jour est long (1958), ce dernier récompensé par le Prix des Amitiés françaises.
Les textes qui suivent sont tirés d’une anthologie Melhores poemas de 2018 chez Global Editora, qui réalise un remarquable travail d’anthologisation des poètes brésiliens, rendant accessibles, de manière certes fragmentaire, des œuvres qui souvent ne sont plus autrement rééditées.
*
Le jardin des confidences
(O jardim das confidências, 1921)
.
La joie de la terre sous l’averse (A alegria da terra sob o aguaceiro)
Du ciel de cendre la pluie filtre en longs fils…
Le parc est mouillé. Quelle joie sur la terre !
Le paysage tout entier boit l’eau de la bonne pluie
tandis qu’une brume subtile erre entre les arbres.
Qu’il fait bon ! C’est quand il pleut qu’il fait bon… Je sens
que quelque chose se réveille dans mon cœur.
Quelque chose… Peut-être une souffrance éteinte.
Peut-être même une autre vie, une autre vie incertaine…
Écoutant le battement de la pluie sur les toits,
j’éprouve un désir triste, un désir douloureux
de vivre seul, de vivre parmi des livres aimés,
dans une ville que vaguement j’imagine…
Je regarde désenchanté les eaux de la baie :
sur la mer, que la pluie rend un peu plus distante,
s’éloigne une voile en quête du quai.
Et d’un point minuscule, très effacé, là-bas,
une fumée dit adieu… « Je ne reviendrai plus !… »
Je regarde à nouveau le parc. Parmi les arbres erre
la brume légère qui les enveloppe et les caresse…
La brume a une longue volupté froide…
Comme si la brume était le geste amoureux de la terre,
un geste languissant de désir et de nostalgie
pour la tendre feuillée sous l’averse…
*
Petits poèmes tendres et mélancoliques
(Poemetos de ternura e de melancolia, 1924)
.
Sourdine (Surdina)
Ma poésie est toute calme.
Je ne gesticule ni ne m’exalte…
Mon tourment sans espoir
a trop de pudeur pour parler haut.
Cependant, les yeux souriants,
j’assiste dans la vie dehors
au couronnement de l’éloquence.
C’est normal : la voix sonore
enflamme les foules ravies.
Quant à moi, je suis de la minorité.
En voyant les foules ravies,
je pense, presque sans ironie :
« Bénie soit l’éloquence
qui vous donne tant de joie. »
Pour ne point blesser le souvenir
ma poésie a des égards…
Elle est si douce, si douce
qu’elle se pose sur les cœurs en peine
comme un baiser sur un enfant.
*
Soirées (Serões)
Monotonie des soirées bourgeoises
après le dîner silencieux…
Monotonie des longs bâillements
pendant les conversations tranquilles,
à la lueur des belles lampes…
Monotonie des soirées bourgeoises
en ouvrant les journaux avec paresse,
dans l’habituelle curiosité des nouvelles dramatiques.
Monotonie des soirées bourgeoises
quand entre par la fenêtre le vent de la nuit
et qu’un bras lent de femme
caresse une tête d’homme, lasse…
*
Portrait de l’adolescent oublié (O retrato do adolescente esquecido)
Qu’est devenu cet adolescent
à la frêle expression timide,
qui parmi de gros livres de classe
s’inclinait sur la table d’étude ?
Comme si de ses yeux roulait
une douceur féminine.
Ô portrait de l’adolescence,
pourquoi viens-tu ce jour
me remémorer la vie absente ?
Me voilà tout mélancolique,
presque en larmes, de seulement avoir
vu cette photographie.
Adolescent à l’air fragile,
dans tes yeux humains brillait
un peu de feu divin.
Il te fallait encore attendre des années…
Et dans ton cœur d’enfant
que d’impatience et d’amertume !
Dans cette pauvre pièce tranquille,
à quatorze ans je pleurais
car je me sentais poète,
mais les sonnets que je composais
(qu’elle était profonde, cette douleur secrète !)
ne disaient pas ce que je cherchais.
Ah, l’éveil de la pensée !
Ma main n’obéissait pas
à cet élan vague et violent.
Et dans ma cervelle était
une confuse effervescence
d’incommunicable poésie !
Ô gamin oublié
à l’air fragile, au regard triste,
entre les gros livres de classe
tu voyais monter ton beau rêve
comme un brouillard qui se répand !
Et dans ce rêve tu t’endormais
sur les gros livres de classe.
*
Un homme dans la foule
(Um homem na multidão, 1926)
.
L’invention de la poésie brésilienne (A invenção da poesia brasileira)
J’écoutais l’homme merveilleux,
le révélateur tropical des nouvelles attitudes,
le maître des transformations en cours :
« Il faut créer la poésie de ce pays de soleil !
Pauvre poésie que la tienne et celle de tes amis,
pauvre poésie nostalgique,
poésie de faibles devant la vie forte.
La vie est force.
La vie est une affirmation d’héroïsmes quotidiens,
d’enthousiasmes isolés dont naissent des mondes.
Une femme passe… Il pleut sur la vieille place…
Pauvre poésie de malheureux à leurs fenêtres !
Je veux du soleil dans ta poésie et celle de tes amis !
Le Brésil est plein de soleil ! Le Brésil est plein de force !
Il faut créer la poésie du Brésil ! »
J’écoutais, les yeux ironiques et calmes,
le maître ardent des transformations à venir.
Il se mit alors à pleuvoir doucement
dans le soir monotone qui s’effaçait.
Par la fenêtre de mon salon éteint
nous regardâmes la place sous la pluie lente.
Nous restâmes silencieux un moment…
Et une femme passa sous la pluie.
*
Poésie (Poesia)
Ils t’entoureront d’attitudes sinistres,
désireront secrètement ta mort,
jetteront sur ta tête
le rire facile des incompréhensions.
Cependant, en toi, indifférentes
comme la pluie calme qui tombe sur un jardin,
les paroles mélancoliques de la poésie
béniront la tragique douceur de la vie.
*
Verger à l’abandon (Pomar abandonado)
Dans le verger à l’abandon
où les vieux pêchers se courbent vers le sol,
des chèvres avides, debout sur leurs pattes de derrière,
rompent les branches couvertes de fruits verts
puis mâchent tranquillement les feuilles.
Les chevreaux plaintifs
vont et viennent autour des mères indifférentes.
Parfois ils se jettent sur les pis
et tètent, à coups de museau assoiffé.
Les chèvres mâchent tranquillement les feuilles
et se remettent debout sur leurs pattes de derrière,
tentant d’atteindre les plus hautes branches,
couvertes de fruits verts.
*
Les marais (Os brejos)
À la tombée de la nuit,
quand l’ombre glacée se répand sur la campagne,
il monte des marais
une respiration légère et rythmique,
un râle vague et sonore :
c’est la timide musique des crapauds dans le soir.
Quelle mélancolie dans cette cantilène monotone !
C’est la saison des pluies.
Des mois durant les averses
couvriront de boue les routes et les champs.
Et tous les soirs, à la tombée de la nuit,
il y aura cette musique dans la campagne,
triste râle des marais
qui semble monter d’une grande poitrine en peine.
*
Province
(Província, 1934)
.
Bruit de pluie sur les feuilles (Barulho de chuva na folhagem)
Il s’est mis à pleuvoir sans que personne le voie.
À la fenêtre sur le jardin,
une haleine chaude venant de la nuit
m’apporte l’odeur de la terre.
Sur les feuilles creuses des caladiums et des courges
la pluie bat, rapide,
avec des gouttes dures qui ne semblent pas mouiller.
Comme si elle avait des pieds minuscules, invisibles,
dansant nerveusement
sur la peau tendue d’un tambour d’enfant.
*
Chansonnier de l’absent
(Cancioneiro do ausente, 1943)
.
Tu parlas de la mort… (Falaste da morte…)
Tu parlas de la mort d’une voix douce,
parlas de la mort comme un enfant
qui suit des yeux le vol d’un oiseau.
Tu parlas de la mort en souriant si calmement,
si délicatement qu’il semble à présent
que la mort ce soir est à ma recherche.
La mort, si elle venait maintenant, serait
comme une hirondelle étonnée dans le jardin.
*
Lamentation du vagabond (Lamentação do caiçara)
Mon enfance est un port, navires et pavillons.
C’est devant un débarcadère que je suis né.
La gesticulation des mâts en partance
me donna le goût des traversées pleines d’aventures
et l’adieu monotone mugi par les sirènes
me faisait rêver à des terres étrangères.
La nuit, le quai somnolent était long.
Des lueurs rouges émaillaient l’obscurité
et une odeur de lointains arrivait dans le vent.
Je songeais – réflexions d’enfant –
qu’au-delà de cette nuit, au-delà de cette mer,
un certain bien attendait ma destinée,
le bonheur qu’en partant je trouverais.
Ce bien espéré, aujourd’hui encore je ne le possède pas,
mais je suis allé de par le monde et me suis même perdu.
À présent c’est sur un autre quai que je viens méditer
et le port où je suis né se trouve sur une autre mer.
Vont-elles jusqu’à lui, ces vagues passant légères ?
Emporteront-elles mon corps sur une plage de palmiers ?
Si elles l’y conduisent, je peux mourir ici.
*
Invocation du port natal (Invocação do porto natal)
Le port où je suis né ! J’étais enfant
quand tu me vis un jour, les yeux vers la mer,
demander mon destin à la mer incertaine.
La mer m’entendit. Mon destin est d’errer.
Où que j’aille, en suivant ce destin,
entre ma mère et moi se trouve la mer.
Enfin, si le bateau dans lequel un jour je reviendrai
doit couler par le fond, que ce soit
devant le port que j’aimais tant.
Et que mon corps inerte, dans le balancement
des vagues retrouvant le bercement maternel,
puisse avoir le repos dans ce port-là.
*
Entre mer et fleuve
(Entre mar e rio, 1952)
.
Adieu à la rue Castilho (Adeus à rua Castilho)
Tu ne verras plus le Tage ni les couleurs
qui se ravivent au soleil dans le pâté de maisons.
Bientôt, sur les terres où tu es parti,
tu éprouveras la nostalgie de l’entre mer et fleuve.
Même sur un sol où poussent des fleurs identiques
ou sous un ciel du même azur tendre,
et même en trouvant d’autres amours,
ton cœur battra plus froid dans ta poitrine.
Car dans la pierre antique de Lisbonne
se trouve la raison de vivre de ta race,
la voix qui blâme mais ne trahit pas,
se trouve ce je ne sais quoi de ferme et d’obscur
qui vient de loin et passe dans ta poitrine,
passé qui est présent et qui est avenir.
*
Loin
(Longe, 1961)
.
Monocorde camonien sur un quai de Lisbonne (Camonocόrdia num cais de Lisboa)
Le rocher de cristal, Camoëns. Nous autres,
irisations de soleil, pauvre poussière.
Langue qui fut aux uns et fut aux autres,
langue de continents, navigatrice,
langue de Blancs, de Noirs et d’autres encore,
qu’il est bon que l’on t’aime comme nous !
Peintres, musiciens et autres artistes
se font comprendre du monde entier,
sur des lieues et des lieues de pays autres.
Mais pas les poètes. La langue est prisonnière.
La voix par laquelle nous chantons les uns et les autres
sera toujours pour ceux d’ailleurs voix étrangère.
Enfants de la citadelle occidentale, nous autres,
fidèles à tant d’effort, tant de fatigue,
aux biens de la renommée comme à tant d’autres
nous savons renoncer, l’âme sereine :
en échange de cet amour, plus grand que les autres,
c’est assez que de pouvoir chanter à notre façon.
*
Celui qui n’a pas voulu naître (Aquele que não quis nascer)
Celui qui n’a pas voulu naître
et aurait eu ta douceur,
c’était comme si je le sentais
dans mes bras en train de s’endormir.
Dans la brume légère,
la nuit, les maisons éteintes
cachaient aussi des tendresses
et des secrets du village.
Dans les prés qui au bord des chemins
s’emperlaient de rosée dans l’air froid,
des vaches à la belle étoile
meuglaient après leurs veaux.
Pays ingénu de Minas
depuis longtemps en déclin ;
les grandes maisons du temps passé
n’étaient plus que ruines.
Dans les hauteurs l’église massive ;
le forum de la rue en bas,
et des jardins buvant au ruisseau
avec leurs plates-bandes de légumes.
Dans ces commencements de route,
la pauvreté elle-même était poésie.
La richesse qui ne viendrait pas
fut un berceau près de la cheminée.
Celui qui n’a pas voulu naître
me paraît quand même vivant,
il continue de s’endormir dans mes bras
et j’ai peur de le perdre.
L’angoisse de Don Juan et autres poèmes de Menotti Del Picchia
Menotti : c’est un prénom, donné par ses parents au poète après que Garibaldi surnomma son fils aîné Menotti en hommage au patriote italien Ciro Menotti. Cependant, comme une autre partie de la famille du poète voulait un prénom chrétien pour l’enfant, son nom complet est Paulo Menotti Del Picchia. On voit que les racines de ce poète brésilien, né en 1892 et mort en 1988, sont italiennes.
Menotti Del Picchia fut l’un des principaux promoteurs, avec Cassiano Ricardo et Plínio Salgado, du mouvement moderniste Verde-Amarelo (voyez ici). Selon certains, il est même la véritable figure de proue de la modernité poétique au Brésil : « Menotti Del Picchia, et non Mario ou Oswald de Andrade, fut le chef du modernisme » (« Foi Menotti Del Picchia e não Mário ou Oswald de Andrade o chefe do Modernismo »), affirme le critique Wilson Martíns, auteur d’une Histoire de l’intelligence brésilienne en sept volumes.
Comme Cassiano Ricardo, Del Picchia commença par des vers parnassiens puis sa longue carrière littéraire refléta les évolutions de la poésie au vingtième siècle. Il est par ailleurs l’auteur d’une œuvre en prose considérable, comprenant notamment de la science-fiction. Il fut également haut fonctionnaire, parlementaire et membre de l’Académie brésilienne.
Les poèmes qui suivent sont tirés de l’anthologie Melhores poemas de Menotti Del Picchia (Global Editora, São Paulo, 2004). Cette anthologie comporte le « poème dramatique » L’angoisse de Don Juan entier, poème paru en plaquette en 1922 et que nous avons traduit intégralement. L’anthologie comporte également en entier la plus célèbre œuvre poétique de Del Picchia, Juca Mulato, de 1917 ; il s’agit d’une œuvre en neuf chants de longueur variable, dont nous avons traduit le huitième.
Dans L’angoisse de Don Juan, Del Picchia imagine un dialogue entre le célèbre séducteur et Faust. Le chant de Don Juan, au commencement, est le texte dont la position de Faust est le commentaire : « et je t’aime peut-être / de ne jamais t’avoir trouvée », « parce que cette âme devine / que je l’adore, peut-être, de n’avoir pas été mienne ». Le poème est en vers classiques, et les répliques courtes (stichomythies) sont, comme c’est l’habitude dans le théâtre classique imprimé, en forme d’escaliers sur la page, ce qu’il est difficile de reproduire dans WordPress, que le lecteur nous excuse.
Quant au cycle Juca Mulato, il raconte l’histoire d’amour impossible d’un homme pauvre, ledit Juca, pour une femme riche, fille du propriétaire terrien pour lequel il travaille. Le nom du personnage, Mulato, peut vouloir dire « mulâtre », c’est-à-dis métis de Noir et de Blanc, ou bien simplement « à la peau mate », selon le dictionnaire Priberam.

(L’omission de l’article défini “A” sur cette couverture est une négligence.)
*
L’angoisse de Don Juan : Poème dramatique (A Angústia de D. João: Dramático, 1922)
La nuit est blanche de lune et le jardin blanc de marguerites. FAUST attend son amour sous le balcon de MARGUERITE. Venu de la nuit et de la distance, un chant se rapproche.
LA VOIX
Je n’ai jamais goûté ton baiser :
un étrange amour me fait trembler ;
je marche et mes pieds saignent.
Tu existes – mais je ne te vois pas ;
tu es belle – je ne te connais pas ;
je t’aime – et ne sais qui tu es !
Dans les villes, dans les campagnes,
j’ai pour destin de te chercher.
Où es-tu ? où vais-je ?
Je sens que tu m’entoures,
mais bien que tu sois partout,
tu n’es jamais là où je suis !
Je te sens répandue
dans la splendeur de la nature,
toi l’Aimée que je n’ai jamais vue.
Je sais que tu es dans la vie,
et où se trouve un peu de beauté
se trouve toujours un peu de toi…
Ô mon vague rêve obscur,
tu ne viens pas malgré mes appels…
Où donc es-tu ? Je ne sais pas !
Cachée, je te cherche
et ne te trouve pas, et je t’aime peut-être
de ne t’avoir jamais trouvée !
Ombre rêvée, divine,
à jamais sois seulement rêvée…
même pas entraperçue !
Fuis ! car notre destin
est de sentir que meurt l’Aimée
quand on trouve la Femme !
La voix s’arrête, DON JUAN paraît.
FAUST
Qui es-tu ?
DON JUAN
Je suis Don Juan.
FAUST
Qu’est-ce qui t’amène ?
DON JUAN
Mon destin.
FAUST
D’où viens-tu ?
DON JUAN
Je viens de la vie.
FAUST
Où vas-tu ?
DON JUAN
À la mort !
FAUST
Que cherches-tu ?
DON JUAN
L’amour…
FAUST
L’as-tu trouvé ?
DON JUAN
Il n’existe pas…
FAUST
Tu chantes parce que tu es heureux ?
DON JUAN
Je chante parce que je suis triste…
Et toi, es-tu un ménestrel ?
FAUST
Moi ? Je suis presque un suicidé…
DON JUAN
Que fais-tu au clair de lune ?
FAUST
J’attends Marguerite…
DON JUAN
T’a-t-elle donné un baiser ?
FAUST
Don Juan !
DON JUAN
T’a-t-elle souri ?
FAUST
Non…
DON JUAN
T’a-t-elle parlé ?
FAUST
Non…
DON JUAN
Pour quoi es-tu si étrange, cette nuit ?
FAUST
Parce qu’elle m’aime et ne le dit pas ; parce que cette âme devine
que je l’adore, peut-être, de n’avoir pas été mienne…
Parce que je n’ai pas encore goûté dans mon fol désir
la chaleur de ses lèvres, la saveur de son baiser.
Parce que je ne sais si en elle cet ardent égarement
trouvera l’amour que cherche mon âme.
DON JUAN
Tu aimes l’indécision ?
FAUST
Je ne sais pas…
DON JUAN
Tes propres chagrins ?
FAUST
Je ne sais pas… dans l’amour je n’aime peut-être que l’amour…
Comprends-tu ?
DON JUAN
Non. Tout cela est très singulier…
FAUST
Pauvre Don Juan ! Tu n’as jamais su aimer !
DON JUAN
Moi ? Moi, je n’ai pas su aimer ? Va donc demander
si je n’ai pas goûté l’amour de toutes les femmes !
Demande-le à la lune ! Demande à la fleur, au nid
combien de passions j’ai semées sur mon chemin,
combien de corps j’ai possédés, ardents de désir,
qui m’ont donné à fleur de bouche la gloire de leur baiser !
FAUST
Et puis ?
DON JUAN
Et puis ?… Cette soif sans remède…
FAUST
Et après le baiser ?
DON JUAN
La possession.
FAUST
Et après la possession ?
DON JUAN
L’ennui…
Un silence. Les marguerites paraissent plus blanches au clair de lune.
FAUST
(d’une voix sourde, pleine de compassion)
L’ennui est à l’amour la même chose que l’absinthe :
celle-ci empoisonne le corps, celui-là tue l’instinct…
Tes amours, Don Juan, en somme ne vont guère au-delà
de l’aveugle exaltation de tes sens.
DON JUAN
(pensif)
Je crois que tu as raison… Dans cette vie pleine d’agitation
j’ai possédé beaucoup de corps, à la recherche d’une âme.
Pour moi l’amour était un vin rosé
dans la coupe humide et fleurie de lèvres de femme !
(abattu)
Toujours la même liqueur ; et dedans, la même léthargie ;
très douce au début, à la fin très amère.
Lasse, notre lèvre cherchait l’amour au hasard ;
je changeais de calice et la liqueur était la même…
Que d’ennui j’ai ressenti ! Je voyais bien, avec tristesse,
qu’aucune femme n’incarnait mon rêve.
Jour après jour grandissait cette angoisse incomprise,
et fatigué d’aimer… je n’ai jamais aimé dans cette vie !
(étreint par l’angoisse)
Je me sens si vide… l’ennui me consume…
FAUST
Raconte-moi ton histoire. Je te raconterai la mienne.
DON JUAN
Mon histoire ? Elle est vulgaire… Un sourire qui vole…
une silhouette qui me suit… une femme qui passe…
une phrase qui va… un regard qui désire…
un corps qui se livre… une bouche qui reçoit un baiser…
une fièvre… un délire… et, après un moment,
un bâillement… une lassitude et un repentir !
FAUST
Non ! Ce n’est pas ça, l’amour ! L’amour est peut-être
dans la douleur d’aimer tout ce qui n’existe pas…
L’angoisse de voir disparaître à l’horizon
le rêve né de nos soifs…
Tout est néant ! L’illusion d’une âme qui se jette en avant,
chantant, après le signe bleu d’un mensonge
pour finir en sang, convaincue
que le mensonge de l’amour est la vérité de la vie !
Silence… Tous les deux s’absorbent dans la beauté du clair de lune. Puis, d’une voix faible, DON JUAN demande :
DON JUAN
Ne doit-on pas cueillir le baiser quand, follement,
pleine d’amour sourit la rose d’une bouche ?
FAUST
On ne le doit pas.
DON JUAN
Pourquoi ?
FAUST
Parce que, pour qui aime,
le baiser est comme la fleur au bout d’une branche.
Quand ta main nerveuse sépare
la fleur de sa tige, ne vois-tu pas que cela tue la fleur ?
Le baiser est la fleur étrange de la mystique amertume :
quand des lèvres le cueillent, il agonise sur les lèvres…
DON JUAN
Le baiser ? Le baiser est tout ! Un contact sublime
qui a goût d’amour et goût de crime !
Cri vivant de l’instinct, alléluias, rugissements
de l’aveugle exaltation de tous les sens !
Rebelle clameur de chair où l’âme folle,
pour trouver une autre âme, nous affleure à la bouche
et attend, et désire, et gémit, et pleure, et crie, et hurle !
FAUST
(ironique)
Un baiser ? Soupir suave qui se défait dans le néant…
DON JUAN
(en colère)
Tu mens ! Le baiser est tout ! Le baiser est la fièvre. Le baiser
est la vie de l’espérance…
FAUST
…la mort du désir.
(rappelant ses souvenirs et dans une profonde méditation absorbé)
Pauvre Don Juan ! Quand sur ton cheval noir,
jetant tes chants à la brise, les cheveux au vent,
mettant un peu de rêve à la fleur d’un boulingrin
comme dans une corolle un peu de miel ;
quand, frère fatal et jumeau de la séduction,
tu partis chanter, rêveur et bohème,
dupe et heureux, insouciant et rieur,
dans l’espoir de trouver la gloire de ton rêve,
j’eus pitié de toi car en chantant tu partais
chercher un bien qui sur la terre n’existe pas…
DON JUAN
Que de lèvres j’ai baisées ! Que de bouches en fleur
j’ai fait frémir d’amour, sans jamais trouver l’amour !
J’ai eu entre les mains des corps soumis comme des esclaves
où, glacée, s’insinuait l’angoisse de mes nerfs…
Et quand, ardente de fièvre, la femme folle et brûlante
s’enlaçait à moi comme un serpent,
me plaquant son baiser sur la bouche, et que sa chair de neige
frissonnait d’amour et de lasciveté,
dans la suprême éclosion de mon effrayant ennui
j’abandonnais la femme… et cherchais mon rêve !
FAUST
J’ai été plus heureux que toi.
Un jour, reflétée dans le miroir, j’ai vu Marguerite.
Folle d’amour, tout agitée trembla
dans mon corps de vieillard mon âme de jeune homme.
On dit que c’est Satan qui, plein de pitié,
rendit ma jeunesse à mes vieux jours…
Mensonge ! Quand l’amour réchauffe la poitrine,
notre existence tout entière exulte et refleurit !
S’il m’a donné un corps, c’est chose bien mesquine
car pour aimer il suffisait d’une âme égale à la mienne…
(se rappelant peu à peu, tandis que DON JUAN s’absorbe dans ses pensées)
Puis je la rencontrai, cette femme étrange,
effeuillant au clair de lune une marguerite.
Elle voulait savoir, peut-être, si je l’aimais ! Pourtant,
la terre, le ciel, la mer, la lumière, l’obscurité, tout
devait lui dire, la voyant si chaste et belle,
qu’aucune femme n’était comme elle aimée !
Pétale après pétale, nerveuse, elle effeuillait la fleur :
« Il m’aime un peu… beaucoup… » Elle sourit… Soupirait…
Tremblante, continuant de dégarnir la corolle.
La réponse de la fleur…
DON JUAN
(concluant)
… elle la trouva dans tes yeux !
(avec un bâillement)
Une histoire courte et sans sel. Comme toutes les autres, vulgaire :
Marguerite… une fleur… un soupir… un regard…
Fade, éternel amour qui, dans le sein où il se pose,
répète la même phrase, redit la même chose.
Sous quelques cieux que tu le cherches,
cet amour est toujours le même dans toutes les femmes !
FAUST
Mais enfin, Don Juan, que veut ton rêve ?
DON JUAN
Quelque chose de si subtil que je ne sais même pas ce que c’est…
Ce rêve mien veut une chose si grande
que cela ne peut être contenu dans un corps de femme.
FAUST
Tu te leurres, Don Juan. Dans nos pauvres vies,
les Faust auront toujours leurs Marguerite.
La fuir, ne point l’aimer, vain égarement :
celle qui doit venir, dans notre destin se montre !
Un jour, par hasard, tu la vois, blonde et belle,
et tu la reconnais alors : « Est-ce toi ? – C’est moi… » C’est elle !
Qui est-ce ? D’où vient-elle ? De l’ombre ou de l’aurore ?
Qui sait d’où vient la femme que l’on adore ?
Personne ne le sait… Du ciel ? de la mer ? des vagues tumultueuses ?
Non ! Tu sais seulement que c’est celle que tu attendais.
DON JUAN
Je l’ai attendue en vain…
FAUST
Nombreux sont ceux dont le destin
est d’attendre celle qui ne vient pas…
Et dans leur passion de la trouver, abusés, ils gesticulent,
croyant qu’ils aiment possédant la femme qu’ils désirent…
Esclaves de l’illusion qui tronque leur bonheur,
ils blasphèment contre l’amour sans avoir jamais aimé !
Ils sont comme toi qui erres dans la vie,
aimant les femmes les unes après les autres, et les détestant toutes !
DON JUAN
(transfiguré)
Non ! Tu ne peux comprendre le plaisir que procure
aimer, comme j’aime, un être qui n’existe pas !
Je l’ai façonnée en moi, en ai fait mon Élue.
Cette femme s’appelle la Beauté Parfaite !
L’aimée de Don Juan, qu’elle est belle ! Au fond,
elle résume tout ce qu’il y a au monde de plus beau !
Devant sa splendeur les étoiles pâlissent :
c’est un poème de chair, un cantique de courbes !
Je l’ai façonnée joignant ensemble au hasard la perfection
que renferme, morcelée, dispersée, la beauté de la terre…
Jamais tu ne comprendras mon rêve exalté :
comme Osiris, l’amour existe mutilé…
Je vois l’élue dont j’ai rêvé, mais – que veux-tu ? –
elle vit éparse dans toutes les femmes.
Je sens, en la voyant dans un sein ou la courbe d’un bras,
que la femme que j’aime est faite de fragments…
Elle existe partout, et chaque belle femme
en cache une part dans son corps !
Celle-ci a son regard, celle-là ses chairs blanches,
l’une la forme du torse, une autre la fuite des hanches.
Prenant à l’une la couleur, à l’autre un trait indécis,
à celle-ci l’ourlet des lèvres, à telle autre un sourire,
bout à bout je recompose une amante,
car en chaque femme se trouve un peu de mon rêve !
*
Juca Mulato, 1917
.
La voix des choses (A voz das coisas)
Et Juca entendit la voix des choses. C’était un cri :
« Tu veux donc nous quitter, fils dénaturé ? »
Un cèdre le morigéna : « Ne sais-tu pas, renégat,
que c’est avec une de mes branches qu’on fit ton berceau ? »
Et le torrent qui roulait dans l’abîme :
« Juca, c’est moi qui donnai l’eau de ton baptême. »
Une étoile, en scintillant, dit depuis les hauteurs éthérées :
« C’est moi qui éclairais ta chaumière obscure
le jour où tu es né. Tu étais fragile et dolent…
Et ton père te prit dans ses bras en pleurant de joie…
– Il sera docteur, dit ta mère, et ton père, raisonnable :
– Notre fils sera paysan de ces bois,
fort comme le perobᆠet libre comme le vent ! –
depuis ce jour tu as été à nous
et nous t’avons aimé, suivant ton chemin incertain
avec des tendresses de mère protégeant son enfant ! »
Juca entendit la forêt : les branches en l’air
semblaient vouloir le serrer dans leurs bras :
« Enfant de nos taillis, viens ! N’avons-nous pas été, Juca,
la fourche de ton lance-pierres, les cloisons de ton piège pour oiseaux,
la perche de ta barque, et ce bois sec
qui la nuit craquait dans le feu de la cuisine ?
Ensuite, homme fait, ta main déterminée
n’a-t-elle pas fait d’un rameau rude un manche pour la houe ? »
« Ne t’en va pas », lui dit le ciel. « Mes étoiles parfaites,
tu ne les verras pas sous un ciel étranger.
Hostiles, à ton regard des astres ignorés
fulgureront comme des pointes d’épée.
Leurs sœurs d’ici, inquiètes,
te chercheront en vain de leurs yeux de feu…
Mesure la douleur de ces pauvres étoiles
courant après celui qui les fuit… »
Juca regarda la terre, et la terre muette et froide
par la voix du silence parlait aussi :
« Juca Mulato, tu es à moi ! Ne fuis pas, car je te suis partout…
Où seront tes pieds, je serai avec toi.
Tout est néant, illusion ! Sur toute la sphère
s’ouvre un fossé, mon ventre attend…
Dans ce ventre est une nuit obscure et sans limites,
et dans cette nuit le sommeil et dans ce sommeil le néant.
Alors à quoi bon partir, comme un fugitif et au hasard,
pour trouver partout la même douleur car tu la portes en toi ?
Tu veux oublier ? Ne fuis pas le tourment…
C’est grâce à la douleur qu’on parvient à l’oubli.
Ne t’en va pas. Ici passeront tes jours les plus sereins
car sur la terre natale la douleur fait moins souffrir…
Reste, car il vaut mieux mourir (ah, je le sais bien !)
sur le bout de terre où l’on est né ! »
† perobá : espèce d’arbre.
*
Poèmes d’Amour
(Poemas de Amor, 1924)
.
Musique (Música)
Le destin qui pleure,
la clameur des crapauds,
un lointain klaxon,
le boniment d’un vendeur ambulant,
le Chopin romantique de la triste voisine,
longues syncopes de silence absolu…
Et dans le silence, plus suave qu’un arpège,
mon baiser, ton baiser, notre baiser…
*
Désillusion (Desilusão)
Qu’est-ce, aimer ? L’étrange douleur
de l’âme qui se brise dans la tendresse…
C’est cueillir au hasard une fleur
pour l’effeuiller sur le chemin.
Et que reste-t-il après tant de soupirs ?
La nostalgie ? Peut-être… Ô âme abusée,
de la fleur et de toi ne reste presque rien :
une poignée de pétales sur la route,
un parfum sur les doigts… – Rien de plus.
*
République des États-Unis du Brésil
(República dos Estados Unidos do Brasil, 1928)
.
Sonnet (Soneto)
Sonnet ! Qu’importe si les pervers parlent mal de toi,
je t’aime et te lève comme une coupe.
En toi chante l’oiseau de la grâce,
dans le nichoir de tes quatorze vers.
Combien de rêves d’amour sont immergés
en toi qui es douleur, peur, gloire et malheur ?
Tu fus l’expression sentimentale de la race
d’un peuple qui vivait en faisant des vers.
Ton lyrisme est la tristesse nostalgique
de cette saudade atavique et tendre
que dans le fond de la race nous a versée
la première guitare portugaise
gémissant sur une plage brésilienne,
cette nuit où le Brésil est né…
*
Le Dieu sans visage
(O Deus sem rosto, 1968)
.
Le cadavre de l’ange (O cadáver do anjo)
Sous les débris de l’avion l’ange était écrasé.
Les hommes de Cap Canaveral
conclurent que c’était l’habitant d’une planète morte.
Les ailes de plumes et la structure de volatile
étaient cependant d’un oiseau monstrueux
avec un visage de beau jeune homme
aux yeux très bleus, comme la poussière céleste
qui habillait son cadavre fluide.
Les savants étaient fiers d’avoir brisé le ciel
et fait se disperser les anges.
Celui-ci, cependant, était venu protester contre l’invasion de son royaume
et dénoncer les hommes qui assassinent les mythes et les rêves.
Il heurta l’aile du jet supersonique qui fusait vers la lune
et tous les deux
l’Icare belliqueux et le Messager des dieux
roulèrent dans l’espace
et s’écrasèrent dans la boue.
*
Le Dieu sans visage (O Deus sem rosto)
Fabriquons, frères, un Dieu qui soit fluide
qui n’ait ni visage ni temple
qui vive caché dans l’illusion de ses fidèles
car les iconoclastes sont lâchés.
Nous avons besoin d’un appui dans le vide,
d’une lumière dans l’abîme.
Mythes et dieux sont détruits,
une science triste et froide vide le ciel d’anges.
À leur place dans des missiles d’acier
volent des astronautes pistant la mort
cherchant avec des yeux mécaniques
la cachette où pourrait s’abriter le dernier rêve.
Nous renonçons aux ultimes valeurs
qui rattachaient la vie au rythme et à l’ordre.
Le miroir artistique des écrans ne reflète plus
notre image car ils nous renvoient
des spectres et des monstres que sans le savoir nous sommes déjà devenus.
Nous rions comme des hyènes
sur des monceaux de cadavres.
Serait-ce que nous sommes morts et ne le savons pas encore ?
Le dieu terrestre a pour trône une capsule.
C’est terrible ! Elle explose !
Ne l’émouvront ni notre panique ni nos suppliques
ni l’offrande des os du monde.
Il veut étendre son empire
jusqu’aux galaxies
pour répandre dans le cosmos
mort et fange.
Réfugions-nous dans les catacombes, frères !
Cachons le Christ.
Prions le Dieu sans visage.
*
Le crépuscule (O crepuscúlo)
À cette hauteur
ma tête frappe du front contre les étoiles.
Ce sont d’immenses mondes de pierre qui roulent dans l’espace
et non des lumières de songe.
On veut arracher mes pieds à la terre et me catapulter dans les nuages
comme un projectile
chose désuète et étrangère à l’ordonnancement du monde.
Sera-t-il nécessaire d’éradiquer la compréhension du paysage terrestre, inutile déjà,
refroidir dans l’homme la chaleur de sa famille humaine
détruire les racines de son passé
le tuer ou
transmuter son essence
l’adapter au style mécanique créé par la machine ?
Je ne suis plus moi-même et mon univers n’est plus mon univers.
Mon voisin ne joint plus ses pas à mes pas
dans l’ennui quotidien des mêmes rues.
Il va par d’autres routes renonçant à son passé
à la recherche d’une chose nouvelle
dont il ne sait ni ce qu’elle est ni où elle se trouve ni quand il la trouvera.
Tout explose !
Dans la fuite vers le nouveau jour
chaque déserteur porte sur le dos le vide d’une idéologie frustrée
les cendres d’une science morte qu’il apprit pendant des millénaires
et qui ne structure plus son esprit
n’éclaire plus ses pas.
Dans leur soif de dépassement
des hommes de toutes les régions du globe
accourent pour édifier la Babel astrale.
Ils mettent le cap sur les galaxies,
chaque peuple tentant de laisser la marque de sa possession
sur l’olympienne innocence d’une étoile.
*
La Babel astrale (A Babel astral)
La malédiction de Jéhovah foudroie l’audace de notre aventure.
La nuit tombe. Les langues se confondent.
Depuis les nuages roulent des ouvriers débandés
balbutiant des choses que nul ne comprend.
Peut-être projetaient-ils
de déchiffrer parmi les astres la langue perdue des anges
tentant de renouveler le message de l’annonce aux bergers
dans la nuit de l’étoile pérégrine
pour apaiser
les convulsions du monde.
Cependant chaque peuple a perdu dans la confusion sa propre langue
et s’est mis à bredouiller un idiome étrange
et les plus savants bégayent des phrases qui n’ont pas de sens
des mots sans connexion
dilués dans une sémantique qui les rend plurivoques
énigmatiques
inopérants
creux.
Qu’est-ce que fascisme communisme démocratie dictature, liberté ?
Les Russes brandissent devant le monde des poings fermés pleins de sable.
La fanatique enfance des Chinois
menace l’univers avec des mains couvertes de sang.
Sur toute la terre descend et circule la vague de l’incompréhension et de la peur.
La peur la peur la peur
La peur…
Un policier se poste dans chaque recoin de l’âme.
La ronde des pressions irrationnelles patrouille notre anxieuse insécurité.
Nous nous sentons tous coupables d’un crime que nul n’a commis.
Tous attendent innocents une monstrueuse sentence.
Tous craignent un absurde et inique châtiment.
Quand finira la nuit ?
*
Message (Mensagem)
Mon cantique est inutile.
Les hommes n’ont pas d’oreilles
pour le langage des pierres.
Mon univers est du passé.
Mes frères se changeront en statues.
Les vieux poèmes
sont des hiéroglyphes que les barbares
déchiffreront avec des instruments électroniques.
À la fin ils se convaincront
qu’hier et aujourd’hui seront toujours la même chose
alors, épouvantés,
ils verront que nous avions nous aussi
beauté, espoir.
*
Lunik
Ndt. Lunik était le nom d’un programme soviétique de sondes spatiales.
Silencieuse
Séléné
somnambule
nuit blanche
vêtue de tulle
foulant sur les nuages
avec des pieds d’albe neige
un gravier d’étoiles.
But de désirs
et de rêves.
Dans la nuit numineuse
tu berces mon ange.
Vierge immaculée.
Soudain
– camélia nocturne –
le maladroit amour des hommes
crache sur ta peau
avec des lèvres de feu
son baiser de fange.