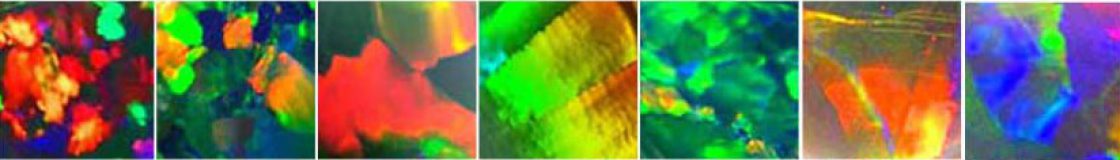Tagged: poésie espagnole
Trains d’Avila ou de Soria : La poésie d’Agustín de Foxá
L’écrivain Agustín de Foxá (1906-1959) fut nommé en 1956 à l’Académie espagnole mais jamais n’y siégea car son élection eut lieu alors qu’il était ambassadeur à Manille, aux Philippines, dont il revint pour soigner une cirrhose du foie qui lui fut fatale.
C’était un personnage haut en couleur, que Malaparte, comme lui diplomate, connut en service en Finlande. Ils visitèrent ensemble le front de Léningrad. Malaparte dresse son portrait sous les traits d’un personnage du roman Kaputt, ainsi que dans son recueil de chroniques La Volga naît en Europe.
Ami de Ramón Gómez de la Serna, Agustín de Foxá fut entre autres poète – l’un de ses recueils est préfacé par Antonio Machado –, dramaturge, auteur d’un roman sur la guerre civile espagnole très lu en son temps, Madrid, de Corte a checa (Madrid, de Cour royale à Tchéka), publié en 1938 et dont le personnage principal est un phalangiste.
Dans son activité en tant que fonctionnaire des affaires étrangères, il fut chargé d’accompagner Eva Perón lors du voyage officiel de celle-ci en Espagne en 1947, à l’occasion duquel – fait notable – elle s’exprima à plusieurs reprises devant des foules pour exprimer la solidarité de l’Argentine justicialiste avec l’Espagne.
Agustín de Foxá était marié à María Larrañaga, architecte et designer, qui fut une figure du Marbella de l’après-guerre quand la ville devint un rendez-vous cosmopolite couru (à la suite, se dit-il, d’investissements immobiliers servant à blanchir de l’argent allemand).
Son œuvre n’a jamais été traduite en français avant nous. Les poèmes suivants sont tirés d’une Antología poética 1933-1948 (Editora Nacional, Madrid, 1948), illustrée par José R. Escassi. Il existe une autre anthologie, plus large, de sa poésie, couvrant les années 1926 à 1955 et dont la dernière édition date de 2022.
*
La fille du roi de la mer (La hija del rey del mar)
Air sous pression et lumière trouble,
les prés du fond de la mer,
chair tremblotante et tritons,
nacre, gélatine et sel.
Les vaches marines mugissent.
Drapeaux d’avis de tempête.
Les scaphandriers guerriers sautent
par-dessus les gencives du corail,
des bulles au-dessus de la tête
comme un essaim d’abeilles.
La fille du roi de la mer
brodait à sa fenêtre,
sous des galères de musique
et des ancres de fin métal.
Queue de poisson et jeunes seins,
robe de fine gaze,
broche d’aurores dormantes,
neige polaire de son cou.
Les nuits sans tempête,
jusqu’au palais royal parvenaient,
ténues, assourdies, les notes
de cloches d’églises.
« Duègne qui montas là-haut,
qu’y a-t-il au-dessus de la mer ? »
« Il y a, mon enfant, des bateaux et des plages,
et le corail est vivant et brûle.
Il y a des hirondelles et des princes,
des poissons aux plumes sans pareilles,
la lune est un panier de neige,
des cloches, du soleil, du cristal. »
« Ah, comme je voudrais aller là-haut !
Duègne, ah, tu me fais pleurer. »
*
Marie-Antoinette (María Antonieta)
Couronne bleue de marquise
sur les cygnes neigeux.
Trois gouttes de sang
sur la perruque poudrée.
Bougies roses, parfumées,
à la molle cire de nard.
L’Encyclopédie aboyait…
Versailles illuminés.
Dans une tasse au liseré rose,
Louis XVI déjeune
de chocolat du Pérou
en un ciel de perroquets.
Seins et coupes vides,
confessionnaux obscurs,
écrans de crinoline
dans les sièges dorés
et un jeu de cartes français,
à l’écart des chandeliers,
versant des gouttes de trèfles
parmi des vicomtes saouls.
Marie-Antoinette descendait
l’escalier de marbre,
le printemps d’un bal
effeuillé sur ses souliers.
Un étrange carrosse l’attend,
tiré par quatre chevaux
aux yeux fous qui poussent
effrayés des cris d’oiseaux.
Fenêtres de guillotine,
lanternes de cierges blancs…
Et pour cochers des bourreaux
couvrant leurs mains.
*
Cimetière 1800 (Cementerio de 1800)
Avez-vous soif, paisibles morts,
avez-vous froid ?
Oh, votre sommeil dans la caisse asphyxiée !
Assemblée de corps.
Dedans, l’humidité, la nuit ;
dehors, le rosier, la lune…
Recouverts
de votre ombre,
et sans printemps !
Voulez-vous de l’eau ?
la fièvre
de votre dernière maladie rosit encore
vos os.
Qu’en fut-il de votre oreiller,
de votre dernière nuit
en un lointain dix-huitième siècle ?
Que disiez-vous ? quelles fiancées ou quelles sœurs
portèrent la tasse à vos lèvres ?
Quels docteurs
vous prirent le pouls vacillant ?
Comment était votre chambre :
pleine de courtines, de portraits ou d’éventails ?
Comment se passa votre enterrement ?
Quelles cloches,
quelles larmes, quels cris ?
Et le délire
de votre mort, quels jardins rouges
peignit-il sur le mur ?
Quelle fut la main
qui vous épongea la sueur dans de la soie ?
Était-ce
un jour de pluie ou de triste soleil ?
Comment était votre voix, votre visage ?
Comment étaient vos grands yeux ?
Vous souvenez-vous de votre rire ?
Vos mains croisées
se rappellent-elles les oranges et les seins ?
Les lettres que vous écrivirent,
que disaient-elles ?
Cendre et fumée,
votre amour lointain,
la joie du baiser et des enfants.
Quelles vagues antiques vîtes-vous ?
Paix à votre décembre…
Écoutez-moi, vous autres
qui mourûtes en avril ou en mai,
fiancées glacées ; vos boucles d’or
sur de noirs oreillers ;
blanches enfants
qui, sautant à la corde parmi les oiseaux,
vîtes la main horrible et vous endormîtes
avec des poupées et des contes dans vos draps.
Écoutez-moi, rêveurs
qui ne voyez plus la lune.
Les rosiers naissent toujours,
le saviez-vous ?
et il y a encore des bouches ; mais les nuages
que vous regardiez sont morts pour toujours.
Par vos yeux creux
leur bord bleu est passé ;
aveugles distants,
un abîme nous sépare.
Voyez mon large corps ;
voyez, soumise à mes pieds, l’ombre épaisse
qui vous enveloppe, vous,
et vous étouffe.
Je suis vivant ; je suis dans votre rêve
comme un dieu ;
ce bruit,
c’est celui de mon cœur ; l’air m’entoure
et dans mes mains je tiens les choses de la terre.
Peut-être se trouve-t-il parmi vous
la femme qui aurait été
ma bleue fiancée ; peut-être parmi cette poussière
ai-je un ami – impossible – inerte.
Je vous aime, paisibles morts ;
femmes qui m’auraient compris,
compagnons lointains,
enfants de jadis.
Si vous pouviez sentir comme l’air souffle,
entendre les bruits qui nous assomment,
éprouver comme il est fatigant d’aller à pied,
et comme il pleut
sur le sang.
Oh, non !
restez calmes, muets ; ne m’enviez pas mon corps,
vous dont la lumière est à présent ce silence
que vous habitez entre plâtre et guirlandes.
Votre cyprès est bon,
les étoiles vous baisent le front,
une croix vous couvre,
et cette terre mouillée, sur vos os
met une paix vespérale ;
frères,
adieu, je vous laisse ;
dans le cyprès
se meut un oiseau couleur cendre et rose ;
seul
son petit cœur palpite
parmi les vôtres brisés.
C’est pour lui que monte la lune et que vient le mois de mai.
*
Les lèvres des mers (El labio de los mares)
Ah si j’avais les vents et les vagues entre mes muscles,
la fleur de lait dans mon sourire et l’abeille dans mes yeux ;
la crinière du lion sur une tête solide
et une sueur d’oranges.
Si j’avais un sang minéral et massif,
des poumons d’arbres fruitiers,
l’épine dorsale du dauphin ou du cheval
et une âme fixe.
Si j’avais la chair sûre des montagnes,
les lèvres des mers, les nerfs de la nuit
et, hissé sur le monde, si j’atteignais la lune
pour en ouvrir les villes !
*
Origine (Origen)
Il me plaît que mon corps pressente l’orage,
qu’une douleur ténue dans la moelle spongieuse
de mon os frontal
annonce les salons de l’éclair.
Je veux
sentir comme une plante, une épine, une vague
le noir tonnerre dans la nuit.
Que m’entrent par la plante des pieds
les durs effluves des minéraux ;
éprouver que j’ai une chair de cheval,
une albumine d’insecte palpitant,
baignée en azur de printemps.
Ô pain, donne-moi ton fruit et ta peau de panthère !
le lait des biches et la grappe lourde,
les quartz et les oxydes, les sauriens primitifs
et ce feu allumé par un bras velu
au premier hiver de la terre.
Je veux être de racines et de nerfs, de tentacules
captant l’ozone des pluies.
Que la conque marine et la tortue soient
comme un rêve de mon sang, dans le plasma salé.
Que la poitrine de la femelle enflamme mes artères ;
que m’épouvante la fétidité douceâtre des cadavres
et que je sente l’effroi nocturne des grottes
peintes de gros bisons rosés.
*
Pêche morte (Los pescados muertos)
Dans les poissonneries il y a des flots dépouillés,
sous les ampoules électriques
des aquarelles d’indigo et des barques rouges.
Chair rose, étendue sur des morceaux de glace.
Ô habitants de la mer, haïs par l’air !
car il ne vous trouva jamais de dociles poumons.
Saumon rose, tachant d’un sang anémique
les fougères. Ô anguille !
serpent bleu, sans oiseaux.
Ô langouste guerrière !
heaume calcaire et l’œil sur une tige.
Roue des sardines, comme une monnaie d’huile.
Crabes d’eau amère.
Ô pâles habitants de la mer qui vîtes les coraux,
nageoires qui frôlèrent les éponges
et ces huîtres malades de perles, qui ambitionnent
les plus hauts diadèmes.
Ô habitants de la mer, flottant sur les mines d’or !
On vend des vagues ; on enveloppe dans des journaux
les yeux globuleux qui ont vu les naufrages.
Il y a des chairs de tempête dans les cuisines modestes,
et quand la lune bronzée monte entre les lampadaires
un désir de marée saisit ces corps morts
qui à travers les devantures fermées écoutent la pluie
comme la dernière troupe de musiciens que leur envoie la mer.
*
Épouvantail (Espantapájaros)
Parmi les sillons rouges,
seul,
l’épouvantail.
Visage de bois, chapeau
et redingote, entre les chardons.
Oh, damoiseau de la mort
parmi les laboureurs,
insomniaque fat,
ivre de rosée ;
tes amis,
les pantins, les fous, les pendus.
Rebut d’homme,
masque du blé,
danseur compagnon de la pluie,
amer
ennemi des alouettes
et viveur endeuillé,
de quelle noce chez les morts
es-tu l’invité ?
Crucifié sur les ais tendres,
des branchettes vertes dans le vieil habit
de ton thorax.
Célibataire de bois, homme sans visage ;
oh – sans feu ni lieu –,
épouvantail,
dans la poche de ta redingote
le grand mouchoir rouge !
Oh, enlinceulé par la lune,
défunt vicomte des champs !
*
Inutile (Lo inútil)
Ces gestes inutiles,
ces voix inutiles ;
la voix de celui qui vend des jouets que personne n’achète,
celle présentant des cravates qui font rire.
Cette main ouverte dans la pluie ;
la casquette entre les doigts du paysan dans le salon ;
ces gestes de rien ;
cette voix de « Docteur, sauvez-la » ;
les humbles paroles,
le regard suppliant face à l’inévitable ;
ces chaussures de l’enfant qui ne protègent pas de la neige.
Le phtisique, sur un banc, qui se couvre la poitrine
avec un journal, comme cette pluie sur le fleuve,
comme la couverture sur le mort
ou cette approche de la rive par le noyé.
Tout ce qui est sans motif,
triste, puéril, inefficace,
comme ces vers que j’écris et que nul ne lira,
comme le soleil frappant les yeux de l’aveugle.
*
Tristesse (Lo triste)
Je suis comme un noyé perdu sur une plage,
alcôve où l’on appelle au moyen d’une sonnette de bois ;
comme ce fonctionnaire qui n’a jamais vu la mer,
comme la pluie qui tombe tristement sur un collège.
Augmentent ma tristesse les cours intérieures,
le chromo avec ours et neige dans l’humble salle à manger,
la vieille gourde ouverte sur le terrain sans palissades,
la boîte de sardines le dimanche soir.
Il y a des plages où la mer lutte de mauvaise grâce
et des tours fatiguées de regarder l’horizon,
des dominos jaunis dans des cafés de province
et des boutiques de parapluies pour habiller les morts.
Je sais que m’ont haï les plantes des ruines,
qu’on décore au ciel le jour de ma mort,
qu’une nuit mon ombre entrera dans mon lit
et, d’entrailles vide, me déchirera les yeux.
Je sais que m’entoure un monde d’os et de métaux,
que de durs animaux me mordent les mains,
que je jetterai un mégot sur le pavé couvert de crachats
et qu’une roue quelconque l’éteindra sous la pluie.
*
Romance des salines de Sigüenza (Romance de las salinas de Sigüenza)
Les salines de Sigüenza,
comme elles sont loin de la mer !
Pour ta chambre, mon enfant,
je te ferai un voilier de sel.
On croirait une tour côtière1
ou un phare, la cathédrale,
quand la brise salée
arrive endormie jusqu’à l’autel.
Volant à travers les salines
qui côtoient les champs de blé,
te voilà mouette humide,
colombe du colombier !
Assoiffés, les paludiers
demandent : – Où est la mer ?
Ah si j’avais, au lieu d’une voiture,
une barque avec des rames !
Sigüenza, pourquoi t’ont-ils parlé
de charrues et de dépiquage,
à toi qui as des rêves de boussole
sous l’étoile polaire ?
Sigüenza, port sans eau,
avec ton Damoiseau-capitaine2
lisant un livre de marine
sous le cristal au plomb !
Si je dessine un jour une carte,
je te placerai au bord de la mer.
1 tour côtière : « torre costera », le littoral méditerranéen espagnol est émaillé de ces tours bâties au seizième siècle pour la défense du territoire contre les pirates barbaresques. Il est probable que les « tours fatiguées de regarder l’horizon », au poème précédent, sont de ces ouvrages.
2 Damoiseau-capitaine : Allusion à Martín Vásquez de Arce, dit le « Doncel (damoiseau) de Sigüenza » en raison du gisant de sa sépulture dans la cathédrale de la ville, un chef-d’œuvre de la statuaire funéraire.
*
Trains d’Avila ou de Soria (Trenes de Ávila o Soria)
Entre tes mains noires
un panier de fraises.
Machiniste d’un train d’Avila ou de Soria,
ta lanterne rouge dans l’épaisse chute de neige.
Direction Medina ou Venta de Baños.
Le Noël du train ; et les drapeaux
qu’au passage à niveau lève ta fiancée
si blonde, sur le tunnel obscur.
Ne dois-tu jamais avoir ta vieille locomotive
avec sa haute cheminée
comme celle de Stephenson qui un jour
défia un cheval en Angleterre ?
Laisseras-tu, cette nuit, glisser
sur un talus de lys ce panier
de charbons qui éclairent la cuisine
de la pauvre garde-barrière ?
Tu contournes des villes à murailles
et frôles, avec l’aube, les églises
quand sonnent fraîches les cloches
des premières messes.
Colombes de mouchoirs sont les quais
où des marchandes de rue annoncent à haute voix
leurs amandes d’Alcalá, boîtes de lait,
babas à la cannelle.
Comme en août suent tes wagons !
Leur résine graissant les valises.
Comme le papier du casse-croûte
colle au chardon violet dans le fossé !
Parfois une étincelle parmi les pins
avec le vent du train devient un incendie.
Train du soir ; avec une lampe
à acétylène où meurt aveuglé
le papillon bleu des pinèdes
qui parfumait la fenêtre ouverte.
Ô humble train, au trajet court !
Avec un wagon servant de bergerie aux brebis
qui partaient à l’abattoir et bêlaient
par peur du loup en traversant la sierra.
Les coqs des cantines de paysan
qui annonçaient l’aube dans un panier.
Le poêle et l’horloge et le Règlement
de la salle d’attente.
Tes « premières » étaient de velours rouge
avec des dentelles jaunes,
y venaient les universitaires modestes,
parfois les fonctionnaires de l’Audience.
Tes « deuxièmes », en bleu, étaient solennelles
avec des curés, des chasseurs, des hommes à carabine.
Et moissonneurs, nonnes et gardes civils
dans le vernis clair de tes « troisièmes ».
Train de mes vacances ! dans tes filets
un jour j’oubliai le cerf-volant
que j’allais lancer dans le ciel d’été,
l’année où commença la guerre.
Des années je vis de mon siège,
en traversant Almazán, sur un balcon de pierre
au-dessus d’un jardin, une jeune fille
qui agitait tristement un mouchoir.
……….
Je la vis se faner année après année
et, me disant adieu, devenir vieille.
À travers la plaine froide, là-bas, vers octobre,
quand transhument les lents troupeaux de moutons
entre de petites églises romantiques gardées par
des saints Jacques aux épées de bois,
ô train qui aurait pu être dans le romancero !
Train de l’année soixante,
dans tes voitures Antonio Machado arriva à Soria
entre les peupliers et la colline violette.
Et Bécquer, emmitouflé et mélancolique
dans son plaid écossais,
en voyant les hirondelles du télégraphe
imagina sa rime la plus parfaite.
Dans une gravure de L’Illustration
tu apparais couvert de drapeaux
à ton inauguration, avec un évêque
et des ingénieurs barbus en haut-de-forme.
Tu continueras d’aller ton chemin,
sans voyageurs ou presque, à travers la steppe gelée,
le long d’auberges où l’on sert l’eau du puits
et où meuglent les génisses attachées.
J’ai beaucoup voyagé depuis : des sleepings
aux locomotives électriques
ont transporté mon ennui ou ma joie
à travers les grandes villes de l’étranger.
Mais c’est vers toi, humble train de Soria,
que vole mon cœur ; car tu étais
la joie initiale de mes étés
au bagage ingénu de cerfs-volants.
*
Les hommes sont venus : Mers d’Australie, 1800 (Han venido los hombres: Mares de Australia, 1800)
I
Les hommes sont venus…
Les hommes sont venus avec leur foie assoiffé,
avec des bouches, des mains et des veines ardentes.
Et la tribu contemple le frêle brigantin
flottant sur l’azur clair des ondes.
C’est un voilier ; il a une charpente lente
qui endort les îles et se gonfle de cannelle.
Œil et nerf, la boussole, avec l’aiguille vers le pôle
de neige magnétique ; le gouvernail tremblant ;
langue qui lèche des éponges, le cordage tombé.
II
Les hommes sont venus à l’innocence pure
des îles nues ; aux nobles cascades
où nagent les jeunes filles en poussant des cris joyeux
dans leur langue sauvage, libre encore d’alphabet.
Les hommes sont venus aux mers les plus libres.
Requins et perles, odeurs de nageoire,
lunes sans télescope qui courrouce les poissons
et bananeraies humides pour suspendre des hamacs.
III
Les hommes sont venus ; ils sont blancs et barbus ;
ils violeront les vierges les plus douces de la tribu
et tueront le sorcier vêtu de kangourou
qui danse les nuits de pleine lune devant le feu.
Ils sont ambitieux ; ils bâtiront leurs usines ;
une locomotive avec sa haute cheminée
déshonorera la forêt ; ils compteront les fruits
et mettront le poisson dans des boîtes pleines d’huile.
IV
Ils ont des yeux d’acier ; apportent l’alcool et la luxure ;
l’anglais de leurs chèques se substituera aux hymnes
au soleil dans la langue que comprennent les mouettes.
Les hommes débarquent ; la tribu les contemple,
nus au milieu de la plage ;
avec des fusils à silex et une vieille Bible,
les hommes blancs achètent le vieux Paradis.
*
Ce navire au nom d’île : Sur le torpillage du Baleares (Aquel barco con un nombre de isla: En el hundimiento del «Baleares»)
Ndt. Le Baleares, navire espagnol au service du camp nationaliste pendant la guerre civile, fut coulé à la bataille du cap Palos en 1938, emportant 741 victimes par le fond. En 1947 fut inauguré à Palma de Majorque un colossal monument aux morts du Baleares, qui a résisté à ce jour aux tentatives d’éradication de la part des autorités politiques de l’Espagne nouvelle, lesquelles ont dû jusqu’à présent se contenter d’effacer des inscriptions mais ne s’arrêteront sans doute pas là dans leur continuation de la guerre par d’autres moyens.
Et tu échangeas la rose contre les algues amères,
la femme terrestre contre la froide sirène.
Et tu traversas en volant le jardin des scaphandriers,
où le poisson à l’œil immobile voit naître la tempête.
Où vas-tu, dans la nuit dangereuse des grands fonds,
marin d’un bateau submergé et sans force ?
Quel « Arriba España ! » depuis la fin de l’abîme as-tu lancé,
qui s’envola en essaim de bulles sphériques ?
Belvédères de Cadix ou du Ferrol, les persiennes
entrouvertes et le piano qui sous sa housse ne joue pas.
La fiancée pleurant au bord de la mer et les phares
que les mouettes réveillent, cherchant ton corps.
« Mère, l’eau est froide, et je me souviens des oiseaux ;
bien que ce soit le mois de mai, j’ai les veines glacées.
Je sais qu’il m’est interdit d’arriver à ta plage ;
pour voir ta fenêtre, je viendrai avec les marées. »
Tu remonteras un jour du fond, évanoui,
avec tes yeux de noyé, pour voir les drapeaux.
À présent que les chevaux du champ de blé sont dans l’eau,
le soldat dans l’écume, et que Peñiscola est à nous.
Tu monteras, l’été, des troubles abîmes
pour voir les oranges, la noria, les vergers.
Toi, sans poids et sans ombre, fantôme exilé,
dont le corps ne peut dormir en terre.
Cherches-tu un tombeau, la racine des arbres,
le lieu qui ne change pas et la dalle sûre ?
Ton sépulcre est païen, le corail ne couvre pas,
et tu es triton, nostalgique du cyprès et de l’étoile.
Tu habitais un navire au nom d’île,
l’écume tourbillonnait dans ses hélices neuves,
et dans l’arc-en-ciel de fioul de son sillon sautaient
comme des obus les dauphins brillants.
Où es-tu, mon bateau, vivante parcelle d’Espagne,
hier forteresse navigante et joyeuse,
aujourd’hui épave inondée, manœuvrée par des morts,
immobile sur un méridien avec sa boussole immobile ?
Vous ne reviendrez jamais à l’amour des îles,
quand les amandes de Majorque sont le plus sucrées,
avec les bateaux captifs pleins de tanks russes,
et l’alphabet courtois de tes drapeaux ne parlera plus.
Par des terrasses qui descendent à la mer, où l’écume
fait bouillonner d’eau inquiète le marchepied de marbre,
les marines d’Espagne viendront avec des couronnes
et le jeune amiral apportera la rose nouvelle.
Alors ils te diront, levant le bras : « Marin
au coquillage de nacre au-dessus des flèches,
au lieu d’un rameau funèbre, pour toi nous effeuillerons
la Rose des vents sur ta tombe incertaine. »
*
La guerre castillane (La guerra castellana)
Il faut retrouver nos voix puissantes
et le geste sûr du javelot ou de l’épée.
Les lèvres et les roses ne doivent pas nous retenir
quand la Castille attend sa dure cavalcade.
Ô gués militaires des fleuves puissants !
Les cerfs au bord de l’eau et les sangliers dans les taillis.
Pour que notre épouse n’affaiblisse point notre vigueur,
qu’en son cloître la garde San Pedro de Cardeña.
Et sur l’arçon de nouveau, déjà pointent les blancheurs
de l’aube castillane, mon jeune chevalier.
En vers sans métaphores, les rudes troubadours
célébreront ton sang dilué dans le Duero.
Si te guette en terres ennemies le malheur
et si tu meurs un codex enluminé dans les mains,
une sépulture t’attend à Silos, auprès de l’abbé Fortunio.
Ton corps fermentera au son des chants grégoriens.
La frontière à nouveau est dans la chair vivante.
Des provinces enragées décrochent leurs cloches
et, faucons de ce siècle, planent au-dessus
les puissants trimoteurs déchirant le matin.
Moscou avance sa guerre, éternelle et hostile,
et sème dans nos sillons ses dures réalités.
Comme la grêle de glace humiliant l’épi,
sa guerre est un cavalier qui rase les villes.
Mais, phalange vigilante, oppose le joug et les flèches
à la faucille qui tranche, au marteau qui écrase ;
pour le combat, frère, tu vêtiras ton habit de fête,
faisant honneur au lignage pur de ta caste.
Et tu retrouveras les voix puissantes
et le geste sûr du javelot ou de l’épée.
Déjà brillent de l’Empire les tours fabuleuses
et sa lune sanglante épouvante les chevaux !
*
Poème de l’antiquité de l’Espagne : Un tank russe en Castille (Poema de la antigüedad de España: Un tanque ruso en Castilla)
Les tanks russes, neiges de Sibérie
sur ces nobles champs espagnols.
Que peut le coquelicot contre leurs huiles froides ?
Qu’oppose le peuplier à leur furie ?
Nous étions encore avec des bœufs et des charrues de bois ;
la Castille n’est pas scientifique ; dans ses terroirs ne pousse pas
l’usine ; sa glèbe produit, comme Athènes,
des théogonies et des oliviers, des batailles, des rois, des dieux…
Pour conquérir l’Espagne, il faut dire, comme le Christ :
« Mon royaume n’est pas de ce monde », et non brandir les faucilles
ni promettre au corps des paradis terrestres,
car en Espagne des voix sortent des tombeaux.
Et il s’y trouve clairement une destinée, rattachée au ciel,
car il s’y trouve généalogie, descendance et oraisons ;
car l’enfant qui naît a deux mille ans
et les bergers commandent avec un geste de rois.
Venez, chars de Russie, mécanisme compliqué,
animaux dépourvus de sang, de femelles et de sueur,
avec un peu de feu comme de qui brûle un arbre,
sur les droits sillons vous serez immobilisés.
Et vous couvriront la terre, la pluie, les insectes,
l’alouette du ciel, les fleurs campagnardes.
Et tandis que votre rouille redeviendra paysage,
la Castille continuera de remplir de Saints son horizon.
*
Catacombes de Saint-Calixte (Catacumbas de San Calixto)
Ceux ici qui communièrent dans le Christ
sous l’épi et ses racines,
humble semence, quand
le poisson et la colombe étaient encore symbole.
Les obscurs frères mystérieux
qui sapèrent les portiques de marbre
et, pour briser les trônes de l’Olympe,
vaillamment s’enterrèrent.
Suave humidité d’ossements et de reliques,
fragile peinture et lampe à huile !
Qui dira à ces graines qu’un jour
la terre éclatera
en efflorescences de hautes coupoles,
décorées de fresques et de cloches !
Là, Cécile, cou tranché,
allume un nimbe sur ses cheveux ;
et les doigts qui caressèrent la lyre
confessent rigides la Trinité de Dieu.
La sécheresse des racines a
ce frais Jourdain, peint en bleu.
Oh, rêver dans la fosse aux morts
le joyeux jardin du Paradis,
plier les ailes d’or des anges
dans la fourmilière sale de la terre !
Dans le tunnel de la taupe, la baleine
mouillée de Jonas ; et dans un ferment
de blés, enterrés, les nappes,
le pain et le vin de l’Eucharistie.
Le crâne de la vierge avec la griffe
du lion et la clameur du Colysée.
Et le diacre, en blanc, avec sa palme.
Et dehors le grand soleil des païens,
la vive lumière des Césars équestres,
les coquelicots des catacombes
sur les os blancs des Papes.
*
La ville sans chevaux (La ciudad sin caballos)
Pour expulser la roue et le cheval
et le bruit, ô Venise,
avec ton fol hippocampe marin,
petit cheval de mer, avec son squelette
de cavalier de jeu d’échecs ; et ces jardins
minimes aux racines
que n’effleurent point les taupes
mais les poissons froids ;
et ces escaliers
de marbre, avec les confettis
d’un carnaval – ton Corpus – vénitien.
Ô terrible république
tenue en l’air,
qui souffles le cristal avec tes poumons
de verre et de miroir ! Pieds d’écume
qui portez les fruits en bateau,
avec tes gondoles
(un cercueil au col de violons),
tes morts dans l’île,
Robinsons de l’os ; et ce masque
avec son poignard et ses délations.
Le Dux, avec son bouffon de jeu de cartes,
va sur son Bucentaure
épouser l’Adriatique ;
ta faune est d’un autre monde,
ton lion a des ailes ;
jamais tu n’as vu les bœufs,
si doux, si attachés à la terre.
Tes chevaux de bronze
galopent dans un pré d’horloges,
de mosaïques et de cloches.
Tu es enluminée, d’or, byzantine,
fleurie de nimbes,
une initiale peinte
par un moine de Prinkipos
ou un missel sur les eaux.
Tes murs sont bateaux, voiles, vent ;
les rames, tes épées.
Tu es à la fois sanglante et délicate,
comme le fragile cristal,
qui toujours blesse.
Silence dans la verdeur de tes canaux ;
seul le grand poisson aux branchies rosacées
se promène dans tes rues la nuit.
Tes rosiers aquatiques
ignorent
le baiser du blanc papillon.
La lune dans les marées
tirera tes rues comme des rubans
(nobles rues sensibles à la lune),
fera gonfler tes places
comme un sein juvénile.
Héroïque sera l’oiseau
qui parvient à tes jardins !
Dis-moi, ville étrange,
le printemps t’arrive-t-il
embarqué ?
*
Ibérie romaine (Iberia romana)
Quand l’Ibérie n’était encore qu’un grand désert d’argent
avec une bordure de bêtes sauvages et des mers de crustacés,
tes légions vinrent, traçant des routes,
des jardins et des théâtres.
Nous étions hommes farouches de la guerre brûlante,
danseurs de la lune aux barbares feux de joie,
et le taureau celtibérique au poisson sur les cornes
mugissait sur les plateaux.
Numance affilait ses dagues de bronze ; dans les coupes
du banquet funèbre fermentait la cervoise,
et un dolmen couvrait le squelette du chef
au diadème d’airain.
Des bisons rougeâtres ornaient encore les grottes
terribles éclairées au moyen d’os de cheval,
et les jeunes filles ardentes, germinales dansaient
au solstice d’été.
Nous étions collés à la boue du Déluge ;
sous la terre brûlait le feu primitif,
et les animaux disparus traversaient encore
le rêve de nos durs anciens…
Rome nous apporta l’arbre fait colonne,
l’assujettissement des sombres instincts au Droit
et la soumission de l’eau sauvage à l’aqueduc,
celle du cri à l’alphabet.
Tu nous donnas la mesure, le nombre, la forme ;
le vers, qui est l’écume du hurlement pendant la chasse,
et tu nous dénudas Vénus, rose de pudeur,
parmi les âpres fourrures.
Tu apportas la comédie, la noble agriculture,
l’araire et la statue, l’éloquence et le vin ;
tu nous donnas des empereurs, et en germe apportas,
occulte, Jésus-Christ.
L’Ibérie, avec ses feux, son sang virginal,
les cavernes de ses songes, de noires mythologies,
antédiluvienne, de vif-argent et de serpents
se sentit secouée.
L’harmonieuse culture du vers et de l’olivier
se fit profonde et douloureuse, mortelle et supraterrestre,
et le Christ saigna davantage dans nos champs
que dans la ville des Césars.
Depuis des siècles nous gardons avec de vaillantes épées,
ô Rome, ta culture contre le danger d’Orient,
et sur trois caravelles les fils de Numance ouvrirent
ton court finistère.
L’Ibérie t’a bien repayé ton sacrifice, Rome,
en te donnant un continent parlant une langue fille
de ce beau latin qui fait que Dieu descend
sur un peu de farine.
*
12 octobre aux Antilles (Doce de octubre en las Antillas)
Ndt. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb posait le pied sur l’île de Guanahani.
Avec une planche et un chiffon3 réalisant des prouesses
et la nuit regardant l’étoile polaire,
l’Espagne entrait ici, déplumant des têtes
et baptisant avec de la nacre au bord de la mer.
Ce fut un beau négoce : pour un perroquet une épée,
et pour de l’or la verroterie qui brille au soleil ;
et l’Indienne nue s’enfuit à travers la forêt, effrayée,
en voyant son visage dans l’eau d’un miroir espagnol.
Ils donnèrent des noms aux choses, comme au premier jour du monde
quand Dieu dit rose, femme, ivoire ;
tout le calendrier chrétien baptisa la route des caravelles,
chaque Vierge d’Espagne eut son île d’indigo.
Ils virent des plages dorées aux palmeraies huileuses
avec des hamacs bleus et le fruit carmin,
et les marmites bouillonnant sur le feu
avec les crânes rongés du banquet sanglant.
Naviguer au hasard de l’aventure espagnole,
la boussole folle mais la foi fixe,
chaque coup de vent une patrie future
et un même langage la plage où ils posaient le pied.
Le sonnet dans la forêt vierge et parmi les serpents le Christ,
la Création aura depuis un « huitième jour »,
car l’Histoire naviguait sur une mer imprévue,
et vont au gré de trois voiles Fray Luis et Platon.
Ils verront le cocotier avec son perroquet irisé
et la hutte cannibale qu’orne un reptile,
et l’Amiral dira que ce climat tempéré
lui rappelle Séville entre avril et mai.
3 Avec une planche et un chiffon : Cette façon de décrire une caravelle, sa charpente et ses voiles, vise à souligner le prodigieux de la chose accomplie.
*
Louis XV (Luis XV)
Louis XV, poudré, essaie des cravates.
La loupe sur la carte, Choiseul lui rapporte
que les Anglais, perdant plusieurs frégates,
ont abandonné les côtes de Coromandel.
On parlera du Québec, et à chaque distinguo
le vieux ministre prisera son tabac ;
il y aura un perroquet de Saint-Domingue
et un page à la turque servant le café.
On ouvre les salons ; les gens conversent ;
la philosophie sourit, à Paris.
La mode est au chinois et au persan,
dans les vitrines triomphe le chien « Fo-hi ».
Voltaire, laid et cynique, se fait courtisan :
décolletés de nacre dans l’auditoire ;
l’as de trèfle dans sa main blanche,
quelque abbé dira qu’il n’y a pas de Purgatoire.
Banquet au Palais, après avoir entendu la comédie
de Rousseau… et bâillements de Sa Majesté.
Une favorite dans l’Encyclopédie
cherche le mot « électricité ».
Les loges se réunissent en secret.
Le tablier maçonnique s’allie aux favorites,
et entre les baisers et la venaison Louis signe le décret
expulsant de France les jésuites.
Le duc passe ses nuits à veiller
parlant de physique ou en transports d’amour.
C’est seulement quand il sentira venir la petite vérole
qu’il laissera sa bonne amie pour le confesseur.
La dauphine blonde attache à ses cheveux
une frégate bouclée avec des fleurs et des poissons.
Le diamant algide irisant son cou
annonce le grand froid de la guillotine.
Le Prince réussit ses caramboles
sur la bille rouge ; cruel crépuscule.
Le perroquet vert de Saint-Domingue
répète le mot « Coromandel ».
La chanson du bohémien et autres poèmes de Felipe Sassone
Felipe Sassone (1884-1959) est un écrivain de nationalité péruvienne qui fit l’essentiel de sa carrière littéraire à Madrid, en Espagne, où il connut le succès comme auteur de théâtre. Il était marié à l’actrice et cantatrice espagnole María Palou, qui joua dans ses pièces et zarzuelas ainsi que pour d’autres auteurs tels que Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, les frères Álvarez Quintero… Sassone et Palou créèrent leur propre compagnie théâtrale.
Felipe Sassone était un ami intime de Francisco Villaespesa, sur la poésie duquel nous avons beaucoup travaillé pour ce blog (voyez par exemple ici, « Les nocturnes du Généralife »), et la poésie de Sassone a clairement subi l’influence de son ami. Les deux se rattachent au courant moderniste introduit en Espagne par le Nicaraguayen Rubén Darío, que Sassone connaissait personnellement et qui fut son maître. Sassone fait partie, avec Federico de Mendizábal (également traduit par nous ici) et quelques autres, de ce que l’on pourrait appeler une école ou un courant villaespésien au sein du modernisme.
Le père de Sassone était italien. Journaliste, Felipe Sassone fut correspondant en Italie pour plusieurs journaux espagnols.
Les poèmes qui suivent sont tirés d’une anthologie personnelle du poète, La canción de mi camino: Todos mis versos (La chanson de mon chemin : Tous mes vers), publiée par la maison d’édition Aguilar en 1954. Dans l’introduction, Sassone explique que, si le sous-titre du livre est « Tous mes vers », il s’agit en réalité d’un choix parmi les poèmes publiés de son vivant, auxquels s’ajoutent des inédits, et il ne souhaite pas reconnaître la paternité des autres. L’anthologie fait tout de même quelque 500 pages.

*
Mon père (Mi padre)
Sous le noble argent de ses cheveux blancs
se dessine serein son profil grec
comme une vivante expression
des vertus lacédémoniennes.
Le geste sobre, la parole énergique,
à la fois bienveillant et fier,
avec l’attitude héroïque d’un guerrier
et la barbe apostolique de saint Paul.
Ô mon père, noble, généreux !
Plût à Dieu que je te visse toujours
fort, dressé comme un vieux chêne,
car je t’aime d’un tel amour sans mesure
que malgré la dureté de mon sort
je t’ai pardonné de m’avoir donné la vie !
*
Villaespesa
Ndt. Francisco Villaespesa (1877-1936) : voyez notre introduction au présent billet.
Sur le front pâle que ronge la pensée,
les cheveux s’inclinent avec langueur ;
noirs comme les ailes du corbeau d’Edgar Poe,
ils confèrent au visage tourmenté la blancheur du marbre.
Le poète mélancolique forge des rimes sentimentales,
pour sa fiancée morte des poèmes passionnés,
et se presse le front dans ses mains ducales,
y sentant palpiter son cœur.
Et ses lèvres murmurent une poésie nostalgique
au beau rythme sonore et musical,
dans laquelle il évoque son Andalousie maure
et pleure les saudades du doux Portugal.
Soudain il s’interrompt, écoutant au loin
le son d’un clavier qu’il distingue confusément
mais qui lui rappelle la musique du piano
où sa fiancée pleurait des nocturnes de Chopin.
Et il reprend la même poésie,
les yeux perdus dans un songe
comme s’ils fuyaient affolés vers le lointain
pour voir le cœur mort de sa fiancée.
« J’ajusterai mes vers au rythme de ma vie. »1
C’est ainsi que le poète exprima l’idéal de son art,
et son ardente muse a une passion
à la fois romantique et sensuelle.
Son imagination exalte les êtres et les choses,
et son vers ailé de troubadour illustre
renferme un trésor de voix mystérieuses,
d’émotions de paysage et de peines d’amour.
Salut, ô salut, poète qui sus rimer
toutes les amertumes de ta souffrance horrible :
comme les élus, tu sus chanter
le chant d’une vie rêvée… sans vivre.
1 Citation d’un vers de Francisco Villaespesa, dans le sonnet « Prélude intérieur » que nous avons traduit ici (tiré du recueil La halte des bohémiens).
*
La chanson du bohémien (La canción del bohemio)
Chante, bohémien, chante !
Le sourire aux lèvres et des sanglots dans la gorge,
libre ton mètre, libre ton rythme,
chante, selon ton caprice, ta chanson !
Porte un toast avec, comme un verre plein de sang, ton cœur !
Que triomphe de la tristesse, bohémien,
le son clair de ton chant ;
chante, bohémien, la beauté,
chante l’amour, la rébellion.
Chante, bohémien, chante,
le sourire aux lèvres, des sanglots dans la gorge !
Alors, le front haut,
et plus haut encore le cœur,
le bohémien impénitent
fit retentir son chant.
Je suis le croisé du rêve, je suis un pâle bohémien,
je sens l’art pour l’art, sans chercher de récompense,
et fou d’idéalisme je hais la raison utile et sérieuse :
je suis le chevalier de la faim, du rire et de la misère.
Bien qu’on entende les lamentations de mon esprit qui pleure,
bien que le prosaïsme de la vie me blesse l’âme,
toujours triomphent les arpèges de mon rire rédempteur,
des roses poussent dans le sang de mes plaies.
J’ai en horreur la routine des formes désuètes,
en horreur le postiche des renommées usurpées,
et sous le rugissement des aristarques, dans l’air vibre, inquiète,
la rébellion sonore de mes rêves de poète.
Un peu iconoclaste, un peu excentrique,
des académies tyranniques mon bon goût m’émancipe
et je poursuis dans le ciel avec une ardeur de visionnaire
les capricieuses volutes que fait la fumée de ma pipe.
Des choses je n’aime que les relations occultes :
j’aime plus que les idées les sensations étranges,
car la pensée est pour le savant mais la sensation est pour l’artiste,
dans la doctrine illogique de mon credo moderniste.
Rebelle, sans abri dans mes nuits d’hiver,
je vague à la recherche d’une forme au loin aperçue ;
je caresse et bénis l’espérance qui me nourrit,
car mon âme rêveuse se chauffe à l’espérance.
J’aime le miracle gothique des vieilles cathédrales,
les lettrines historiées dans les missels,
la musique solennelle des chants grégoriens
et le dévot panthéisme des mystiques chrétiens.
Même si des savants fats, dans leur ardeur scientiste,
plaisantent du mystère et m’ordonnent de ne point croire,
Jésus-Christ fut un bohémien, un poète et un artiste,
douce est la doctrine du Rabbi de Galilée.
Ma subsistance est incertaine, les nuages me font un toit ;
mais je possède un grand trésor d’illusions dans ma poitrine
et je m’enorgueillis d’avoir la vertu et le courage
de pleurer avec mes idées et de rire avec ma pauvreté.
Illusions, espérances sont mon pain de chaque jour
et, douloureux et vaillant, je rêve beaucoup, vis peu ;
mais grâce aux faveurs de mon ardente fantaisie,
si je ne vis point ce que je rêve, je rêve tout ce que j’écris.
Avocat de l’absurde, de l’ivresse et de la folie,
avec mon feutre, qui est mon casque de Mambrin2,
chevalier, je joue sur le rythme de mon vers sonore,
comme ce fou de Don Quichotte galopait sur le dos de Rossinante.
Sans que la rudesse du sort parvienne à me ployer,
car la force de mon rêve est plus forte que ma fortune,
j’adresse mes plaintes amoureuses à la lune,
sur le chemin de la vie, chemin de la Mort.
Je vis seul, pauvre et fier.
Si je ne vis point ce que je rêve, je rêve tout ce que j’écris.
Toujours à la recherche d’une forme
qui doit devenir la règle de mon art ;
l’aimée,
la rêvée,
la toujours poursuivie,
jamais atteinte,
et en lutte avec le sort,
j’erre,
je vagabonde
sur le chemin de la vie, chemin de la Mort.
Sans repos, sans fortune,
j’adresse mes plaintes amoureuses à la lune ;
ma bohème se nourrit
des choses que lui conte
mon imagination exaltée,
et fier de mon rêve, de mon amour et de ma poésie,
je suis un roi en haillons, un picaro ayant de la noblesse ;
douloureux et vaillant, j’attends tout et ne veux rien
car la misère et la faim m’ont adoubé chevalier.
2 Mambrin : Roi maure des romans de chevalerie, que son casque magique rendait invulnérable.
*
La chanson du retour (La canción del regreso)
Loin de toi, chère patrie,
le souvenir t’a rendue plus belle, et mon affection
rêva que cette pauvre terre où je jouais enfant
était la terre promise.
J’aspirai l’odeur nostalgique
de candeur et bonté que tu émanes
et je reviens à toi, patrie où riait mon enfance,
pour verser des larmes d’homme triste.
Et pour faire une halte sur la route
si longue, si dure, si solitaire,
je viens avec mon bâton de pèlerin
chercher un arbre de mon jardin
et l’âtre de mes parents,
deux consolations, d’ombre et de tiédeur,
pour le soleil d’été de mes amours
et pour mes hivers de tristesse.
Dans une nuit bleue, majestueuse,
la baie fut une ligne de lumières,
comme une denture brillante
qui me voyant arriver souriait.
Mais j’abordai à ton rivage et suis peiné
car de loin je t’avais vue plus belle :
nul don ne vaut une promesse,
il n’y a pas de réalité comparable à l’espoir.
Je vague dans la ville, retrouve
ce que j’ai naguère connu,
mais en découvrant dans les visages amis
un air de lassitude qui ne s’y trouvait pas.
Je vois une rue barrée,
une maison à moitié effondrée :
la grille rouillée n’a pas de fleurs
et la belle promise ne s’y montre point !
La vieille maison où je suis né n’est pas à moi,
d’autres en sont maîtres, par un coup du sort ;
elle n’est plus celle qui fit un temps ma joie,
je ne peux plus dormir du même sommeil !
Je ne peux plus dormir car il m’accable
de revivre ma vie de folie ;
mon autre vie, avec les baisers de ma fiancée,
sans vanité ni littérature.
Et je suis triste, et ma mère affectueusement
me répète le saint nom de Dieu,
ma mère qui m’aime comme un enfant,
sans comprendre mes inquiétudes d’homme.
Et mon père, ce père qui m’adore,
puritain, sévère, moralisateur,
souffre, maudit, rougit, verse des larmes
à cause de mon amoral sensualisme d’artiste.
Tout est si différent, pourtant rien n’a changé ;
entre l’hier et l’aujourd’hui s’ouvre un abîme :
sont-ce les gens qui ont changé d’esprit
ou bien mon cœur n’est plus le même ?
C’est que le temps a passé, et son pas
a laissé son empreinte sur les êtres et les choses,
sillonnant de rides un teint de satin,
emportant le parfum de quelques roses.
Il m’a rempli l’esprit de vérités
et couvert la tête de cheveux blancs ;
au fruit vert de mes jeunes années
il a donné la maturité de la tristesse.
La nuit, dans l’obscurité qui m’entoure,
tandis que ma vie s’avance vers la mort,
je pleure sur le passé qui ne revient pas
et je sens que tout espoir s’éloigne.
Tout ce que j’emportais, je ne le ramène pas
de retour dans ma patrie ;
j’ai perdu mon pauvre cœur en voyage
et reste loin encore.
Mon pauvre cœur sans innocence
qui goûta de la pomme biblique
à l’ombre de l’arbre de la science
dans le jardin d’une courtisane.
Et je repartirai, telle est ma vie :
je m’immole à l’inquiétude de mon ambition ;
près ou loin de toi, chère patrie,
je serai toujours triste, toujours seul.
Toujours pleurant à cause des mêmes chagrins,
je soupire pour le Pérou en terre étrangère ;
« Italie » dit le sang de mes veines,
mais ici mon cœur me crie « Espagne ! »
Face à l’inconnu, je marche, décidé
à te revenir quand j’aurai perdu
la certitude d’être fort,
pour attendre dans la prison de ton oubli
la suprême liberté de la mort !…
*
Rosaire de douleur : In memoriam VI (Rosario de dolor: In memoriam VI) [Le dernier de six sonnets]
Morte de mon cœur, morte aimée !
bien que le sort de toi m’ait séparé,
tu es en moi tellement vivante que je crois te voir
sur mon lit d’amour, endormie.
Ne crains rien, non, mon âme ne t’oublie pas :
ton souvenir est si profond, si fort
que tu es toute la vie de ma mort
et tu es toute la mort de ma vie.
Repose en paix sous l’azur serein.
Je resterai triste et resterai bon
comme tu m’aimais, et si à ma porte un jour
frappe le charme mensonger d’un nouvel amour,
je saurai lui répondre, en larmes,
que j’aime une morte.
*
Métempsycose (Metempsicosis)
Ma pauvre âme, éternelle voyageuse,
prisonnière de la boue de ma chair,
à la fois si humaine… et si divine !
et toujours mélancolique et sincère.
Je ne sais quel mystère dirige ses actes
ni quelles tristesses inconscientes elle pleure,
où naquit la peine qui l’afflige,
ce qu’est la flamme d’amour qui la dévore.
Je sais seulement qu’elle est éternelle ; qu’elle a vécu
avant moi, pleuré avant moi,
qu’avant moi elle a joui et souffert
et que je suis la victime de son passé.
Et qu’en métamorphoses capricieuses
elle fut l’âme de choses bonnes et nuisibles,
qu’elle m’apporte aujourd’hui le parfum des roses
et la cruauté mortifiante des épines.
Je ne me souviens pas et nulle science humaine
ne peut me démontrer la vérité
de ma vie antérieure, mais dans la conscience
j’éprouve l’angoisse de son antiquité.
Et je pense au mystère indéchiffrable
de ses incarnations passées
qui pourraient expliquer l’inexplicable
de toutes mes sensations étranges.
…..
Où s’en est allée mon aimée la folie ?
Où ma sensibilité devint-elle malade ?
Où ai-je bu une telle passion pour l’aventure ?
une telle aspiration au bien et à la vérité ?
…..
Mon âme fut celle de Job, peut-être un jour
vécut-elle des heures bibliques et funestes
et rendit grâces à Dieu, pouvant encore
gratter au soleil la pourriture de ses plaies.
Ou bien elle fut guerrière et se couvrit de gloire
quand son corps s’exerçait dans les combats,
et elle fut la vélocité et la victoire
dans la pierre sacrée de David ;
puis, faite lumière et harmonie,
elle vola libre dans l’espace bleu
depuis la harpe où elle fut la musique
apaisant les colères de Saül.
…..
Ou bien elle fut grecque et confère, mystérieuse,
une hellénique dignité d’art à ma vie,
et la luxure animant le taureau
qui fit gémir d’amour Pasiphaé !
Et la délectable fraîcheur de l’eau claire
du lac où, impudique et téméraire,
se baignait une nymphe nue
tandis que Pan guettait, sa flûte à la main.
Plus tard, dans la fièvre de l’aventure,
elle entreprit les exploits de la conquête,
conduisant en Amérique dans sa caravelle
la croix du Christ et l’étendard d’Espagne.
Et comme Cortès brûla ses vaisseaux
et s’imposa, chrétien, espagnol,
mon âme aima une Indienne aux formes suaves
qui parlait quechua et adorait le soleil.
Elle célébra ses libres noces
avec une ñusta3 barbare et brune
parmi les trilles doux des troupiales
et la triste psalmodie de la quena.
C’est pourquoi je sens dans ma boue fragile,
image de ma lignée ancestrale,
l’indomptable férocité de Pizarro
et la douleur d’une reine détrônée.
Ensuite… je ne sais… peut-être… Une lagune
s’ouvre dans le vague de mon souvenir…
Mon âme vola-t-elle aux parcs de la Lune,
et c’est une folie lunaire dans laquelle je me perds ?
Pourquoi, autrement, noctivague et douloureux,
quand les nuits claires sont d’argent,
j’aime la Lune comme une confidente,
nouveau Pierrot d’une autre sérénade ?
Ou bien est-ce que mon âme, perdant son rang,
s’incarna dans le corps d’un animal
et fut un chien, apprenant de lui
à hurler à la lune et à être loyal ?
Ou fut-elle un chat noctambule et sagace
au dos électrique et sensuel
et suis-je sadique à la manière de ce félin
aux griffes contractées pour le mal ?
Ou bien une violette ayant poussé sur le cadavre
d’un homme saint et bon,
ou bien un serpent, héritant de son venin,
de sa sinuosité, de son poison ?
Ou faite ensemble d’ardeur et de fraîcheur
fut-elle lumière dans le soleil et eau dans la mer,
si bien qu’elle reste pleine d’amertume
et que mon cœur brûle comme une forge ?
Tout cela, et plus encore, pauvre âme, tu le fus :
tu volas vers l’azur, tombas dans la boue,
et c’est pourquoi je suis fatigué et triste,
c’est pourquoi je suis si mauvais et si bon !
Parce que tu es venue à moi trop tard,
je ne vis pas seulement du présent :
c’est pourquoi je suis parfois si lâche
et pourquoi parfois si vaillant.
En outre je ne suis plus maître de mes actes
car avant de t’incarner dans mon être,
dans la nuit des temps tu conclus un pacte
avec l’âme qui animait une femme.
Quand tu fus rose, elle fut rosée ;
quand tu fus lumière, elle fut couleur ;
quand tu fus le lit du fleuve, elle fut le fleuve ;
quand tu fus l’arbre, elle fut la fleur.
Elle fut trille quand tu fus oiseau ;
quand tu fus poème, elle fut chant ;
quand tu fus vent, elle fut navire ;
quand tu fus rivage, elle fut la mer.
C’est pourquoi il est forcé qu’elle réponde à ton amour,
c’est pourquoi ta passion est si amère,
il y a en elle la perfidie des vagues
et ton cœur comme la mer rugit.
Mais peu importe, voyageuse éternelle,
prisonnière de la boue de ma chair,
à la fois si humaine… et si divine !
et toujours mélancolique et sincère.
Quand tu fuiras la terre vers les hauteurs
pour réaliser tes rêves visionnaires,
libérée de mon corps, belle et pure,
et que dans les espaces interplanétaires
tu accroîtras l’harmonie des astres,
ton âme jumelle suivra ta trace
et cette sainte que tu adoras un jour
sera lumière avec toi dans une étoile.
3 ñusta : Princesse inca.
*
Le fantôme du maître (El fantasma del maestro)
Pourquoi, dans l’obscurité de la nuit,
revient le fantôme du maître ?
…..
Je ne veux pas penser à lui ;
mais toutes les nuits j’y pense,
j’entends son pas qui se traîne
et son bâton frappant le sol.
Pas et bâton dans la nuit
ont un rythme d’anapeste,
le vers qu’il me censurait
quand j’écrivais un sonnet.
Ah, s’il lisait ces lignes,
le terrible rhétoricien !
Il m’aimait affectueusement
et je ne pus jamais l’aimer.
Il n’aimait pas le vin comme Horace,
dont il aimait beaucoup les vers,
et voulait à tout prix
que je fusse un garçon sérieux.
Il était pénible et insistant
et je ne pus jamais l’aimer !
Pourquoi, dans l’obscurité de la nuit,
revient le fantôme du maître ?
Puisque les morts voient tout,
sait-il, ce mort,
à quel point mon affection était fausse,
de quelle manière je lui payais son amitié ?
Mais aussi pourquoi fut-il si antipathique,
étant si sage, si doux et bon ?
Je n’ai jamais aimé par gratitude,
j’aime seulement à qui je ne dois rien.
Mon cœur sent et ne pense pas,
ma volonté n’y commande point.
Pauvre vieillard antipathique,
pour moi si tendre et doux !
Je lui obéissais sans que l’aimât
le mauvais caprice de mes nerfs ;
je ne sais pas aimer qui me commande,
et ses conseils m’empoisonnent encore.
Pourquoi, dans l’obscurité de la nuit,
revient le fantôme du maître ?
– Que fais-tu ? Quelles bêtises !
Ce que tu écris là ne sont pas des vers !
Ce n’est pas ce que je t’ai appris !
– crie-il, troublant mon silence.
Et j’entends sa voix,
je l’entends et n’aime pas.
J’entends son pas et son bâton
imitant un rythme d’anapeste.
…..
Oh, je ne peux pas vivre ainsi,
je n’en peux plus :
que je meure sur le champ
ou que je tue ce mort !
*
Mon cœur est comme un chien (Mi corazón es como un perro)
Mon cœur est comme un chien
qui la nuit hurle aux fantômes ;
mon cœur est comme un chien
que j’entends haleter sous mon oreiller.
Mon cœur, à la fois sauvage
et humble, comme un chien de garde,
depuis la cage de mes os
surveille toutes mes actions.
Si j’entraîne mon âme vers le péché,
mon cœur m’avertit en aboyant,
et il enfonce ses crocs dans mon corps
pour sauver mon âme.
Mon cœur est comme un chien
qui la nuit hurle aux fantômes !
Mon cœur est parti dans ta poitrine
– c’était un noble chien dans une flaque –,
par le cou tu l’attrapas
car il n’avait pas de collier clouté.
Mon cœur, regardant le ciel
plein de lune dans une nuit claire,
mit une douleur silencieuse et tendre
dans l’humidité de mes regards.
Mon cœur a soif.
Mon amour, qu’as-tu fait de ton eau ?
Mon cœur est comme un chien
que j’entends haleter sous mon oreiller !
Mon cœur suit avec zèle
l’Illusion et l’Espérance ;
mon cœur est comme un chien
qui ne se fatigue jamais.
Mais une voix lui dira : Tais-toi !
Mais une voix lui dira : Ça suffit !
Mon cœur mourra
une nuit au pied de ta fenêtre.
Si son lit doit être un tas de fumier,
la lune lui fera son linceul.
Mon cœur est comme un chien !
*
La tristesse de compter (La tristeza de contar)
Je suis triste et j’ai peur
depuis que j’appris à compter.
J’étais joyeux et vaillant,
ne sachant pas compter.
Celui qui est fort, sain et jeune
ne s’arrête jamais pour compter.
Quand nous cueillons le jour
et que le bon soleil nous fait oublier,
les heures, comme nuages sur la mer,
passent légères sur nos âmes exaltées
qui n’apprirent à compter ;
mais dans la nuit mystérieuse,
quand le silence semble parler,
quand l’esprit est plein de souvenirs
et l’âme folle d’angoisse,
nous nous arrêtons effrayés
et nous nous mettons à compter.
La nuit est tombée sur mon chemin,
jamais le jour n’y reviendra…
Je compte, je compte
et voudrais pleurer !
Mais je ne compte pas l’argent que je gagne
ni celui que je donne,
ni les baisers que portent encore
à mon automne une bouche de fleur ;
je ne compte ni les soupirs
ni les heures d’amour,
je n’ai plus les biens prosaïques du monde
ni le miel que donne l’illusion :
non, je compte autre chose…
quelque chose de pire.
En quel détour du chemin
ai-je perdu ma jeunesse ?
Je la tenais dans mes mains
pour l’offrir à l’amour…
Je la tenais dans mes mains
et de mes mains elle tomba.
Pourquoi ma route rétrécit-elle,
quand si large elle avait de la place pour l’illusion ?
Pourquoi ma route rétrécit-elle,
pourquoi se change-t-elle en sentier ?
Pourquoi est-ce sur le chemin de la mort
que je marche ?
…..
Je compte un à un mes pas,
je compte le tic-tac de l’horloge,
de l’horloge que je ne vois pas mais que j’entends
dans ma poitrine en rumeur sourde,
et l’horloge qui est mon for le plus noble
dit : « Cœur ! cœur ! »
J’étais léger comme l’oiseau,
je savais voler et chanter ;
j’étais fier de mes ailes,
elles ne me servent plus à rien ;
elles volaient haut dans la vie
et tombent dans l’éternité,
tombent jour après jour, plume à plume,
et chaque plume est un jour de plus :
un jour perdu pour le vol,
gagné pour le repos.
…..
Mes plumes étaient légères, blanches,
comme l’écume de la mer !
Je ne sentais pas la rigueur des vagues,
ne sentais pas les jours passer,
je disais à mon âme : « Va tout là-haut, mon âme,
la vie c’est voler… et oublier. »
…..
Je n’oublie plus,
je me souviens,
j’éprouve le poids
des jours ;
ce qui était bleu
est noir, noir…
Je me sens avare
et je compte, compte…
Je compte les larmes
que je verse ;
je compte plein d’angoisse
les pensées
que je n’aurai pas le temps d’exprimer.
Je compte mes pas
et transi
je voudrais qu’ils fussent lents,
car ils m’entraînent
vers l’éternel
et dernier
rêve.
…..
Je compte les jours passés
depuis que je ne suis plus jeune ;
je compte les jours qui me manquent
pour être autre chose qu’un vieux,
pour être autre chose que chair,
pour voler vers d’autres cieux,
pour être moins qu’un homme,
être seulement squelette…
Et mon cœur doit s’arrêter,
heureusement,
quand il se fatiguera de marcher
vers la mort,
doit s’arrêter
en arrivant.
…..
Celui qui est sain, fort et jeune
ne s’arrête jamais pour compter ;
j’étais joyeux et vaillant,
ne sachant pas compter,
et je suis triste et j’ai peur
depuis que j’appris à compter.
*
Congestion cérébrale (Congestión cerebral)
À la mort d’Enrique Gómez Carrillo
Ndt. Le Guatémaltèque Enrique Gómez Carrillo (1873-1927) fait partie de ces écrivains latino-américains, comme Rubén Darío et Felipe Sassone, qui passèrent la plus grande partie de leur vie en Europe. Mort à Paris et reposant au cimetière du Père-Lachaise, il fut le premier mari de l’artiste d’origine salvadorienne Consuelo de Saint-Exupéry, femme de l’écrivain Saint-Exupéry. Dans les paroles que Sassone prête à Enrique Gómez dans ce poème, on perçoit un certain ressentiment envers Consuelo (« ton cœur est plein d’oubli »), Consuelo qui était la femme d’Enrique au moment de la mort de celui-ci et qui devint plus tard la gardienne de la mémoire de son époux français au détriment de celle de son époux guatémaltèque.
Et le maître, qui avait tué le sommeil,
avant de s’endormir pour toujours,
dans les flammes de la fièvre
dit ces paroles incohérentes :
« J’étais un ancien mousquetaire ;
Alexandre Dumas eut six fils :
un, l’amant de Marguerite4,
et de ses mousquetaires j’étais le cinquième5.
La neige dépose son coton sur le sang du crépuscule,
le ciel est mauve et chaud ; mais l’air, glacé.
Sur le carreau de ma fenêtre,
un bout de rue blanche comme un suaire s’est étendu.
De ma terre du Guatemala je vois la croix et le clocher,
je ne vois pas la cloche mais je l’entends, la devine.
Dans le silence du soir,
un chien de bronze pousse un hurlement.
La cloche est une femme,
elle a la forme de tes habits ;
on dirait ta robe,
mais les jambes se sont perdues.
Dis-moi, qu’as-tu fait de tes jambes ?
Ton buste et ton visage, où sont-ils ?
Tais-toi, ne dis pas que je suis fou,
que j’ai des visions et délire.
La cloche est vide à l’intérieur ?
Alors qu’elle est pleine de sons !
C’est ton cœur qui est vide,
car il est seulement plein d’oubli.
Tais-toi, la cloche vient
comme une vague de bronze liquide ;
elle résonne dans l’air
et me baigne dans ses notes.
Sa voix est lumière au crépuscule,
éther musical, lent et tiède ;
elle se répand, elle court…
Quand je serai mort, je veux ce battement,
cette chaude caresse
pour mes pauvres os froids.
Pourquoi es-tu venue de si loin
pour me chanter tes chansons ?
Non ; toi, non ; toi, non ; la cloche !
Tes baisers, non, car ils n’étaient pas à moi,
sur moi ou sur d’autres ils étaient tout le temps à toi ;
tu te donnais des baisers à toi-même, mais ce son,
ce son est seulement à moi,
car je suis le seul à pouvoir le déchiffrer ;
tu te donnais des baisers à toi-même,
je me comprends et sais ce que je dis.
Tais-toi, tais-toi, laisse chanter
la cloche de bronze liquide.
…..
Qui a retiré de la fenêtre la rue blanche ?
Qui a porté le suaire jusqu’à mon lit ?
Le carreau est tout noir.
Arrête, n’allume pas ces cierges.
Donne-moi la croix du clocher ;
donne-la-moi, te dis-je :
je veux porter parmi les ombres
comme une épée le crucifix.
Viens, Consuelo, n’aie pas peur ;
je sais qui tu es et qui j’ai été :
tu es la dernière fleur de mon automne,
moi, Enrique Gómez Carrillo. »
…..
C’est ainsi que le maître, vainqueur du sommeil,
s’endormit pour toujours.
4 l’amant de Marguerite : Alexandre Dumas fils fut l’amant de Marie Duplessis, dont il fit la Marguerite de son roman La Dame aux camélias.
5 j’étais le cinquième : On sait que les « trois mousquetaires » étaient quatre.
*
Rue de ville moderne (Calle de una ciudad moderna)
.
Maisons de cinquante étages,
servitudes colorées,
des millions de circoncis,
de machines, journaux, affiches,
et douleur, douleur, douleur.
Rubén Darío
.
Sous un grand vol d’aéroplanes,
la rue déroule ses bruits ;
la grande rue cosmopolite,
Noirs et blonds, Indiens et Chinois,
tous frères, tous Caïns,
tous distincts.
Des hommes impurs, qui ne s’aiment pas,
traversent le pur air libre,
bleu que l’envie tache de jaune.
Et l’air est plein de voix irradiées,
comme la terre de klaxons,
de sifflements,
de Noirs qui triturent de la musique
et la reconduisent au bruit primitif ;
bruit qui est plus bruit
car il possède un rythme,
est plus insistant et répété,
odieux, comme des assonances à la suite.
Les hommes élèvent des maisons de cent étages
et ne parlent plus aucune langue,
comme dans la Babel du châtiment biblique.
Les hommes ne s’aiment pas
et il semblait que le ciel allait les unir.
Dans mes oreilles vibre cette phonation :
oio, oio, oio, oio !
Dans la cuisine il n’y a pas de nourriture ;
au son de l’orchestre de casseroles
dansent les commensaux délirants,
et les vieilles grenouilles de Galvani
avec leurs pattes en tire-bouchon font des sauts dans le charleston.
Vénus athlétique en maillot de bain.
Des boxeurs ressemblant à des dentistes.
Des dentistes ressemblant à des boxeurs.
Des saxophones jouant au golf…
Oio, oio, oio, oio !
Le sanglier d’une motocyclette
passe en lançant ses grognements.
Les blonds jouent au football
avec la tête d’un Noir :
le pauvre Noir perd ses cheveux,
ses raisins noirs de Corinthe s’éparpillant sur la pelouse.
Fruits peints sans goût, fleurs peintes sans odeur,
gigantesques policemen de cirque.
Chez les barbiers on rase à l’ice cream soda
et l’on boit le savon liquide.
Les hommes ne sont plus ni hommes ni femmes
mais des êtres hybrides ;
elles se sont coupé les cheveux, eux les idées.
Homme et femme ne sont plus différents.
La rue a une lumière noire,
tant elle est profondément enfoncée sous le ciel de plomb.
On voit voler des oiseaux d’acier
et s’élancer des chemins de fer de trois étages.
Oio, oio, oio, oio !
Il n’y a plus de théâtre :
ce sont les photographies des films qui parlent.
Il n’y a plus de musique :
sur les gramophones croassent les disques ;
les hommes ont une voix de femme,
les femmes ont une voix de baryton.
Oio, oio, oio, oio !
Les maisons entassées
jouent aux dés du cubisme ;
les arêtes des coins de rue
coupent comme une lame.
Des couples passent en voiture,
s’embrassent et ne se sont jamais aimés.
Les cœurs sont-ils morts ?
on ne les entend plus battre.
L’air est plein de dérision, de haine,
de convoitise et de mauvais appétits.
Un bruit atroce :
Oio, oio, oio, oio !
Noirs à l’âme noire et au sang noir :
car nous sommes tous égaux, crie le socialisme.
Un cheval romantique passe comme une protestation,
trottant avec un rythme d’alexandrin :
il trotte, chantant avec une grâce rythmique,
rythme vivant, fringant et fier.
Il passe… et le bruit revient :
Oio, oio, oio, oio !
…..
Je ne sais que faire ; je mâche du chewing-gum
en pleurant, complètement ridicule.
*
Tachycardie (Tachicardia)
Sur le mur de la salle à manger, l’horloge
– cœur de la maison –
soumise au métronome du temps,
pas à pas, tic-tac, marche comme un soldat.
Parfois, après un gémissement de ses ressorts
– râle, toussotement ? – sa voix de bronze chante.
Sa chanson est triste,
car c’est la chanson des longues heures.
Mais elle ne chante pas à son gré, seulement quand
la baguette de Chronos le lui commande.
L’horloge de mon cœur va plus vite,
n’obéit pas, et l’émotion la fait sursauter.
Parfois elle bat des ailes comme un oiseau
et le médecin dit que c’est la tachycardie.
Mon cœur est un inquiet et sait
qu’on l’attend de l’autre côté :
ma mère, mon père et mon frère,
tendant leurs mains depuis l’autre rive,
mettent leurs doigts dans l’horloge de mon cœur
et l’accélèrent.
Mais le médecin, qui ne croit pas aux morts,
me dit que c’est seulement la tachycardie.
J’ai une nouvelle famille,
une femme douce et bonne ;
elle me regarde dans les yeux
mais ne voit pas à l’intérieur de moi.
J’ai une nouvelle maison
qui n’est pas comme l’ancienne ;
celle-ci, je la trouvai à ma naissance,
cette autre, je la loue.
C’est en vain que je cherche en elle un coin
où pleurer l’incompréhension de ceux qui m’aiment,
qui prennent soin de la santé de mon corps
et sont bons mais ignorent mon âme.
L’horloge de mon cœur est pressée,
et l’horloge du mur dit les heures longues.
Elles ne vont pas du même pas ;
mais toutes les deux se fatiguent.
…..
Malheur ! quand tous les cœurs du monde
seront atteints de tachycardie.
*
Isabel Flores Oliva, sainte Rose de Lima (Isabel Flores Oliva ¡Santa Rosa de Lima!) [Trois sonnets : complet]
I
Rose Flores Oliva, suave, douce,
nom qui tout à la fois oint et parfume,
divine plume du jardin liménien,
plume d’ailes angéliques et non d’oiseau.
Le vent a l’odeur du miel de ton rosier,
ta candeur frise les écumes du Rimac,
ta lumière céleste déchire notre brume
et du ciel péruvien tu es la clé.
De la sainte de Sienne, Catherine,
tu fis ton modèle, dans tes ferveurs transportée ;
mais autre fut la volonté divine,
qui souhaita que ta pieuse entreprise fût hispanique
et d’Avila t’envoya une hirondelle
avec l’habit et l’âme de Thérèse.
II
Si tu ne fus pas docteur parmi les docteurs
ni ne fis leurs vers ni leur prose,
les insectes, les oiseaux et les fleurs
écoutèrent tes paroles silencieuses.
Jésus fut l’amour de tes amours,
tu cherchas les épines d’une autre rose,
et généreuse tu donnas à mon drapeau
des couleurs de rose blanche et rouge.
Refuge d’infinie consolation,
reine de l’humilité dans la palestre,
soulagement des douloureux et des contrits,
toi, maestra du nocturne rossignol,
minime dompteuse de moustiques,
salut, douce Patronne et notre mère !
III
Étant Isabelle, comme Isabelle de Hongrie6,
la Vierge du Rosaire te fit Rose ;
encensoir de tes propres parfums,
tu répands une séraphique ambroisie.
Ton nom, clair comme la lumière du jour,
fit de ta ville son reliquaire ;
tu auras ici basilique et sanctuaire,
liménienne Rose de la sainte Marie !
Avec ta grâce tu viens à notre secours ;
dans nos poitrines fidèles n’enfonceront pas
leurs dards les péchés capitaux,
mais sept aiguillons de vertu,
sept abeilles qui butineront le miel
de la rose sans pareille de tes rosiers.
6 Isabelle de Hongrie : Isabel de Hungría. Le prénom Isabelle est emprunté à l’espagnol, où Isabel est une altération du prénom Élisabeth sous lequel cette sainte est connue en France, à savoir Élisabeth de Hongrie.
*
Les roses de la guerre (Las rosas de la guerra)
Ndt. Ce poème fait partie d’une série consacrée à la guerre civile espagnole, pendant laquelle Sassone prit parti pour le camp nationaliste, dont il se fit l’avocat depuis le Pérou après avoir échappé à la mort en Espagne.
.
Les fleurs du romarin,
enfant Isabelle,
aujourd’hui sont des fleurs bleues,
demain seront du miel.
Luis de Góngora
.
Les blessures de la guerre,
reine Isabelle,
aujourd’hui sont des roses de sang,
demain seront du miel.
Miel de paix victorieuse,
sainte résignation
de mères qui adoucirent
le sel de leur douleur.
Miel d’abeilles héroïques
qui butinèrent la fleur
triple des trois clous
du doux Rédempteur.
Les ombres de la guerre
demain seront lumière,
par la croix de l’épée
et la divine Croix,
et dans cette Espagne qui naît,
enveloppée de tulle blanc,
sur la terre imite le ciel
chaque chemise bleue.
Les hélices des avions
produisent le tourbillon ;
du tonnerre garde l’écho
la peau du tambour,
et dans la brume dense
de poudre et de bruit,
des aigres clairons
en chantant sort le soleil.
L’Espagne était endormie ;
incube de Satan
fut le sanglant prélude
du réveil violent ;
réveillée, la grande nouvelle
sera portée au monde
dans les cinq directions
des flèches de son faisceau.
Lie dans ta gloire, Espagne,
avec des branches de laurier
le joug de Ferdinand,
les flèches d’Isabelle,
car les blessures de la guerre,
tragique floraison,
aujourd’hui sont des roses de sang,
demain seront du miel.
*
Dernier rêve (Último sueño)
Je rêve mon dernier rêve de poète
car mon destin s’accomplit.
Longue ou courte, la vie est un chemin
qui nous conduit tous à la même destination.
Bien que je connaisse la recette de la vie,
l’envie de m’en servir diminue :
quand manque la force, l’adresse ne sert à rien
pour esquiver la dernière flèche.
L’âme lasse, engourdie,
j’aspire à la mort et dédaigne de vivre,
sentant en moi la jeunesse perdue.
La lutte pour la vie est une vaine entreprise
puisque vivre est seulement rêver la vie,
mourir est s’éveiller d’un songe.