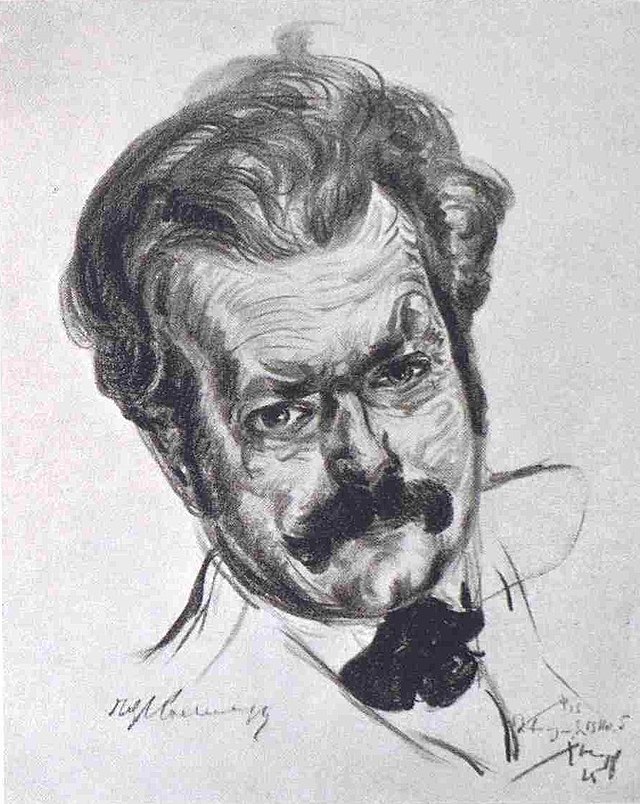Tagged: poésie allemande
La récolte des pommes et autres poèmes d’Eberhard Wolfgang Möller
L’écrivain allemand Eberhard Wolfgang Möller (1906-1972) est l’auteur d’un des thingspiels qui furent joués devant le plus grand nombre de spectateurs : il s’agissait de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Berlin en 1936.
Le thingspiel est une forme de théâtre monumentale de plein air qui se développa au début du vingtième siècle dans le monde germanique. La pièce de Möller représentée aux Jeux de 1936, Das Frankenburger Würfelspiel (Le jeu de dés de Frankenburg), est tirée d’un autre thingspiel, de l’Autrichien Karl Itzinger. Il s’agit d’un drame historique relatant un événement de la guerre de Trente Ans : en 1625, les meneurs des insurgés réformés de Frankenburg en Haute-Autriche furent condamnés à mort mais le stathouder les informa que la moitié d’entre eux seraient graciés suivant le résultat de lancers de dés, deux par deux. Cette macabre parodie de justice conduisit à un soulèvement général connu sous le nom de guerre des paysans de Haute-Autriche (Oberösterreichischer Bauernkrieg).
Si le genre du thingspiel a quasiment disparu, le texte d’Itzinger continue cependant d’être joué de nos jours, tous les deux ans, par pas moins de cinq cents acteurs, à Pfaffing en Haute-Autriche (sur les lieux de l’événement), « sur la plus grande scène naturelle d’Europe » selon les organisateurs. Le texte de Möller pour l’ouverture des Jeux olympiques fut quant à lui représenté sur la scène monumentale de la Dietrich-Eckart-Bühne, étrennée pour l’occasion et qui accueillit plus de 20.000 spectateurs, le maximum de la capacité de cette « Thingplatz ».
Comme le laisse entrevoir le titre du présent billet, les poèmes qui suivent ne se rattachent pas à la veine épique ou historique de ce théâtre monumental. Il s’agit d’une poésie intimiste, terrienne, parfois religieuse, et, dans la seconde partie ici, marquée par les drames humains de la guerre. Elle est de forme classique. Les textes suivants sont tirés de deux recueils, l’un de 1934, l’autre de 1941.
*
La première moisson
(Die erste Ernte, 1934)
.
Chanson d’automne (Herbstlied)
Il fait doux, l’automne
flamboie. Chante haut, mon cœur.
Le soleil est sur le satin bleu
comme une petite bougie pâle.
Ô chante, mon cœur, ta dernière chanson
de l’année. Les choses deviennent plus sérieuses.
De la montagne le berger descend
avec son troupeau rassasié.
De la montagne descend le ruisseau
grossi par les orages,
emportant dans ses tourbillons
tant de feuilles mortes, rouges.
Les nuages n’ont point de repos
et les oiseaux sont partis loin.
Les forêts écoutent la brise,
les champs sont couverts de fils de la Vierge.
Seul reste assis dans le pré,
comme si c’était encore l’été,
un couple d’amoureux,
ayant dans son amour oublié le temps qui passe.
*
Retour en hiver (Heimkehr im Winter)
Quand je partis, c’était le printemps ;
à mon retour, les toits étaient blancs,
le ciel plein de neige,
et les étangs
couverts de glace.
La rue sommeillait
et devant chaque porte se trouvait
du bois à brûler, les lampes
brillaient aux fenêtres
depuis le début de l’après-midi.
Des enfants chantaient, tout respirait
l’Avent et la Saint-Nicolas,
deux vieilles femmes
promenaient leurs petits chiens
gris dehors.
En silence elles regardèrent
l’homme inconnu ;
seuls les petits chiens
s’approchèrent, et de froid
ils se mirent à aboyer.
*
La préparation des gâteaux (Kuchenbacken)
L’aire a été balayée,
les premiers semis effectués,
les feuilles sont tombées,
le gris vent du nord
frappe aux carreaux et dans la cheminée.
Alors nous préparons le pain
pour saint Nicolas,
avec de la farine blanche
et des amandes, de la muscade,
de la cannelle, des œufs, du citronnat,
la brioche aux fruits et
le läckerli de Bâle,
les petites cornes de sucre,
les bretzels et les étoiles à la cannelle,
les quatre-quarts aux noix
et les fougasses aux raisins secs,
les spéculoos
et, avec leur glaçage au sucre,
les gros stollens de Noël
qui doivent longtemps attendre
jusqu’à ce que le saint Christ
soit arrivé
et que les enfants pieux et bons
aient le droit d’entrer.
Pour le moment ils doivent rester à l’écart
et cherchent à deviner
ce que l’on met dans les fours,
ce que mélangent en tintant les cuillères,
et avec leurs petits nez
ils reniflent les odeurs de cuisine.
Mais ceux qui
ont été sages pourront
sur les plaques de four
rompre les croûtes brunes
et sur le bord des saladiers
lécher la pâte sucrée,
et dire si les gâteaux de Noël
sont réussis.
*
Le réveil (Das Aufstehen)
Nous joignons les mains.
Le soleil est à l’est.
Sur les champs encore
le gel du matin.
La table est déjà propre,
la cuisine balayée.
La mère allume le feu
de bois dans l’âtre.
Les enfants, mal réveillés,
engourdis et muets, remuent
le lait dans leurs bols
avec leurs cuillères.
Le père se passe
le dos de la main sur le menton
et ses yeux vont soucieux
de l’un à l’autre.
Il bourre sa courte pipe
de tabac noir, puis
enfile sa veste raide
en cuir
et sort. Les moineaux
pépient sous le toit.
Quant aux poules, elles grattent le sol :
nous sommes depuis longtemps debout.
*
Le tonneau au bord du chemin de fer (Die Tonne am Bahndamm)
Ndt. Dans le passé, le beurre et la margarine se conservaient et vendaient en tonneaux ou tonnelets.
Le tonnelet dans la nouvelle platebande
a été frotté d’ammoniac,
cependant sous ce badigeon, décolorés mais encore lisibles,
on voit les mots « Attention, margarine ».
Il porte cette inscription comme un insigne
du côté regardant le remblai de la voie
et à quiconque passe en train
il se plaint de ce qu’on a fait de sa dignité.
Parfois quelqu’un de retour chez lui
du marché, mangeant son petit déjeuner,
jette par la fenêtre le papier d’emballage de sa tartine,
qui tombe sur la platebande de radis
bien ratissée. On le ramasse alors pour le mettre
dans le tonneau, qui frissonne mélancoliquement.
*
À la clôture (Am Zaun)
Une conversation à la clôture
séparant les deux jardins,
quand le voisin fait brûler
ses vieilles broussailles,
et parler de beaucoup de choses,
quand la main fait tourner le râteau
et que la fumée de mauvaises herbes
monte, haute et mince.
Dans les platebandes,
l’aneth et la marjolaine mouillent les pieds,
et du remblai vient le continuel
bourdonnement d’un chemin de fer.
Et puis le soir tombe, silencieux,
et le monde est bon et vaste.
Dans les buissons le grillon
chante l’infini argenté.
Loin dans le ciel reste
un petit point noir, un ballon dirigeable,
comme si Dieu nous regardait
depuis sa tonnelle.
*
La récolte des pommes (Die Apfelernte)
Le garçon tient l’échelle
sur laquelle est monté son père.
Les platebandes non retournées
sont fumantes de fumier frais.
Le pommier élancé
est tranquille comme un agneau.
Le soir d’automne descend, frais, pâle,
derrière le remblai du chemin de fer.
Le père lève lentement
sa main vers la branche.
La pomme de reinette
tombe dans le sable.
Le père invective son garçon.
Celui-ci a couru
vers la maison
et se moque du vieux.
Dans la pomme est le ver.
La mère la nettoie
et la range dans un tiroir
de son buffet à la cuisine.
*
La besse (Die Birke)
Ndt. Une « besse » est en patois un bouleau ou une bouleraie (plantation de bouleaux). Nous avions besoin d’un nom féminin car Birke est féminin et le poète se sert du genre grammatical allemand pour sa métaphore du bouleau, de la besse comme mariée.
Un cœur tendre doit t’aimer,
petite besse du jardin.
De toutes les fleurs de l’été,
toi seule es restée blanche et jeune.
La terre est moissonnée, affermée.
Seule la sarriette se dessèche, oubliée.
Mais toi tu es comme une belle mariée
et tu attends impatiemment que la nuit tombe
et que des brumes montant du sol
sortent les étoiles et la lune douce,
et que le hérisson qui vit dans le bois mort
s’installe confortablement sous tes branches.
La lanterne solitaire à ta droite
bientôt allumée regarde ta danse,
et avec les derniers amis tu célèbres
tes noces dans les dernières nuits chaudes.
*
Le repas du soir (Das Abendessen)
Apportez les paniers dans la maison,
appelez les enfants et la mère,
apportez le pain, allez chercher le beurre
dans les abris frais du cellier.
Les chèvres ont été traites,
le lait fume dans les tasses.
Ne laissez non plus aucune pomme
d’automne, humide, dans le jardin.
Coupez-les en fines rondelles
ou bien en dés, et là-dedans
râpez soigneusement
les radis frais cueillis,
avant de mélanger le tout en salade
avec de la crème bien épaisse.
Sur le dessus, de la tomate garnit
le plat en parts égales.
Alors asseyez-vous et plutôt que de prier
laissez la porte ouverte.
Si Dieu passe par là,
il entrera chez vous.
*
Promesse (Verheißung)
Ndt. Ce poème et les deux suivants font partie d’une série de « Sonnets de Pâques » (Österliche Sonette).
Avant que la nuit prenne fin
et que le brouillard se lève,
je te le dis, mon cher, tu seras
entré dans la vie éternelle,
et tes blessures comme des roses
rouges écloront,
mais ta tête lasse reposera
sur les vastes genoux de Dieu.
Ce que dans cette vie
tu n’as guère osé penser,
à travers l’espace infini
lancer des racines, des branches
à la manière d’un arbre verdoyant,
le ciel te le donnera.
*
Les anges apparaissent aux apôtres (Die Engel erscheinen den Jüngern)
Ils montèrent à travers les bois
jusqu’en un lieu où se tenaient deux hommes ;
ils secouèrent la poussière de leurs pieds
car le chemin était très sablonneux.
L’un de ces hommes était grand et merveilleux,
comme un arbre sur des jambes humaines ;
il dépassait de beaucoup la taille de l’autre,
un nimbe clair entourait ses cheveux.
Quand ces deux-là demandèrent du feu
pour allumer une pipe de tabac,
ils les regardèrent émerveillés.
Et quand tous furent enveloppés de fumée,
ils dirent que le Seigneur était ressuscité
et que les apôtres devaient l’annoncer au monde.
*
L’incrédule (Der Ungläubige)
Il fit entrer le Seigneur dans sa maison
et lui servit du pain et de la charcuterie,
et, le regardant, il but dans une jatte
pleine de yaourt, y laissant un trou.
Il dit à voix haute ce qu’il voulait garder pour soi :
« Ce n’est pas lui, il ne mange pas comme avant. »
Et il chercha sous la table son orteil
pour voir s’il criait quand on le pique.
Le Seigneur, remarquant tout cela,
alors se leva et se retira sans un mot.
Le sceptique l’appela : « Tu oublies ton chapeau ! »
Et voulut le saisir. Sa main se referma
sur un lacis d’épines qui le piquèrent.
Il vit son sang et resta pétrifié de peur.
.
L’année fraternelle
(Das brüderliche Jahr, 1941)
.
Confession (Bekenntnis)
Je fus comme vous un homme plein de doutes,
l’à-peu-près m’angoissait.
Je n’ai rien vu mûrir, vu beaucoup de choses se rider,
mais mon âme aspirait à autre chose.
J’ai vu que les enfants étaient comme des vieillards ;
j’ai vu que les vieillards étaient éternellement enfants ;
j’ai vu l’étranger s’unir à l’étranger
et l’apparenté se détacher.
Je devinais ce qui transformait ce monde
mais ne voyais pas le monde qu’il deviendrait.
Tant agissent mal qui agissent comme il faut,
et tant sont heureux qui font erreur !
Tant vivent sans être jamais nés !
Tant de ce qui naquit est mort !
Rien ne reste inchangé, nous seuls demeurons stupides
et louons ce qui nous a dégradés.
Nous seuls restons dans les flots de l’incertain
et ne voulons rien avoir à faire avec l’absolu,
et, de nous-mêmes arrachés, nous ne devenons
jamais nous-même et jamais un autre.
*
Ce qui dure (Das Beständige)
Les siècles doivent passer et les peuples disparaissent,
là où étaient des rois se trouvent les broussailles et la mousse.
Ah, qu’est-ce qui tempête dans l’orage, et tombe avec la neige,
qu’est-ce qui chez les plus grands était grand, immortel ?
Est-ce, ô forêts qui sans rien sentir et muettes
avez poussé sur les monts, est-ce la pure Nature
qui, se libérant dans la pluie, se découplant dans l’éclair,
passait continuellement à travers ce qui s’en va ?
Est-ce le ruisseau argenté qui se hâte sans se fatiguer,
ou le jardin bourgeonnant, le rameau du sureau ?
Combien ne vous ont pas demandé, jours du printemps : « Restez ! »
sans que rien ne pût retenir votre impatience.
Nous allons de l’avant sans relâche, un mystère nous entraîne :
ô force de septembre qui pousses aussi les grues cendrées,
doux nuages de la nostalgie qui vous écoulez toujours,
tandis que vous, forêts du pays natal, souriez et restez.
Quand je serai couché sans volonté, ruisseaux, jardins, collines,
accueillez-moi, volatils, dans vos royaumes immuables !
Si vous ne le voulez pas, prêtez-moi des ailes, seulement des ailes,
que je vole au-dessus de vous comme les grues cendrées qui partent.
*
Dédicace (Widmung)
Vous viendrez, mes amis, et repartirez
le cœur joyeux, j’espère. En attendant,
la forêt continue de murmurer. Les chansons les plus tendres
se chantent au printemps, quand les cressons fleurissent
et les mauves dans les jardins. Ils saluent encore,
les lointains sommets aimés où nous allâmes
pour sur les vallées amicales à nos pieds
jeter un regard réjoui, dans les années heureuses.
Ah, elles ne sont point taries pour vous, les sources célestes,
et les années heureuses n’ont point passé en vain,
même s’il ne vous en reste que les images, dans une rapide
succession. Les présents de la vie ne sont pas autrement.
Car ce qui dure reste dans la pensée
et même les dieux, que l’on n’oublie pas,
viennent dans l’habit des souvenirs
là où nous sommes souvent allés, sur notre route.
*
La nuit est claire (Die Nacht ist hell)
La nuit est claire et brille comme un lac,
et de blancs nuages y nagent comme des cygnes.
Sèche, ô sèche tes larmes, mon amour ;
car le trèfle embaume les prés.
C’est à nouveau l’été, près de la source
habite le ver luisant sur la mousse irrorée,
et, pâle, belle comme un nénuphar,
la lune aimée de nous éclôt haut dans le ciel.
Sur toi aussi se répand sa douce lumière,
sur toi aussi s’étale une mer d’étoiles,
et quelle que soit la distance entre nous
le même été nous couvre tous les deux.
Notre amour n’est-il pas assez grand
pour traverser la distance
sur les ailes de rossignol de la nostalgie
et nous ramener l’un à l’autre ?
Ne rend-il pas cet été plus beau que jamais,
le vœu qui s’est réalisé dans les étoiles ?
Apprends, mon amour, apprends à espérer :
car le trèfle embaume les prés.
*
Bill
Le voilà qui court dans ces hautes, belles prairies
du ciel où d’autres comme lui batifolent,
il gronde contre les grandes étoiles dorées
qui telles des chiens inconnus souhaitent le renifler.
Il peut gambader à sa guise
sur ces montagnes que nous appelons des nuages,
sans se fatiguer faire la course
avec les oiseaux et les bourdons.
Il peut attendre impatiemment le soir,
quand les cerfs viennent au bord des forêts,
que Dieu sorte de sa pommeraie
et l’appelle pour la promenade.
Alors il prend sa balle et sa laisse
et conduit le Seigneur à la limite des nuages,
d’où l’on peut voir en bas, et il jappe
vers nous, pauvres humains qui pensons à lui.
*
Le mourant (Der Sterbende)
Il était couché sur une carriole,
je voyais sa bouche ;
il tremblait doucement sans se plaindre,
comme une femme en train d’accoucher.
Son corps était sanglant, ouvert,
c’est de la mort qu’il accouchait ;
une trace de sueur perlait
au milieu de ses cheveux en bataille.
Ses yeux tournaient en silence,
comme s’ils se reprochaient sa souffrance.
Un camarade pleurait doucement à ses côtés
et toutes choses pleuraient avec lui.
*
Complainte de jeune fille (Mädchenklage)
Je vais toujours, vais en silence,
comme si je te cherchais,
mais je ne te trouve pas.
Tu es dans le noir,
et le monde est trop grand, trop vaste
pour les fatigués et les aveugles.
Tu es comme une pensée
que l’on rêve et qu’on oublie bientôt
et qu’on veut retrouver.
Ah je pensais à toi
cette nuit funeste
où ils t’ont enterré.
J’allai vers ton cœur
quand il se brisa cette nuit-là,
je voulais te rejoindre.
J’ai couru, couru sans m’arrêter,
j’aurais tellement voulu
te prendre par la main.
À présent je ne cesse d’aller, muette,
en cercle autour de moi,
car je t’entends gémir.
Mais ce n’est peut-être que le vent,
car les yeux de ma fenêtre
sont couverts de larmes.
*
Bienheureuse Certitude (Selige Gewissheit)
Qu’est-ce que la patrie ? Un lopin de terre ?
Une forêt, une route, une pensée amicale
pour un domaine aux vrilles de mûres,
aux jeux d’enfant près de l’âtre maternel ?
Est-elle dans le geste plein de flamme de la jeunesse,
dans le souvenir nu, dépouillé des ancêtres morts,
conservé pour nous d’une longue querelle
pour qu’il soit à nous ?
Ô bien plus que cela ! Ceux qui durent mourir
pour sa gloire, ont su ce qu’elle est.
Ils gisent sous sa bonne garde
et sont sûrs et bienheureux. Car ils ont su
que, si le valet meurt en vain, nous autres
avons un peuple qui n’oublie pas ses enfants.
*
Les morts (Die Abgeschiedenen)
Nous vous saluons depuis ce silence profond,
comme une mare couvert de nénuphars.
Muets sont le rossignol, la grenouille et le grillon,
et celui qui n’a pas de corps n’est qu’un flottement.
Et ce n’est qu’un glissement de lumières blanches
quand nous volons dans la brume à travers la nuit.
Alors nous vous voyons avec des visages de verre
couchés dans vos lits comme les morts.
Et nous vous saluons. À la vie oubliée
le jour vous rappelle, le jour nouveau, identique.
Mais nous ne sommes plus, nous, et nous pouvons flotter
sans mémoire et sans regret.
*
À mon frère tombé au champ d’honneur (An meinen gefallenen Bruder)
Es-tu poirier ou bien un hêtre,
un bois de bouleaux, une petite feuille de lierre ?
Je te cherche, mon frère, je cherche
la chose en quoi Dieu t’a changé.
Ton âme est-elle attachée à une image,
est-elle quelque chose de vivant, un objet ?
Je veux l’aimer telle que je la trouverai,
et même si c’est une pierre elle m’est proche.
Est-ce un brin d’herbe, une grappe de lilas ?
Je veux demander au soleil de te dorer
de tous ses feux en chaque être
qui ressemble à ton être.
Je veux m’apitoyer sur le petit scarabée
qui s’extrait tant bien que mal de ta sépulture,
la croix de bois, le sable, je veux les embrasser,
bénir l’oiseau qui chante au-dessus de la tombe.
Oh tu es une pensée qui, quand nous la pensons,
nous conduit au-delà des limites terrestres,
alors je voudrais m’absorber en elle si profondément
que je te retrouverais dans la pensée de Dieu.
*
La visite (Der Besuch)
Le dimanche, quand glissent les nuages blancs,
je suis parmi vous. Vous ne me voyez pas.
Je suis l’ombre sur vos fenêtres,
dans laquelle votre vie se réfléchit.
Je m’assois invisible sur vos chaises.
Quand le jardin rougeoie et devient silencieux,
je suis la brise qui rafraîchit vos fronts
et l’abeille qui bourdonne autour de vous.
Je suis dans le grand arbre les feuilles des branches,
le crépuscule vert de vos heures vespérales,
les paroles du père, le sourire de vos invités
et la sévère politesse de ma mère.
Je suis l’appel du soir qui remplit les cœurs
d’impatience et d’une douce inquiétude.
Et puis je m’envole dans le clignotement de vos chandelles,
dans le pas léger des amants,
dans la chanson des merles aussi, depuis leurs nids,
et quand la tendre, la nuit vient,
je suis sur la gorge de ma sœur
un collier qui la rend plus belle.
*
Les transfigurés (Die Verklärten)
Mais un jour nous deviendrons légers
et le vent nous emportera,
nous monterons aux domaines de lumière
où les étoiles louent le Créateur.
Et où il y a un tintement éternel
de météores rapides ;
nous serons libérés des ténèbres
et renaîtrons plus heureux.
Nous n’aurons plus de corps, sans poids
comme des nuages, et nous passerons
sans fin devant les astres
en argentines mélodies.
*
Ceux qui ne connaissent que le quotidien (Die nur das Tägliche kennen)
Ceux qui ne connaissent que le quotidien
ne connaissent pas l’éternel ;
leurs âmes brûlent
mais ne brillent pas.
Ceux qui ne veulent que le quotidien
n’ont jamais connu Dieu ;
ce qu’ils bâtissent avec des pierres,
ils l’élèvent sur du sable.
Ceux qui ne servent que le quotidien
n’ont ni but ni étoile ;
pour eux la fatigue est proche,
mais l’accomplissement est loin.
Ver Sacrum : La poésie d’Erwin Guido Kolbenheyer
Erwin Guido Kolbenheyer (1878-1962) est connu pour des romans historico-philosophiques mettant en scène des philosophes ou penseurs célèbres, à l’instar de Giordano Bruno (Giordano Bruno. Die Tragödie der Renaissance, 1903), Spinoza (Amor Dei, 1908), Jakob Böhme (Meister Joachim Pausewang, 1910), Paracelse (dans sa trilogie Paracelsus, son œuvre la plus renommée, 1917, 1922, 1926). De formation philosophique, il exposa sa vision du monde dans le livre Die Bauhütte (« Les bâtisseurs de cathédrales », 1926, publié dans une version remaniée en 1952) et d’autres textes de moindre étendue développant sa « métaphysique bio-naturaliste » (biologisch-naturalistische Metaphysik).
Sa poésie, le plus souvent de forme classique, occupe avec son théâtre le huitième volume de ses œuvres complètes, publiées par la Kolbenheyer-Gesellschaft en 1961. La partie consacrée à la poésie connaît en outre une édition à part sous le titre Lyrik.
En tant que poète, Kolbenheyer paraît influencé entre autres par Rainer Maria Rilke. Je l’écris à mon corps défendant car je ne suis pas un grand admirateur de Rilke, traducteur de Valéry et adoptant les mêmes tendances que ce dernier, sur lesquelles je me suis exprimé dans mon essai « L’art poétique sophistique de Paul Valéry » (voyez ici, ou, pour le Pdf, ma page Academia). La poésie de Kolbenheyer se rapproche de celle de Rilke par l’hermétisme, ainsi que par une certaine coloration « philosophique », ce qui n’est guère étonnant compte tenu de ce qui vient d’être dit de ses romans.
L’opinion de Thomas Mann sur Rilke, qui parlait de lui comme d’un « archi-esthète » (Erz-Ästhet), est évidemment infirmée par la dimension intellectualiste de cette poésie mêlée, car un archi-esthète ne peut être que celui dont l’œuvre est purement dans la sphère esthétique, tandis que Valéry et Rilke à sa suite ont au contraire introduit l’abstraction de la sphère dianoétique et ses moyens dans l’esthétique pure, adultérant les moyens propres de celle-ci et mettant fin à l’archi-esthétisme du modernisme poétique, auquel cette qualification s’applique seul. – Que l’on défende le recours à de tels moyens dans la poésie est une chose, mais qu’on décrive ce procédé comme de l’archi-esthétisme relève d’un aveuglement profond sur la nature de la poésie et de l’esthétique, lequel aveuglement ne s’explique que par le fait qu’il s’agit du jugement d’un auteur principalement de romans, et que la poésie est la seule littérature pure.
Ces réserves faites, ce qui peut rendre, de deux arts poétiques constitués sur de tels fondements post-modernistes, l’un meilleur que l’autre, c’est la qualité de la philosophie qui s’y trouve. Celle de Rilke consiste en la vaine tentative, comme chez Valéry, de rendre profond l’optimisme.
Les poèmes qui suivent, traduits pour la première fois en français, sont tirés du volume Lyrik, présenté ci-dessus, dans lequel les textes apparaissent sans indication de dates. Je les soumets dans l’ordre où je les ai trouvés, selon une constante pratique de cette série de traductions.
*
Le matin (Der Morgen)
Toi, rose de tous les instants,
lasse des parfums qui te voilent,
à peine détachée des étoiles,
ô floraison éveillée par la rosée,
comme je suis plein de ton
désir cristallin
de recevoir le soleil
depuis l’intarissable pureté.
Verse ton aube légère
dans mes feux obscurs,
qu’une prière éclose
sur l’étendue de mes mains !
Rose de tous les instants,
lasse encore de tes voiles,
penche-toi sur nous, libérée,
toi la plus pure bonté du ciel.
*
Déambulation bénie (Wandersegen)
Alors vous êtes à moi. Et les noms qui vous furent donnés,
inessentiels, n’ont plus cours.
Fleuve, vagues des collines, forêt, rochers,
et village et vallée, soyez-moi visage !
Nul bruit ne nous sépare. En doux poème de printemps
allez et venez et donnez-moi une vie de paix,
bénissez mes pas dans le bonheur de la marche.
Chantez la douce chanson de la mélancolie,
depuis les lointains, le tintement primordial :
nous étions un, autrefois ! Jamais
la détresse de s’épanouir ne revient sur ses pas – le chef-d’œuvre
qui nous conquiert devient éternel battement d’ailes !
Restez-moi, et à moi, en cette aurore,
dans l’attente, ouverts, un épanchement
de pressentiment dans la forme – un fluir ensemble.
Vous ne connaissez ma détresse, je ne connais la vôtre.
Posséder devient une chaîne, parole et droit deviennent la mort.
Que l’odeur des prairies au printemps soit notre loi.
*
Heure lasse (Müde Stunde)
La ronde des moustiques danse encore dans la lumière…
Un appel ! Un oiseau ! – C’était un cri d’alarme.
Comme si toutes choses reposant déjà dans le sommeil et le silence
avaient été effrayées par le hasardeux du réveil.
Rien – ce n’était rien. À travers les branches des sapins
le soleil filtre encore ses rayons cléments
et couvre de sa toile les diurnes visages.
Les coupes du rêve se remplissent.
Et la volonté se replie dans la pénombre,
me reconduit au halo de la lampe.
Merci, mon jour. Sois le bienvenu, silence :
berce mon cœur. Il se recueille – il est prêt.
*
Avant-printemps (Vorfrühling)
Oui, tout est prêt pour la fête,
entrouverture pleine d’attente.
La profondeur du tapis verdit la robe pâle,
les collines lointaines, couvertes de brume,
encore sérieuses, déjà promettent un souffle délicat,
tendre dans le rougissement des bourgeons.
Sur la glèbe repue incline le panache,
l’impatiente touffe printanière du noisetier
pleine de vert-doré suspendu, sa frondaison.
Suave, somptueux, le sang rayonnant du soleil
penché sur la terre illumine la fraîcheur humide,
comme si frémissait déjà dans les beffrois célestes
à toute volée un badonguement de cloches –
pourtant tout reste enveloppé de rêve, reste attente.
Du ciel bleu et clair fleurit,
comme l’ouate d’une voile vers l’ouest,
la lune, blanc nuage, encore éteinte.
Et tel qu’un salut de l’année accomplie†,
avec un battement d’ailes continu, silencieux,
un sombre essaim d’oiseaux vole vers les nids.
† l’année finie : L’année calendaire commence au milieu de l’hiver (1er janvier), mais l’année du cycle des saisons finit avec l’hiver et commence avec le printemps.
*
Pluie d’été (Sommerregen)
Elle tombe comme une vie, la pluie d’été.
Et sa musique résonne sourdement, ancienne,
pour que sur les parterres, les chemins au repos,
dans l’haleine de la maturation le fruit s’éploie.
Et avec elle résonnent les heures gardées secrètes,
tout remords expié. Elles devinrent légende :
dans l’étang noyées et muettes, disparues,
depuis longtemps détachées des cris de joie et des lamentations.
Mais elles remontent au grand jour, comme si n’était pas chantée faux
la chanson qui depuis longtemps voulait avoir disparu,
et la cloche ne s’est pas amortie
qui devait en annoncer la paix.
La vie tombe comme une pluie d’été.
Réveille-toi une fois encore dans l’herbe qui pousse
au parterre endormi sur le bord de chemins abandonnés !
Il est un désir qui brûle toujours et ne veut s’éteindre.
*
Recueillement (Einkehr)
C’est l’heure : en bleuissant, la lumière pâlit.
Dans la neige est étendue silencieuse – visage endormi –
la terre. Au-dessus de son rêve s’allume
l’étoile gardienne, qui ne connaît ni désir ni douleur.
Et toute chose s’ouvre à la profondeur.
Le batelier de la lune fait signe depuis sa barque d’argent.
*
Baume éternel (Ewiger Trost)
Sur ta douleur tout entière
pulse une danse étincelante de lumières.
Autour de la sanglante couronne d’épines de ton cœur,
des étoiles silencieuses tissent l’oubli,
agissent et tissent en éternelle clarté.
Dans les profondeurs de la nuit d’étoiles
donne repos à ton cœur frémissant.
Une constante élaboration couvre toutes les blessures,
éteint la flamme, rompt sa puissance de mort.
Crois, tes pères ont souffert comme toi.
*
À mon vieux noyer (Meinem alten Nussbaum)
Au-dessus de tes racines profondes,
qui trouvèrent il y a longtemps le sol
qui ne s’assèche : une terre
jeune que tu ne convoites point.
Les esprits silencieux de tes feuilles
tombent sur elle chaque année,
comme la bénédiction de mains généreuses
qui se passent de remerciements.
Et dans ta vaste couronne,
comme une douleur dissimulée avec art,
meurt éventée par la sombre frondaison
ici et là une branche lasse.
Une branche que plein de désir
nostalgique tu tendais autrefois vers le ciel.
Beau avec mesure et bienveillant d’ombre,
au soleil comme sous la pluie tu donnes
la réponse de ton être silencieux.
Et c’est comme si tu attendais,
encore en fleur, encore en fruit,
la venue de l’ultime orage.
*
Le pays de ta jeunesse (Jugendland)
L’heure vient, que l’espace de tes ailes
hardiment s’éploie à travers le vaste monde,
l’heure approche : au bord du ciel brillant d’étoiles
apparaît le pays de ta jeunesse, un rêve de paix,
et entre lui et toi – un champ en friche.
Où est ton grain ? Gaspillé un peu partout.
En pays étranger il a poussé pour faire du pain étranger.
Les gelées ont presque brûlé la tenace mauvaise herbe.
Ton champ veut le repos. Du dernier thym
une haleine lasse. Et la patrie te manque.
Ta joie et ta douleur, tu ne les entends plus !
Une rumeur de source plus profonde en couvre le bruit.
Murmurent-ils encore dans ton sang, les bouleaux de ton enfance ?
Si hardi que tu sois, sagace, éprouvé, vieux –
tu entendras la source. Tu restes son fils.
*
Roses tardives (Späte Rosen)
Si épanouie que soit votre floraison – je ne vous crois plus.
Le vent balaie la jaune course froufroutante
autour des niches de mon chemin. Froid et vide
demeure le jour. Mais vous, vous osez flamboyer.
Vous, mes roses, qui êtes là comme les heures
inabouties de ma jeunesse,
comme si la pression du sang ne pouvait s’atténuer –
et qu’était vrai éternellement ce qui n’était que rêves.
Vous, menacées par le givre, tendez-nous votre abondance !
À deux mains je vous saisis et presse
contre vos langues de feu mon visage.
Mon souffle secrètement las ne me trahit point.
Ne faites qu’éclore ! Croire me devient-il difficile ?
Vous ouvrez une chose emportée par le vent, que je ne peux oublier.
*
Éternellement nouveau (Ewig neu)
Enfant, mon cher enfant,
dois-tu des mêmes tourments
si sauvages, insensés
colorer les rayons de ton matin ?
Écoute mes paroles d’ancien,
regarde-moi, j’ai souffert,
me suis jeté par-dessus bord aussi,
engagé dans le bruit et la lutte
non pour triompher, non pour une récompense.
Pour me sentir, oser être moi-même,
j’ai voulu supporter la douleur, les sarcasmes amers,
les blessures sans victoire.
N’était-ce pas assez ?
Te faut-il tout recommencer ?
Ce qui m’a rudoyé te rudoiera-t-il ?
N’ai-je rien pu gagner pour toi ?
Rien, si ce n’est le sillon
que le vent a donnée à la graine :
porteur seulement, aile seulement,
pour la vie originaire.
*
Le pays natal (Der Heimat)
En silence, ô mon pays, salut,
mille fois salut, vallée de mon enfance !
Loin et seul, je sais que tu es à moi
et as longtemps attendu le fils qui revient
et reste pour toujours et se repose et – se repose pour toujours.
*
Élégie du sapin de Noël (Christbaumelegie)
Ndt. En Autriche et dans le sud de l’Allemagne, on appelle Christbaum, c’est-à-dire arbre du Christ, le sapin de Noël.
Arbre du Christ, enlève ton habit de paillettes,
redeviens humble et vert.
La charmante nuit de Noël est finie,
le monde restera couvert de neige
quelques semaines encore puis refleurira.
Trois rois ont descendu la rue,
tu as vu l’étoile briller
et perdu quelques centaines d’aiguilles.
Le poêle menace, sépulcre de tes scintillements :
encore une fois il te faut étinceler.
Pour la turbulente Christel, la petite Ulla,
tu chaufferas chemisettes et bas.
Ton odeur de forêt bénira la pièce ;
tu seras un véritable arbre du Christ
jusqu’à la dernière bûche.
Alors les tourbillons du vent prendront
au sortir de la cheminée ta dernière volute
et porteront cette odorante fumée de sapin
haut dans les nuages, en action de grâce,
au cher enfant Jésus.
*
L’arbre perd ses feuilles (Baum im Entblättern)
Des feuilles qui tombent, de la pluie verticale
les branches libérées se tendent vers le ciel,
elles connaissent la floraison, la maturation et la bénédiction,
sentent l’orage et remuent à peine.
Elles ont porté ce dont d’autres ont joui,
dans le confort de l’ombre beaucoup de nids reposaient.
Mais déjà les bourgeons couvrent un croît futur,
en sommeil pelotonné dans la ramure dévouée.
Les sèves insistantes déclinent, se dérobent.
Dans le cercle des forces, du sang jusqu’au fruit,
elles consolident sous l’obscurité de l’écorce
la niche circulaire et fermée des saisons.
La vie, c’est donner à pleines mains capables !
Ainsi grandissent la frondaison, les racines
sans remerciements ni regrets. Une pieuse prodigalité
fonde le mur, couvre le pays et la maison.
*
Il neige (Fallender Schnee)
Que peut-il y avoir de plus doux, chute bénie !
Nul souffle, toi seul dans ce flottement descensionnel
depuis la blanche clarté. La vie écoute craintive
sur la terre les cieux pieusement moutonner.
Autour des troncs nus s’étendent les sombres couronnes
qu’enveloppe ce duvet mou, de plus en plus épais,
elles qui berçaient, joyeuses de soleil, l’abondant
murmure des feuilles et des fleurs, les bourdonnements et les ailes.
À présent le silence devient bonheur. Pris d’une envie de dormir,
le buisson et la haie attendent, tandis qu’augmentent grâce et clarté.
Été, printemps, automne, dissous en rêve, écument,
la mort et la vie sont au giron obscur suspendues.
Mon visage vers le ciel, assoiffé de lumière !
Laisse les flocons par milliers toucher ton front, tes mains
et faire monter des larmes chaudes à tes yeux ouverts ;
laisse le plus pur des baisers mouiller tes lèvres chaudes.
*
Observance (Heiligung)
Ta paix est tout entière dans le travail constant,
un Moi ne peut apaiser la suprême nostalgie.
Tout le courage de croire, toute la force de l’humanité
est dans l’agir, délaissée la volonté.
La volonté banquète. À ses rêves laisse-la.
L’acte plein d’amour ouvre les portes.
Ouvre-toi ! Laisse joyeusement déborder,
et ton moi craintif deviendra Soi.
Apprends seulement à oublier demain.
C’est de plus loin que vient le cœur.
Mesuré à l’étroitesse de l’heure,
nourrir le désir de créer est un fardeau.
Dans le Tout jette ton libre Mien,
et dans toute étendue cherche-toi.
Du seul silence non rédimé du cœur
ce qui t’est le plus propre t’irradie.
*
Ver Sacrum
C’était plus encore, ce que vous avez donné,
offert à votre peuple,
comme la fleur dans le verre d’une divinité dévorante,
c’était plus que votre vie.
Car en vous reposait,
pas encore délivré mais dans une force germinale en attente,
ce que pour des milliers d’âmes assoiffées
aurait pu le plaisir, le rafraîchissement, le baume
dans la libération de votre œuvre future.
Une fois seulement, seule et en chacun de vous,
elle serait éclose, comme une bénédiction. Et ceux qui l’auraient reçue
dans la profondeur la plus vivante, la profondeur de la nostalgie,
mille fois auraient auprès de vous gagné
une vie lumineuse dans le bonheur,
plus riche.
Ce plus haut point donné à l’homme, dans la lumière,
dans la nécessité et la joie de créer,
vous l’avez sacrifié à votre peuple, car la lumière vous a quittés,
votre œuvre future.
Ce qui depuis longtemps grandissait en vous,
pressenti, conservé, promis,
ne peut plus vous être compté :
non accompli, manqué, perdu
avec vous.
N’est plus à vous.
Vous n’êtes devenus pour nous
qui vivons encore à la lumière
rien d’autre qu’une trace effacée.
Vous êtes le signe de la loyauté,
de la vie créatrice à venir.
Votre sacrifice est une image
de cette foi la plus sainte.
*
Élégie viennoise (Wienerelegie) [Traduction de trois poèmes sur cinq]
III
Vers toi battait mon cœur comme une source contenue,
sans but mais sachant que de la roche éclatée
le clair courant s’accomplit,
est consacré, Université !
Précoce ardait mon optimisme, une impulsion à peine soutenable
pressait mon pouls jusqu’à la douleur, exacerbait mon souffle :
tu étais libération et salut
plus que rêve, Université.
Jamais pied plus intimidé ne foula le seuil de ton aula,
jamais cœur ne battit plus désireux de ton remède ;
tu t’ouvris, découvris
dans l’exaltation ton sein maternel.
Partout où dans sa quête fébrile mon esprit chercha et trouva,
ton domaine m’offrit un bonheur en germe
et la connaissance s’ouvrit comme une plante
et je me reconnus.
Pays de l’éclosion heureuse, ton éclat rayonne toujours
sur moi dans la vallée qui s’assombrit. Mes yeux sont
toujours dans les tiens, même quand
ta bouche reste silencieuse, amère dans l’accomplissement.
Il y a longtemps que je suis retourné chez moi. Je semai mon automne
à poignées dans ton champ, un son de ton souffle,
et j’accomplis la nostalgie.
Elle reste à toi, Université.
IV
Comme presse mon désir, si chaud de sang et jeune !
Comme si ces années lointaines devaient,
d’ici jusque là-bas saut d’un instant,
à nouveau s’épanouir au matin.
Le flux précipité d’une rue se tait,
noyé derrière de vieux portails,
au Herrenhof un mendiant joue sur son violon
un air à moitié effacé, ivre de souvenirs.
Et dans les rangées de maisons abandonnées –
d’un baroque fané, pâle –
le vieux Steffl grisonnant invite à l’intérieur,
silencieux et placide comme les ancêtres.
Il sait ce que c’est, quand le temps et l’esprit
passent de la jeunesse à l’âge mûr,
mais cernée de pierre une cloche
a gardé le même son.
Le son de son premier âge de cloche,
encore sourd du flux brûlant de la fonte.
Comme s’élance dans la vaste splendeur
sa voix, l’appel d’un géant !
La tour en tremble. La cloche vrombit.
Le changement constant – est oublié.
Rêve et renoncement, expiés et réconciliés.
Seule la nostalgie vibre neuve et sans mesure.
Elle porte une floraison si chaude de sang et jeune,
comme si devaient ces années lointaines,
d’ici jusque là-bas saut d’un instant,
à nouveau s’épanouir au matin.
V
Toujours jeune et belle, comme le premier amour,
te vois-je, source de la vie éclose,
car le monde s’est ouvert à moi ainsi qu’un pays de Cocagne,
Vienne de ma jeunesse.
Je fus étranger dans le regard des autres,
leurs saluts restaient étrangers partout où j’habitais.
Seule la vallée de mon enfance, par-delà les années,
me salue comme tu le fais.
Trois fois a verdi la victoire dans l’essor de la vie,
trois fois les lauriers et la couronne :
instinctivement la vie du destin ancestral a germé –
sans savoir –, l’enfance.
Hardie, elle attend la plénitude de son héritage,
pour lequel son optimisme s’est lancé dans la tribulation de son peuple,
cet optimisme de la jeunesse, qui la première tresse la guirlande
de l’amour créateur.
Temps bénis de la patrie de notre enfance, en maturation !
Espérant sans rêve, oui, s’éveillant du rêve,
pour l’homme doit s’accomplir le franchissement de ce seuil ultime
au-delà du bonheur.
Enfance : enveloppée de lumière, un nuage matinal,
absorbée dans la totalité, le don du pressentiment…
Jeunesse : bouche éveillée près de la source murmurante,
annonciatrice de vie…
Coiffant d’un feuillage sombre : dernière des couronnes…
Tu contraignis tête et cœur à l’action,
tu fus la première à élever à la vérité la source de la jeunesse
devant ma conscience.
Éternellement jeune et belle, comme le premier amour,
jeune seulement car tu es l’amour et – loin de toi
ma nostalgie fleurit pour toi qui as réalisé mon destin,
Vienne de ma jeunesse.
*
Tu dois faire un bout de chemin… (Du sollst ein Wegstück…)
Tu dois faire un bout de chemin avec moi,
regarder mon étoile et la tienne
haut dans notre ciel
tissant des rayons merveilleux.
Mets ta main dans ma main,
lève les yeux, oublie le sable rude
et la brûlure de tes pieds !
Nous voulons du courage.
*
Si dénuée de grâces… (Mag sie ungesegnet scheinen…)
Si dénuée de grâces qu’elle paraisse
en ses fatigues quotidiennes à l’intérieur d’un cercle étroit,
ce n’en est pas moins la meilleure façon
d’unir nos vies.
Le monde a beau se détruire lui-même,
misère, affliction dans les rues sévir,
un foyer nous est resté
et tu dois en faire un cadeau de Noël.
Si ce ne sont des exploits
mais de petits soucis sans fin,
sans louanges, de nos mains
s’écoulent nos plus grandes faveurs.