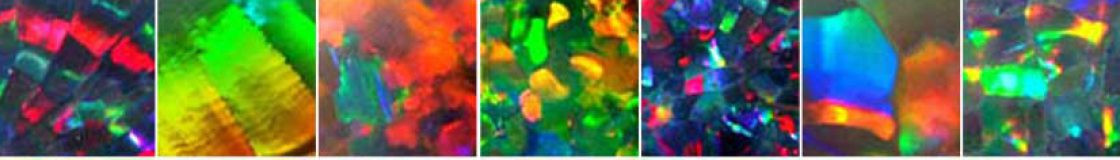Tagged: António Ferro
N’était la mer : La poétesse Fernanda de Castro
Fernanda de Castro (1900-1994) est, avec Florbela Espanca et Virgínia Victorino (traduite par nous ici), un grand nom de la poésie féminine portugaise du siècle précédent. Elle fut l’épouse de l’écrivain Antόnio Ferro, qui, après avoir édité en 1914 la revue Orpheu, l’organe influent de la dénommée « génération Orpheu » comprenant en son sein les noms aujourd’hui les plus fameux des lettres et des arts portugais du vingtième siècle, fut pendant plus de quinze ans le « monsieur culture » de l’Estado Novo salazariste (en tant que « Secrétaire national à l’information et à la culture populaire » de 1933 à 1950) ; je vois dans cette donnée biographique la raison – à caractère idéologique – pour laquelle Fernanda de Castro est inconnue en France.
Descendant par son père de l’« Architecte en chef » du royaume du Portugal au dix-huitième siècle, João Frederico Ludovice (né Johann Friedrich Ludwig), elle était par sa mère d’un lignage de brahmanes indiens, de Margao dans la région de Goa, colonie portugaise jusqu’en 1961. De son mariage avec Antόnio Ferro sont issues plusieurs figures intellectuelles, leurs enfants, le philosophe Antόnio Quadros et les femmes de lettres Rita Ferro et Maria Ana Ferro, et parmi leurs petits-enfants la femme de lettres Maria Gautier ; cas singulier d’une dynastie intellectuelle d’origine brahmanique au Portugal. Cette filiation est évoquée dans le poème « Atavisme » ci-dessous (où l’aïeul brahme est dit « bouddhiste »).
Fernanda de Castro reste de nos jours une figure respectée de la littérature portugaise. Un dossier spécial lui a été consacré par la revue littéraire Nova Águia du deuxième semestre 2020, pour les cent vingt ans de sa naissance, avec la contribution de nombreux auteurs.
En 1969 elle publia une anthologie de son œuvre poétique, en deux volumes, Poesia I-II. Les textes du présent billet sont tirés du premier tome. – « N’était la mer », du titre de l’un des poèmes traduits, parce que l’âme portugaise est celle d’une nation maritime, qui eut un outre-mer avant tous les autres pays européens.
.
Photo : Fernanda de Castro e Antoninho Gabriel, par Sarah Affonso, 1928. Il s’agit d’un portrait de la poétesse avec son fils, qui deviendra le philosophe Antόnio Quadros. Sarah Affonso était l’épouse du peintre Almada Negreiros, le grand nom du modernisme pictural portugais, membre de la « génération Orpheu ».
*
Danses de ronde
(Danças de roda, 1921)
.
Méditation (Meditação)
Parfois, quand la nuit tombe
lentement, paisiblement,
je m’assois à la fenêtre et suis des yeux
la courbe mélancolique du couchant.
Je ne veux pas allumer. Dans la pénombre
on pense davantage et l’on pense mieux.
La lumière blesse les yeux, éblouit,
et je veux voir en moi, mon amour.
Pour faire mon examen de conscience
je veux le silence, la paix, le recueillement,
car c’est ainsi seulement, pendant ton absence,
que je parviens à libérer ma pensée.
Je cherche alors à supprimer en moi
l’influence néfaste qui domine
mes nerfs fatigués ; mais à la fin
je reconnais que t’aimer est mon destin.
Loin de toi je m’enhardis à penser
à cette force étrange qui m’enchaîne,
et j’ai la sensation de la haute mer
dans une sauvage nuit de tempête.
Tu as dans le regard des magies de prophète
qui sait lire dans les cieux, la mer, les braises.
Tu le devines, je serai le papillon
qui voyant la lumière se brûle les ailes.
Pourtant je ne me plains pas, ne déplore pas
cette volonté qui s’impose à la mienne.
Je ne me révolte pas, je cède à l’enchantement
– esclave qui ne sut être reine.
*
Ville en fleur
(Cidade em flor, 1924)
.
L’esplanade (O aterro)
Ndt. L’Aterro da Boa Vista fut un chantier urbanistique majeur de Lisbonne au dix-neuvième siècle. Il s’agit du terrassement de sols boueux au bord du Tage. Sur cette « esplanade », comme nous l’appelons dans cette traduction, fut bâti un long boulevard, l’avenue du 24 juillet.
Le long de ce quai, énorme et mal fréquenté,
du Tage aux troubles eaux boueuses,
s’étend le marché.
Sur le bord,
ce sont des luttes violentes,
et sanglantes,
dans les mille tavernes du quai.
Fatales, éternelles,
les luttes pour la vie,
le vin, l’amour,
la douleur
déforment des crânes déjà grossiers.
Et il y a des visages noirs et des mains crochues
dans les bouges.
Ce gamin-ci, aux yeux profonds,
déjà sait larronner
et fait des gestes immondes
à qui passe devant lui.
Et cet autre qui va par-là,
cigarette à la bouche et casquette de côté,
est déjà maître dans l’art d’embobiner.
Et cette fillette ingénue
aux gestes timides,
quelle vie a-t-elle menée !
De retour de la Ribeira,
une poissonnière ambulante,
silencieuse, sculpturale,
a des mouvements agiles de sardine,
sent le sel.
Voilà que retentit le sifflet d’un train,
secouant la torpeur du chemin de fer,
immobile, endormi.
Macrocéphales, bilieux, les tramways
passent sur les rails rigides et géométriques.
J’entends un cri de boniment,
et le timbre, extraordinaire,
me fait penser
aux vers de Cesário†.
Un vieux clocher sonne midi
au-delà de Pampulha.
Sur les docks,
le fleuve a sommeil,
et clapote.
Le marché est à présent
un monticule de détritus,
où passe une vieille sorcière
traînant ses os.
Sur le quai, la marée tire avec force,
tente d’arracher la boue,
mais elle n’est jamais parvenue à l’emporter tout entière
et les eaux restent couleur d’argile,
et sur les murailles de pierre croît le tartre.
Ingénue et jolie,
seulement une note :
au loin, sur le Tage,
un vol de mouette.
† Cesário : Le poète Cesário Verde (1855-1886), qui peignit de la campagne et de la ville des tableaux passant pour plus réalistes que ceux des poètes antérieurs.
*
Le marché (O mercado)
– Béni soit le Soleil ! On dirait une orange
qui fait couler son jus !
– dit la femme de la baraque,
en regardant le soleil en face.
Et je songeai : À quoi sert d’être poète ?
– Hé là, attention ! ne m’écrasez pas les fruits !
Elle ne regarde pas ses pieds parce qu’elle porte un chapeau !
Et je pense, résignée :
Tant de brutes
sous ce ciel clair et lumineux !
Je traverse des rues de légumes,
cela donne envie de boire tant de fraîcheur.
– Mademoiselle, s’il vous plaît ? –
alors surgit de derrière un panier
une fraîche et jolie fleur humaine :
– Oui, madame, voulez-vous prendre le reste ?
Mince, flexible comme un roseau,
elle a le visage rond, un petit nez aquilin,
et à force d’habitude cette jeune femme
a pris la couleur des fruits et des corbeilles.
Par un étrange et curieux mimétisme
qui rend leur apparence plus gracieuse,
les paysannes qui vendent leurs légumes
sont fraîches, estivales comme des fanes de navet,
et sentent le thym, la menthe.
Des poissonnières, dans leurs gais habits,
empressées, sveltes comme des yoles,
portent leurs paniers à travers la ville
telles des bateaux voguant le vent en poupe.
Des laitières sentant la crème, sentant le lait
sont descendues de la sierra, dures et farouches,
penchées sous le poids des pots.
Villageoises sans le moindre fard
qui ont sur la peau l’odeur des pâturages
et passent avec grâce, balançant leurs cruches.
– Les bonnes fraises mûres ! elles sont de Sintra !
Moins cher ? Non pas ! Quelle grippe-sou !
Et sur les fleurs, les fruits et les femmes,
le soleil devient plus doux, plus doré.
Épars dans l’air flottent mille plaisirs
et chaque regard réfléchit, passionné,
ce paganisme ardent du marché.
*
Jardin
(Jardim, 1928)
.
Un grand amour (Um grande amor)
Un grand amour ne tient pas dans un vers
de même qu’une vie ne tient dans un jardin,
que Dieu ne tient dans l’Univers,
ni mon cœur en moi.
La nuit est plus petite que le clair de lune
et le parfum est plus grand que la fleur.
La vague est plus haute que la mer.
Dans aucun vers ne tient un grand amour.
Dire en vers ce que l’on pense,
idée de Poète, idée folle.
La plus longue phrase ne peut suffire,
le baiser dit plus que la bouche.
Personne ne doit raconter son secret.
Les vers d’amour doivent être faits seulement
comme les oiseaux chantent dans les arbres,
comme les fleurs se baisent au jardin.
Quel vers incomparable, infini,
fait de soleil, d’éclat mystérieux
pourrait dire ce qu’avec un cri
la femme dit quand lui naît l’enfant ?
Et quand sur nous descend la tristesse,
comme la pénombre sur le jour,
une larme triste et sans beauté
dit plus que la froide parole nue.
Poème d’amour… pour l’écrire
que Dieu me donne l’encre du clair de lune,
la lampe suspendue d’une étoile,
l’immense encrier de la mer.
*
Soleil de Paris (Sol de Paris)
Pâle, imberbe, frileux et blond,
ce soleil de Paris,
bel et jeune et drapé d’or,
ne semble pas heureux.
Il traîne par les rues le dégoût
de son ennui sans fin.
On voudrait lui passer sur le visage
un peu de carmin.
Il y a je ne sais quelle nostalgie glacée
dans son regard distant.
Il traîne avec lui toute la neurasthénie
du long boulevard.
Il voit ses poumons se désagréger en sang,
aspire de la cocaïne,
et les taches violettes de son corps exsangue
sont des baisers de morphine.
À midi déjà sa poitrine malade
s’arque de fatigue.
Et il lui faut encore, avant de voir la fin,
traverser l’espace.
Lumière de Paris, anémique, épuisée
par tant de sensations :
l’herbe des jardins, fraîche et mouillée,
te fait mal aux poumons.
Soleil de trois heures, soleil dolent et blond,
déjà face à la mort.
La rue de la Paix, dans ses vitrines, a plus d’or
que toute ta cour.
Soleil de Paris, tu pâlis tout
ce sur quoi tes lèvres se posent :
les miroirs, les bijoux, le velours,
les roses et les femmes.
Cette lumière, grisâtre et sans chaleur,
qui te donne des tons de vert-de-gris,
te porte aux lèvres une fausse couleur,
tu dois avoir beaucoup de fièvre.
Cinq heures de l’après-midi. Cette lente agonie
m’affaiblit et me rend triste.
Le soir est à présent funèbre, couleur de cendre.
Le Soleil s’endort dans la Seine.
*
Communion (Comunhão)
Comme un oiseau fou, chante la cloche.
L’encens est comme un voile,
une auréole enveloppant chaque sainte.
Ce matin a saveur de ciel.
L’église est tout entière un grand autel,
et chaque autel est un brancard de procession
où les saints et les roses vont ensemble.
Ce matin a saveur de fleur.
C’est l’heure où l’hostie approche.
Les voiles de communion
sont plus blancs que la farine.
Ce matin a saveur de pain.
Dieu ceint d’un long, doux embrassement
la multitude fidèle.
Une saveur de printemps flotte dans l’air.
Ce matin a saveur de miel.
Dans la pénombre de l’église l’hostie bénite,
comme un phare lumineux,
arrache à l’obscurité la foule grise.
Ce matin a saveur de soleil.
Au sol s’effeuille le genêt à profusion,
la lavande des bois.
L’émotion monte à fleur d’yeux.
Ce matin a saveur de fontaine.
C’est l’heure où la foi, dans la communion,
expulse les pharisiens.
L’église à présent est tout entière un cœur.
Ce matin a saveur de Dieu.
*
De ce côté de l’âme et de l’autre
(Daquém et dalém alma, 1935)
.
Atavisme (Atavismo)
I
D’une aïeule blonde, pâle, innocente,
plus claire que la clarté même,
qui aimait en Jésus-Christ l’Humanité,
et qui mourut sans histoire, humblement…
D’une aïeule blonde, fragile et dolente,
plus chaste que la chasteté même,
qui d’un geste apaisait la tempête,
et qui aima sans délires, chrétiennement,
j’héritai les yeux clairs, sans péché,
toute une tradition, tout un passé
d’innocence, d’amour et de pardon,
un désir de paix, de vie calme,
une âme capable d’être seulement âme,
et mon douloureux cœur humain.
II
D’un aïeul mystérieux et fataliste,
aux gestes rares, au regard lointain,
qui vit arriver aux terres du Levant
les hordes européennes de la conquête…
D’un aïeul qui fut noble et fut bouddhiste
depuis les yeux jusqu’à la soie de son turban,
et voyait mourir, à dos d’éléphant,
des crépuscules d’opale et d’améthyste,
je reçus la couleur sombre de la cannelle,
l’étrange indifférence de la gazelle
qui meurt, en pardonnant, sans un cri,
je reçus des gestes et des croyances d’autres temps,
un respect sacré pour les animaux
et la volupté de la mort et de l’Infini.
*
Poème de la maternité (Poema da maternidade)
« Ce n’est pas possible ! Je ne veux pas ! Je ne consens pas !
Tout en moi se révolte, la chair, l’instinct,
ma jeunesse, mon amour,
ma vie en fleur !
C’est un mensonge ! Un mensonge !
Si mon enfant respire,
si mon corps consent,
mon âme ne le veut pas !
Je ne veux pas être mère ! Il me suffit d’être femme !
Il me suffit d’être heureuse !
Et mon instinct dit :
c’est fini, fini ! À présent renonce,
ta nuit commence, ton jour est terminé !
Tes vingt ans ? Envolés ! Ta jeunesse
a perdu sa flamme et sa chaleur, perdu son âge.
Résigne-toi. Tu es femme. Dieu l’a voulu ainsi.
Tu étais fleur, à présent seulement racine.
Cela ne se peut ! Mon sort est injuste,
je ne veux pas donner la vie à qui m’apporte la mort.
Je refuse de souffrir. Ma jeunesse
me demande horizon et liberté.
Mon destin doit avoir un autre lustre !
Je veux vivre ! Et je meurs, je meurs…
Mon enfant !
Ce n’est pas possible, Jésus ! Je ne mérite pas tant !
Enfant de ma douleur, je ne pleure plus, je chante !
Parce que, Seigneur,
il n’y a qu’un seul mot : amour, amour, amour !
Donnez-moi une autre voix qui n’ait jamais dit
de mauvaises choses, des choses viles, et qui ait saveur d’Infini.
Donnez-moi un autre cœur, plus pur, plus profond,
car le mien s’est brisé au contact du monde.
Donnez-moi un autre regard, qui n’ait jamais regardé,
ne possède ni présent ni passé.
Donnez-moi d’autres mains car les miennes ont touché
la vie et la mort, le bien et le mal, et ont péché.
Mon enfant, pourquoi ? En venant à moi,
tu as changé en jardin
les épines de ma triste chair.
Et comment es-tu parvenu
à peindre de soleil les heures les plus sombres ?
Mon petit, dors, dors,
et laisse-moi chanter
pour écarter
la vie, cet énorme croque-mitaine.
Allons jouer maintenant…
Avec quel jouet, mon petit ?
La mer, le ciel, cette rue ?
Je t’ai déjà donné mon destin,
je peux bien te donner la Lune.
Voici un bateau, un cheval,
une étoile, la mer sans fond.
Tu trouves encore que c’est trop peu ? Laisse ça !
Si tu le veux, je te donne le monde.
Pourquoi ne veux-tu pas jouer,
pourquoi préfères-tu pleurer ?
Jésus ! Qu’a donc mon fils ?
Quelle vie étrange brille
en ses yeux ?
Une vie inquiète et sombre
que je ne lui ai pas donnée
est en train de brûler sa fraîcheur.
Aujourd’hui encore, mon fils, tu n’as pas souri
et ton regard est triste,
tu as l’odeur de la nuit, du deuil, du vert-de-gris…
Seigneur, mon fils a la fièvre,
son souffle est brûlant, son regard, incandescent !
Lui dont la respiration sentait l’œillet
et qui avait un regard d’étoile ou d’émeraude,
il a maintenant dans la bouche un goût amer
et sent la nuit, le deuil, le vert-de-gris…
Seigneur, mon fils a la fièvre !
Retirez de mes yeux le ciel et la lumière,
délivrez-moi du blasphème… Dieu, Jésus,
car si mon fils meurt, s’il agonise,
pourquoi y a-t-il sur la terre des fleurs qu’il ne foule point ?
Si je dois le déposer dans une fosse, à genoux,
pourquoi les astres sont-ils si hauts ?
Seigneur, je suis coupable, je sais ce qu’est le péché,
mais lui, mon Jésus, n’a pas vécu.
Pour moi il n’est point de maux que je n’accepte,
mais lui, si près de ton ciel encore !
Sa vie a consisté à boire mon lait…
Dans le regard dont il me regardait il y avait un voile
de brouillards, de brumes d’autres vies.
Parfois il avait les paupières baissées
et se mettait à pleurer contre mon sein,
avec la nostalgie, peut-être, du ciel, de l’espace.
Ô mon fils a la fièvre !
Pourquoi entends-je chanter sur les chemins ?
Pourquoi y a-t-il des berceaux et des nids ?
Vie ! Mon fils était beau,
mon fils était fort !
Vie, quelle mère es-tu ? Défends-moi de la mort !
Vie, Vie, Vie…
Loué soit Dieu ! La mort s’en est allée,
tu n’as plus de fièvre !
Mon petit enfant vit,
cet enfant à moi, à moi seule !
Et mon petit enfant pleure, et je peux chanter !
Et mon petit enfant rit, et je peux pleurer !
Et mon petit enfant vit et toute la vie chante,
toute la terre est une gorge fraîche et sonore !
Que tout le monde le sache, que toute la terre le voie !
Dieu soit loué !
Qu’il soit loué !
*
Solitude (Solidão)
J’avais peur de la solitude. Je craignais
de me trouver face à face avec moi-même,
et je me résignais à vivre contente,
ne pouvant vivre heureuse.
Je voulais beaucoup de gens autour de moi,
partageais en minutes ma journée,
cherchant l’illusion d’une joie
que je désirais tant, en vain.
Mais bientôt je compris que la solitude
était de n’avoir personne dans le cœur,
alors cherchant un autre but à mes pas
je fis de la vie un chant plus profond
et peu à peu limitai le monde
à la courbe réduite de mes bras.
*
Trente-neuf poèmes
(Trinta e nove poemas, 1941)
.
L’île (A ilha)
Sur une carte de continents inconnus,
avec des forêts de rêves et d’étoiles
d’où jamais n’approchèrent les caravelles
des routes maritimes fréquentées,
sous le soleil tropical des climats chauds,
il est une Île avec des colombes et des gazelles,
des lits d’aromatiques ombelles
et des jardins de pommes et de serpents.
Bronzée et parfumée, mon Île
sent la cannelle, le santal, la vanille,
elle a la Lune et le Soleil dans sa peau sombre,
et ses pierres brûlent comme des braises.
Ah, qu’attends-tu ? Allons-y, si tu as des ailes
et as soif et faim d’Aventure.
*
Exil
(Exílio, 1952)
.
Exil (Exílio)
Je sais où je suis née : dans cette rue
d’arbres morts et de vieilles maisons
où je fis mes premiers pas
et où mes ailes puériles, timides
se changèrent peu à peu en bras.
Mais que m’importe ? Je me sens perdue
comme quelqu’un qui s’est perdu dans une vie d’enfant,
et je sais que ma vie est une autre vie,
je sais que je ne suis pas moi, que je ne suis pas moi !
Que je viens de plus loin, du pays reculé
qui flotte entre le rêve et la réalité,
que jamais mon enfance n’eut de patrie,
que mon âge n’eut jamais d’âge.
Que mon pays, s’il existe, est comme la quille
d’un bateau qui demande inutilement
une impossible île inconnue
baignée par une mer inexistante.
Et pourtant je suis née dans cette rue
d’arbres morts et de vieilles maisons
où je fis mes premiers pas
et où mes ailes puériles, timides
se changèrent simplement en bras.
*
Arôme, essence, pollen, harmonie… (Aroma, essência, polen, harmonia…)
Moi qui aime seulement les vieux vêtements,
les vieilles maisons aux murs obliques,
les poussières ancestrales, les cendres mortes,
les roses et les rouges décolorés ;
moi qui aime seulement les vieux domaines
aux agrestes rosiers mal arrosés ;
les rideaux de dentelles ajourés
par de vieux doigts dans de vieux dés ;
moi qui aime seulement les vieux tiroirs,
les vieilles malles pleines de satins défraîchis,
de soies, de rubans, de parfums oubliés,
éventails, missels, bouquets de violettes ;
moi qui aime seulement ce que nul ne convoite,
ors de soleil, argents de brume,
filigranes de fleurs sur les plates-bandes,
feuilles détachées que disperse le vent,
écume des marées, coquillages vides,
scintillations d’étoiles, cieux distants,
gouttes de rosée – frais diamants,
chants de bulots – vertes mélodies ;
moi qui ne demande à Dieu que les restes
des humaines ambitions et des vains partages,
continents de clair de lune, îles rêvées,
nuages de fumée que ne désire personne ;
moi qui n’aime que la rude symphonie
du vent libre, et les doigts de velours
de la pluie sur les toits de ma rue,
arôme, essence, pollen, harmonie,
moi qui n’aime rien, j’aime tout :
j’aime la Poésie.
*
N’était la mer ! (Não fora o mar!)
N’était la mer,
je vivrais heureuse dans ma rue,
au premier étage de ma maison,
en voyant, de jour, le Soleil et, de nuit, la Lune,
silencieuse, tranquille, sans coup d’aile.
N’était la mer,
mes pas seraient comptés,
tant pour vivre, tant pour mourir,
et tant de mouvements des bras,
petite angoisse, petit plaisir.
N’était la mer,
mes rêves seraient sans violence
comme des bulles irisées de savon,
cristal éphémère, transparente apparence,
et le reste – gouttes d’eau dans ma main.
N’était la mer,
ce cruel désir d’aventure
serait musique vague au crépuscule
et non braise vivace, une brûlure,
à peine plus que le parfum d’une fleur.
N’était la mer,
le long appel, le chant de la sirène,
serait seulement une illusion, un mirage,
brève chanson, courte promenade sur le sable,
balbutiant désir de voyages.
N’était la mer,
résignée, au lieu de regarder les étoiles,
tout ce qui est haut, inaccessible, profond
– sommets, châteaux, tours, nuages, mâtures –,
je marcherais dans le monde les yeux baissés.
N’était la mer,
mon chant serait fleur et miel,
aile de papillon, rossignol,
et non rude hallali, serre cruelle
d’aigle royal défiant le Soleil.
N’était la mer,
ce poulain sauvage, sans arçons,
la crinière au vent, sans harnais,
mon cœur altier, indomptable,
n’était la mer, mangerait dans la main,
n’était la mer, accepterait le frein !
*
L’oiseau bleu (Pássaro azul)
De la cage dorée
la porte était fermée.
Oiseau bleu, quel crime noir fut le tien !
Tu t’es posé sur une fleur,
tu as bu la rosée,
et bleu dans l’azur
tu fus un petit ciel dans le grand Ciel.
Oiseau bleu, le nuage ne te l’a donc pas dit ?
L’âme des hommes est mesquine et plate.
Des oiseaux bleus le monde rit.
Que lui importe l’arabesque d’une aile ?
*
Âme, Rêve, Poésie… (Alma, Sonho, Poesia…)
J’entrai dans la vie
avec des armes de vaincue :
l’âme, le rêve, la poésie.
Quand je chantais
le monde riait,
mais peu m’importait :
je chantais.
Un jour,
le monde jeta des pierres contre mon chant
et mon âme se déchira.
Qu’était-ce ?
Peur, effroi,
révolte ou simplement douleur ?
Quoi que ce fût,
l’orgueil fut plus grand.
Avec dix poignards dans les ongles effilés
et dans les yeux bleus deux épées,
jamais, plus jamais je ne serais
celle qui entre dans la vie
avec des armes de vaincue.
Mon vouloir fut alors plus profond :
moi d’un côté, de l’autre le monde.
Et j’engageai la lutte inégale
du tigre et de la gazelle.
Elle fut vaincue.
Mais quels lauriers reçut de cette victoire
le monde aveugle et brutal ?
Le sang des Poètes ? Triste gloire…
Des cendres de rêves morts ? Maigre fruit…
Ah, non, épées et poignards !
Je veux seulement chanter ! Je ne veux pas d’ossuaires
ni, sous les pieds, un sol de tombes rases.
Je veux seulement chanter ! Je veux seulement mes ailes
et ma mélodie :
Âme, Rêve, Poésie.
Âme, Rêve, Poésie.
*
Oiseau de nuit (Ave da noite)
Ô sorcière noire, noire et belle,
voici mon corps, prends-le dans tes bras.
Peut-être que mes fatigues se termineront enfin,
ô noire sorcière, noire et belle !
Je ne te vois pas mais te connais : tu es longue et courte
comme la fumée que le vent répand et disperse.
Ton habit blanc est un brouillard
en forme de suaire.
Personne ne connaît ta voix
mais dans le silence tu touches
cloches, cithares, harpes, violons
de tes doigts sans phalanges.
Fille de la nuit, pâle, spectrale,
aile noire d’oiseau de la Lune.
Lac aux eaux vertes,
ton visage nu.
Tes yeux, des puits profonds ; et, tout au fond,
une astrale phosphorescence
de commencement du monde.
Tes pieds, furtives fleurs silencieuses.
Tes bras longs, longues nébuleuses,
blancs rayons lunaires.
Le long de tes doigts
il y a des sortilèges et des peurs.
À travers le silence des sphères,
m’appelle ta bouche sans lèvres.
Oh ce doux, ce vénéneux appel
de sirène de glace !
Ô ton haleine de soufre, émanation
de cratères éteints,
de printemps morts.
Musique silencieuse ton pas léger,
un lent tomber de neige
sur les feuilles d’automne.
Et de tes yeux aveugles
coulent le venin et le miel du rêve aimé.
Depuis les blanches brumes liliales
viens de ton pas court, irréel,
ailée, immatérielle, tranquille et forte.
Viens avec tes longs bras, viens,
ô mort, ô ma mort,
viens !
.
.
Photo : Portrait de Fernanda de Castro par Tarsila do Amaral, 1922. Tarsila do Amaral est une artiste peintre brésilienne, membre du « Groupe des cinq » avec l’artiste Anita Malfatti et les écrivains Menotti Del Picchia (voyez nos traductions ici), Oswald de Andrade et Mário de Andrade, figures séminales du modernisme brésilien.