Le sablier sournois et autres poèmes de Lionello Fiumi
Le poète italien Lionello Fiumi (1894-1973) fut un acteur majeur des relations culturelles franco-italiennes de son époque. Établi à Paris de 1925 à 1940, il y fonda en 1930 la Société Dante Alighieri, le réseau de ces sociétés étant l’équivalent italien des Alliances françaises à l’étranger. De la Dante Alighieri de Paris il fut secrétaire général jusqu’en 1934. En 1932, il fonda la revue Dante : Revue de culture latine, qui dura jusqu’en 1940.
Il fut responsable de deux anthologies de littérature italienne contemporaine en traductions françaises, en 1928, Anthologie de la poésie italienne contemporaine, et 1934, Anthologie des narrateurs italiens contemporains. Il existe de sa poésie des traductions françaises par Jules Supervielle, Valery Larbaud, Pierre de Nolhac, Eugène Bestaux et d’autres. Il a lui-même traduit de la littérature et de la poésie françaises en italien, dont Le cimetière marin de Paul Valéry. En tant que critique littéraire, il a entre autres publié un essai sur Supervielle (Supervielle, il poeta della relatività, 1934), un essai sur le poète « crépusculariste » Guido Gozzano, traduit en français en 1934, un autre sur le poète et académicien Pierre de Nolhac (Un grande amico dell’Italia: Pierre de Nolhac, 1934). En 1935, il sortit en italien une anthologie de poètes japonais contemporains (Poeti giapponesi d’oggi) en collaboration avec l’écrivain japonais Kuni Matsuo. Nous retiendrons aussi son Corrado Govoni de 1919, consacré au poète dont nous avons traduit sur ce blog plusieurs textes (entre autres ici) et dont il passe pour le premier disciple.
La poésie de Lionello Fiumi est en vers libres, ce qui, à l’époque où il commença à écrire, n’était pratiqué en Italie que par les poètes du mouvement futuriste autour de Marinetti. En préface à son premier recueil de 1914, il explique que, tout en se servant du vers libre (parfois rimé), il ne cherche pas à suivre les tendances du futurisme, au-delà de la forme. Son rattachement à Govoni est tout à fait logique puisque ce dernier fut, peut-on dire, l’un des moins futuristes des futuristes, c’est-à-dire un des moins intéressés, dans le cadre des formes nouvelles du vers libre, à expérimenter, à forcer l’inspiration dans des voies inconnues des prédécesseurs (l’idée étant que l’originalité d’un poète ne dépend pas tant d’un tel travail plus ou moins méthodique d’expérimentation que de sa personnalité).
Les poèmes qui suivent sont tirés d’une anthologie de 1963 (Poesie scelte [Poésies choisies], Casa Editrice Ceschina, Milan). Compte tenu de ce que nous avons dit plus haut, il est possible, voire probable que plusieurs de ces poèmes aient déjà été traduits en français (et par des plumes connues). Des anthologies de la poésie de Fiumi ont paru en français en 1950 (Poèmes choisis) et 1962 (Choix de poèmes). De même, le recueil Sopravivvenze de 1931 (ci-dessous quatre poèmes) sortit la même année en traduction française, Survivances, avant une seconde édition en 1935 « avec de nouvelles traductions » (ce qui laisse penser que la version française de 1931 n’était pas une traduction de l’intégralité du recueil original, à moins que ces nouvelles traductions ne fussent tirées d’autres sources).

*
Pollen
(Polline, 1914)
.
Le sablier sournois (La clessidra maligna)
Dans le laboratoire de l’alchimiste
plein d’ombre et de fumée,
parmi les alambics, les compas et les volumes rongés
gisant comme des pensées
obscures mais précurseurs,
ironique le sablier trônait bien en vue.
Le sable de la boule supérieure
pleuvait en fil constant
et fin
comme un cheveu ;
quand la boule était vide,
le vieux sage retournait
l’appareil
et le sablier se remettait habile
à tresser le fil du temps.
Mais la Vie
est une poignée de sable sanglant
pesée
par le Destin
et placée à l’intérieur d’un sablier sournois :
à la boule affamée
d’en bas
le sinistre Inventeur
a retiré le fond.
Le sable
coule
comme mû par une rage
sans répit :
coule
coule
chuinte
et disparaît
dans le Néant.
*
Canicule (Solleone)
Oh sur la place pavée
la brutalité blanche de la lumière
qui étrangle les pupilles !
Chaleur étouffante. Inertie. Brûlantes pendent
les bannes de toile grise
des cafés où les tasses
se remplissent de boissons glacées
fébriles de mousse
et l’avidité rouge des visages
se penche sans attendre sur ces gouttes
d’hiver
perdues au milieu de l’aride violence de l’été.
Et dehors, implacable,
la brutalité blanche de la lumière
qui étrangle les pupilles.
Et dehors, sortant de l’ombre,
toute la place énorme comme
une gifle de lumière.
*
Impression d’une nuit d’été (Impressione d’una notte estiva)
Nuit dans le parc :
immense drap muet
où seul fait une déchirure
ronde et brutale
là-bas dans l’allée
un globe électrique.
Une lumière crème cogne acide
sur l’herbe
et en manières fantastiques
esquisse les contours noirs
des trames aériennes
des branches.
Passe une mince figure :
visage brillant de fard
dans le bassin obscur
d’un grand chapeau à plumes.
Sous le globe le visage prend
des tons violets : la grande bouche
engloutit un bonbon.
Par les chemins elle se perd
en la verdure complètement noire.
Massif dans la nuit,
le parc se recueille en silence,
constellé de lucioles,
jaunes
gouttes
de lune.
*
Mousselines
(Mussole, 1920)
.
Celle tant cherchée (La tanto cercata)
Elle existe, peut-être. Ailleurs.
Dans ces villas miniatures nouvelles
aux marges de la ville, à l’écart.
Enchâssées dans des jardins pomponnés,
pompeusement parées de petits balcons
à fins filigranes
sculptés dans le nougat ;
avec des fards vifs
rouge pompéien,
des ornementations florales
discrètement baroques.
Ce serait un crépuscule d’été délicieux comme un abricot mûr.
Le mari revient du travail :
en tramway, dans lequel s’agglutine
une foule anonyme
qui semble prendre au crépuscule
des reflets terreux
(le wagon déjà orné de son ampoule blanche) ;
et le long des voies rectilignes
marbrées de rumeurs couleur de brume
la cocotte aux joues fardées
sous le grand chapeau « à sensation »
d’où jaillissent des plumes de marabout,
malgré son regard de velours
titillant
ne l’intéresse plus,
lui semble une mauvaise femme,
tandis que la baby-sitter
poussant des enfants en habits de marin
bleu clair
s’en retourne des parcs aciérés de couleur olive,
de parcs brunâtres à présent lilas
(le wagon glisse avec son sifflement gris cendre),
tandis qu’éclosent par centaines
les ballons électriques,
cocons de soie
sur l’indolence du ciel
qui s’ourle à l’occident d’un tendre jaune chamois.
Il descend. Il est arrivé. Une bonne odeur embaume
l’air et subjugue
les narines
heureuses.
Mais que se passe-t-il ? Une course rose :
sa femme se précipite à sa rencontre,
la chère ! si charnue.
Attente rose, onde cramoisie
(dans la pénombre elle a un peu de bleu)
d’une robe de chambre en crêpe de Chine
(le caprice châtain
de cette boucle en crochet
sur la pommette opaline !)
Un franc baiser.
« Je t’ai préparé la sauce que tu aimes. »
Délices d’écouter tout près
une voix qui ne soit pas intellectuelle
et où s’abandonner comme sur un oreiller.
Puis la véranda :
blanche dans le crépuscule, et qui répand
les bons arômes des plats ;
qui baigne dans la lumière moelleuse
comme en un bain de glycines bleues.
Blanche rumeur de coups de cuillère. Bleue d’assiettes.
Il y a aussi, distinguée,
la rotonde gloire d’un pudding
glacé, couleur de paille
et rouge rubis par les grains de groseille.
Et enfin le jardin ouaté dans une paix à présent lilas argenté.
Je ne rêve donc pas. Elle existe. Je le sens,
je l’ai pour voisine, je le sens,
celle attendue en vain, celle tant cherchée,
la joie !
*
L’Autre (L’Altra)
Je ne le nie pas : ta fascination me fait de l’effet
tandis que tu portes à ta bouche
la tasse d’épais chocolat chaud,
mais, vois-tu… tu es trop présente.
Ton trop de réalité me fait mal.
Je ne t’aime pas, ne peux t’aimer, j’aime
l’Autre,
celle dont je peux d’autant plus jouir qu’elle est absente.
Celle, disons, qui vit au-delà des mers,
disons, où la canne à sucre dessine les limites
de violacées forêts séculaires
de campêche et d’acajou.
On dit : « Cacao… Havane… »
Des mots, mais c’est une ouate qui bande l’âme et l’éloigne un peu,
vers où peuvent nager
mes yeux éternellement assoiffés de couleurs.
Peut-être qu’elle m’attend.
Devant le manoir
enveloppé dans une gaine de feuilles,
l’agave déploie ses langues hirsutes
de pulpe verte et grasse.
C’est midi, et peut-être qu’elle m’attend,
la créole au regard brun comme un cœur de tournesol.
Sur le hamac : en robe aérienne de baptiste
à noisettes améthyste.
Alors que le planteur catalan
est loin
(son hacienda de tabac le retient ailleurs ces jours-ci),
avec des gestes las
lisant superficiellement un journal de mode française,
elle attend peut-être le poète des pays inconnus
« au-delà des mers ».
Et si j’arrivais ? Je l’embrasse. Elle a des grâces
de colibri.
Encore, je l’embrasse encore, mais elles ne sont pas encore rassasiées,
mes lèvres, mais toute, mais seulement là,
un baiser seulement sur les escarpins brillantinés de copal.
Je pose mon casque colonial.
Alors, couché sur l’herbe, parler : évoquer
les pays inconnus « au-delà des mers ».
C’est elle qui le veut.
Elle ferme à demi les yeux, ses yeux bruns comme un cœur de tournesol,
et boit mes paroles : les mots ont pour elle
la blanche exquisité d’un tiède tapioca
que boit à petites gorgées un languide convalescent.
Dans les pauses on entend une faible musique :
fontaine jaillissante
qui murmure murmure
qui s’élève et ploie
et rebondit
dans la vasque
où faiblement
elle s’écrase.
L’eau,
quand on la regarde, a des reflets vert paon changeants.
« Juanita ! » La génoise et le vieux vin d’Alicante
nous sont apportés par la fidèle mulâtresse
en robe écarlate,
nouveaux prétextes pour parler
des pays inconnus « au-delà des mers ».
Mais la nuit en promenade dans le parc public, sous des blocs de noir compact,
par les chemins tatoués d’ombres.
Quelque rare lampe à incandescence
d’un suave orange
entre les branches semble de loin un ananas.
On croise des señoras en sombreros et mantilles à plumes.
Elles ont des yeux cernés de charbon
et passent, délicates, d’un pas moelleux.
« Ah ! cachons-nous ! là-bas… Don Pedro ! »
Encore plus d’ombre, alors.
Il y a des recoins où se trouve plus d’ombre.
Mais seuls dans cette draperie d’épais silences.
C’est la nuit cubaine. Plongés dans une ombre verdâtre.
Des frissons. Presser les seins diaphanes
qui ont presque (c’est l’ombre) la transparence
d’une pulpe de cédrat.
*
Désenchantée (Disencantata)
Ô peut-être est-ce une lubie
que de croire la trouver un jour.
Tu la cherches, la vois, mais tu observes et te rends compte
que ce n’est plus la « volupté ».
À la place tu sens, te taraudant,
un mal couleur de cendre,
ton incurable mélancolie.
Imagine réalisé ton rêve le plus cher.
Tu es sur la Riviera
où face à la convexité turquoise
des villas sucrées comme des bonbons,
des villes d’hôtels aristocratiques échiquètent avec le plâtre
toute une mousse d’orangers nains, de roses, de cédrats, de citrons :
ce sont les villes du jeu où s’enfièvrent des trésors
d’ors
cosmopolites.
Tu passes ton bras autour de la taille
de l’aventurière magnétique,
« l’Impure »,
qui s’est éprise de toi « à la folie »,
et vous marchez.
Tu reviens de la baignade par le chemin bordé de palmiers
un soir sulfureux
d’été
et te délectes,
toi qui l’adores, de noter sur son visage les artifices
du crayon rouge :
tu lui mordrais la bouche sans attendre n’étaient
les garçonnets et fillettes qui jouent au cerceau
autour des fréquentes fontaines neigeuses,
vaporeuses
comme le tulle.
Ne penses-tu pas l’avoir trouvée ?
Sornettes. Tu sens que te taraude
une pointe silencieuse.
La maladie cendreuse
que tu connais : ton incurable mélancolie.
Ah ! où peux-tu bien alors chercher la volupté ?
Peut-être que si vous vous appuyiez là, sous les palmiers, contre la grille.
Sur les impeccables avenues seigneuriales,
tigrées de maillots féminins,
pleines comme des nids,
fusent des antres automobiles, pleuvent des écharpes de rires et de cris.
Vous êtes donc appuyés contre la grille :
lisse est sa chevelure
qui prend aux reflets de pourpre la teinte violacée
du palissandre :
humez l’odeur
d’amande
du laurier-rose
qui filigrane cette soirée :
et peut-être…
Mais rien non plus. Oh ! où donc est-elle ?
Voilà, il est plus tard, deux heures sont passées
depuis le coucher du soleil :
une cristallerie faite de brise et de neige brille sur la nappe,
dans le sèvres blanc et bleu le homard diapré
s’émulsionne de jaune mayonnaise.
La magnétique aventurière,
ses yeux de lune noircis à l’antimoine,
avec un accent de soie te parle légère
dans son délicieux français :
à l’improviste elle te décoche un gros baiser,
toute féline :
les serviteurs en livrée orange
restent hiératiques.
Par la fenêtre, en face de la marina
des halos électriques violacent des masses cubiques d’obscurité :
tu penses que là-bas
est la cité du jeu et que dans une roulette se cache « la Fortune »
(n’est-ce pas l’Unique que tu cherches ?…)
Mais il est tard. La nuit est invitante. Noue-toi à son corps parfumé.
Voilà ! Perdez-vous ! C’est bien.
Le ciel entre les franges des palmiers, ocellé de grosses gouttes bleues,
est tout pompeux
comme une immense roue de paon.
Ah ! peut-être que tu la touches, que tu la tiens. Oui ?
Mais rien non plus. Rien. Sornettes.
Tu sens ton incurable mélancolie.
Où se trouve-t-elle donc ?
Peut-être
que la volupté est tout entière
dans le désir.
*
Survivances
(Sopravvivenze, 1931)
.
Fenêtres illuminées (Finestre illuminate)
Fenêtres illuminées, odeur de foin
quand les villages se jettent à la rencontre de ton train,
remuant leurs maisons comme des mouchoirs.
Le soir est rentré, a mis la nappe.
Sous la fleur de lumière, mirage éblouissant,
un monde arrêté d’affections sereines.
Arrêté. Et il ne lève même pas les yeux.
Arrêté. Et il ne montre pas non plus du doigt
ton cœur qui passe en un éclair,
qui court, pauvre lièvre pourchassé.
Un monde. Tant de mondes. Chaque pays, chaque ville
qui se précipite à cet instant à la rencontre de chaque train
dans le silence de la nuit coud
ses fleurs de lumière
sur la sérénité.
Toi seul ne sais que partir,
ignores la douceur de s’arrêter,
le baume aux yeux brûlés.
Et soudain ton cœur
est le lièvre tremblant de palpitations
pris dans le piège à dents de la nostalgie.
*
Nature morte (Natura morta)
Banane dépaysée qui vieillis
sur l’infime horizon de cette assiette,
je ne connais pas d’autre oreille
qui donne une minute d’attention
à ton chagrin de Cendrillon.
Et pourtant ton exil s’afflige, je le sens,
de l’impur contact
de la bouteille qui a violé la nappe,
de la pipe éparpillant
son agonie de cendres.
Pureté des proximités, fortes ou tendres,
parmi les splendeurs originelles !
Feuilles, immenses et courbes pagaies
ramant avec un fracas de train
sur les vastes mers fabuleuses !
Perroquets d’arc-en-ciel,
singes de caoutchouc, gazouillis
de folles lavandières !
La nuit frappe ses silex,
fait jaillir des pupilles de jaguar,
la clairière s’illumine et disloque
ses membres dansants en frénésie diabolique
autour d’une Vénus noire.
Pureté des proximités fortes ou tendres !
Dans ton exil, banane dépaysée,
depuis l’horizon de porcelaine
du médiocre après-dîner
tu t’offres à l’oreille non distraite.
Et j’accueille ton chagrin
qui est le mien à rebours :
savoir que je ne ferai jamais
le voyage que tu fis.
*
Le rêve (Il sogno)
Cette fleur que je vis au bord
du rêve,
cela fait des jours que je la convoite,
mais personne ne l’a jamais vue
ni ne pourra la recomposer.
La tige ne montait-elle pas, résolue,
comme le déclic d’un ressort ?
Et le déploiement de la corolle,
d’un jaune d’ouraline†.
Elle baignait dans une lumière médiumnique
et soudain me promit doucement
quelque chose : le bonheur ?
Mais
diabolique
une main se tendit et l’arracha.
Cette fleur que je vis au bord du rêve,
depuis cette nuit je la convoite.
Pour la recomposer
je m’esquinte le cerveau
et j’effeuille j’effeuille – en vain ! – les traités de botanique.
† ouraline : Verre traité à l’uranium, avec une teinte jaune ou verte, phosphorescent à la lumière ultraviolette. Le procédé connut une grande vogue en verrerie, avant que l’on découvrît les effets de l’uranium sur l’organisme.
*
Mirages (Miraggi)
Quand la lune confie ses muets mystères
au silence qui tend l’oreille,
des choses terrestres jaillissent des ténèbres
pour dérober cette magie.
Au fond de la chambre le miroir
peuple de pensées phosphorescentes
son ennui rectangulaire.
Des rails chevauchant la distance
veulent eux aussi s’engemmer
d’éclairs élégants.
Les étangs anachorètes
entre les cils des roselières
sont tout yeux pour épier.
Indifférente, la lune laisse faire.
Elle largue les amarres vers des rivages d’elle seule aperçus
entre des mystères que nul ne connaîtra jamais.
Les choses terrestres restent là
déçues comme des mains vides.
*
L’ombre sur le cœur
(Sul cuore, l’ombra, 1953)
.
Bonheur (Felicità)
Nous étions heureux cette nuit-là sous
la lune, mais si complètement
heureux que nous voyions – ou qu’il nous a semblé voir ?
ou bien étaient-ce, dans cette vaste blancheur, des ailes de lune ? –
les anges suivre notre ombre.
Notre ombre s’allongeait
mêlée sur le trottoir ;
et les anges chuchotaient, même eux
jaloux de notre bonheur,
si complètement heureux.
À ce moment, la lune
du cimetière dut faire dans une tombe
une ouverture de clarté :
quelle nostalgie de sortir
alors saisit les pauvres morts.
Ils n’avaient pas d’ombre, eux, puisqu’ils
sont l’ombre ; et soudain un coup de vent
nous souffla dans le dos, glacial.
Infinie pitié ! À voix basse, presque
timides devant la lumière éblouissante,
les ombres faites pour l’ombre
nous confièrent que de tout ce que
l’on voit sur terre,
ils n’enviaient rien tant ce soir
que nous deux, que ce fait que nous soyons heureux,
mais si complètement heureux.
Ils dirent cela. Et au moment même,
en les voyant, et en nous voyant nous un jour
futur, et ce soir trop beau sous
la lune, nous fûmes un peu moins heureux,
plus si complètement heureux.
*
Les choses non dites (Le cose non dette)
Et maintenant qu’après le baiser tu as pris
congé, et que les murs seuls restent
pour ma voix veuve,
cela me revient tout à coup,
ô cela qu’il m’importait de te dire
et qui dans le trop-plein resta prisonnier, et tomba, oublié.
Des riens chers que tu ne sauras jamais,
dissous avant d’exister.
De pensée en pensée, tristement,
j’aborde au temps où nous ne serons plus,
pense à des amants pareils à nous et de qui, lune égale
et vous, étoiles égales, vous recevrez
des confidences pareilles aux nôtres,
et les douces choses dites par nous, mon amie,
seront comme si
elles n’avaient jamais été…
Mais les autres, ah les choses non dites ?
que tu n’auras jamais sues, qui plus encore,
qui doublement – celles-là – seront comme si
elles n’avaient jamais été…
*
Le fils mort, à sa mère qui osa lui survivre (Il figlio morto alla madre che osò sopravivvere)
Mère qui étais tellement mienne hier, et qui es mienne encore
pour ce moi désert de terre
infime et décomposée,
je te retourne – prête attention ! – le fer dont aujourd’hui
tu me perças quand je te vis au soleil
respirer une rose
et rire – à qui ? à qui ? –, un moment
complètement oublieuse et donc plus à moi !
Cette terre que je suis a soif, mère,
de larmes seulement. Quand tu ris,
quand tu tournes la flamme noire de tes grands yeux
vers d’autres yeux, vers les fleurs, les eaux, le ciel,
tu n’es plus moi, je te sens, amarres larguées,
voguer sur les ailleurs, m’abandonnant
dans le gouffre qui n’a pas d’ailleurs.
Qui n’en a pas. Je souffre, je me tourmente impuissant,
je veux ta pensée qui est ma seule
vie estompée. Appelle-moi un monstre, je veux
ta souffrance, ta souffrance faite
de moi, qui est moi seul.
T’avoir liée à mes vides
ossements comme le fagot
docile, que tu ne fasses un pas sans
ce triste fardeau, ah ! que je suis pour toi.
Que pour toi il n’y ait plus d’allégresse
sur un sol qui couvre le fruit de ton sang !
Comment ? tu pourrais avoir de la joie
quand lui n’a plus de joie ? lui qui t’est né,
lui ton mort ?
Prostrée sur mon cippe,
oublie tout ce qui n’est pas
moi, ne vivant plus que de ma mort,
c’est comme ça que je t’aime et te veux ; jusqu’à
ce que vienne pour toi la joie licite de mêler
ta froideur novice à celle, habituée
aux pluies venteuses parmi les cyprès,
de ton monstre d’amour.
LA MÈRE RÉPOND :
Non, pas un monstre, mon fils ! Ô voix aimée,
il me semble t’entendre à fleur de cœur.
Le monstre, c’est moi. Je m’accuse d’avoir
souri : c’était le soleil !
Cher enfant, mes lèvres ne connaîtront plus
jamais cette courbe injurieuse.
Des larmes, rien d’autre, les larmes qui te nourrissent.
Mais que Dieu exauce le vœu longtemps formé
– que je descende à ta place et que tu retournes au soleil,
toi, mon fils, – oh alors !
pour toi rien d’autre que toujours le sourire
et le rire et la joie sans fin !
*
Toi seule, et pour si peu de temps (Tu soltanto, e per poco)
Bonheurs passés, à présent que vaut
votre inexistence de feuilles desséchées
qu’un tourbillon de vent
a balayées au loin pour toujours ?
Et qu’es-tu, avenir,
avec ce silence de sphinx ?
Ce sont des roses trompeuses que tes mirages ;
Qu’y a-t-il dans la si infime, si pauvre aumône
que fait encore ta main avare,
de sûr, d’irrécusable : la chute ;
et un abîme à la fin.
Ô ma douce, n’éprouves-tu point de peur
entre ces deux terribles
immensités de néant ?
Ô mienne, tout ce qui compte, c’est que le présent
ait ton cher visage.
Toi seule, et pour si peu de temps,
as le pouvoir de changer un avenir
d’ombre, jour après jour, heure après heure,
en présent solaire.
Ah ! aussi longtemps que tu le peux, grande petite chose,
toi, femme entre les deux murs du vertige,
aie pitié de ce cours d’eau
– eau trouble, vaine,
cours précipité, inéluctable –
qu’est notre vie humaine.
*
Portraits d’ancêtres (Ritratti d’avi)
Portraits d’ancêtres, combien, dans votre
glaciale fixité qui semble être un jugement
et intimide, combien
étrangers vous me paraissez à ce monde
en délire d’aujourd’hui.
Vous, d’un monde qui allait lentement,
étale comme le respir d’un sein
en un juste sommeil !
Vous êtes partis en silence, un jour. Sans
claquer la porte, et laissant derrière
vous un sillon de larmes…
Où sont à présent ces larmes ?
Évaporées comme l’eau d’une jatte
dans un midi d’été.
Et vous, et vous, ô miens, où êtes-vous allés ?
Aucun de ceux qui restait ne le savait.
Et vous ne le saviez pas non plus, vous. Ni moi, votre fils,
de cette époque orgueilleuse.
Savoir ! Je vous ferai bientôt signe
pour vous appeler à ma table
familièrement : pain, vin, choses
de cette terre qui fut la vôtre.
Ah joie cruelle de vous étonner,
comme des indigènes de la forêt vierge,
avec cette lumière
qui jaillit d’un bouton, avec la musique
qui sort d’une boîte étrangement,
et bien d’autres choses encore.
Ô vous inconnus ! Tout vous donner
de ce dont je me sens débiteur. Cette
existence dans l’aujourd’hui au soleil, à qui,
à qui la dois-je sinon à votre existence
avant ces ténèbres que vous êtes à présent ?
Ce trait de moi, cette couleur
des yeux, ce défaut étaient à vous,
je le vois, l’ai compris.
Comment me sont-ils venus ? Je passe un long moment penché
sur le voyage secret de votre
sang par des aventures aveugles comme
de fleuves souterrains, jusqu’à moi.
Rien. Je ne trouve pas. Prodige dont les voies
sont un mystère solennel.
Semblable à celui
de la graine infime qui devient
l’arbre gigantesque ;
à celui des astres
qui roulent au firmament, exacts.
L’esprit défaille devant un tel abîme
d’inconnu. Humblement, je ploie ce front
sur un brin d’herbe et ne parviens
qu’à balbutier, angoissé, un nom : Dieu.
*
Et la vie s’obstine
(E la vita si ostina, 1961)
.
Feux d’automne (Fuochi d’autunno)
Les arbres s’incendient de feux jaunes,
sur les fossés de peau verte et rugueuse.
En pâleurs d’agonie saignent
ces hortensias, et déjà tombent dans les vergers
les poires en chutes molles.
Demain la brume, à pas de velours
de gros chat gris, se coulera
dans les prés. Et puis ce sera le vent couleur
de pluie sale, l’hiver qui éteint tout.
Je me trouve dans ce midi fatigué.
Je suis cet automne.
Et déjà mes mains sont pleines d’ombre.
Mais voilà qu’à l’improviste je me souviens
de mêmes feux jaunes accrochés aux branches
des peupliers, et c’était le printemps !
L’image des peupliers en flammes jaunes s’estompe
et dans mon triste automne déclinant
qui enfonce ses pas dans les feuilles mortes
se superpose ton image,
ô feu si doux
qui m’est printemps.
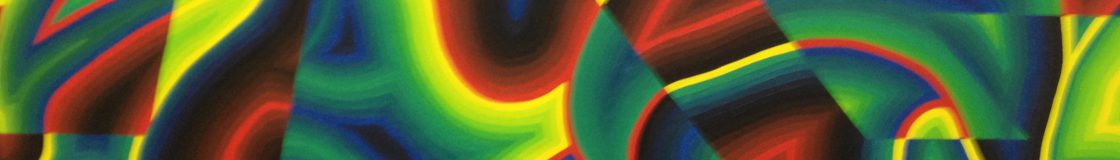
Complimenti! Ottima traduzione e personaggio interessante nel rapporto culturale Francia-Italia.
Grazie mille!