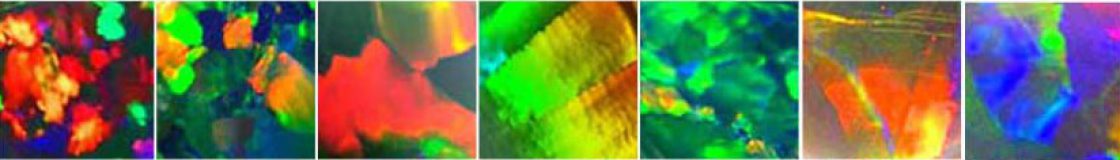Tagged: Cantabrie
Ecrit avec du sang goth : La poésie de Concha Espina
monumental pergamino
escrito con sangre goda
Concha Espina (1869-1955), femme de lettres espagnole, est surtout connue pour ses romans. Elle fut la première femme en Espagne à vivre de ses revenus d’écrivain [Ajout 24/1/24 : cette affirmation semble fausse : voyez notre note en partie Commentaires de ce billet] ; je ne donne pas ce fait, en soi, comme la preuve d’un mérite littéraire mais comme celui d’un mérite commercial. Dans l’édition de ses poésies (à peu près) complètes (Ediciones Torremozas, 2019), le préfacier explique que la plupart des gens qui lisent les romans de Concha Espina ne savent pas qu’elle a écrit de la poésie.
C’est pourtant par de la poésie qu’elle commença, et c’est en envoyant des poèmes aux journaux, qui les publièrent, qu’elle se vit suggérer, car elle avait une bonne plume, d’écrire des romans. La même anecdote se rencontre chez d’autres auteurs et l’on peut en conclure que le déclin de la poésie dans les lettres occidentales est dû à ceux qui publient de la littérature pour gagner de l’argent, car la prose se vend mieux. Ceux qui vivent de la littérature ont détruit la fibre poétique de ceux qui vivent pour la littérature. Très prise par son activité de romancière à succès, Concha Espina a écrit relativement peu de poésie : trois recueils et quelques poèmes épars dans les journaux. Les éditions précitées ont publié un volume de l’ensemble de son œuvre poétique (ou presque, s’agissant des poèmes épars : on peut lire sur internet des poèmes qui ne se trouvent pas dans ce volume, dont le titre est donc un peu trompeur), Poesía reunida.
.
*
Mes fleurs
(Mis flores, 1904)
.
À la Vierge de mon autel (A la Virgen de mi altar)
Image à la beauté si douce
qui demeures parmi les fleurs de mon autel,
ton aimable visage tourné vers les cieux
comme pour de leur grandeur implorer
remède à mes douleurs.
Lorsque j’étais heureuse encore,
je te consacrais mon bonheur et mes chants
et te cherchais aussi, et je t’aimais…
À présent que je souffre et pleure, ma Mère,
apaise mon chagrin !
Ô Vierge à l’immaculée pureté,
au manteau bleu comme le ciel,
rayon de lumière éclairant mon voyage,
de l’âme contrite qui te cherche
exquise consolation !
Je ne sais si sur le chemin de la vie
existe une douleur plus profonde que la mienne ;
pleurant l’absence de ma mère,
je sais seulement que dans mon âme est une blessure
que le monde ne guérit pas.
Et dans le doux enchantement du nom de Mère
je sens grandir ma peine chaque jour ;
cherchant quelqu’un qui puisse adoucir ma perte,
je viens arroser tes pieds de mes larmes,
en disant : Ma Mère !
Je sens, ô Reine, que tu m’accordes
tout ce que de ta pitié je sollicite ;
pour moi tu seras deux fois mère…
Que de raisons pour murmurer dans mes prières
ce nom béni !
Promesse, espoir si riant
comme cette image de toi qui sourit,
étant en ton nom maîtresse de mon autel :
laisse une âme rêvant de toi
se confier à ta pitié !
Que jusqu’au dernier moment de ma vie
m’embrase le feu saint de ton amour ;
que ma pensée te cherche,
t’apportant dans chaque parole un soupir,
un baiser dans chaque phrase.
Dirigeant mon vol vers les hauteurs
où cette affliction en joie se changera,
quand tu me couronneras dans le ciel,
avec quelle passion, avec quel élan béni
je te dirai : Ma mère !
*
La Vierge de l’Espérance (La Virgen de la Esperanza)
À l’entrée de mon village,
au pied de vertes collines,
il y a une petite église abandonnée
où dans la nuit silencieuse
s’abritent les colombes.
Ce lieu solitaire
jouit d’une paix si riante
que l’âme en rêve
et souhaite aller trouver
les ruines du sanctuaire.
Il y vit une belle plante
qui de ses fleurs atteint
et couronne, dévouée,
le trône où repose
la Vierge de l’Espérance.
Et cet arbuste exubérant
qui l’entoure de fleurs
est, par un art miraculeux,
l’oracle d’amour
des jeunes filles du village.
Pas une qui, amoureuse,
n’ait, contente, trouvé
dans la petite église abandonnée
pour chaque fleur effeuillée
un rêve couleur de rose…
J’étais la proie du chagrin,
rêvant à mille chimères,
et me rendis un jour à l’ermitage,
mon âme en pèlerinage
cherchait l’espoir.
La plante, indulgente,
me gratifia de la faveur
de son innocent secret,
m’accordant une illusion radieuse
dans les pétales d’une fleur…
À présent que l’amour me comble
de joyeuse sécurité,
je pense à la petite église du village
et dis : Bénie soit
la Vierge de l’Espérance !
*
À la Vierge des Douleurs (A la Virgen Dolorosa)
Autrefois, avec ferveur
je venais, ma Reine, à tes côtés
chercher un doux réconfort
sous ton manteau bleu,
manteau couleur de ciel.
Aujourd’hui qu’en lancinante agonie
tu rends tribut à la douleur,
je viens te tenir compagnie :
comme tu es triste, ma Mère,
en ce manteau de deuil !
Noir comme tes douleurs
et tes angoisses mortelles,
s’il n’y a pas de fleurs dans ses plis,
il s’y trouve un trésor d’amour
et de larmes célestes.
Tu portes la palme du martyre
en cet habit mélancolique,
l’âme pleine d’amertume
et, gardant un calme saint, un poignard
enfoncé dans le cœur…
Quand dans mon ciel paraissent,
mêlées de joies,
des tristesses qui l’assombrissent,
comme elles me paraissent petites
auprès des tiennes !
Si tu lèves vers le temple
tes yeux fatigués de pleurer,
tu le trouveras triste,
comme la lumière de ton autel
et le manteau dont tu te couvres.
La pure lumière de tes yeux
résiste aux ténèbres ;
tu peux, Mère sans bonheur,
égayer l’église obscure
et l’âme tellement triste.
En ce jour, versant des pleurs amers,
tu me présentes dans ton deuil
la même sainte consolation
que je trouvais sous le manteau
couleur de ciel.
Gardant en ta pitié
l’espoir de la félicité,
les chagrins fuient l’un après l’autre,
car aucune ombre n’atteint
où parvient ta lumière.
Et je me réjouis dans ta joie
et suis heureuse de tes gloires ;
dans ton agonie lancinante,
ma Mère, je veux poser mes lèvres
sur la frange de ton noir manteau.
*
Ce que je souhaite (Mis anhelos)
À mon fils
Espérance bénie qui m’apparais
dans les paisibles lueurs matinales de ma vie ;
fleur parfumée qui croîs à mes côtés ;
illusion embellissant mes heures ;
ange de mes amours.
Enfant dans le candide regard de qui
brillent des joies du ciel ;
tandis que je couvre de baisers ton visage de rose,
entends la voix qui, tendre, affectueuse,
te dit mon souhait.
Écoute, ma vie, le doux accent
par lequel mon affection ardemment cherche
à donner former à ta pensée innocente
et remplir de sentiments d’amour
ton cœur d’enfant.
Aujourd’hui je ne désire rien d’autre, mon petit,
que t’endormir tranquillement contre mon sein,
me voir dans tes yeux couleur de ciel,
attendre que tu récompenses mes veilles
en m’embrassant.
Plus tard, ta bouche de corail
essaiera la douceur d’une phrase,
et en sourires célestes
écloront sur tes lèvres virginales
des paroles de tendresse.
Alors, avec cette maladresse ravissante
qui accompagne les premières années
et possède tant de doux mystères,
te berçant dans mes bras comme à présent
je t’entendrai dire : Espagne !
Espagne ! Saint nom qui résonne
pour moi comme une délicieuse musique ;
nom que j’écoute pleine d’enthousiasme ;
doux souvenir qui transporte
de délectation mon âme…
Bien que Dieu voulût que tu naquisses
loin, bien loin des lares de ta patrie,
sans que tu le comprennes, te parleront
d’Espagne mes agréables caresses
et mes pauvres chants.
Quand tu seras homme, je veux
que tu vives amoureux de ta patrie ;
que sa colossale grandeur t’émerveille ;
qu’à son nom glorieux soit uni
ton orgueil de soldat.
Que tu ceignes l’épée
au service de cette belle patrie
et, s’il le faut, que ce soit ton bonheur
de risquer ta vie avec courage,
jusqu’à mourir pour elle.
Valparaíso – Chili
*
Sourires (Sonrisas)
Quand, fatigué de jouer avec moi,
tu t’endors en souriant contre mon sein
tandis que je te prodigue de douces caresses,
avec quel immense plaisir je te bénis !
avec quel amour je te serre dans mes bras !
Près du berceau plein de mystères,
en veillant j’attends ton sourire
et, le cherchant sur ton visage serein,
je passe ainsi les heures, étrangère à la fatigue,
tenant compagnie à ton ange gardien.
Quand brille dans tes yeux rêveurs
l’aube souriante de ma vie,
comme je suis illuminée par leur éclat
en faisant avec ferveur
le signe de la croix sur ton front !
Et du centre du foyer où elle règne
et qu’elle baigne de chatoiements,
ton charmant sourire accueille
la belle image que vénère ma foi…
la Sanctissime Patronne d’Espagne.
*
Aux mères des soldats espagnols combattant à Cuba (A las madres de los soldados españoles combatientes en Cuba)
Ndt. Évocation de la guerre entre l’Espagne et les indépendantistes cubains, qui dura de 1895 à 1898. Les indépendantistes étaient soutenus par les États-Unis, et l’Espagne perdit au cours de cette guerre, devenue entre-temps la guerre dite hispano-américaine, ses dernières possessions coloniales en Amérique – Cuba et Porto Rico – ainsi que dans le Pacifique – les Philippines et Guam. Cette défaite et ces pertes territoriales provoquèrent un grand traumatisme en Espagne. (L’Espagne ne conservait plus que sa colonie africaine de Guinée équatoriale mais allait bientôt s’emparer d’une partie du Maroc.)
Santiago du Chili, 1896
Mères, vous qui d’un fils
pleurez l’absence,
tremblant à toute heure
pour sa vie ;
vous qui l’avez vu partir
sans verser une larme
pour ne point troubler le calme
du jeune homme vaillant ;
aujourd’hui mon chant veut
souffrir avec vous,
pauvre expression d’une âme
qui vous aime tant !
Pleurant en un pays lointain
vos chagrins,
je vous envoie mon affection
avec mes strophes.
Ce n’est pas une voix seule
qui m’appelle vers vous ;
je vous aime comme mère,
comme Espagnole,
comme amie de l’affligé,
du malheureux,
avec une profonde tendresse,
lien sacré
qui m’unira
à vos infortunes
tant que durent, liées aux vôtres,
celles de ma vie.
…..
Quand vient la nuit,
claire ou sombre
mais toujours touchée
de poésie,
en ces heures pleines
d’un calme doux
où la mère dans un baiser
met toute son âme,
tous mes contentements
deviennent infimes,
car je pense à vous
et à vos fils,
et je dis bien des fois
avec amertume :
« Que peuvent faire ces mères
de leur tendresse ? »
…..
Mais, séchez vos larmes,
donnez du répit au deuil,
car toujours l’espérance
brille dans le ciel
et peut-être, un jour
proche et solennel,
embrasserez-vous ceux
par qui vous vient votre agonie.
À son retour, avec quel orgueil
le soldat déposera
à vos pieds la gloire
qu’il aura conquise !
Que de baisers, gardés
pour ce moment !
Vous n’écouterez plus alors
les phrases consolatrices,
car, prodiguées
à pleines mains,
vos joies seront plus grandes
que vos tristesses.
…..
D’autres mères tristes,
pauvres femmes !
verront leurs souffrances
s’accroître encore.
D’autres fils reviendront
pleins d’honneurs,
mais pas ceux
de leurs amours !
Mères, pour vous
il n’est aucune consolation ;
vous ne donnerez de paix aux larmes
ni de répit au deuil.
Et, pourtant, dans
votre douleur profonde,
le monde versera
ses rayons de gloire.
Les braves que la patrie
a sacrifiés,
en pages éternelles
elles les glorifie ;
dans son livre, même après
que les ans ont passé,
les noms des héros
ne s’effacent pas !
dans ses pages brillantes
elle garde
pour vos nobles fils
un lieu sacré.
Aucun Espagnol n’ignorera
leurs exploits,
tous prieront pour eux,
tous les pleureront ;
et vos larmes peut-être
couleront plus lentes
en pensant à leur gloire,
de savoir que dans votre peine
vous n’êtes pas seules ;
et pensez que vous êtes mères…
mais Espagnoles !
*
Covadonga
Ndt. Covadonga, dans les Asturies, est le lieu où l’avancée des armées omeyyades fut arrêtée en 722 par le roi Pélage (Pelayo en espagnol), qui put alors fonder le royaume d’où devait partir la reconquête de l’Espagne. Le site sert par conséquent de lieu de mémoire. La « sainte grotte » (Santa Cueva) de Covalonga est un sanctuaire. Concha Espina écrit ce poème alors que l’Espagne est « sur son triste chemin » : cela décrit la situation du pays après la défaite de 1898 (voir la ndt [note du traducteur] au précédent poème).
En montant à la grotte
Quand sur ta splendide étendue
je pose mon pied incertain,
j’éprouve sur les piliers
de tes rochers séculaires
le vertige de la hauteur.
En muette contemplation,
surprise, admirative,
je ne sais, dans cette vision,
où fixer mon attention,
où poser mon regard.
Tant de beautés me séduisent
toutes plus les unes que les autres,
et mon imagination vogue
dans l’harmonie silencieuse
de si noble grandeur…
Aujourd’hui, sur son triste chemin,
se tourne vers toi l’Espagne tout entière,
ouvrage d’un artiste divin,
monumental parchemin
écrit avec du sang goth.
Le torrent qui se déchaîne
sur tes escarpements
depuis ton lac d’argent
semble encore conter
les exploits d’autres âges.
En toi brille l’éclair lumineux
de l’histoire de nos ancêtres
qui pour la mémoire éternelle
illuminera de sa gloire
le sépulcre de Pelayo.
Et j’humilie mon front devant Dieu,
à l’éclat immaculé
de la lumière céleste de qui
triompha de l’Arabe le Caudillo
de ta légende immortelle…
Pèlerine que n’arrête point
l’âpreté de la route,
je cherche parmi le lierre
les escaliers de pierre
qui mènent à la grotte…
Covadonga ! il n’est que trop juste
que je porte ton amour dans mon âme,
moi qui dans mes jours meilleurs
cherchais tes fleurs au printemps
et ta neige en hiver.
C’est de la joie, à mes yeux,
que les brumes de ta couronne,
et tes chardons sont des reliques
depuis qu’à genoux j’ai prié
aux pieds de ta Patronne !
*
À la mer (Al mar)
Tu berças le couffin de mon innocence
et désignas leur route à mes destins,
ô mer, des soupirs pérégrins de qui
est plein le chant de mon existence !
En accents de candide éloquence
tu m’apportas de divins contes d’amour,
quand expatriée sur d’âpres chemins
j’aspirais à la présence de mon littoral.
J’ai traversé la surface de ton gouffre
et senti de ta colère les déchaînements
quand le calme était rompu de ta beauté.
Aujourd’hui, que tes rumeurs soient paisibles ou sauvages,
de ma tendresse je te consacre la ferveur
sur la mer cantabrique de mes amours.
*
À Séville (A Sevilla)
Sur les marches de ton autel,
sous ton ciel divin,
je viens pincer les cordes de ma lyre :
voici mon chant
pérégrin, devant tes portes !
Ouvre-moi, Séville :
sur le seuil de ta magnificence
un cœur qui t’aime appelle,
car tu es fleur d’un rameau
qu’il porte en lui enraciné.
Noble cité de Séville
que, seule, j’ai rêvée
merveilleusement couronnée
de la classique mantille
des dames espagnoles.
Bénis soient de tes chants
les sentimentaux accents,
et les châles de flamenco
dans lesquels prennent les cœurs
tes femmes idéales.
Bénies soient, belle matrone,
les riches et fines dentelles
de la gracieuse couronne
qui me livre dans ses rets
à tes pieds ravissants.
Bénies soient les délices
de ta campagne somptueuse,
qui dans ses riantes images
me montre les dents
de ta peineta gitane…
Tu ne trouveras pas en mes chants
ta chaleur méridionale ;
échos de mers lointaines,
ils porteront chez toi
leur tristesse originelle.
Histoires faites en vol
par des échos mélancoliques,
derrière le voile immatériel desquelles
mon ciel pâle est
défait en blancs lambeaux.
Voix dont l’accent possède
des sentiments purs
et dont le rythme s’accompagne
des peines de ma Montagne,
des ombres de mes noyers…
Dans des tendresses que tu ne convoites pas,
laisse-moi jouir des tiennes ;
tu feras bien si tu te fies à elles,
elles valent peu pour être miennes
mais beaucoup pour être cantabriques !…
Des gouttes d’eau salée
de cette mer veulent mourir
de tendresse amoureuse
dans le courant bleuté
du doux Guadalquivir.
Des baisers de brises languides
du trésor de Cantabrie
cherchent les sourires de ton soleil,
volant en aimante hâte
jusqu’à la Tour de l’Or.
Des nuages légers de la plaine,
notes dont le rythme se chauffe
au cers du mont voisin,
dans ton Alcazar souverain
demandent ta Giralda…
Permets donc que fassent la cour
avec douce obstination,
en transports amoureux,
mes pauvres brumes du Nord
à ta lumière du Midi.
*
La maison triste (La casa triste)
Anniversaire
Il y a un an, annonçant
les blandices de l’été,
naissaient en Cantabrie
des milliers de fleurs,
quand la fleur la plus belle
de ma vallée
expira doucement,
rêvant d’amours.
Depuis lors, la maison
où sereine
régnait sa joie,
pur enchantement,
a une vague et plaintive
rumeur de chagrin
qui fait monter aux yeux
des nuages de larmes.
Si la brise matinale
de la montagne
comme avant
pose ici son vol,
c’est qu’elle pleure l’absence
à la fenêtre
de la chambre de l’enfant
qui est au ciel.
Si, pour qu’on ne puisse
le taxer d’ingratitude,
le soleil porte dans la maison
ses rayons magnifiques,
ils sont tous pour le nimbe
de son portrait,
tous pour les traces
de son souvenir.
Et son jardin luxuriant,
son bosquet ombreux
vêtent tristement désormais
leurs opulentes beautés,
car elle est loin
de ma vallée,
la princesse de ses charmes
et de ses fleurs.
Bien que grimpent les fraîches
roses de mai,
escaladant la maison
avec vaillance,
là-haut les attend
une triste déception,
car elles couronnent
une jalousie fermée.
L’hymne que chante
la saison du printemps,
la beauté qu’en elle
Dieu réunit,
est dans la maison triste
une voix monotone,
qui, appelant l’enfant,
soupire et pleure…
Et pendant ce temps les âmes
qui l’adoraient
vont par le monde
sans consolation,
cherchant ces yeux,
qui se fermèrent,
dans les lumières divines
du ciel, là-haut…
De nombreuses années passeront
comme a passé celle-ci,
succession de joies
et de chagrins,
et toujours elles laisseront
triste la maison
où est morte l’enfant
de mes chansons !
*
Entre la nuit et la mer
(Entre la noche y el mar, 1933)
.
Saeta
Ndt. Une saeta est une chanson religieuse composée pour les processions de la Semaine Sainte.
Aie pitié, Seigneur,
de l’oiseau qui chante
et du papillon venu
se poser sur mon nid ;
de la douleur secrète
qui dans mon sang s’effraye
avec un gémissement sourd,
et du vent qui porte dans sa gorge
le son terrible
de la mer qui se lève.
Aie pitié, Seigneur,
de tout ce qui naît,
de toute plante vivante
où le frère Amour
palpite caché.
Tiens dans ta main pure
la rose et l’animal, le squelette
dont un travailleur triture toujours les os
de sa houe inquiète,
pour en donner de meilleures semailles
à la récolte, à la fleur
et à l’enfant.
Pour les choses qui ne veulent point naître,
ni surgir,
et pour tous les êtres tristes
qui doivent souffrir
et mourir,
aie pitié, Seigneur,
de ce monde que tu fis
avec amour !
*
Devant ma statue (Delante de mi estatua)
I
Femme aux yeux qui n’ont point pleuré,
femme dont la chair n’a point souffert,
tu n’as pas une chevelure légère
messagère de rêves merveilleux,
ni lèvres rouges, ni pied blessé.
Tu n’as jamais rugi comme une folle
ni ne t’es enflammée telle un brasier ;
tu n’as pas connu le goût du sang dans ta bouche,
nectar du baiser qui désespère
car il prend fin quand on le touche.
Tu ne connais pas les convulsions
de la caresse enracinée ;
tu n’as pas vaincu les ailes pures ;
tu n’as point enfanté ni éclairé
la peine humaine des enfants.
Tu ne donnes pas tes tresses en nœud ferme
au col ami, comme témoignage
de t’être donnée avec un plaisir muet.
Tu n’offres pas ton sein clair et nu
à la pointe aiguë des poignards.
Tu n’as jamais eu le front enflé
par les douleurs de la pensée
et n’as jamais ouvert, comme une blessure,
la source vive du sentiment,
torrent assoiffé de vie éternelle…
II
Marbre froid qui montres des veines
où ne coule aucune passion forte,
vase aux lignes chastes et sereines
où ne gémit point, triste dans ses chaînes,
l’oiseau rouge du cœur.
Donne-moi ta glace, pour mon esprit ;
pour mon âme, ta rigidité ;
donne-moi ta pierre dure, innocente
pour mes lèvres, pour mon front,
comme un pansement de candeur.
Donne-moi la paix immobile de tes mains
que tu ne veux ouvrir à aucun prix ;
ni à la lecture des mystères,
ni aux roseraies du printemps,
ni au serment de l’avenir.
Donne-moi la frange de ta robe
qu’aucun vent ne peut agiter,
pour mon habit qu’ont secoué
les bourrasques noires et furieuses
sur la terre, sur la mer.
Pour tout un vaste rêve de gloire
donne-moi ton signe de jeunesse ;
inutile emblème de victoire,
donne-moi ta grâce pour ma lie,
donne-moi tes épaules pour ma croix…
*
Mon enfant (Mi niño)
Mon enfant brun
comme un Nazaréen,
tu t’en es allé !
Ton chant perdu,
ta poussière endormie,
quelle tristesse !
Ton sourire était
un vol d’ailes sans le moindre
empressement ;
ton regard, un plaisir,
un puits candide
de lune ;
ta voix une goutte,
séraphique note
du ciel ;
ta grâce, un enchantement
pareil au chant,
pareil au vol…
Plus personne ne dit ton nom ;
ta vie, dans l’ombre
s’achève ;
Ton ombre est une mésange ;
mon chagrin est un cri
qui s’enfuit.
Dans l’obscurité répand
sa cendre blanche
ton argile ;
mais, immobile et muet,
pour moi tu n’es
pas du tout mort.
Que vivent, par une
fortune inouïe
d’abîme,
sur le même sommet
ta neige et ma lumière
ensemble…
La flamme qui crépite
est mon âme infinie
qui supplie ;
ma chaude étoile
allume ta trace
sonore.
Et en moi, fleuri,
joyeux, ailé,
tu subsistes…
La flamme et la glace,
ton rire et mon deuil…
Quelle tristesse !
*
La seconde moisson
(La segunda mies, 1943)
.
Santander
C’est en vain que te persécutent les tempêtes,
les colères de la mer sur les falaises rongées,
toi, vieille terre de capitaines,
bruyère de caravelles et de pilotes.
Flammes, vagues, écumes, éperviers
de ton héraldique sont, génies inconnus,
une aube de rudes clans primitifs,
destin de siècles pour toi lointains.
En vain les éléments rebelles
mordent ta chair avec une violence traîtresse ;
tes forces sont de bronze et de roche,
souffle vital de l’invincible Espagne,
et plus rapide et plus haute que les vents
est l’étoile qui dans le ciel t’accompagne.
*
Complainte (Endecha)
Une goutte de lumière tomba sur la branche
où dormait le rossignol farouche
et l’oiseau réveilla sa mélodie
qui était elle aussi goutte et flamme.
Plus tard, le soleil au zénith alluma
le brasier d’une violente mi-journée,
et l’oiseau cacha son chant
dans l’ombre que le bois prodiguait.
Aube de clarté matutinale,
ainsi la complainte bleue de mes amours,
également à cheval sur le ponant,
fuit-elle les aveuglants midis :
aube et lune pour seules délices,
voix de poètes et de rossignols.
*
Au cœur divin (Al divino corazόn)
Cœur immense,
cœur oint,
qui répands sur le monde
ton saint battement.
Cœur torche,
qui es allumé
dans l’éclat de tous les astres,
pour les créatures, sur les abîmes.
Cœur s’écoulant
comme une source
où sourd la veine profonde
de l’amour infini.
Cœur ouvert,
cœur blessé
qui t’offres comme une promesse
de chemin éternel…
Jésus de Nazareth,
Seigneur qui connais
toutes les misères
de tous les hommes.
Doux voyageur
qui jamais ne déplaces
le triste horizon
de la vie humaine,
car tu cherches toujours
de nos douleurs
les confins où pleurent les enfants,
où souffrent les pauvres,
les obscures ténèbres
des cœurs
qui gémissent pleins de larmes,
malades d’amour…
Permets moi d’aller, sûre et vagabonde,
sur l’humble chemin, dans la marge occulte
où la rumeur de la terre acquiert
un profond mystère de mer insondable.
Permets-moi de te sentir
comme un pouls divin dans ma chair,
dans mon entendement comme une étincelle
qui jamais ne s’éteindra,
sur ma route comme un drapeau
de linge blanc,
qui me conduise au pays des âmes,
vaincue la mort sur la vallée noire.
Laisse-moi te suivre, laisse-moi t’atteindre !…