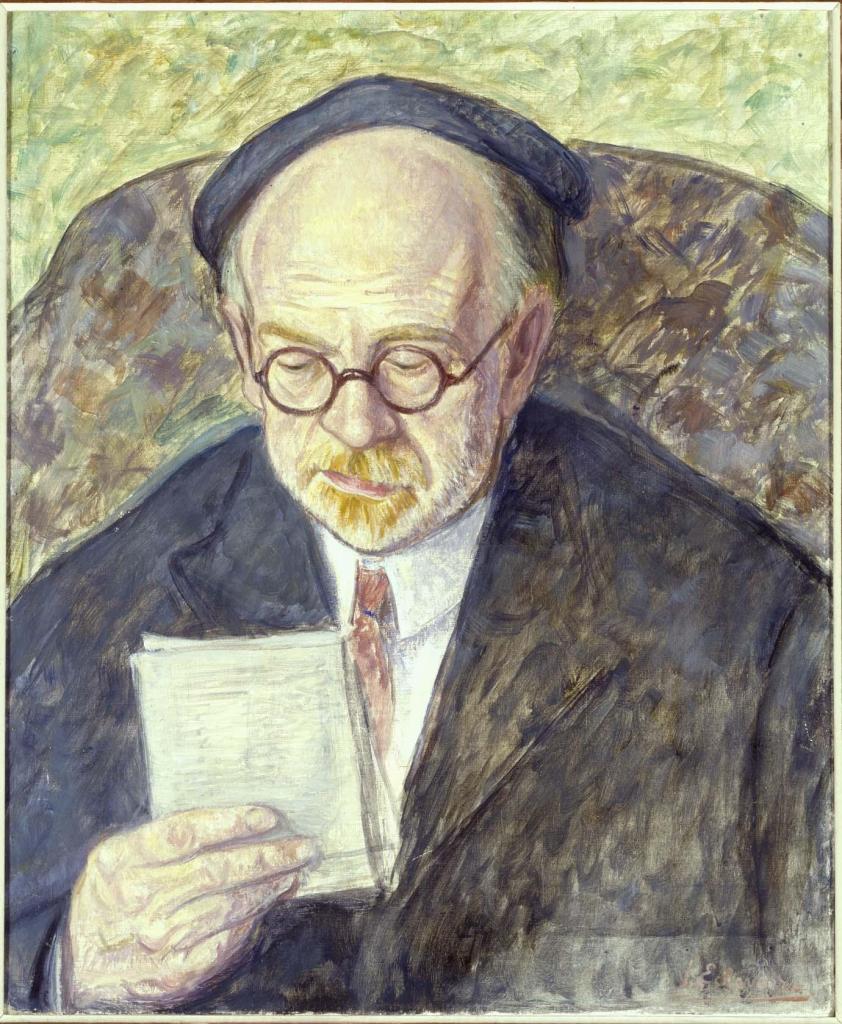Tagged: Canciones del suburbio
L’armoire aux squelettes : La poésie de Pío Baroja
Le célèbre écrivain espagnol Pío Baroja (1872-1956), auteur d’une monumentale œuvre romanesque, n’a publié qu’un seul recueil de poésie, à plus de soixante-dix ans, Canciones del suburbio (Chansons des faubourgs), sorti en 1944. Malgré son âge avancé et son inexpérience en matière de versification, Baroja a écrit là des vers classiques, pour lesquels il demande, en exergue, l’indulgence du lecteur mais qui sont remarquables par leur fraîcheur et leur spontanéité : preuve supplémentaire du grand talent de cet écrivain.
Le titre du recueil fait penser aux œuvres de Jean Richepin (La chanson des gueux), Jehan Rictus (Le cœur populaire), voire François Coppée (Les humbles, Le Noël des pauvres). Or, si l’on trouve dans le recueil de Baroja des poèmes de cette veine, y compris avec force argot, le livre est divisé en cinq parties dont la plus longue, la deuxième, Souvenirs de vagabond, se passe hors de la ville et des faubourgs, évoquant les campagnes du Pays basque et d’autres contrées ibériques. La première partie, Jeunesse, correspond le mieux au titre du recueil, avec divers tableaux urbains et faubouriens d’Espagne. Les trois dernières parties évoquent quant à elles le séjour parisien de Baroja à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qu’il vit éclater alors qu’il se trouvait dans la capitale française. C’est donc aussi une évocation de la ville, mais avec le regard plus distancié d’un étranger ; ces derniers chapitres ont une coloration moins « costumbriste » qu’introspective et mélancolique. Les deux derniers poèmes du présent choix font revivre les débuts de la Seconde Guerre ; le dernier, en particulier, rapporte les sentiments de Baroja quand il vit des soldats français partir au front en chantant Auprès de ma blonde, un poème pressentant la débâcle imminente de l’armée française.
Poète espagnol ou poète basque de langue espagnole, nous ne saurions dire ; toujours est-il que la partie Souvenirs de vagabond s’intéresse particulièrement à la culture terrienne basque, ce dont notre choix rend assez bien compte. En revanche, les poèmes à la manière de Richepin ont moins retenu notre attention.
Comme nous l’avons dit, c’est le seul recueil de poésie de Pío Baroja, et il ne paraît pas avoir été traduit en français. Tous ses romans, du reste, ne sont pas non plus encore traduits, loin de là, dans notre langue.
Dans le présent choix, les poèmes figurent sous le titre des sections correspondantes du recueil.
*
*
Jeunesse
(Juventud)
.
Café-concert (Café cantante)
Le guitariste monte
circonspect sur l’estrade
et s’assoit sur une chaise,
pas franchement décontracté ;
le chanteur, à côté de lui,
va se placer sur un banc,
et avec une courte baguette
qu’il tient dans la main droite,
à sa manière, sans doute,
marque le rythme.
Le guitariste est de teint cireux,
brun, velu, maigre.
Le chanteur est un gros homme
avec un air de gitan.
Les fioritures commencent,
les arpèges compliqués
sur la guitare, et bientôt
le gros se met à chanter.
Une plainte étrange s’élève,
ainsi qu’un oiseau,
puis retombe
comme une bécasse tirée en plein vol ;
elle remonte à nouveau,
encore plus haut,
et c’est alors une plainte
d’une excitation toute théologique,
qui parvient presque à avoir
l’émotion de quelque chose de sacré,
comme peut le paraître une plaisanterie
ou un commentaire particulièrement fruste.
Les lamentations s’arrêtent,
on voit le gros suffoqué,
enflé, rouge
comme une lanterne vénitienne.
Les deux canailles se lèvent,
reçoivent acclamations, applaudissements,
puis sont remplacées par un bougre
spécialiste de tango.
Il chante avec une petite voix
un répertoire de jadis :
chansons de tauromachie,
de guerres et de soldats,
des saillies sur les politiciens
et sur les us et coutumes
propres à Madrid
ou aux gens de Cadix.
Ensuite viennent danser des séguedilles,
sévillanes et fandangos
quelques femmes brunes
aux grands yeux peints
dans des robes à falbalas
qui leur tombent jusqu’aux pieds.
Certaine étoile de l’art
se démène comme un diable
et danse avec tant de force
un rigaudon si barbare,
avec un tel fracas,
que toute l’estrade tremble.
*
Opéra italien (Ópera italiana)
Fioritures, roulades,
grands duos, grands arias,
saccharines violentes
de l’opéra italien.
La Favorite, Lucia,
Rigoletto et La Traviata,
vous nous avez donné le virus
d’une maladie romantique
dont ne pourra nous guérir
aucune thériaque.
Nous sommes embourbés
jusqu’au cou
dans les morceaux de bravoure,
les romances clinquantes,
les ritournelles classiques,
les cavatines compliquées
où la diva déploie sa voix
brillante dans la salle.
Aucun Haendel ne pourrait nous sauver
ni aucun Bach refermer la blessure,
car il nous plaît, à nous autres,
quand ça se présente, de l’élargir.
Nous laisserons les gens
de la tribu wagnérienne
se consacrer à ce travail
d’hygiène ou de gymnastique
et attendrons que, demain,
des mélomanes ils fassent
une foule savante
appliquant à la musique
les formules mathématiques.
*
Le mitron du boulanger (El pinche del panadero)
Pauvre garçon de l’orphelinat,
dont la vie fut si misérable !
Le boulanger de la rue,
Monsieur Blas, l’adopta.
Personne ne connaissait son nom ;
quand il fallait l’appeler,
on disait seulement : « Mitron ! »
et lui répondait : « J’arrive ! »
Il travaillait de longues heures,
vivait sans repos,
dormant sur quelques sacs
au fond du vestibule.
La boulangère, une grosse femme
mauvaise, basse et soupçonneuse,
tenait le mitron pour malhonnête,
hypocrite et déloyal,
lui attribuant toutes sortes
de friponneries et méchancetés.
Lui ne savait que faire
pour se disculper ;
il parlait à tort et à travers,
n’étant guère sagace.
Parfois il s’embrouillait
dans les comptes.
Chaque année, le mitron
attrapait une maladie,
dont il guérissait par hasard,
ou restait sans guérir.
Un jour, au cours d’un hiver bien froid,
ce pauvre travailleur
eut la mauvaise idée
de sortir avec d’autres
et se saoula si bien
qu’il retourna chez lui mal en point
après avoir titubé par les rues
dans le froid et l’humidité.
Le lendemain,
il pouvait à peine respirer
à cause de douleurs suraiguës,
une inflammation des bronches.
Une semaine plus tard,
on le portait en terre
dans une pauvre petite voiture
tirée par un cheval spectral,
un soir triste et noir
du jour de Noël.
*
Souvenirs de vagabond
(Recuerdos de vagabundo)
.
Veilles de sabbat (Vísperas de aquelarre)
Juana, Chiqui, Petra Motza,
la Gerona, l’Asunciόn,
la Churriqui, la Roshari,
la servante du recteur
et quatre ou cinq autres vieilles,
les unes veuves, les autres non,
les unes grêles, squelettiques,
une autre comme un dragon,
sont réunies un dimanche
– un soir de canicule –
à l’ombre des arbres
qui les protègent du soleil,
pour faire quelques parties
de mus et truquiflor1.
Pendant qu’elles battent les cartes
et jouent avec passion,
elles vident une bouteille
qui n’est pas du sirop d’orgeat.
Le liquide transparent
enflamme leur furie,
et entre rires et quolibets
et quelque plaisanterie féroce,
elles deviennent frénétiques
et parlent avec véhémence
des vieux, des jeunes,
de la vie, de l’amour,
des maléfices qu’il y a
dans la laine d’un matelas,
dans les flaques et sur les chemins,
et de tout le reste.
On tremble de voir un sabbat
en train de se former,
les balais apparaître
par quelque art déloyal,
et les vieilles monter dessus
en sauvage équipée
au cri de : « Hue, sorginas2 ! »
et après avoir dit : « Adieu ! »
voler comme des flèches
à la recherche du Tentateur
en un proche Zugarramurdi3
ou quelque autre coin
où leur apparaîtra Jaun Gorri4
avec son air de grand seigneur
ou bien un bélier noir
à la barbichette atroce.
1 mus et truquiflor : Jeux de cartes. Le mus est d’origine basque. Le truquiflor est une variante du truque ou truco joué dans tout le monde hispanophone.
2 sorgina : Mot basque désignant une sorcière. Baroja l’hispanise en sorguiña, mais ni l’une ni l’autre forme n’est reconnue par le Dictionnaire de l’Académie royale espagnole. Le terme employé pour « sabbat », aquelarre, est en revanche d’usage ancien en castillan et lui-même emprunté à la langue basque (akelarre).
3 Zugarramurdi : Voyez le poème suivant. Il s’agit d’une localité du Pays basque espagnol.
4 Jaun Gorri : ou Jaunagorri, le « seigneur rouge », figure des légendes basques ; identifié ici au diable du sabbat.
*
La grotte de Zugarramurdi (La cueva de Zugarramurdi)
Grotte de Zugarramurdi,
fameuse en sorcellerie !
Tu es pleine de secrets,
comme une caverne antique
dédiée aux mystères
de Cérès, Dionysos ou Mithra.
Ton sol est traversé
le long de la vaste galerie
par l’eau claire d’un ru
qui s’écoule, furtive.
Le ruisseau de l’Enfer,
c’est ainsi qu’on nomme l’onde
limpide qui parcourt
l’antre des sorcières
et raconte dans l’obscurité
qui règne en ce lieu
les illusions qui furent
les vérités et les mensonges
d’époques aussi reculées
que le Paléolithique.
Cet antre des lamies,
ainsi qu’un autre un peu plus loin
où se trouve un pupitre de pierre
et qui s’appelle Berroberria,
furent les étranges anthologies
de cultes anciens.
Là se maria la nuit
avec la clarté du jour,
là se réunit le grand bouc
avec les cruelles Érinyes,
et c’est là qu’il poussa une queue
aux aimables ondines.
Là se rassemblaient
sibylles et prophétesses
pour célébrer leurs mystères
de magie et d’incantations ;
là concocta ses philtres
quelque vieille Canidie,
et là, au son du tambourin,
quelque bénédictine dansa
une danse frénétique
au milieu de la calegira5.
Aujourd’hui, après tant de siècles,
dans ton sein rigide ne nichent plus
que le silence et l’obscurité,
la solitude et la mélancolie.
5 calegira : Néologisme castillan formé à partir du basque kalegira, désignant une troupe de musiciens ambulants.
*
Les forges (Las ferrerías)
Dans les provinces du nord,
près de ruisseaux aux ondes claires,
j’ai vu qu’il y avait encore
des forges dans les campagnes.
Elles ont un aspect de ruines,
et leurs murs pleins de lichen
et de pierres leurs toits
servent de refuge aux lézards.
Posées au-dessus de l’eau,
elle sont si couvertes d’herbes folles
que l’on dirait des rochers
plutôt qu’une œuvre humaine.
À l’intérieur elles sont toutes noires,
et quand quelque chose est fondu,
la forge allumée,
les vieux forgerons basques
s’agitent comme des diables
au fond des flammes.
Les étincelles brillantes sautent
en l’air jusqu’au plafond
et les marteaux résonnent
avec un tintement acharné.
Le tableau, dans cette caverne,
a quelque chose de magique,
évoquant des images passées
de ces travaux fantastiques
dans une époque déjà lointaine,
plus noble et plus belle.
*
Confusion ethnographique (Confusiόn etnográfica)
Magie, tabous, amulettes,
rhombes, fétichisme,
cultes d’arbres et de plantes,
de rochers et de rivières.
Carnavals et déguisements,
masques et totémisme,
jugements de Dieu, matriarcat,
les Pygmées, les Négritos,
les Aruntas, les Bechuanas,
les Papous, les Dravidiens,
représentants d’un monde
mystérieux et primitif ;
le culte des serpents
et des vieux crocodiles
chez les peuples africains,
qui conservent encore leurs mythes ;
exogamie et endogamie,
couvade, cannibalisme,
anthropophagie sacrée,
confusion et labyrinthe,
vengeance contre les choses,
contre les animaux, châtiments,
danses au milieu des forêts,
liberté des instincts.
Zarathoustra en chemise de nuit,
exaltant le corps ;
crécelles et castagnettes,
tam-tam, grosses caisses et cymbales,
magiciens et prêtres
tatoués jusqu’au nombril,
agitant des clochettes,
couverts de plumes et d’anneaux,
dansant avec autant d’art
que la belle Chichito6 ;
peintures et clubs rupestres,
étude de l’agriculture,
des huttes, des céramiques,
des tenailles et des marteaux ;
tout un monde extravagant
qui s’agite en délire
entre les rives du Niger
et les bords du Nil.
Ce feuilleton de l’humanité,
de sa vie et de son destin,
est le plus extraordinaire,
singulier et suggestif
qui se puisse trouver dans les pages
d’un livre sérieux,
et en comparaison est tellement pauvre
ce monde maniéré,
bien pompeux et bien ridicule,
mi-romain mi-sémitique,
que les professeurs nous présentent
comme quelque chose de définitif
et qui n’est ni très ancien
ni même intéressant.
6 La Chichito : En note, le commentateur Manuel García indique qu’il s’agit d’une danseuse espagnole de flamenco de la fin du dix-neuvième siècle.
*
Le Lac noir (La Laguna negra)
Au sommet de cette montagne,
dans une gorge étendue
couverte toute l’année
par le triste linceul
qu’y laissent les neiges
des grandes avalanches,
au milieu de la blancheur
et tout au fond du ravin,
comme une goutte d’encre
un cercle se dessine.
Ce cercle noirâtre, cette tache,
c’est le lac que les gens d’ici
appellent le Lac noir,
et dont ils disent que par temps d’orage
il exhale d’épais nuages
et rugit, s’agite
et brame comme un démon.
On croit que cet abîme obscur,
en dépit de son grand calme,
est peuplé dans ses eaux mystérieuses
d’habitants monstrueux
qui dévorent tout ce qui tombe dedans,
les gens et les vaches,
les agneaux et les chevaux,
les brebis et les chèvres,
et ne laissent que les poumons
flottant à la surface,
matière indigeste
de peu de substance.
Ces pauvres imaginations,
ces inventions diverses,
il y en a qui veulent les combattre
comme de futiles mensonges,
et ces bons pédagogues
pour mettre la farce en évidence
entrent dans le lac,
y plongent, se baignent.
Mais bien qu’ils démontrent ainsi
que rien ne leur arrive
d’une manière décisive
ayant presque force axiomatique,
ils ne parviennent à convaincre
la malice des paysans.
*
Le défilé de Pancorbo (El desfiladero de Pancorbo)
En arrivant depuis la France
à Pancorbo,
on a l’impression d’entrer
dans un lieu de légende
qui pourrait être l’entrée
de quelque enfer d’Orcus.
Le défilé se fait
par endroits plus étroit
et prend un air sombre,
désolé, majestueux.
Un ruisseau, l’Oroncillo,
court entre les pierres, au fond,
et le terrain devient
de plus en plus impraticable.
Le soleil brille haut dans le ciel
avec de grands traits d’or.
Sur les falaises sauvages
aux durs contours,
on voit quelques ruines
d’ermitages et de petites auberges,
et il y a des formations de rochers
à l’apparence mystérieuse
qui ressemblent aux antres
de toutes sortes de monstres,
Pégases aux pieds ailés,
Polyphèmes n’ayant qu’un seul œil,
comprachicos ceints de poignards
et contrebandiers féroces.
Quand on parvient au sommet,
au bout du chemin scabreux,
l’imagination se calme
et l’on se sent un peu ridicule
d’avoir eu peur
d’un danger illusoire.
*
Le rhabdomancien de Trebejo (El zahorí de Trebejo)
À Puerto del Caballo
comme au château d’Almenara,
à San Martín de Trebejo
et parmi les cailloux du Jálama,
sur la colline du Berraco,
et du Duero au Guadiana,
il existe une légende très répandue,
dans la plaine comme dans la montagne,
selon laquelle des trésors sont cachés
dans des pots et des amphores
pleins d’or en poudre
ou bien en grands lingots.
Dans une caverne resplendissante
comme le soleil du matin,
la nymphe Lutidès habite
parmi les fleurs et le faste,
et dans un superbe palais
de marbres et de statues,
où vivait le consul Lentulus,
il y a des bijoux ciselés d’or.
On raconte dans ces pays
qu’il y a des mosquées sous les eaux,
où priaient des émirs,
des sages mauresques et des sultanes.
Moi, qui suis bon rhabomancien
par tradition et par hérédité,
avec de grandes connaissances
d’une science vaste et profonde,
je n’ai jamais trouvé d’or
ni d’argent ;
mais je vis de ma science,
laquelle est chose noble,
et mène ma barque avec art
dans cette dure vie,
sans nuire à personne
ni déranger une souris.
Il se peut que d’aucuns affirment
que je suis un inepte
trafiquant de supercheries
et marchand d’impostures,
mais ceux qui disent cela,
s’ils ne sont insensés,
savent bien que je ne suis pas le seul
à jouer cette carte.
*
Impressions de Paris
(Impresiones de París)
.
Mélancolie d’hôtel (Melancolía de hotel)
La chambre vieille et défraîchie
n’est pas sans un certain air aristocratique,
avec ses bouquets de roses
sur le papier peint à moitié flétri ;
il y a un canapé-lit,
un miroir et un lavabo,
une cheminée centenaire,
une table et une armoire.
Par la fenêtre on peut voir
au fond de la cour,
entre les murs noirs,
le sol plein de flaques.
Là-haut se montre le ciel
entre les gouttières et les toits,
morceau d’espace gris
qui parfois devient bleu.
Dans cette petite chambre,
en hiver comme au printemps,
je passe presque tout mon temps
à lire un peu et à rêver.
Le jour je peux tolérer
les bruits du voisinage,
mais la nuit il n’y a pas moyen
de les éviter ni de les supporter.
Ce sont des agitations absurdes,
des tapages et des chahuts,
qui montent par l’escalier
jusqu’au couloir devant ma chambre.
Ce sont des ramdams constants
de bottes et de chaussures,
de pattes de plantigrade
qui doivent être de quelque barbare,
et les pas de quelque nymphe,
souples comme ceux d’un chat ;
c’est la voix rauque et brutale
d’hommes grossiers et lourds,
et des bavardages de femmes,
long vacarme d’oiseaux.
Puis ce sont, pendant un moment interminable,
les robinets, les lavabos, les canalisations,
et des heures durant
les bruits des salles de bain.
Cette existence de la ville
me donne un tel dégoût
qu’il me vient l’illusion
de vivre à la campagne
et d’avoir pour tout meuble
un banc calé contre un arbre ;
mais la campagne est morte,
elle se trouve elle aussi livrée
à la vengeance, à la colère,
à la passion et au saccage ;
aussi le seul espoir qui me reste
est-il d’en finir avec cette comédie
et son détestable tohu-bohu
sous une couche de terre
de deux ou trois empans.
*
Les tristes rues de Paris (Las calles tristes de París)
Il y a ici des lieux noirs et tristes
entre les grands monuments,
des rues silencieuses, mortes,
d’une tristesse hostile.
Il y en a d’autres majestueuses,
avec des murs de jardin
et des façades baroques,
comme sur l’île Saint-Louis.
Il y a des ruelles étroites
d’une misère sénile,
avec un commerce miteux
et une couleur entre noire et grise ;
il y a des rues avec hôpital,
où je me sens malheureux,
mélancolique, écrasé,
sans autre volonté que de sortir de là ;
il y a aussi des rues sinistres
vers le canal Saint-Martin,
et celles qui débouchent
sur les cimetières d’Auteuil et de Bercy,
de Montmartre et des Batignolles,
de Montrouge et de Gentilly,
ou encore celle du triste cimetière
près de Vitry,
où l’on emmène les condamnés
exécutés à Paris.
*
L’armoire aux squelettes (El armario de los esqueletos)
Dans l’atelier compliqué
de l’anatomiste expert
en dissections savantes
et conservation de fœtus,
à l’intérieur d’un cagibi profond
avec une étroite fenêtre,
se trouve une vieille garde-robe
de trois à quatre mètres carrés,
entièrement occupée
par des squelettes
de femmes et d’hommes,
de jeunes et de vieux.
Ces carcasses de blancs ossements
pendent à quelques crochets enfoncés
dans le bois du plafond ;
les uns semblent rire
avec une grimace espiègle ;
d’autres ont un emballage
de spectres fatidiques ;
il y a celui qui a l’air sévère
et celui qui a l’air grotesque,
spécimen de danse macabre
comme en peignait le moyen âge.
Quand la rue tremble
au passage tonitruant
d’un de ces énormes camions
qui portent des charges colossales,
la garde-robe occulte
se met à trembler tout entière,
ébranlant l’assemblée
de cette armoire sinistre.
Il y a un squelette qui bouge
les phalanges de ses doigts
et dont le crâne grince
avec un accent lamentable.
Un autre semble jovial,
un autre paraît en verve,
un autre encore se balance
en un mouvement obscène.
On croirait distinguer,
même sans peau ni cheveux,
l’idiot et le sage,
le vaurien et l’imbécile ;
et sans chair ni graisse,
sans les bourrelets et sans les fesses,
ces restes d’Homo sapiens
font rire et en même temps font peur.
*
Promenades (Paseos)
Je sors tous les matins
sans autre dessein majeur
que d’attendre que soit terminé
le ménage dans ma chambre.
Je traverse des rues et des places
et j’entends la rumeur confuse
des camions et des voitures
qui, comme l’éclair,
passent avec des hurlements rauques,
une vitesse atroce.
Et puis la multitude
bout comme dans un creuset,
hommes, femmes et vieillards
vont à leur lutte féroce
pour le pain de chaque jour
avec une persévérance infatigable,
sous la pluie ou dans le brouillard,
qu’il neige ou que se montre le soleil,
transis de froid
ou asphyxiés de chaleur.
Les esclaves du travail
sont légion.
Personne ne fait attention à son prochain,
tous vont à leur labeur,
entraînés par une seule volonté,
la faim ou la passion ;
l’employé à son bureau,
le boutiquier à sa boutique,
la modiste à son atelier,
chacun à ses obligations.
Du fond du métro surgit
la fourmilière envahisseuse
qui se répand dans les rues,
tandis que continue la chanson
des voitures et des camions
qui dans leur marche précipitée
font un bruit de ruche,
ronflent comme une toupie.
Je m’approche à pas lents du fleuve,
qui a l’air menaçant,
emportant dans son courant tranquille
une alluvion printanière.
J’aspire la fraîcheur et l’odeur
de l’eau trouble
et me prépare à rentrer
m’assoir dans mon fauteuil.
Quand je suis dans la chambre,
je pense, pris d’une certaine stupeur,
qu’il est sot de vivre
sans qu’aucune illusion ne nous anime.
Et qu’il n’est pas non plus très sage,
voire peut-être que c’est pire,
de passer sa vie entière
confiné dans un coin.
*
Noirs dimanches (Domingos negros)
Bien souvent j’ai pensé
que la vie n’a pas de sens
et que nous allons et venons
sur une planète galvaudeuse.
Le travail me distrait
comme un charme magique ;
le divertissement, au contraire,
me paraît ennuyeux,
je le crois une invention stupide,
la trouvaille de quelque andouille,
l’idée d’un imbécile
ou d’un pédant.
Il n’est pas trop de dire
que dans cette question des jeux
subsiste encore l’influence
des esthètes hellènes.
Mais qu’elle soit de ces derniers ou du diable,
dans cette sotte supercherie
ne se trouvent que les pensées
d’un parfait crétin.
On comprend bien que dans un village
il y ait peu de choses
pour le loisir et pour l’oubli ;
mais dans une ville magnifique
comme Paris, il est étrange
de ne rien trouver de décent
qui puisse satisfaire
les enfants comme les vieux,
les messieurs et les dames,
les malins comme les niais.
Quels ennuyeux dimanches !
Quelles avenues, quelles promenades !
Quels visages stupides et tristes !
Quelle hostilité, quels gestes !
Et c’est là ce qu’il y a de meilleur au monde,
la crème de l’univers.
Qu’en sera-t-il du reste
quand tout est si fruste ici !
Je me rappelle avec horreur
ces longs dimanches noirs
que j’ai passés en marchant
sans trouver le moindre attrait
capable de me faire
un peu tuer le temps.
*
Mélancolies grotesques
(Melancolías grotescas)
.
Le pêcheur de la Seine (El pescador del Sena)
Ce pêcheur à la ligne
au bord de la Seine
me cause un tel étonnement,
comme s’il pêchait dans la terre.
Je l’ai vu cent fois
avec sa canne à pêche et son panier
sans jamais observer
qu’il tirât le moindre poisson.
Le temps passé en vain
ne le préoccupe ni ne le chagrine.
C’est un cas d’optimisme
qui me paraît tellement étrange.
Leibniz et le docteur Panglosse
sont des enfants à la mamelle, à côté de lui.
Il est si persuadé
qu’il n’y a pas de fleuve sans poissons
qu’il apprête toujours son hameçon
avec une parfaite assurance,
un espoir admirable,
une illusion de poète,
sans jamais penser qu’il tirera
des eaux troubles,
au lieu d’un beau poisson,
d’une truite ou d’une tanche,
quelque guenille de caleçon
ou la semelle d’une chaussure.
En ces jours de danger
où menace la guerre
avec ses terribles désastres
et ses visions sinistres,
où les gens s’entassent
dans les gares pleines
et les autos filent à toute vitesse,
dévorant la route,
ce pêcheur reste impavide
dans son aimable indifférence,
contemplant le large fleuve
et ses rives désertes.
Les terreurs de la foule angoissée
ne le troublent guère,
pas plus que ne l’agitent
les bombardements et les alertes ;
il garde l’espoir
de voir pris à sa ligne
un magnifique saumon
tout brillant et frétillant.
Pauvre pêcheur à la ligne
des bords de Seine !
Nous ne te demanderons jamais
la démonstration de ton habileté ;
mais tu pourrais nous prêter
un peu de ta confiance éternelle,
une petite dose d’optimisme,
de cette espérance si sereine
qu’elle serait comme un trésor
d’une splendide récolte
pour des gens morts de faim,
consumés dans le malheur.
*
Épilogues de l’époque
(Epílogos de la época)
.
La chanson des soldats (La canciόn de los soldados)
Les soldats, en traversant
les rues de Paris,
chantent une vieille chanson,
au moment de partir
pour la guerre, une chanson
avec ce refrain :
« Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir ! »
Aucun enthousiasme féroce,
aucune frénésie maniaque,
pas d’inquiétude, ni la crainte
d’une fin malheureuse,
seulement un stoïcisme triste,
décadence sénile.
« Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir ! »
Pourquoi La Marseillaise
ne parvient-elle à resurgir,
ou Le Chant du départ,
avec une juvénile ardeur ?
C’est l’âme d’un peuple
qui se sent décliner.
« Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir ! »
Nostalgie paysanne
de vie pastorale :
plutôt le dégoût de tuer
que la peur de mourir.
Sérénité, amertume,
résignation et spleen.
« Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir ! »
La victoire n’est pas pour ceux
qui veulent vivre
sans tragédies brutales,
sans travail fébrile ;
ni pour ceux qui entonnent, pacifiques,
avec un accent puéril :
« Auprès de ma blonde,
qu’il fait bon dormir ! »